
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Fluxus Films, Entre Chien et Loup, Mathematic, Midas Filmes
ALMA VIVA
Cristèle Alves Meira | France/Portugal/Belgique | 2022 | 88 minutes | Panorama international
C’est le réalisme prenant du film de Meira qui vient nous frapper, plutôt que ses allusions à la magie, c’est l’intimisme d’une caméra à hauteur d’enfant qui s’immisce subrepticement dans les retranchements intimes d’une famille d’excentriques vivant dans les montagnes portugaises. Il y a quelque chose d’Ettore Scola dans les performances maniaques de la distribution, toujours à fleur de peau, gueulant et invectivant les uns et les autres dans le sillon de la mort d’une matriarche que les villageois prennent pour une sorcière, exhibant une fougue à peine tempérée par le stoïcisme et la sobriété de la jeune protagoniste Salomé (Lua Michel, criante de vérité). On s’amuse donc énormément à voir la famille se déchirer (et lutter contre l’opprobre populaire) rien que pour mieux se réunir à la fin, lors d’une scène d’enterrement qui pourrait bien faire époque. Or, le film n’est pas qu’un simple drame familial, même si c’est sans doute l’étiquette qui lui sied le mieux, puisqu’il s’agit aussi d’une exploration de la puissance des mythes, du pouvoir de la suggestion, et de la nature ultimement prosaïque de la spiritualité. En cela, même les moments plus oniriques — les promenades nocturnes d’une héroïne « possédée » par l’esprit de sa grand-mère pour accomplir ses basses besognes posthumes — revêtent un caractère réaliste. En fait, c’est dans l’ambiguïté même entre le potentiellement véridique et l’hypothétiquement fantasmatique que le film ancre son discours sur la magie, de sorte qu’on ne sait jamais vraiment si Salomé est véritablement possédée ou si elle agit en proie à la foi, celle qu’a insufflé en elle son aïeule en lui disant qu’elle était un réceptacle pour les esprits…
Le film s’ouvre sur la perspective de l’enfant qui, à travers un trou dans le mur, assiste à l’exorcisme d’un homme orchestré par Avó (avant sa mort par AVC), et dont nous partageons la vision grâce à une série de plans subjectifs nerveux et encombrés. Le « vrai » est aussi affaire de point de vue, semble nous dire le film, et nul n’est plus impressionnable que le regard enfantin, pour qui la contiguïté des superstitions équivaut à leur véracité au sein d’une économie de la foi axée sur des rapports de proximité familiale. Et pour ce qui est de la proximité, on la ressent très bien tout au long du film, dans l’exiguïté des espaces domiciliaires que partagent les deux femmes avec tante Fátima, un oncle aveugle et d’autres parents satellites. Ce sont d’ailleurs les scènes domestiques croquées sur le vif qui nous restent en mémoire, plus que les panoramiques extérieurs grandioses sur les environs vallonnés : la scène de repas, où les poissons frits tournent un œil mort vers la vibrante fratrie, celle où la grand-mère et sa petite-fille twerkent sur quelque vidéoclip pop, et celle où deux sœurs endeuillées en viennent aux mains après s’être dit leurs quatre vérités, allant jusqu’à renverser le cercueil de la matriarche. C’est le flot tempétueux de la vie qu’on célèbre finalement ici, celui que ne peut endiguer la mort. (Olivier Thibodeau)

prod. Ecce Films
GRAND PARIS
Martin Jauvat | France | 2022 | 72 minutes | Section Temps Ø
Ni parfaitement mémorable ni complètement oubliable, Grand Paris est de ces expériences cinématographiques tout à fait charmantes qui, sans laisser de souvenir vraiment précis et pénétrant ou d’impression particulièrement forte, se rappellent à la mémoire avec ce genre de sourire suscité par un sentiment général de bien-être et d’amusement. Présenté comme une comédie de stoners rafraîchissante doublée d’un soupçon de fantastique, ce premier long métrage de Martin Jauvat s’avère davantage cousin du « bromance » américain, ce type de comédie romantique platonique entre potes masculins, sur le mode du road movie. Leslie et Renard, deux copains banlieusards, délaissent la combine foireuse qui les a entraînés aux abords des chantiers du Grand Paris, la future ligne de métro visant à faire de la ville et ses abords une « métropole mondiale », pour se lancer dans une sorte de quête mystique après la découverte d’un curieux artefact d’origine inconnue (terrestre? extraterrestre?). Il va sans dire que, pour ces deux paumés sans grande ambition et sans direction, le principal intérêt de cette quête est le pognon qu’ils pourraient possiblement en tirer. S’ensuit une série de rencontres toutes plus improbables les unes que les autres, de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Cergy-Pontoise en passant par une dizaine d’étapes du circuit nocturne de la RATP périphérique.
Si, au fil des va-et-vient de nos deux comparses, le film semble finalement se foutre de plus en plus de sa propre intrigue, plus intéressé par l’ambiance, le vagabondage, le merveilleux des moments saugrenus ou parfaitement anodins qui ponctuent cette longue nuit d’errance, il en résulte justement quelque chose de peut-être plus intéressant qu’une réponse concrète au mystère de l’artefact. C’est un certain esprit de la banlieue qui s’exprime à travers la quête de ces personnages, qui brosse un portrait loin de tout ce qu’on entend habituellement à son sujet au cinéma et dans l’actualité. Délaissant le drame des inégalités sociales et de la violence toujours rapportées, Jauvat s’intéresse davantage au vide, aux pérégrinations sans but, à l’oisiveté, à l’enchevêtrement des routes, à la juxtaposition pêle-mêle des champs, des espaces industriels, des chemins de fer, des maisonnettes silencieuses, des supérettes ouvertes 24 h/24, des cités-dortoirs ternes, mais aussi à la solidarité inattendue et à l’improvisation sympathique, caractéristiques incarnées par ces deux protagonistes — l’un, relativement désabusé et désemparé; l’autre, plutôt optimiste et candide. Le cinéaste en tire une poésie et une humanité qui baignent le film d’une douce folie doublée d’un humour décalé et absurde plus près de la série Atlanta que de Pineapple Express (2008). Métaphore d’une marge qui se soutient et s’entraide, comme la banlieue placide qu’elle illustre et les personnages qui la peuplent, Grand Paris se montre étonnamment touchant, trouvant dans des petits moments de tendresse — comme les siestes passagères l’un sur l’épaule de l’autre dans les bus de nuit, le menu remarquablement étendu du livreur/revendeur Chicken 3000 ou les premiers pas au bord de la mer — ce fameux sourire de bien-être et d’amusement. (Claire Valade)

prod. Les Films du Clan, Micro Climat, Cinémage 16
JACKY CAILLOU
Lucas Delangle | France | 2022 | 92 minutes | Panorama international
Pour son premier long métrage, Lucas Delangle nous offre un film, à proprement parler, fantastique, une œuvre qui se tient en équilibre, comme l’entendait Todorov, entre l’« étrange » et le « merveilleux » sans qu’on ne puisse jamais tout à fait statuer sur la teneur des événements. « Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. » Car c’est bien sur cette hésitation, sur cette incertitude, sur cette oscillation, que chancellent les personnages et les spectateurs avec eux. La grand-mère de Jacky est une sympathique guérisseuse chez qui le village se presse afin d’y voir soulager ses maux en échange d’offrandes. Ses propos sibyllins, sa voix faiblarde, ses dents pourries, sa silhouette voûtée, ses rides profondes, ses « yeux cerclés de bagues » (comme aurait dit Rimbaud), tout son physique inspire la confiance; elle ressemble à l’idée de que l’on se fait d’une guérisseuse. Tout est question de « suspension consentie de l’incrédulité » (comme aurait dit Coleridge). Or, voilà-t’y pas qu’au terme de la troisième bobine, l’octogénaire calenche, non sans avoir préalablement montré à son petit-fils les rudiments du magnétisme. Il prendra la relève. Or, avec l’acné qui lui ravage le visage, les cheveux drus qui lui tapissent le crâne, la boucle de métal qui lui pendouille à l’oreille, l’élocution mollassonne qui lui sourd du goulot, Jacky a plus l’air d’un adolescent complexé que d’un magicien humaniste. Aussi se pressera-t-on moins.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences, nous enjoint à penser Delangle. Une scène, dans le bar du village, nous montre Jacky dansant, buvant, fumant avec son pote, lequel est incapable de tenir l’alcool, hurlant des propos déplacés aux convives, plombant l’ambiance, échappant même son porrón qui éclatera sur le carrelage. « C’est mon meilleur ami, dira le héros, il est flic. » Jamais je n’aurais cru!
Aussi, quand il entendra, le lendemain, pépier l’oiseau qu’il aurait guéri (le conditionnel passé s’impose), Jacky est persuadé que mamy lui a légué ses trucs. Il a pourtant été incapable de guérir la guérisseuse quand celle-ci s’est affalée de tout son court. Mais sont-ce vraiment ses pouvoirs qui ont ragaillardi le volatile? Il finit par voir des signes partout, ceux qui lui conviennent, ceux qui font son affaire. Il s’éprendra d’Elsa, venue le voir pour une curieuse tache qui s’agrandit dans son dos. Fou d’amour, désirant la guérir, croyant lui-même à ce legs, il mimera les us de l’aïeul : enlacer les arbres, avaler du foie cru. Il doit guérir Elsa, dont la touffe lui laisse penser qu’elle est, la nuit, le loup qui dévore les brebis égarées. Et nous voilà donc forcé de croire ce jeune homme qui, croyant de moins en moins à ses pouvoirs, croit de plus en plus à cette métamorphose. Jacky veut aider sa communauté. Il le veut. Désespérément. Mais le peut-il? Quand le petit Loïc recevra accidentellement un coup de douze dans le cou, c’est à l’hosto qu’on le conduira dare-dare. Foin de la magie dans ce cas-ci. Il y a un moment ou la croyance ne suffit plus.
Les adultes t’adulent quand tu guéris leurs mioches. Ils y croient tant qu’ils croissent. Mais quand ils ne croient plus que ton amour leur donne la vie, ils te haïssent à mort. Or, les guérisons de Jacky sont-elles le fruit de sa croyance ou de la leur? Est-ce la guérison qui suscite la croyance ou la croyance qui suscite la guérison? Quelle est la différence entre croyance et confiance? Il existe de grands films avec de petites questions et de petits films avec de grandes questions. Jacky Caillou fait partie de ces derniers. (Jean-Marc Limoges)

prod. Filmes Fantasma, House on Fire, Terratreme Filmes
WILL-O'-THE-WISP [FOGO-FÁTUO]
João Pedro Rodrigues | Portugal | 2022 | 67 minutes | Compétition internationale
En 2069, dans une chambre presque vide, est allongé à l’orée de la mort le vieux prince Alfredo, descendant d’une famille royale portugaise. Sa voix tremblote en évoquant les bribes d’un souvenir qui se déplie bientôt sous nos yeux, une parenthèse de jeunesse vieille de cinquante ans, alors qu’un Alfredo juvénile choisit, malgré l’inévitabilité d’une commotion familiale à venir, de s’engager comme pompier bénévole pour résister à l’étendue des feux de forêt qui ravagent l’arrière-pays.
Dans la caserne où rapidement échoit le prince, c’est toute une fantaisie chorégraphique d’usinage de la masculinité qui s’exhibe, en des entraînements répétés ou des séquences parodiques où les pompiers miment, pour le calendrier annuel, des poses de tableaux classiques, de Velázquez à Rubens. Le monarque, étudiant gringalet d’histoire de l’art aux dents serties de broches, détonne immédiatement de la foule athlétique. La rencontre avec Alonso, jeune pompier noir qui devient son instructeur attitré, laisse rapidement la place à une relation intime, amicale et amoureuse, lien de proximité où se joue toujours la question du refoulé colonial propre à l’historique familiale d’Alfredo. Si une esthétique de la performance athlétique est empruntée aux séquences militaires canoniques du Beau travail de Claire Denis (1999), les corps filmés par Rodrigues n’apparaissent ici non comme les instruments machiniques d’une violence d’état mais plutôt comme la composition d’images érotisées et de sujets désirants. Se compose ainsi une caserne lubrique, qui se dessine comme une alternative à la rigidité normative qui pouvait structurer, tout en tension, une autre récente communauté cinématographique de pompiers, celle de Titane (Julia Ducournau, 2021).
Le film est fort d’un humour audacieux qui préfère l’imperfection à la raillerie bien rodée, consensuelle et soporifique, et la mesure de l’humilité qui apparaît dans ses moments musicaux dansés - puisqu’il s’agit aussi, en partie, d’une comédie musicale - où les interprètes semblent parfois malhabiles dans leurs mouvements, équivaut à l’honnêteté de son enthousiasme. Se distingue dans ces gestes, qui ne tendent pas à la perfection mais à l’expression du plaisir comique et sensuel, une modestie paradoxale qui fait de Will-o’-the-Wisp une sorte de petit film. Ses maigres 67 minutes lui permettent alors d’emprunter l’allure du mythique feu follet titulaire, cette attirante lueur fantomatique qui disparaît par vacillements, qui préfère faire naître l’intrigue plutôt que le chemin bien tracé. (Thomas Filteau)
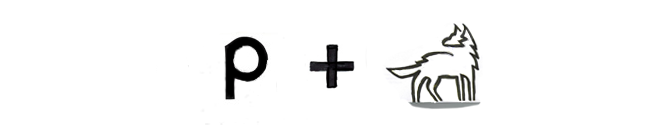
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
