
prod. Twenty Nine Studio & Production
L’ARBRE DE L’AUTHENTICITÉ
Sammy Baloji | République démocratique du Congo | 2025 | 85 minutes | Les nouveaux alchimistes
Le documentaire de Sammy Baloji s’ouvre sur un plan de drone réussi comme peu d’entre eux savent l’être. La caméra s’avance au-dessus d’un village de la République démocratique du Congo, survolant de très haut une communauté, traçant des parallèles humaines contre le serpentage verdâtre du cadre et travaillant dès lors à entomologiser notre vision de cette disposition d’habitations englouties par l’imposante nature qui les borde. Restant un long moment en surplace par-dessus le hameau, la caméra finit par descendre progressivement, suivant un angle parfaitement perpendiculaire à sa première trajectoire, au fur et à mesure qu’émergent des maisons et de la forêt les enfants du village qui accourent ; la caméra se dépose même au sol en petit hélicoptère provoquant des vagues de poussière. Malgré la perfection qui amorce le plan, Baloji n’y tient pas au point de dissimuler son dispositif, qu’il préfère affirmer comme un instrument scientifique, une manière de gagner en perspective sur une situation, tout en refusant de tenir à l’état de sujets distants les Congolais·e·s qu’il filme. L’éthique du geste a déjà de quoi convaincre.
Car la raison de cet éloignement maintenu tient bien dans le point de vue que cherche à travailler le photographe-cinéaste, en constituant une focalisation marquée par l’anthropocène à travers un film-essai scindé en trois parties bien distinctes. La première, racontée à partir des années 1930, présente un magnifique herbier décolonial de la station biologique de Yangambi, dont les archives journalières recueillies entre 1937 et 1958 ont été découvertes il y a quelques années. Compilant le temps de fleuraison des arbres, la température moyenne environnante et les centimètres de pluie, ces archives ont permis depuis à des scientifiques d’étudier avec précision l’évolution des changements climatiques ainsi que l’absorption de carbone dont est capable cette forêt centrale du Congo, la deuxième plus importante au monde après celle d’Amazonie.
Or, l’herbier ouvre à une autre histoire cachée parmi les arbres, celle du premier fonctionnaire noir du pays, Paul Panda Farnana, agronome de formation, plus encore, premier Congolais sorti d’une université, volontaire lors de la guerre de 1914-1918, et finalement mort mystérieusement, en 1930, au moment où il était de plus en plus impliqué dans la reconnaissance de l’indépendance économique de sa nation. L’injustice coloniale qui a fini par, sinon à le tuer, au moins à épuiser Farnana, précède dans le film son envers, montré à travers la perspective d’Abiron Beinaert, un scientifique flamand qui n’a pas connu Farnana mais qui travaillera quelques années plus tard dans la même station biologique que lui, permettant par le biais de son journal de poursuivre la narration du lieu dans une deuxième partie aux allures concentrationnaires.
En se reportant de plus en plus à des images des ruines délaissées, L’arbre de l’authenticité nous plonge dans l’inhumanité typique de l’institution coloniale en nous mettant dans les souliers d’un collaborateur de bonne volonté, plutôt porté par la science (il sera un grand innovateur de l’agriculture de l’huile de palme) que par les abus de pouvoir. En offrant cet opposé qui rejoint la première partie par leurs extrémités scientistes respectives, Baloji parvient à la fois à signer un poème écrit à la chlorophylle et à livrer une charge anticoloniale écrite au sang des opprimé·e·s, liant inextricablement les deux à travers des dynamiques d’exploitation qui rarement ont paru aussi fortement imbriquées l’une dans l’autre.
Quant à la narration du troisième segment que nous ne voudrions pas gâcher ici, disons que le cinéaste poursuit son habile jeu dimensionnel de focalisation et qu’il achève de nous convaincre de la beauté courageuse de son projet et de notre hâte à découvrir ses prochains. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival international de Rotterdam 2025
Prochaine projection : 14 octobre à 17h30 (Cineplex Quartier Latin)
WRONG HUSBAND (UIKSARINGITARA)
Zacharias Kunuk | Canada | 2025 | 100 minutes | Les incontournables
On comprend vite l’attrait international d’un film comme Wrong Husband, dernier-né du célèbre réalisateur d’Atanarjuat (2001). La mise en scène, toujours parfaitement lisible, fait la part belle aux décors naturels grandioses du Nunavut et à des personnages de chasseurs aux costumes parfaitement étudiés, au fil d’un scénario universel teinté de mythologie locale qui rappelle une version inuite de la tradition shakespearienne. C’est l’occasion pour les spectateur·ice·s de voyager, tout en restant attaché·e·s à un récit extrêmement familier d’amour transi aux teintes mélodramatiques d’usage, nourri à l’imagerie du cinéma de genre grand public. Il ne s’agit pas moins d’une production soignée, minutieusement recherchée, qu’il fait bon de voir, mais comme un spectacle populaire, qui inclut même des monstres de films d’horreur et des batailles magiques.
Fort d’une distribution constituée d’une poignée de vétéran·e·s (Mark Taqqaugaq et Karen Ivalu) et de plusieurs nouveaux visages (Theresia Kappianaq, Haiden Angutimarik et Leah Panimera dans les trois rôles principaux), le film raconte l’histoire de Kaujak qui, après la mort de son père lors d’une bataille onirique contre un shaman ennemi, voit sa mère Nujatut remariée à un homme louche, qui la traîne à sa suite dans son campement, où elle sera mariée à son tour à un jeune homme cruel auquel elle sera forcée d’obéir tout en rêvant de Sapa, l’homme qu’elle aime vraiment. Il reviendra alors à ce dernier de venir la délivrer. Déployant a priori un message féministe appuyée, où l’on insiste sur le ségrégationnisme sexuel dès l’enfance (« Tu seras un bon chasseur », dit-on au bébé Sapa, tandis qu’on promet à Kaujak qu’elle sera « séduisante » et que tous les hommes voudront d’elle), le film joue beaucoup sur cette tension, qui se résorbe malheureusement dans le spectacle ultime de l’héroïsme viril de Sapa.
Adoptant une posture rigoureusement réaliste, au gré d’un scénario élaboré de concert avec les aîné·e·s d’Igloulik, doté d’une bande sonore trépidante où le duo de chanteuses de gorge PIQSIQ troquent leurs instruments électroniques pour la sonorité organique des percussions traditionnelles, Wrong Husband surprend par l’intrusion d’éléments en apparence immiscibles. Les effets de synthèse, notamment, qui, malgré leur usage restreint et leurs applications spectaculaires (le décor d’inframonde rougeoyant où se battent les deux sorciers et l’aura ouatée de la « dame des brumes »), jurent néanmoins avec le naturalisme de la direction artistique, incluant la plastique superbe du Qallupilluit, dont la présence semble presque purement esthétique étant donné sa fonction narrative diffuse. Le montage d’entraînement à la Rocky (1976), où Sapa doit gravir une colline en portant un os de baleine sur le dos, surprend encore plus, puisqu’il s’agit d’un clin d’œil évident à une tradition complètement étrangère à l’univers millénaire représenté à l’écran. Cette touche de postmodernisme pleinement assumée n’en demeure pas moins au service d’un art de la narration toujours aussi captivant, et elle ressort finalement moins comme une concession que comme un outil de plus dans l’arsenal de ce conteur exemplaire qu’est Kunuk. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2025
Prochaine projection : 18 octobre à 14h45 (Cineplex Quartier Latin)

prod. Dart Film & Video / seriousFilm / et al.
DESIRE LINES
Dane Komljen | Serbie / Bosnie-Herzégovine / Pays-Bas / Croatie / Allemagne | 2025 | 108 minutes | Les nouveaux alchimistes
Branko ne dort part. Arpentant les rues de Belgrade, il est traqué par la caméra tandis qu’il suit les pérégrinations homosexuelles de son frère cadet. Difficile de dire si les scènes de cruising éveillent chez lui envie, répulsion, fascination. Difficile aussi de dire si ce frère existe réellement, lui dont on distingue à peine le visage et dont la silhouette se confond constamment avec celle de Branko. Un jour, Branko arrive aux limites de la ville et n’interrompt pas sa marche. Il continue à travers vallons, prairies et bâtiments abandonnés, jusqu’à ce qu’il chute au sol. Trois protagonistes énigmatiques le recueillent, l’intègrent à leur cercle. Avec elleux, il apprendra à tendre l’oreille aux récits que le non-humain raconte, à se laisser absorber petit à petit par ce monde d’humus et de contes — jusqu’à y disparaître.
En architecture et en géologie, une ligne de désir est un chemin alternatif tracé là où il n’était pas prévu, à force d’avoir été emprunté. Si le plan d’urbanisme d’une ville est inadapté, des sentiers de traverse se dessinent alors sur le sol, pour relier de manière plus commode et intuitive deux points dans l’espace. Aussi n’est-il pas étonnant que le réalisateur Dane Komljen ait choisi de donner ce titre à son film. D’abord parce que son personnage principal semble lui-même dévier d’une trajectoire torpide d’insomnie et d’angoisse tranquille qui le fait parcourir incessamment les rues minéralisées de la ville pour emprunter d’étranges voies le menant à une sorte d’osmose avec le monde micellaire des champignons et des racines. Ensuite parce que le film, dans sa structure, semble bondir d’un paysage bétonisé et mortifère à une orgie de végétation luxuriante, ses personnages effectuant aussi au passage un saut du quasi-mutisme à la logorrhée poétique. Dans Desire Lines, le personnage central comme le récit empruntent des raccourcis imprévus pour se rendre au cœur des choses.
Spectatrice du film, je me retrouve moi aussi à multiplier les sillons interprétatifs, à alterner entre les pistes à suivre. Me raconte-t-on l’étrange mimétique du sentiment érotique et l’effritement de notre désir toujours capturé ou érodé par les cartographies des métropoles néolibérales ? Suis-je face à une fable complexe exploitant l’allégorie visuelle pour dire quelque chose de la ruination du monde et de la misère existentielle contemporaine ? Me met-on en contact avec une sorte d’énigme posthumaine où la parole est laissée au langage des plantes ? Probablement tout ça à la fois, et jamais de façon docte ou prétentieuse, mais grâce à un travail patient et astucieux de l’image qui nous donne, à nous aussi, l’envie d’ébaucher des trajectoires inédites. (Laurence Perron)
Prochaines projections : Aujourd'hui, le 13 octobre à 20h00 (Cinéma Moderne)
19 octobre à 20h00 (Cinéma Moderne)

prod. Elastica Films / Ventall Cinema / DosSoles Media
ROMERÍA
Carla Simón | Espagne / Allemagne | 2025 | 104 minutes | Les incontournables
Carla Simón poursuit l’élan autobiographique amorcé dans Été 93 (2017) avec ce retour aux sources doux-amer dans la Vigo galicienne du début 2000, où sa protagoniste Marina (Llúcia Garcia) part à la recherche des traces du père biologique qu’elle n’a jamais connu. La cinéaste reprend aussi les thèmes majeurs d’Alcarràs (2022), notamment la tyrannie des documents officiels qui viennent baliser l’existence de ses personnages ; c’était le titre de propriété perdu qui condamnait la famille du précédent film, c’est l’attestation de filiation qui manque aujourd’hui à sa protagoniste. C’est pour acquérir ce document, indispensable à l’obtention d’une bourse d’études, que Marina se retrouve à Vigo, apprenant d’une fonctionnaire que seule une déclaration assermentée de ses grands-parents lui permettra d’inscrire son nom au registre comme fille de son père. Elle doit alors remonter la filière familiale, au fil d’une quête pour l’aval de ses aïeux, mais surtout pour reconstruire le récit nébuleux de ses parents, particulièrement celui de son père, dont la séropositivité et la dépendance à l’héroïne constituent autant de secrets enfouis sous le vernis craquant de l’existence paisible, mais hantée de la famille Piñeiro.
L’interrogation des mécanismes du souvenir est très féconde ici, surtout que l’acte de mémoire est associé à un désir (parfois inconscient) de cacher des choses, de s’inventer un nouveau passé ; elle se cristallise dans un jeu de regards semi-croisés, évitants, pas tout à fait perçants, à la recherche d’une vérité élusive que seules trahissent certaines postures individuelles (l’intransigeance de la grand-mère par exemple, le caractère évasif d’un oncle, ou le rapport aux drogues décomplexé qu’entretient la jeune génération). Simón cultive admirablement le mystère, la lourdeur des non-dits, dans un film de retour qui s’apparente brillamment à un film d’enquête, où l’on ressent parfaitement la posture délicate d’une héroïne qui ressemble à la fois à un membre aliéné, périphérique d’une fratrie à laquelle elle n’appartient pas totalement, mais aussi à une figure d’enquêteuse, qui tenterait de s’immiscer trop près, trop vite, au cœur de celle-ci.
La coprésence du passé et du présent constitue surtout l’occasion de multiplier les rapports spéculaires entre Marina et sa mère, que tous·tes (ou presque) s’entendent pour affirmer qu’elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Rapports a priori intrigants qui deviennent de plus en plus troublants, de plus en plus intrusifs, de plus en plus contre-productifs au fil du récit. La superposition des extraits du journal maternel aux images numériques tournées par sa fille contribue d’emblée à un déconcertant flottement mémoriel, la présence de Garcia dans les photos d’époque accrochées au mur, et son acquisition d’une robe faite d’un matériau transmis par ses aïeules nous rappellent son indéniable lien de filiation avec elles. Tout s’effondre malheureusement à l’occasion d’une plongée onirique dans le passé au détour d’une rencontre avec un chat errant, l’animal totémique de Marina, qui revit alors l’idylle tourmentée de ses parents lors de la transition démocratique, interprétant elle-même le rôle de sa mère dans des scènes sexy d’ébats avec son père et de maladroites séquences de consommation d’héroïne. Nonobstant les implications psychanalytiques douteuses de cette immersion mémorielle, on sent qu’elle va à l’encontre des tactiques auteurielles, déchirant le voile de mystère scrupuleusement déployé jusque-là, et solutionnant cavalièrement le problème de l’imprécision du souvenir, autant de subtilités sur lesquelles s’était bâti un film qui s’abîme finalement à trop vouloir montrer, à trop vouloir exhiber les secrets qu’il avait si habilement cultivés. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 19 octobre à 14h30 (Cineplex Quartier Latin)

prod. Filmika Galaika / Bando à Parte
ARIEL
Lois Patiño | Espagne / Portugal | 2025 | 108 minutes | Les nouveaux alchimistes
C’est à la manière d’une parfaite contrepartie au magnifique et expansif Samsara (2023) que se profile ce nouveau film de Lois Patiño, substituant à la rêverie spirituelle des consciences voyageuses un huis clos insulaire tirant dans l’imaginaire théâtral shakespearien pour déployer son récit sur la fragile possibilité de s’extraire des rôles préconçus et imposés. En résulte avec Ariel un film-berceuse dont la cadence s’accorde parfaitement à l’oscillation des surfaces océaniques cintrant l’archipel des Açores qui sert d’assise à son récit flottant. Agustina Muñoz y interprète le rôle d’une actrice du même nom, invitée à rejoindre la tournée « pop-shakespearienne » d’une petite troupe dont l’adaptation de La tempête s’apprête à être présentée sur l’île. C’est le rôle d’Ariel qu’elle se prépare alors à porter, esprit des eaux emprisonné par le magicien Prospero, figure de recherche d’une indépendance toujours différée par l’autorité du maître. Mais à la sortie du traversier, Agustina troque son rôle d’actrice contre celui d’une spectatrice interventionniste, découvrant que les habitant·e·s de l’île sont elleux-même enfermé·e·s dans une existence cyclique où chacun·e doit porter le destin d’un personnage tiré du théâtre shakespearien, négociant avec l’obligation de dicter chaque jour, avant que le soleil ne disparaisse, les répliques menant à une fin pré-écrite et souvent tragique.
Ce cauchemar de répétition, qui rappelle celui de Céline et Julie vont en bateau (Jacques Rivette, 1974), nous mène vers un état transi de contemplation instigué par la beauté plastique de ses images éthérées où la communauté d’icônes du quotidien — employé·e·s de supérette ou enfants errant auprès des paysages côtiers — prend la charge de cette scène théâtrale, comme autant de corps ventriloqués par la force obscure d’un texte dictant la mesure de chacun de leurs mouvements. Dans sa rencontre avec Irene Escolar, qui incarne le rôle d’Ariel dans l’écosystème carcéral de l’archipel, Agustina pourra alors se faire la voix d’une libération potentielle, incitant à la fuite devant la captivité des paroles scriptées. Mais en se collant à la rigueur conceptuelle de sa proposition métanarrative, déployant jusqu’à sa finale les renversements parfois trop familiers du réel déplié dans la fiction, Patiño dévoile aussi que la force de son imaginaire haptique d’invocation réside toujours davantage dans le geste filmique que dans le dire scénaristique, dans la manière dont ses images se permettent de pointer vers l’abstraction riche plutôt que de s’en tenir à la fonctionnalité de leur nouage en récit. Au plus près de corps figés par l’obligation, c’est l’ouverture sensorielle plutôt que la clôture narrative qui pourra alors servir de salut, et ce sont les séquences superbes de balancements aqueux baignés dans une lumière pourpre qui resteront les plus évocatrices, dans une séquence répétée se soldant par l’apparition inopinée d’un interstice scindant l’image en deux, comme l’ouverture d’un rideau lumineux se fermant et s’ouvrant successivement sur la surface double de l’eau et de l’écran. (Thomas Filteau)
DEAD LOVER
Grace Glowicki | Canada | 2025 | 95 minutes | Compétition nationale
Dead Lover est le genre de film que l’on a envie de décrire par un jeu de comparaison éclectique : c'est comme du Guy Maddin sur une production Troma avec une touche de Tex Avery ! Cela s’avère approprié pour une œuvre qui porte sur le collage (de morceaux de cadavres, dans une variation irrévérencieuse sur Frankenstein) et qui est elle-même bricolée et rapiécée avec quelques ami·e·s (Ben Petrie, entre autres, qui coscénarise le récit et interprète pratiquement la moitié des personnages), filmée en studio sur des fonds noirs avec des décors constitués de quelques bouts de carton. Mais aligner ces références tend à diminuer l’impact de l’esthétique singulière développée par Grace Glowicki, une sorte de gothique minimaliste qui se pavane dans le mauvais goût et l’humour absurde, qui alterne entre le gore juteux et les accélérés accompagnés de bruits cartoonesques, entre le vomi balancé directement sur la caméra et les déclarations mélodramatiques d’amour éternel.
Ainsi, la cinéaste interprète le personnage principal (l’un de ses multiples rôles), une fossoyeuse qui ne se départit jamais de sa pelle, même pour baiser, et qui peine à trouver le grand amour parce qu’elle dégage une puanteur indécrottable. Mais quand un poète (Petrie) vient enterrer sa sœur, il se voit irrésistiblement attiré par la croque-mort, et les deux développent une idylle abruptement interrompue lorsque le jeune homme meurt en mer. Seul son doigt sectionné parvient à notre héroïne, qui essaiera dès lors de faire repousser le corps de son amant, puis, lorsqu’elle se retrouve plutôt avec un doigt long comme une branche, de lui en trouver un autre, celui de sa sœur fraîchement enterrée apparaissant parfait pour l’occasion. Mary Shelley est citée en introduction, parfois quelques scènes emblématiques sont détournées (le non-voyant qui recueille le monstre devient un baigneur aveugle, nu et hilare), mais la filiation est très lâche. C’est surtout un prétexte parfait pour une mise en scène résolument artisanale, avec des éclairages colorés évoquant la palette de Kenneth Anger, captés sur pellicule 16 mm par Rhayne Vermette, mais aussi pour s’amuser avec les normes de genre. En effet, Glowicki et Petrie jouent autant des hommes et des femmes, et la fossoyeuse semble indifférente au sexe de son amant, le film créant un univers joyeusement lubrique où un doigt réanimé peut satisfaire les désirs en attendant de retrouver un corps complet. Il en résulte une œuvre jouissive et ludique, drôle et inventive, qui exalte le plaisir de la création. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 13 octobre à 18h30 (Cineplex Quartier Latin)
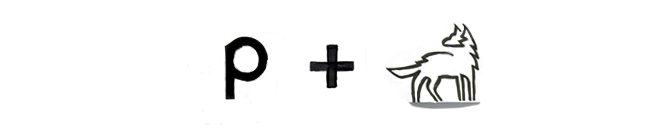
Partie 3
(L'arbre de l'authenticité,
Wrong Husband,
Desire Lines, Romería,
Ariel, Dead Lover)
Partie 4
(Blue Moon, Magellan,
Two Prosecutors,
Father Mother Sister Brother,
Planètes)
Partie 5
(Sound of Falling,
Affection Affection,
Levers, Dracula,
A Useful Ghost)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
