MIROIRS NO. 3
Christian Petzold | Allemagne | 2025 | 86 minutes | Les incontournables
Dès les plans ondoyants du générique, avec le titre, la pièce homonyme de Ravel qui résonne, le ton est fixé. Miroirs No. 3 résonne en sautillant sur cette étendue d’eau qu’on voit, avec ces quelques noms qui défilent très simplement. Christian Petzold. Paula Beer. Barbara Auer. Matthias Brandt. Enno Trebs. Quatre interprètes, deux lieux et 86 minutes signées par un maître de la mise en scène émotionnelle.
Ce nouveau film est si « petit » pour Petzold qu’il ne peut s’agir que d’un exercice de simplicité volontaire, distillant les effets principaux de son cinéma, toujours subtils mais toujours sentis, en une sorte de comptine sans prétention, jouant avec l’idée de Ravel d’une esquisse impressionniste des sentiments. Quelques éléments : une maison vers la fin de l’été, un couple qui passe devant, puis qui repasse en sens inverse après s’être chamaillé entre temps. Lui voulait faire une sortie de couple avec des amis communs, mais elle (Paula Beer) n’en avait pas envie parce que, de toute façon, elle n’est plus capable de supporter ce copain égocentrique depuis belle lurette. Cette escapade semble être la goutte d’eau de trop et, comme c’est souvent le cas chez Petzold, la situation initiale démarre avec une force émotionnelle capturée in media res. On se surprend de la réaction du personnage, on la trouve même exagérée, sans réaliser à quel point elle doit sûrement endurer depuis bien longtemps les caprices de son partenaire.
Comme par un sinistre miracle, ils rebroussent donc chemin et, une fois passée la maison du début, la catastrophe arrive : un accident de voiture où lui termine mort et elle indemne — la voilà libérée. Cela fait peut-être 5 minutes que le film est commencé et la résidente de la demeure sort affolée pour courir au secours de la femme. À peu près 10 minutes plus tard, la décision a déjà été prise qu’elle restera là en campagne, en convalescence. Sa vie à Berlin n’est pas abordée, le couple d’amis de la scène d’introduction n’est plus jamais évoqué, la vie réelle s’est évaporée dans un conte des frères Grimm où l’on tombe sur une maison isolée qui deviendra le théâtre psychologique d’une relation maternelle surprenante, où chacun suspendra sa crédulité pour que l’idylle reste en place. Il vaut mieux se raconter cette histoire que de crier, pleurer, se traumatiser encore plus avec l’accident, et Petzold parvient avec cette magie qui est bien à lui, à esquisser quelque chose d’émotionnellement très précis avec des coups de pinceau très lousses, très libres. Le sous-titre de la pièce de Ravel étant « Une barque sur l’océan », cela permet de poursuivre dans cet isoloir champêtre l’exploration des tonalités d’eau de son cinéma, qui se plaît à se réfracter constamment en ondoyant, en regardant au large (Transit [2018], Afire [2023]), en rêvant de sirènes (Paula Beer dans Undine [2020] et ici), en réfléchissant le passé comme ces nappes tranquilles des peintres impressionnistes d’où émerge à la surface, éventuellement, la vérité.
Or c’est précisément avant d’embarquer sur un traversier que Paula Beer décidera de faire demi-tour, comme si elle refusait d’aller rejouer dans le film précédent (Afire) qui explorait justement le huis clos comme un espace toxique placé en bord de mer. Dans Miroirs No. 3, au contraire, Petzold abandonne les grands thèmes lourds ; il dira après le film qu’il est devenu trop vieux pour encore s’obstiner à traiter de l’Allemagne d’après-guerre et des « grands sujets », qu’il aimerait se consacrer à des petits films, à des retours à l’essentiel. En cela son nouveau est peut-être délibérément mineur, peut-être aussi bloqué par le mur de beauté que lui tend Paula Beer et qu’il ne parvient toujours pas à percer, l’intériorité de son actrice fétiche semblant, de film en film, continuer à lui échapper. Ici par contre, la candeur de la prémisse et de sa résolution laisse entrevoir une ouverture vers un autre mouvement pour sa filmographie, tourné vers la discrétion, la retenue, comme si le réalisateur voulait maintenant céder à ses personnages l’intimité de vivre sans avoir à nous les instrumentaliser pour nous les livrer.
À notre époque où les cinéastes cherchent constamment à se dépasser, à viser des sujets de plus en plus gros et graves (comme Ari Aster et Julia Ducournau ici à Cannes), il appert que ces exercices de simplicité volontaire tel celui que vient d’accomplir Petzold est porteur d’une vérité finalement plus grande et d’une générosité qui, à l’image de son film, sait s’oublier dans son adresse au monde. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival de Cannes 2025
Prochaines projections : 9 octobre à 21h00 (Cinéma du Musée)
18 octobre à 14h30 (Cineplex Quartier Latin)

prod. Rêves d'Eau Productions / 24images Production
PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
Sepideh Farsi | France / Palestine / Iran | 2025 | 110 minutes | Panorama international
Il n’y avait certainement pas d’œuvre plus essentielle à voir à Cannes cette année. Cela ne dit rien sur les « qualités esthétiques » des autres films ou de celui-ci, mais il y a des films où le lieu de visionnement finit par prendre de l’importance au point de les rendre incontournables dans l’instant présent, puis dans la façon dont on se souviendra d’eux et dont ils circuleront.
Fatima Hassouna était une photographe palestinienne de 24 ans que la cinéaste franco-iranienne Sepideh Farsi (La Sirène, 2023) a commencé à interviewer en avril 2024, plusieurs fois par semaine, à travers des appels vidéo sur WhatsApp. Conversation sur conversation, Fatima, qui est prise au Nord-Est de Gaza, entre Jabaliya et Beit Hanoun, confie à la cinéaste ses espérances, son quotidien apocalyptique qui pourtant se décline dans un langage tout à fait normal. Son sourire est irrésistible, même si elle dit que deux personnes de son quartier viennent de mourir dans un bombardement, qu’elle a déjà perdu des dizaines de membres de sa famille, qu’elle parvient à distinguer à l’oreille les différents types d’engins de mort qui volent au-dessus de leur territoire assiégé. Fatima rêve de voyager pour « toucher le monde en dehors de Gaza », sortir de cette « boîte », elle qui n’est jamais sortie de la bande. « Je rêve d’avoir du chocolat. Je sais que c’est un luxe, mais c’est quand même important de pouvoir en avoir », laisse-t-elle tomber, avant de partager plus loin la manière dont elle arrive à sortir pour affronter la mort complètement aléatoire qui l’attend dehors chaque jour : « Tu mets ton cœur dans ta main, et tu marches. »
Rythmé par ces appels incessants, par la crainte que Fatima ne puisse plus répondre, le film est entièrement composé d’images captant le téléphone de la cinéaste en plein appel (ce n’est pas un enregistrement directement extrait de l’appareil), créant un surcadre simplissime qui nous ramène à cette appréhension terrible qui se renouvelle à chaque déconnexion, à chaque tentative de connexion, qui sont légion, car l’oppresseur israélien n’est jamais bien loin, à brouiller les communications. Put Your Soul On Your Hand And Walk n’est pourtant pas misérabiliste, et s’évertue à faire aimer les petites joies du quotidien de Fatima. Son premier paquet de chips en 10 mois, son petit frère gêné de voir la cinéaste, la première « femme d’ailleurs » à qui il peut parler.
C’est aussi Fatima qui confie son amour pour The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994), qui annonce qu’elle lira un jour A Room of One’s Own de Virginia Woolf et qu’elle tient à cette petite chambre de réfugiée qu’elle ferme à clé et qui contient la totalité de ses possessions sous la forme de quelques sacs et de valises. Au-delà de tout ça, c’est aussi et peut-être surtout ses désarmantes photographies de la guerre, que le film présente fièrement à travers quelques intermèdes, transformant le métrage en ultime galerie pour l’artiste à l’œil attentif qu’elle était. Car survient le 15 avril 2025, un mois avant la première du film à Cannes, cet appel où Sepideh apprend à Fatima que le film qu’elles ont fait ensemble sur leur téléphone respectif vient d’être sélectionné au festival, qu’elle y est invitée, que des membres de sa famille pourront l’accompagner. Le sourire de la photographe, qui n’avait jamais d’ailleurs été absent d’aucune des conversations précédentes, s’illumine encore davantage, folle de joie qu’elle est d’enfin sortir de la fournaise génocidaire et d’aller fièrement partager sa vie avec le monde entier.
Ce soir-là sa maison est bombardée et Fatima meurt en même temps que toute cette famille qu’elle nous avait présentée, achevant l’œuvre sèchement, brutalement, sur un gigantesque sentiment d’impuissance, laissant le public seul, abandonné par son rire dans cette salle sur la Croisette, en pleurs. Projeté à l’ACID, l’une des seules sections du festival qui ne soit pas financée en partie par une riche entreprise dégueulasse appuyant le génocide palestinien, Put Your Soul On Your Hand And Walk était accompagné d’un autre film qui jouait en dessous de l’écran et entre les sièges, celui du privilège ou de l’impression de culpabilité honteuse, de cette tristesse élémentaire et irrépressible qui fait nous demander pourquoi nous sommes là et pas elle. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival de Cannes 2025
Prochaines projections : 9 octobre à 18h00 (Cinéma du Parc)
12 octobre à 17h00 (Cinéma du Parc)
WHAT DOES THAT NATURE SAY TO YOU (GEU JAYEONI NEGE MWORAGO HANI)
Hong Sang-soo | Corée du Sud | 2025 | 108 minutes | Les incontournables
Projetées sur l'écran de l'opulent Berlinale Palast, les images imparfaites et soi-disant « pauvres » de What Does That Nature Say to You jurent gracieusement. Elles narguent le décorum ambiant et l'ostentatoire richesse de ce casino déguisé en salle de cinéma le temps d'un festival, questionnant par leur présence même le prétendu « professionnalisme » qui s'érige habituellement comme barrière afin de bloquer l'accès de certains films à des lieux tels que celui-ci. Creusant depuis un bon moment déjà le sillon de la basse résolution, Hong Sang-soo l'a désormais normalisé — à un point tel que les plans hors foyer ne surprennent plus, chez lui. Lorsque Kwon Hae-hyo s'étonne que Ha Seong-guk ait des lunettes, ce dernier lui répond qu'il n'avait jamais remarqué que sa vision était floue, jusqu'à ce qu'il se mette à en porter. Il se cache, derrière la nonchalance de cette réponse, une clé de lecture de l'œuvre du cinéaste coréen. Car, à trop vouloir intellectualiser sa démarche, on passe à côté de l'essentiel : chez lui, les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. La forme est simple, modeste. Elle relève d'un naturalisme qui permet à l'émotion de transparaître, tout bonnement.
L'émotion en question, c'est bien entendu cette mélancolie existentielle que l'ivresse attise. On boit toujours autant, chez Hong Sang-soo. On boit au point de perdre le contrôle de soi, de révéler sa vraie nature et d'exposer maladroitement ses angoisses les plus intimes à sa belle-famille que l'on rencontre pour la première fois. On perd la face. On titube sous l'influence du makgeolli. Mais, de façon de plus en plus franche, ce malaise provoque aussi le rire. What Does That Nature Say to You est donc à ranger du côté des Hong Sang-soo « comiques », avec ses remarques récurrentes sur la moustache de Ha Seong-guk et ses conversations inopinées sur la Kia Pride 1996 qu'il conduit. L'humour y est spontané, comme d'ailleurs tout le reste. Rien n'est jamais forcé. Cultivant l'insouciance et la légèreté, le cinéaste trouve ainsi dans cette mise en scène leste et décomplexée une partie de la solution aux questionnements esthétiques soulevés par ses personnages de poètes et d'artistes : quelle est la meilleure façon de faire ressentir à l'autre ce que l'on a soi-même ressenti ? Sans ambages, sans artifices. Avec la plus grande sincérité possible, quitte à ce que la finition soit un peu rugueuse, inégale. Sans être ni une comédie, ni un drame. Car la vie n'a que faire de telles catégories, et Hong Sang-soo non plus. (Alexandre Fontaine Rousseau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2025
Prochaines projections: 9 octobre à 20h30 (Cinéma du Parc)
18 octobre à 16h45 (Cineplex Quartier Latin)
SHIFTING BASELINES
Julien Élie | Québec | 2025 | 100 minutes | Compétition nationale
En lever de rideau, Shifting Baselines nous invite dans la chaloupe d’un groupe de pêcheurs béliziens qui commentent la petite taille des poissons qui frétillent au bout de leurs lignes sans cannes. On baigne dans la plus pure tradition du cinéma direct, on va à la rencontre des gens ordinaires dans leur quotidien miséreux. Les hommes discutent de la longueur, mais aussi de la quantité des prises (qui parfois remplissent deux ou trois glacières, parfois un demi-seau). Puis, l’un d’eux, l’intellectuel que le cinéaste affectionne, se met à exiger des réponses à savoir ce qui explique la rareté et le gabarit décroissant de la faune océanique. Puis, le plan coupe et le film nous catapulte vers le Starbase de SpaceX à Boca Chica dans le Texas septentrional, l’utopie technologique d’Elon Musk dont les tours cyclopéennes se découpent dans une brume opaque sur de la musique sinistre. Le contraste est frappant, glaçant même, entre la luminosité de la séquence précédente et l’opacité enveloppante de celle-ci, entre l’intimisme du rapport direct et le traitement pictural des images apocalyptiques qui accaparent l’écran, entre la chaleur humaine des pêcheurs et la froide technicité du complexe, entre la grandeur écrasante de l’un et la petitesse des autres. Le message est clair : à trop regarder les étoiles, on oublie ce qu’il y a en dessous. Et dès lors, on a l’impression que tout est déjà dit, que le discours du film ne sera jamais plus éloquent, ce qu’Élie confirme en grande partie au fil des oppositions mécaniques qu’il propose ensuite entre les plans de la base et ceux de l’écosystème environnant, entre les apôtres du progrès et les environnementalistes errant sur les plages encombrées de débris, au sein d’un effort dialectique qui finit vite par lasser.
Shifting Baselines déborde néanmoins d’entrevues fascinantes et d’images marquantes (la base et ses fusées semblent tout droit sorties de la science-fiction dystopique et les objets du culte d’Elon sont à glacer le sang) ; les intervenant·e·s sont assez mémorables, particulièrement les deux astronomes et l’armée d’admirateur·ice·s du projet de conquête spatiale (et d’exploitation ouvrière) du mégalomane sud-africain, dont l’alternance évoque les deux extrêmes d’une rationalité écartelée entre le savoir scientifique et le culte du progrès. Ce faisant, le film multiplie les pistes de réflexion intrigantes et les lieux de tournage, mais sans jamais établir de rapports probants entre ceux-ci. On pense notamment à l’idée de colonialisme moderne, évidente dans les références à Christophe Colomb et à ses trois vaisseaux, au problème de pollution lumineuse et au syndrome de Kessler provoqué par Starlink, mais également au glissement du cadre de référence titulaire qu’impliquent les bouleversements constants de l’écosystème provoqués par l’action humaine. Autant de réflexions porteuses qui se perdent dans le genre de flottement narratif et d’esthétisme onirique qui faisaient les choux gras de Soleils noirs (2018), mais qui ici évoquent plutôt une œuvre décousue qui s’essouffle bien avant la tombée du rideau. (Olivier Thibodeau)
Prochaines projections : 9 octobre à 20h30 (Cineplex Quartier Latin)
16 octobre à 18h00 (Cinéma du Parc)
KONTINENTAL '25
Radu Jude | Roumanie | 2025 | 109 minutes | Les incontournables
Dans les rues de Cluj-Napoca, Roumanie, un homme bourru erre, grognon. On le devine, son hostilité à l’égard de son environnement n’est pas étrangère à sa condition sociale ; elle en est le miroir. Sans domicile fixe, il se promène, côtoie la faune urbaine. Dans un parc, il est agacé par un robot-chien qui le poursuit. Le type ronchonne, le chien persiste. La scène est drôle, mais c’est lorsqu’un quidam injurie le grincheux qui s’en prend à la bête mécanique qu’on capte véritablement la signature grinçante de Radu Jude. On semble alors prioriser la défense du tas de ferraille canin — l’innovation faite meilleur ami de l’homme — plutôt que de reconnaître la souffrance humaine du laissé-pour-compte. Et le manège est enclenché, c’en est reparti pour une autre comédie sociopolitique à la lucidité acidulée dont l’ancrage dans l’hypermodernité provient certainement d’une urgence aussi créative que sociale. Tandis qu’il délaisse pour une rare fois le territoire de Bucarest, Jude aborde la montée des nationalismes racistes en regard de la situation géographique propre à la Transylvanie, puis frappe sur la crise du logement en s’amusant de la perspective d’un propriétariat « sensible ». Dans Kontinental ‘25, il revisite la culpabilité petite bourgeoise de la protagoniste d’Europa ‘51 de Roberto Rossellini et l’enrobe de sa sauce vulgaire, conférant une aura diogénique au film. Orsulya Ionescu (Esther Tompa), huissière, est tâchée d’évincer d’une salle de chaufferie un indésirable occupant, Ion Glanetasu (Gabriel Spahiu). Elle lui laisse une vingtaine de minutes pour quitter l’espace, juste assez de temps pour qu’il se donne la mort d’une façon aussi absurde que symboliquement chargée : à l’aide d’une corde de métal, il attache son cou au radiateur. Son dernier geste, de mort et de résistance, aura été de se ligoter à une source de chaleur lui étant inhospitalière.
S’en suivent les épanchements larmoyants de la protagoniste prise de remords, qui s’avèrent grossiers dans la mesure où ils sont stériles. Ce n’est pas le fait d’avoir causé la mort mais plutôt l’idée d’avoir pu apparaître insensible qui semble provoquer la honte. Orsulya et ses pairs sont en mode gestion de crise, car vient immanquablement un scandale sur les médias sociaux, commentaires haineux puis balivernes idiotes et fascistes pavant leur chemin jusqu’à la triste femme. En somme, la crise morale déclenchée par l’événement résulte-t-elle d’une véritable empathie pour l’autre ou davantage de cette pitié distanciée qui laisserait croire qu’il est presque plus intolérable d’être témoin de la misère humaine que de la subir ? Scotomisation et dissonance cognitive, comment est-ce possible qu’une âme charitable qui paie sa dîme mensuelle à coup de quelques 2 euros par cause humanitaire via sa compagnie de téléphonie cellulaire puisse-t-elle se retrouver dans pareil mauvais rôle ? Une longue conversation entre Orsulya et son amie Dorina (Oana Mardare) sur l’odeur de caca exhalant d’un sans-abri illustre parfaitement cette idée selon laquelle la puanteur de l’indigence est un fardeau insoutenable pour la classe aisée forcée de respirer les émanations de crasse. Et Dorina de référer à Perfect Days de Wim Wenders comme un chef-d’œuvre : il faudrait un bon ouvrier qui prendrait plaisir à nettoyer la saleté.
Tourné à l’aide d’un iPhone, le film à l’esthétique garrochée rappelle par moments Hong Sang-soo, notamment lors d’une scène de beuverie philosophique où l’autofocus de l’appareil ajoute un petit glitch qui sied bien à l’ivresse. La séquence alcoolisée culmine d’ailleurs dans une sexualité carnavalesque, toujours aussi précipitée et bancale que ce à quoi le cinéma de Radu Jude nous a habitué·e ·s. Bien que la culpabilité bourge de la protagoniste soit vaine et risible, elle octroie un caractère attachant à cette dernière, sa bonhomie donnant un brin d’espoir en l’humanité. C’est que Radu Jude ne condamne pas ses personnages à une cruauté immuable. Son diagnostic nous indique que ce sont avant tout l’idéologie et le système capitaliste qui posent problème. Kontinental ‘25 rappelle le sens initial de l’école philosophique du cynisme, qui n’a rien à voir avec la satire complaisante et nihiliste contemporaine préfabriquée. En résulte un élan de subversivité qui dénonce l’hypocrisie morale sans verser dans ce pessimisme qui confère une fatalité au statu quo. (Mélopée B. Montminy)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2025
Prochaines projections : 9 octobre à 21h00 (Cineplex Quartier Latin)
13 octobre 17h30 (Cinéma du Parc)
DUAS VEZES JOÃO LIBERADA
Paula Tomás Marques | Portugal | 2025 | 70 minutes | Compétition internationale
Il est difficile de ne pas penser à Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado, présenté au FNC en 2023, quand on voit le film de Paula Tomás Marques, tant il apparaît lui aussi comme un essai filmique qui interroge les conventions de la biographie pour aborder une figure défiant les normes de genre. Les deux œuvres utilisent quelques procédés similaires, notamment une mise en scène réflexive soulignant la nature construite de ce que nous regardons, mais là où le premier se penchait sur un roman et sur l’acte de lecture et d’interprétation, le second porte sur une personne persécutée par l’Inquisition portugaise, et sur la difficulté d’approcher un sujet historique trop peu documenté. Car non seulement nous ne savons pas comment João Liberada se définissait, non seulement nous nous demandons s’il existait au 18e siècle un vocabulaire permettant d’échapper à la binarité homme/femme, mais, en outre, le seul témoignage de son existence provient de ses bourreaux : comment filmer l’histoire d’un tel personnage sans la réduire au peu que nous en savons, c’est-à-dire à la violence subie, et sans trahir une vie intérieure dont il ne reste aucune trace aujourd’hui ?
Two Times João Liberada se présente comme une fiction sur un tournage à propos de João Liberada, interprété·e par June João (dans son propre rôle), une actrice trans qui s’identifie de plus en plus avec son personnage, comme si ce nom de João qu’iels partagent créait un lien défiant le temps. Le film flirte ainsi avec le surnaturel, tout en multipliant les manières de rompre avec le réalisme attendu dans une proposition biographique, que ce soit par des séquences expérimentales, jouant sur la surface égratignée de la pellicule (16 mm), ou diverses ruptures stylistiques et narratives. Il faut savoir d’ailleurs que Liberada est une création, un amalgame conçu à partir des procès de l’Inquisition portant sur des personnes au genre non conforme. Or, c’est bien ce geste, jouant de la frontière entre fiction et réalité historique, qui est au cœur du film, l’imagination servant ici d’outil venant combler les lacunes des archives, à l’instar de June qui cherche à reconnecter avec l’esprit de son personnage pour lui octroyer une intériorité absente des documents officiels. Ce travail d’introspection de la part de l’actrice permet de redonner vie au passé, de le réinterpréter à travers une belle performance qui cherche à incarner les questions posées. Cela dit, celles-ci apparaissent finalement assez peu explorées, même si elles sont denses et fascinantes, le film restant à la surface d’un sujet qui sert surtout de prétexte à quelques expérimentations formelles. (Sylvain Lavallée)
Prochaines projections : 10 octobre à 19h15 (Cinémathèque québécoise)
13 octobre à 17h45 (Cinémathèque québécoise)
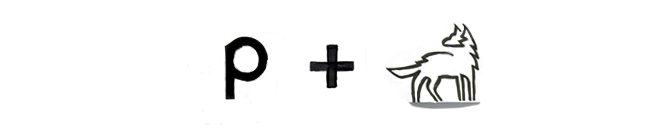
Partie 1
(Miroirs No. 3,
Put Your Soul on Your Hand and Walk,
What Does That Nature Say to You,
Shifting Baselines, Kontinental '25,
Duas vezes João Liberada)
Partie 3
(L'arbre de l'authenticité,
Wrong Husband,
Desire Lines, Romería,
Ariel, Dead Lover)
Partie 4
(Blue Moon, Magellan,
Two Prosecutors,
Father Mother Sister Brother,
Planètes)
Partie 5
(Sound of Falling,
Affection Affection,
Levers, Dracula,
A Useful Ghost)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
