
prod. Studio Babelsberg/Elizabeth Bay Production
A HIDDEN LIFE
Terrence Malick | Allemagne/États-Unis | 2019 | 173 minutes | Les incontournables
Sans doute le meilleur film de Terrence Malick depuis Tree of Life (les détracteurs de son cinéma récent diront que c’est peu dire), A Hidden Life n’est toutefois pas le grand retour en forme que l’on aurait pu espérer. En fait, peu de choses ont changé depuis To the Wonder, nous sommes à nouveau devant cette caméra errante, souvent collée au plus près des acteurs, et continuant à collectionner le même type d’images (des amants et des enfants qui jouent, une insistance sur les mains, des champs à moissonner, la nature dans toute sa splendeur, des angles étranges, des mouvements subits, tournoyants), avec ce montage elliptique, cette trame sonore (composée en majorité de chants religieux) couvrant le film mur-à-mur, et cette enfilade de voix off remplaçant pour l’essentiel les dialogues. En même temps, A Hidden Life suit une ligne narrative très claire, contrairement aux films précédents, et tous ces tics de mise en scène sont amenuisés, ou du moins cette esthétique ne vaut plus pour elle-même, Malick cherchant à nouveau à raconter.
Et il faut bien avouer que ce récit sur un fermier autrichien, Franz Jägerstätter, pendant la Seconde Guerre mondiale, refusant de porter allégeance à Hitler, jusqu’à se faire emprisonner, battre, puis condamner à mort, sied bien au cinéaste texan : ancrant sa narration dans la correspondance que Franz (August Diehl) entretenait avec sa femme (Valerie Pachner), Malick peut aborder de front la foi religieuse, cette conviction intime permettant de garder espoir dans un monde sans espoir, de poursuivre jusqu’à l’absurde une résistance en apparence futile. Plus que jamais, Malick semble chercher le divin, soit dans les paysages sublimes écrasant les hommes, quand nous sommes à l’extérieur, dans le village de Franz, où se trouve sa liberté, soit dans le visage des hommes, quand nous sommes dans les espaces clos de la prison. C’est peut-être cette quête de l’invisible, de ce qui est partout et nulle part à la fois, qui justifie le sentiment de répétition, de longueur, le film faisant du surplace entre chaque séquence-clé, chaque nouvel événement. Il y a bien quelque chose d’éprouvant ici, dans l’effort constant que déploie Malick pour trouver ce qu’il cherche — ses détracteurs diront qu’il s’agit d’une pose, d’une transcendance feinte de tous les instants, mais il me semble que c’est plutôt cet effort, cette recherche s’effectuant à travers cette caméra curieuse, tâtonnante, que Malick met en scène, et non une transcendance effective, qui serait donnée ou qui aurait déjà eu lieu.
La foi de Franz serait alors une inspiration pour la mise en scène, comme si Malick partait d’une posture de doute pour retrouver ce que son personnage, lui, peut voir. Une vie cachée, le titre est tiré d’une citation de George Eliot (« for the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life »), et il renvoie à la fois à cette vie ordinaire, à l’écart de la grande Histoire, mais garante du bien commun, et à cette vie cachée que seule la foi peut révéler. Malick peut, par son film, rendre visibles les actions de Franz (à plusieurs reprises on lui fait remarquer que ses actions sont inutiles puisque personne ne peut les voir), mais ce n’est au fond que la moitié du chemin, car le plus important est encore de découvrir (pour soi) ce monde caché que Franz peut voir et qui lui permet de garder confiance. C’est là le projet du film — quelque part c’est tout le projet du cinéma, redonner foi en notre monde en trouvant une nouvelle façon de l’habiter par des images qui nous le révèlent autrement — et c’en est un, il me semble, qu’il faut saluer. D’autant plus qu’à quelques reprises nous avons bel et bien l’impression de frôler ce que cherche Malick (peut-être que rendu là il n’en appartient qu’au spectateur de faire le dernier pas), ce qui, à mon sens, vaut bien la peine de souffrir quelques moments d’ennui. (Sylvain Lavallée)

prod. Cinekap/Frakas Productions/Les Films du Bal
ATLANTIQUE
Mati Diop | France/Sénégal/Belgique | 2019 | 104 minutes | Les incontournables
La mise en scène est d’abord bruyante. Les gestes fusent, les figures inondent le cadre, la caméra se coince au centre de foules agitées qu’elle regarde dans la panique. La fébrilité des corps qui occupent le cadre le fait déborder de vie, la variation de leurs gestes diffuse le regard sur une multiplicité de présences qu’on se met à observer, à concevoir dans ce qu’elles ont de particulier ; encore impossible de mettre le doigt sur un protagoniste lorsqu’on ne triche pas et Mati Diop ne triche jamais, son style n’impose d’emblée pas d’héroïsation ni de focalisation narrative exclusive, tout le monde est dans la même situation, le même panier, l’arrière du même camion, l’intérieur de la même pirogue océanique, partageant leur sort sur la terre comme à la mer.
Atlantique est une œuvre simple et magnifique, qui marque aussi la première prise africaine d’envergure pour Netflix, qui s’est payé les droits de sa distribution internationale après sa diffusion au dernier Festival de Cannes (où il a gagné le Grand prix). Si à première vue ce repêchage peut sembler surprenant, le film de Diop convainc rapidement de son universalisme mystérieux, notamment dans sa manière de poser cette fébrilité inaugurale comme le haut point d’un film qui descend progressivement vers la mort et l’immobilisme. Ainsi Atlantique se calme progressivement, privilégiant notamment l’ellipse afin d’imposer à la trajectoire de cette jeune femme amoureuse des douleurs profondes qui ne sont pas pour autant des cruautés de mise en scène. Patiente alors qu’elle attend des nouvelles de son premier amour récemment lancé dans une traversée qui vise à le conduire de Dakar à l’Europe, Ada (Mame Bineta Sane), finira par se voir imposer un nouveau conjoint, un type riche, insupportable, gravitant autour d’un hôtel 5 étoiles qui vient d’ouvrir sur le littoral de la ville portuaire.
À partir de cette attente que Diop propose d’abord comme une variation élégiaque sur l’amour perdu, Atlantique verse graduellement dans la fable horrifique, faisant de tous les exploités morts pour la centralisation outrancière des richesses africaines les soldats d’une révolte morte-vivante. La possession des êtres se répand dans les classes pauvres de la société au fur et à mesure que la mise en scène nous rend conscients de la source des inégalités qui habitent le cadre, érigeant l’Atlantique comme un mur symbolique qui enferme une Afrique en proie depuis fort longtemps à un processus d’autodévoration économique. Alors les zombis de Diop mangent les riches qui les ont forcés à quitter, proposant une révolte imaginaire qui répond à la fois d’un besoin cathartique de voir brûler les figures de cet appauvrissement, mais aussi d’une poésie macabre qui ouvre l’espace réaliste du cinéma africain et qui lui redonne de cette magie permettant de rêver aux révolutions. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Sine Olivia Pilipinas/Spring Films
THE HALT
Lav Diaz | Philippines | 2019 | 282 minutes | Les Nouveaux Alchimistes
Cinéaste de la mémoire, cherchant à faire revivre l’histoire de son pays, avec The Halt Lav Diaz se tourne vers le futur pour parler de l’oubli : « A Nation Without Memory », comme le dit le titre d’un ouvrage au centre du film. Ce futur rapproché (2034) tient bien sûr d’allégorie pour le présent, une dystopie aux accents parfois surréalistes (suite à une éruption volcanique, un nuage de fumée cache en permanence le soleil), mais puisant aussi dans le passé du pays (la loi martiale sous Ferdinand Marcos, d’ailleurs cité comme modèle par le dictateur de la fiction). Sans être directement inspiré par la littérature russe (Dostoïevski dans Norte, the End of History, Tolstoï dans The Woman Who Left), The Halt possède une densité narrative rappelant cet important legs littéraire, Diaz suivant pendant près de cinq heures (un moyen métrage selon ses termes) divers personnages, du plus puissant aux plus démunis, du pouvoir en place à la résistance.
Le film accumule ainsi les figures de l’oubli, de l’aveuglement (un ancien musicien rock déjà à moitié aveugle vit sous la menace constante de perdre la vue), de la perte d’identité (une professeure d’histoire devenue prostituée doit refouler toute émotion, ne pas parler, pour satisfaire ses clients ; un homme efface son passé pour jouer le rôle d’un autre), alors que le pouvoir est plutôt caractérisé par sa folie (le dictateur entend des voix, est pris de convulsions qu’il ne peut apaiser qu’en écoutant de la guitare rock dissonante). Le discours est limpide : dans une nation taisant son histoire, il ne reste que la noirceur d’un monde sans avenir (la meilleure perspective pour un enfant orphelin, nous dit une travailleuse sociale, est encore la mort). S’il y a bien ici une forme de répétition du passé, le film tente plutôt de nous plonger dans un temps suspendu, la notion de « temps » devenant désuète dans un monde caractérisé par l’oubli. Le travail sur la durée permet alors de jouer sur ce contraste entre notre expérience de spectateur (impossible d’ignorer que l’on s’engage dans un film de près de cinq heures) et ce temps suspendu de la fiction (comment marquer le passage du temps quand il n’y a plus de lumière pour rythmer notre quotidien ?), comme s’il s’agissait de rappeler que le temps défile malgré tout, et que c’est dans cette durée, du moment que l’on sait l’accueillir, ou y habiter, que peut naître l’espoir.
De façon semblable, le statisme de la mise en scène (presque tout le film se déroule en longs plans fixes) participe à cette impression d’immobilité, alors que la caméra s’attarde sur ses hommes et ses femmes qui existent malgré tout, et qui portent en eux le mouvement de la vie qu’une nation tente de freiner. Loin d’une posture de contemplation, le statisme de la caméra communique ainsi tour à tour une rage contenue, une tendresse bienveillante, une dérision mordante, Diaz maintenant en tout temps dans sa mise en scène une posture éthique d’une rare justesse. La démarche du cinéaste ressemble en fait à ce personnage délaissant la résistance par les armes pour aller prendre soin des enfants : c’est en portant attention aux humains qui nous entourent que nous allons pouvoir entendre l’histoire qu’ils portent en eux, et résister à la violence de l’oubli. Pour Diaz, il en revient au cinéma d’éclairer les ténèbres de la salle en projetant la lumière de cette humanité que notre monde préfère ignorer, ou encore de réintroduire du temps là où il n’y en a plus, afin de connecter le passé au présent pour ouvrir l’avenir. Difficile d’imaginer un cinéma plus essentiel aujourd’hui. (Sylvain Lavallée)

prod. Heyday Films/Netflix
MARRIAGE STORY
Noah Baumbach | États-Unis | 2019 | 136 minutes | Les incontournables
Pour Noah Baumbach, un film nommé Marriage Story ne peut porter que sur le divorce. Heureusement, le potentiel cynisme de ce titre ironique laisse place à un sentiment beaucoup plus complexe, jouant sur ce renversement de l’un dans l’autre, du mariage au divorce, pour faire de la séparation une continuité, un renouveau plutôt qu’une fin définitive. La première séquence, au fond, dit tout : en voix off, Charlie (Adam Driver) nous dit ce qu’il aime de sa femme, Nicole (Scarlett Johansson), que nous voyons alors à travers les yeux de son mari ; ensuite, c’est au tour de Nicole de se prêter au jeu et de décrire son mari. Nous découvrons ainsi un couple aimant, avec leur enfant, nous voyons l’un et l’autre dans leur vie ordinaire, à travers les petits gestes, leurs manies, leurs tempéraments, tout ce qui forme qui ils sont, et tout ce quotidien qui semble être à la base de leur amour — avant de comprendre qu’en réalité les voix off que nous entendions sont les lettres qu’ils se sont écrites, à la demande de leur thérapeute, pour entamer le processus de séparation sur une note positive, pour se rappeler ce qu’ils ont perdu.
Voilà pour le mariage devenu divorce, mais le titre nous indique aussi que nous avons affaire à des mots, des récits : dans ces lettres, déjà, Charlie raconte Nicole et Nicole raconte Charlie ; plus tard, devant son avocate, Nicole se raconte, revient sur les raisons de ce divorce qu’elle a initié, sur son sentiment d’être invisible auprès de son mari, de ne pas avoir de voix, justement, Baumbach recueillant alors les paroles de Nicole dans un plan long qui lui accorde toute la liberté, le temps et l’espace, dont elle a besoin ; dans les mains des avocats, le divorce devient une compétition qu’il faut gagner en trouvant le bon récit, celui qui valorisera le mieux le parent défendu et démonisera le plus fortement l’autre parent ; et quand les avocats parlent pour le couple, la caméra s’attarde sur les visages de Charlie et Nicole, pour laisser parler leur silence, leur évident désarroi devant un récit qui leur échappe, une histoire qui est la leur mais qui dans ces mots n’est plus la leur. Pour Baumbach, tout l’enjeu du film consiste à trouver le ton juste, trouver les bons mots pour ses personnages, pour exprimer toutes ces tensions entre ce qui est dit mais non-entendu, entre ce qu’on arrive à dire et ce qu’on préfère taire, entre ce qui est bien dit et ce qui sort confus, entre la vérité appartenant à l’un et à l’autre et les mensonges servant ce qui tient de justice.
Baumbach déplace ainsi son cynisme usuel vers les institutions, les rouages judiciaires, pour rester au plus près de ses personnages, de ses acteurs principaux, tous deux magnifiques, émouvants, et de la galerie d’acteurs secondaires qui les accompagnent (Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Wallace Shawn… un casting on ne peut plus impeccable). Un certain déséquilibre dans le temps alloué à chaque parent mine un peu le projet du film (après les procédures de divorce amorcées, Nicole reste à l’arrière-plan), et quelques moments poussent la note un peu trop fort (une engueulade qui va loin dans le concours d’insultes), mais pour l’essentiel le film maintient avec grâce ce ton difficile, trouvant toujours de l’humour même dans les situations les plus dramatiques, et capable en tout temps de souligner l’amour qui persiste malgré ce qui se joue. Et en ce sens, le titre n’a rien de cynique, il s’agit bien d’une histoire de mariage, d’un mariage qui se poursuit dans le divorce, ou à l’inverse d’une séparation qui n’est rien d’autre qu’une nouvelle façon d’aimer. (Sylvain Lavallée)

prod. Lo & Hu Company Productions Ltd.
RAINING IN THE MOUNTAIN
King Hu | Taïwan/Corée du Sud | 1979 | 120 minutes | Temps Ø
Chez King Hu, la virtuosité repose d’abord sur la fluidité du mouvement — celui des corps comme de la caméra, qui épouse avec grâce les déplacements des personnages dans l’espace. On parle à tort et à travers de « mise en scène » ; avec King Hu, on renoue avec la signification véritable de cette expression. Tout, chez lui, relève de l’orchestration de l’action. Dans son cinéma, la précision est à la fois au service de l’élégance et du sens. Sa poétique en est une d’harmonie, d’équilibre, en parfaite adéquation avec des principes bouddhistes qu’il cherche à représenter non seulement à travers le récit, mais aussi par le biais de la mise en scène.
Raining in the Mountain s’inscrit dans la lignée du classique A Touch of Zen, pierre angulaire du versant « spirituel » de l’œuvre de Hu. Il forme avec Legend of the Mountain, tourné la même année, un vague diptyque sur les textes sacrés du bouddhisme. Dans ce film, un jeune érudit était chargé de traduire et de retranscrire un sutra conférant à son détenteur une emprise sur le royaume des morts. Ici, divers individus complotent afin de mettre la main sur un manuscrit d’une valeur inestimable. Mais pour Hu, il ne s’agit que d’un objet ; et tout son film s’affaire à nous rappeler qu’il n’a d’importance qu’à travers les enseignements qu’il contient.
Aux futiles jeux de pouvoir qu’il dépeint, Raining in the Mountain oppose les gestes posés du quotidien dans le temple de même que la pérennité de la nature l’entourant. Les rites des moines servent de contrepoint à l’agitation superficielle, aux magouilles stériles ; le montage articule une confrontation entre l’ambition matérielle et l’aspiration spirituelle, alors que l’image continue de suivre avec une attention irréprochable le déroulement de l’action. Fasciné par les gestes, Hu construit tout son discours autour de leur économie. Même les coupes franches, à travers la rupture, créent immanquablement de la continuité.
Fluidité, donc. Encore et toujours. Non seulement comme fondement esthétique de l’entreprise cinématographique, mais aussi comme principe moral sous-jacent. Comme une affirmation de la grâce à laquelle l’être humain peut tendre, dans son rapport à l’univers et à la nature. Ce n’est pas pour rien que les films de Hu commencent souvent par de longues déambulations dans des paysages époustouflants. L’environnement n’est pas seulement un décor, un tableau sur lequel le corps pose les traits d’une existence par laquelle il s’exprime. Il surplombe l’humain, lui rappelant à la fois sa grandeur et sa petitesse, son importance et son insignifiance. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. My New Pictures/Les Films du Bal
ZOMBI CHILD
Betrand Bonello | France | 2019 | 103 minutes | Les incontournables
La dualité fait partie intégrante du cinéma de Bertrand Bonello. Que ce soit à travers ses personnages ou leurs récits, les films du cinéaste reflètent cette approche duelle qui traverse son œuvre, qu’on pense aussi au personnage double de Tiresia (2003) ou à la construction narrative dichotomique de Nocturama (2016). Zombi Child n’y échappe pas et autant qu’il puisse paraître plus en retenu (et il l’est pour le mieux), il est totalement bonellien. Dès le début du film, on assiste à une présentation en deux scènes des deux dualités, tant temporelle que thématique, qui vont cohabiter et éventuellement se rejoindre dans le film. Haïti, 1962 : on assiste à la fabrication de la poudre utilisée pour rendre les hommes zombi. On découvre ensuite le malheureux qui subira la zombification malgré lui, Clairvius Narcisse (son cas fut documenté dans le livre The Serpent and The Rainbow de Wade Davis paru en 1985), qui sera donc passé pour mort avant de revenir de sa tombe. On se déplace ensuite dans le pensionnat de la Légion d’honneur à Saint-Denis, 55 ans plus tard, où on y découvre les quelques jeunes filles qui écoutent un exposé (par Patrick Boucheron) sur les différentes notions de liberté au 19e siècle en France, apportant une approche discontinue de l’histoire de la France et de se qu’elle lègue. Cette introduction sert donc de piste de lecture pour tout le film qui suit.
En Haïti dans les années 60, Clairvius Narcisse revient des morts, désincarné, pour se faire enlever et forcer à travailler dans les plantations de sucre. En France, 55 ans plus tard, Mélissa, la petite-fille de Clairvius, se trouve dans un pensionnat de jeunes filles où Fanny, sa nouvelle amie de classe, lui propose d’entrer dans sa sororité littéraire. Mélissa leur parlera de ses origines haïtiennes et Fanny et ses amies développeront alors une curiosité grandissante pour le vaudou. À travers ces deux récits en parallèle, Bonello propose une relecture du colonialisme et de l’esclavage en Haïti, amenant ces deux jeunes filles, l’une Française et l’autre Haïtienne, à (ré)apprendre l’histoire de l’autre, ce qui les lie et la filiation qui les attache de leurs ancêtres jusqu'à elles-mêmes. Plusieurs parallèles viendront alimenter les scènes de chaque récit, des rituels vaudou aux rituels d’initiation que s’inventent les filles pour leur sororité, des visions en rêve des Clairvius et Fanny de leur être aimé respectif, de cette vie nocturne que chacun vit (Clairvius en zombi qui erre dans les plantations tandis que Fanny et Mélissa passent leur nuit dans leur sororité secrète), de cette vie en retrait du monde que chacun vit (Clairvius condamné à être zombi et Fanny prise dans ce pensionnat). D’ailleurs on reconnaît cet aspect dans tous les films de Bonello, qui fonctionnent en plaçant des personnages dans des lieux clos (le centre commercial de Nocturama, le lieu de séquestration dans Tiresia, la maison close de L’Apollonide). Pendant tout ce temps, Mélissa semble avoir des moments de possession étranges durant certaines nuits, tandis que Fanny est constamment hantée en pensée par le jeune homme qu’elle aime qui semble loin d’elle. Cet amour déchirera Fanny une fois qu’elle recevra une lettre de cet être aimé qui semble vouloir mettre un terme à cette relation. C’est alors qu’elle expérimentera la détresse de se sentir possédé d’un être qu’on ne veut plus en nous. Faisant des parallèles entre le sentiment d’amour et de possession, le film poursuit dans cet élan en créant des dualités à travers les thèmes qu’il explore, alliant amour et possession, possession et esclavagisme, esclavagisme et liberté, faisant cohabiter des époques et des musiques qui semblent si éloignées (de Moonlight Benjamin à Damso).
Entre l’essai didactique et le film atmosphérique, Bonello démontre encore une fois sa maîtrise exceptionnelle dans un film plus en retenu, plus modeste, qui ne perd aucunement en puissance. À travers un rythme lent qui devient hypnotique, des images majoritairement nocturnes aux éclairages très sombres, Bonello réussi à produire une atmosphère mystérieuse, digne d’un grand film d’épouvante. Cependant Zombi Child n’en est pas vraiment un et ne cherche pas non plus à en être un. Son souci de réalisme et son entrée en matière plus didactique viennent attacher le récit aux racines mêmes du vaudou, à l’histoire de la France et de l’Haïti, évitant de tomber dans l’exploitation en décidant plutôt de ramener le zombi à ses origines (zombi étant étymologiquement le terme d’origine français, tiré du créole zonbi), tout en confrontant l’occultisme au rationalisme. (David Fortin)
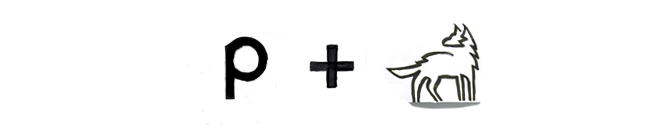
PARTIE 1
(Aren't You Happy?, Die Kinder Der Toten,
Little Joe, Ma nudité ne sert à rien)
Dieu existe, son nom est Petrunya
PARTIE 2
(Acid, Liberté, Serpentário, Soylent Green,
The Vast of Night, Wind Across the Everglades)
PARTIE 3
(Diner, 37 Seconds, Guest of Honour,
J'ai perdu mon corps, Videophobia)
PARTIE 4
(Ma nudité ne sert à rien, Bacurau,
Family Romance, LLC, , Monument, Parasite)
PARTIE 5
(A Hidden Life, Atlantique, The Halt,
Marriage Story, Raining in the Mountain,
Zombi Child)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
