
prod. Jeonwonsa
INTRODUCTION
Hong Sang-soo | Corée du Sud | 2021 | 66 minutes | Les incontournables
Depuis sa « trilogie de l’infidélité » (On the Beach at Night Alone ; La caméra de Claire ; The Day After) et deux films funèbres, sur la mort et les conséquences des actions que l’on pose de notre vivant (Grass et Hotel by the River), Hong Sang-soo semble avoir regagné goût à la vie – bien qu’une vie teintée d’incertitude et de bifurcations. Le prolifique et systématique auteur coréen fait ici suite aux déambulations de The Woman Who Ran avec Introduction, dont le motif principal est à nouveau la rencontre. Rencontre à la fois passagère et anodine (cette initiation que laisse pointer le titre) et déterminante, charnière — culminant, trois fois plutôt qu’une, en un rapprochement inattendu. En trois parties distinctes, on devine une ébauche de la vie de Young-ho (Shin Seok-ho) — beau jeune homme qui décidera de devenir acteur ; qui se fera larguer par sa copine Ju-won (Park Mi-so) ; qui changera d’avis sur sa carrière ; et ainsi de suite, des suites d’un échange chargé avec son père (docteur), la copine en question (partie étudier la mode à Berlin) et sa mère (qui bouclera la boucle). « Ébauche » car la structure d’Introduction relève du croquis — à la fois dans la minceur des thèmes qui y sont abordés (l’émancipation, la croisée des chemins, la pression familiale, la rancœur) — que dans cette qualité de « page blanche » qu’Hong semble adopter ici, plus que jamais et qui se traduit dans la facture visuelle du film. Contrairement à la palette que Kim Hyung-koo (directeur-photo de Memories of Murder, The Host, Peppermint Candy, etc.) apportait à ses précédents films monochromes, le noir-et-blanc digital qu’Hong choisit ici (à titre de son propre DP) est âpre et plat, sans grand intérêt autre que de pointer vers la nature approximative de cette mini-production de 66 minutes. C’est-à-dire : un film-croquis, de fenêtres et de cieux surexposés, d’une blancheur éblouissante qui menace d’engloutir les personnages telle la surface d’une page blanche sur laquelle Hong aurait gribouillé quelques mots entre deux cigarettes — sans pour autant approfondir la réflexion éthique (ou même structurelle) posée par ses films précédents ; tel l’océan glacial face auquel se trouve Young-ho, des suites d’une hallucination revancharde. Peut-être s’agit-il, à l’image de ces trois rencontres, d’un nouveau départ pour le plus consistant des cinéastes. Mais connaissant sa rare capacité à excaver les émotions les plus intimes de ses personnages, on se permet d’espérer un portrait plus étoffé au prochain détour de l’œuvre. (Ariel Esteban Cayer)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2021

prod. micro_scope, Pimienta Films
LES OISEAUX IVRES
Ivan Grbovic | Québec | 2021 | 105 minutes | Présentations spéciales
D’un point de vue technique, Les oiseaux ivres est une œuvre plus accomplie que Roméo Onze (2011), le premier long métrage d’Ivan Grbovic. Il s’agit en fait d’une version plus mature de cet irrésistible prédécesseur, quoiqu’il n’y ait pas que du bon dans cette évolution. La mise en scène est désormais plus raffinée, avec des travellings incroyablement complexes, de même que d’habiles juxtapositions temporelles et fantasmatiques. Par contre, le récit est moins accrocheur, s’apparentant plutôt aux grands classiques du romantisme qu’au conte d’ennui adolescent qui avait fait la renommée du réalisateur. À preuve : la prémisse quasi opératique du jeune Mexicain, Willy (Jorge Antonio Guerrero), parti en quête de sa dulcinée, ex-copine d’un caïd dont il a facilité la fuite hors du pays, et dont il tente aujourd’hui de retrouver la trace sur le territoire québécois en acceptant un emploi saisonnier dans la ferme de Julie et Richard (Hélène Florent et Claude Legault). Le résultat à l’écran est magnifique, fruit d’un auteur humaniste doublé d’un habile conteur, secondé dans sa tâche par l’exceptionnelle Sara Mishara (sa complice de 2011) à la direction-photo et à la scénarisation. Le film ne possède pourtant pas l’originalité de Roméo ni son économie narrative, ni la performance mémorable d’Ali Ammar.
Il est toujours éclairant de voir se déployer à l’écran la réalité immigrante et d’en partager les paramètres par procuration, comme c’était le cas de son film de 2011, où un jeune protagoniste d’origine libanaise avait maille à partir avec un père mécontent de son célibat. Lui-même fils d’immigrants, Grbovic s’attarde ici plus précisément, et très finement, au sens du lieu et à la place qu’occupent les personnages dans ces lieux, œuvrant toujours à partir d’espaces striés, éminemment anthropocentriques : la maison familiale des propriétaires terriens, la villa abandonnée du caïd mexicain, même les baraques qui abritent les travailleurs saisonniers, toutes débordantes de souvenirs. Ces espaces sont immédiatement propices à l’ancrage émotionnel des individus puisqu’ils participent tous à une iconographie domiciliaire d’inspiration internationaliste, vectrice de l’idée selon laquelle on porte toujours sa maison avec soi. Grbovic crée même des espaces mentaux parallèles pour ses personnages, lesquels s’intègrent subrepticement à la réalité environnante. Dans son exploration de l’expérience humaine, il transcende donc maintenant le réalisme social et émotionnel, matérialisant avec doigté les souvenirs et les pensées des protagonistes, même leurs fantasmes narcotiques, d’une façon tout aussi vibrante que leurs environnements, privilégiant ainsi une relation précieuse et symbiotique entre ceux-ci et les spectateurs.
Le problème réside dans le caractère romanesque du récit, dans cette prémisse fantaisiste d’amour éternel, qui détone fortement avec le caractère extrêmement prosaïque, voire banal, du drame vécu dans le film précédent par Roméo, et dont la relative insignifiance illuminait un angle mort du cinéma adolescent, soit les conséquences de la crédulité issue du désespoir amoureux. Si l’interprétation d’Ali Ammar est plus mémorable que celle de Guerrero, ce n’est donc pas simplement parce qu’une plus grande partie du temps d’écran lui est imparti, mais parce que son personnage est moins idéalisé, plus imparfait, plus vraisemblable, imbriqué dans un récit qui ne rappelle ni les grands thèmes de la littérature mondiale, ni ceux du cinéma hollywoodien. (Olivier Thibodeau)

prod. See-Saw Films, Brightstar, Max Films, BBC Films, Cross City Films, New Zealand Film Commission
THE POWER OF THE DOG
Jane Campion | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande/Canada | 2021 | 128 minutes | Les incontournables
Travaillant avec son plus grand budget en carrière, soutenue par Netflix, Jane Campion nous offre avec The Power of the Dog une sorte de version édulcorée de son cinéma habituel, qui jusqu’à maintenant a su être autrement plus radical. Peut-être que les attentes (les miennes du moins) étaient trop hautes, mais avec sa trame narrative télégraphiée, qui nous mène sans grande surprise vers la conclusion que l’on anticipe dès les premières minutes, le film s’avère plutôt décevant. Amour, jalousie, désirs refoulés, violence émotionnelle, masculinité toxique… nous retrouvons bien tous les thèmes de Campion, ancrés dans un splendide décor de western, mais sans la complexité psychologique caractéristique de son œuvre. Les personnages apparaissent trop minces, compte tenu, entre autres, d’un scénario qui change de perspective à mi-chemin, laissant certains protagonistes derrière pour en ramener d’autres vers l’avant, les empêchant de se développer pour acquérir une véritable densité émotionnelle. De même, d’autres aspects demeurent sous-exploités, notamment les enjeux de classe sociale, qui disparaissent en cours de route après avoir été centraux au départ.
The Power of the Dog déçoit surtout parce qu’il s’inscrit dans l’œuvre d’une cinéaste exceptionnelle, parce qu’on espérait qu’il s’agisse d’un grand film plutôt que d’un bon film. Campion demeure apte à mettre en scène des personnages enfermés en eux-mêmes, cherchant échappatoire à leur solitude douloureuse, à bâtir une tension dramatique à partir des non-dits et du langage corporel. Elle est aidée par des acteurs remarquables, Benedict Cumberbatch en premier, dans un contre-emploi surprenant (d’ordinaire, il n’a rien du cowboy rude et viril) ; Jesse Plemons, dont les airs innocents, cette fois, sont au service d’une douceur, loin de la violence cachée à laquelle il est souvent associé ; et Kirsten Dunst, qui, un peu comme chez Sofia Coppola, se retrouve prisonnière d’un lieu clos, invisible aux yeux des autres (son personnage, au départ beau et prometteur, souffre malheureusement plus que tout autre des faiblesses du scénario). Mais il manque au film ce je-ne-sais-quoi qui permettrait de faire vivre le scénario au-delà de la simple anecdote ; il manque l’érotisme et la dimension hautement sensorielle de la caméra de Campion, lorsqu’elle embrasse les corps, les paysages, pour faire ressentir les désirs, particulièrement les plus refoulés, non-avoués, inavouables. Cette sensibilité semble perdue derrière les allures d’un classicisme maîtrisé mais assez froid, alors que The Power of the Dog invite sans jamais atteindre l’intensité passionnelle à laquelle l’autrice nous a habitués. (Sylvain Lavallée)

prod. Filmika Galaika, Bando à parte
SYCORAX
Lois Patiño et Matías Piñeiro | Espagne/Portugal | 2021 | 20 minutes | Compétition internationale court métrage
Le duo intellectuel formé par Matías Piñeiro (The Princess of France, 2014) et Lois Patiño (Red Moon Tide, 2020) est intimidant. Le premier a déjà excellé dans l’intertextualité (pour Isabella, 2020, fait d’une mosaïque de personnages féminins tirés de plusieurs œuvres shakespeariennes), le second dans ses travaux plastiques, capable de travailler l’historicité naturelle des paysages, ce qui revient à pointer sa manière particulière de filmer des étendues désertées dans Red Moon Tide et ici de capter des arbres… Car avant d’être une récupération adroite de la femme-sorcière de The Tempest, contestant le point de vue unique du despote Prospero qui la châtie, avant d’être ce genre d’arrêt-sur-personnage qu’aurait bien aimé Orson Welles, Sycorax, est un beau film sur les arbres, très vieux, très bien enracinés, qu’on retrouve dans les Açores où les réalisateurs ont tourné.
Là-bas, Piñeiro et Patiño travaillent d’abord comme si leur film était un secret. Ils regardent les passants, les affublent des grands noms de la pièce, à la recherche de celle qui pourra jouer la sorcière qui aurait condamné Ariel, esprit de l’air, à vivre dans un arbre. Basculant alors dans une étude d’une nature déjà-là du temps de Shakespeare, la caméra réussit à s’enfuir du monde des humains grâce à des panoramiques juste assez lents, glissant d’une dimension spatiale à l’autre, de la superposition épistolaire au donjon théâtral avant de finir dans la forêt brumeuse. On pense à Pedro Costa, à Albert Serra, à Apichatpong Weerasethakul enfin, une bonne compagnie vers qui Piñeiro et Patiño pagaient gaiement, et ce, même si le projet bicéphale souffre un peu dans ses sutures, notamment dans ses transitions de l’urbanité documentaire à la nature onirique. Heureusement, Sycorax est aussi une carte de visite : le duo a déjà prévu un second film, un long, centré sur cet Ariel prisonnier d’une île. (Mathieu Li-Goyette)
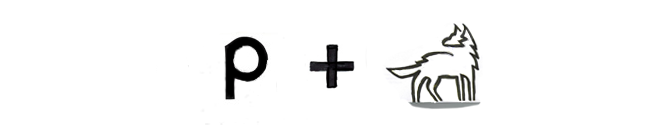
PARTIE 1
(Introduction, Les oiseaux ivres, The Power of the Dog, Sycorax)
PARTIE 2
(Celts, Extraneous Matter, North Shinjuku 2055, Wheel of Fortune and Fantasy)
PARTIE 3
(La contemplation du mystère, Damascus Dreams, Wood and Water, Zeria)
PARTIE 4
(Earwig, Saloum, What Do We See When We Look at the Sky?,
The Worst Person in the World)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
