1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Ingenious Media, RB Entertainment, Redline Entertainment, Our Turn Productions, FirstGen Content, LB Entertainment
CALL JANE
Phyllis Nagy | États-Unis | 2022 | 121 minutes | Présentations spéciales
Call Jane a eu sa première à Sundance en janvier 2022; au mois de juin dernier, la Cour Suprême des États-Unis infirmait l’arrêt Roe v. Wade, redonnant ainsi la liberté à chaque état de promulguer sa propre loi sur l’avortement. Le film de Phyllis Nagy (scénariste du magnifique Carol [2015] de Todd Haynes) brosse le portrait du Jane Collective, un service illégal d’aide à l’avortement qui œuvra à Chicago de 1968 à 1973, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’arrêt Roe v. Wade soit rendu, l’organisation perdant alors sa raison d’être, son propre militantisme féministe ayant largement contribué à soutenir la cause. En un sens, Call Jane ne saurait être plus d’actualité : depuis le mois de juin, les femmes de certains états américains sont de retour en 1968, le film se regardant comme un passé qui est redevenu notre triste présent. Mais il est aussi évident que la production a été pensée avant les événements récents, et que l’atmosphère générale, assez détendue, comique, nous parvient de ce qui est déjà une autre époque. Impossible aujourd’hui de réaliser un tel film, impossible, surtout, de terminer sur la même note optimiste, sur les paliers de la Cour Suprême pour célébrer les droits enfin acquis, dans un happy end qui nous dit que nous pouvons maintenant passer à autre chose. Il est difficile de regarder une telle scène triomphante (dépourvue d’ironie) sans se dire que même en 2021, au moment du tournage, on aurait bien dû savoir qu’un tel sentiment est aveugle, et que la bataille est loin d’être gagnée définitivement dans le climat conservateur actuel.
Call Jane souffre de sa fausse actualité, mais aussi d’un ton trop sage, trop rangé dans les conventions hollywoodiennes du « sujet historique important ». Emprunter le point de vue d’une bourgeoise (Elizabeth Banks), choisissant l’avortement parce qu’elle est atteinte d’une maladie rare qui pourrait lui enlever la vie au moment de l’accouchement, permet de découvrir le Jane Collective avec elle, et de la suivre alors qu’elle s’y implique de plus en plus, nous amenant dans la salle médicale pour suivre avec minutie les détails de l’opération et dans des réunions qui exposent les difficultés auxquelles l’organisme fait face. Il y a des vertus à cette perspective pédagogique, très bien écrite, mais elle finit par aborder trop succinctement des sujets qui n’apparaissent qu’en dialogues : le difficile accès à l’avortement pour les plus pauvres, et en particulier pour les femmes racisées (l’opération coûte 600$), ou les diverses raisons qui mènent vers une telle décision, notamment le viol et une absence d’éducation sexuelle dans le contexte protestant. Notre protagoniste nous offre un point de vue confortable, qui permet un regard global un peu plus détaché (surtout que les possibles tensions avec sa famille sont vite dissipées), mais aussi ce ton bienveillant plus malavisé. C’est surtout une question de nuance : mettre l’accent sur la solidarité féminine permettant de surmonter les difficultés est essentiel, tant que cela n’amenuise pas la réalité du drame, bien plus terrible pour des femmes dans des positions moins aisées.
Cela dit, il ne s’agit pas d’un mauvais film, il a toutes les qualités typiques de ce genre de production, parfaitement compétente, avec des actrices impeccables (dont Sigourney Weaver dans le rôle de la fondatrice du collectif) et une mise en scène habile qui maintient notre attention et suscite l’émotion. Mais Call Jane trouvera son véritable intérêt dans des événements comme celui organisé par le FNC, comme porte d’entrée efficace et accessible à une discussion plus large sur les enjeux qu’il soulève. (Sylvain Lavallée)

prod. Hi-Vis Film
QUEENS OF THE QING DYNASTY
Ashley McKenzie | Canada | 2022 | 122 minutes | Compétition nationale
Suite à ce qui apparaît comme une énième tentative de suicide, Star (Sarah Walker), une adolescente neurodivergente, réatterrit entre les murs d’un hôpital où elle semble bien connue du personnel. Mais si cette visite s’avère pour elle familière, comme la dernière d’une longue suite de séjours, elle diffère nettement de ses précédents passages. Star a maintenant dix-huit ans, et elle quittera bientôt un noyau familial violent sans l’assurance d’une protection institutionnelle pourtant défaillante; durant cette escale clinique, elle fait aussi la rencontre de An (Ziyin Zheng), jeune étudiant·e chinois·e queer, qui tente d’agrémenter son dossier d’immigration par des postes bénévoles, assurant ici une douce surveillance et errant avec Star dans les corridors impersonnels de l’hôpital. Queens of the Qing Dynasty trace ainsi les détours d’une rencontre qui souhaite se poser hors des balises d’une relation normative, s’inscrivant dans les marges d’une relation de soin, d’une responsabilité quasi-familiale, d’une proximité romantique, d’une intime amitié.
Star se révèle parfois perdue, flottante, mais souvent investigatrice, faisant serpenter son œil hagard et attentif sur les gens et les objets qui l’entourent. Dans la pièce où résident les bambins orphelins ou abandonnés, son lieu favori de l’hôpital qu’elle s’empresse de montrer à An, on enserre les bébés dans des couvertures blanches. « It’s like an evil hug », observe-t-elle. C’est aussi cette expression contradictoire qui pourrait définir l’approche esthétique de McKenzie, qui s’éloigne du néoréalisme employé dans Werewolf (2017) au profit d’un cadre statique, dont la froideur se heurte par moments à la douceur potentielle du lien qu’il explore. Il est rapidement clair que la caméra de McKenzie ne s’assimile pas à la perspective de Star ou de An, position explicitée par l’un des premiers plans, lorsque l’image qui s’apparente au regard subjectif de la jeune fille dans son lit d’hôpital prend plutôt le rôle d’une inspection rapprochée. Ses mains sont en avant-plan, des corps floutés au pied du lit, puis une infirmière dont le visage reste hors-champ commande le mouvement du regard de Star alors que le cadre reste statique : « Peux-tu me regarder… Oui, continue de me regarder ». Cette adhérence scrutatrice, impassible et ambigüe que développe McKenzie nous situe toujours hors d’une possible intimité face à ses personnages, qui se dérobent, nous restent indisponibles, et si dans ses pires instants elle permet à la confidence de se déplier davantage sur le mode du choc scénaristique que de l’intimité affective, c’est aussi cette étreinte cruelle de l’image qui situe la tendresse comme un moment d’exception fragile, où l’attachement perce la perspective scrutatrice. (Thomas Filteau)

prod. Kedr Film, Protim Video Production
KLONDIKE
Maryna Er Gorbach | Ukraine/Turquie | 2022 | 100 minutes | Panorama international
Prenant pour toile de fond l’écrasement de l’avion de la Malaysia Airlines, abattu par les forces militaires russes, le 17 juillet 2014, à Chakhtarsk, dans la région de Donetsk (dans l’est de l’Ukraine), ce long métrage nous transporte au tout début de l’interminable conflit russo-ukrainien. Oubliez les caméras à l’épaule, les giclures dans la lentille, les courses dans les décombres, les cadavres jonchant le sol, les montages haletants, les bandes-son explosives... Foin du film de guerre pacifiste dans son propos, mais militariste dans sa facture. Ici, Tolik (Sergiy Shadrin) et Irka (Oksana Cherkashyna) — qui porte en elle la vie tandis que la mort règne autour — s’entêtent à habiter leur quotidien pendant que les déflagrations pètent autour de leur baraque : puiser de l’eau, traire la vache, cueillir les tomates, préparer les repas, réparer les dégâts, épousseter les meubles, regarder la télé, se laver, dormir, baiser (ou, du moins, essayer)... La cinéaste, nous invitant à vivre dans l’intimité de ce couple, place sa caméra dans le centre de cette maison dont la béance de l’un des murs, canonné et réduit en poussière dès le générique, ouvre ironiquement sur l’horizon, un horizon à la fois magnifique et décoloré, un horizon à la fois embelli par les lueurs de la nuit et assombri par les affres de la guerre.
Maryna Er Gorbach sait soigner la composition de ses plans pour capter la décomposition de son pays. La richesse de ceux-là jure avec la pauvreté de celui-ci. Sa caméra, empruntant constamment de lents mouvements, délaisse à plusieurs reprises la fin d’un récit (l'enterrement des viscères du bœuf qu'on vient d'abattre) pour capter le début d’un autre (l’arrivée des militaires) et nous invite ainsi à camper la position de témoins constatant les dégâts plutôt que de nous exciter à vivre le rôle de ceux qui les causent. De surcroît, la cinéaste, afin de provoquer les plus grinçants télescopages, superpose parfois la bande-son d’une situation (la femme qui perd ses eaux) à la bande-image d’une autre (les militaires qui gagnent les lieux). Quand elle se fixe, sa caméra encapsule souvent deux actions dans son cadre (on se décrasse au premier plan quand la route s’empoussière au second plan), jouant de surcroît avec les surcadrages (qu’ils soient simples fenêtres ou outrageuse ouverture) ou la profondeur de champ (tantôt pour diriger le regard, tantôt pour le laisser vagabonder). Chaque plan est donc gorgé d’émotions et saturé d’informations qui rendent palpables leur invivable train-train. Cette maison, que tentent péniblement de reconstruire ses membres — lesquels s’entredéchirent puisqu’ils appartiennent à des camps adverses — devient donc la métaphore d’un pays à feu et à cran. Il ne nous reste qu’à nous demander si le bébé, auquel la mère donnera, seule, naissance, pendant que son mari et que son frère rendent leurs âmes et que les militaires rangent leurs armes, sera jeté avec l’eau du bain de sang. (Jean-Marc Limoges)

prod. Toei Tokyo
SAMURAI WOLF
Hideo Gosha | Japon | 1966 | 75 minutes | Histoire(s) du cinéma
Kiba le loup enragé (Isao Natsuyagi) est un rônin solitaire, bon enfant et perpétuellement sans le sou. Après avoir suivi la trace de quelques bandits de grand chemin, il aboutit dans un petit village-relais sous l’emprise d’un dignitaire corrompu du Shogun (Tatsuo Endô), dont la seule opposition semble être une princesse aveugle et déchue (Junko Miyazono) qui gère le service de poste. À Kiba, la princesse confie la dangereuse mission d’accompagner un convoi chargé de pièces d’or pour la protéger de la cupidité du vil dignitaire. Mais ce dernier a lui aussi engagé un sanguinaire et vicieux rônin (Ryôhei Uchida), dont le passé semble lié au village-relais.
Même si Hideo Gosha (Sword of the Beast [1965], Three Outlaw Samurai [1964]) est l’un des grands cinéastes de chanbara, Samurai Wolf se goûte comme une variante de série B. Avec sa prémisse de rônin errant qui trouve son rival dans un autre rônin errant et ses coups de katanas qui produisent des geysers de sang, le film s’inscrit très ouvertement dans le sillage du Yojimbo (1961) de Kurosawa. Sans être particulièrement audacieux dans son récit, il est néanmoins assez judicieux dans son dosage entre la répétition et la variation des stéréotypes du genre. Par exemple, les personnages sont d’emblée des archétypes, mais possèdent tous un gimmick amusant. Le protagoniste emploie des ciseaux comme main gauche, la princesse est aveugle et la brute qui sert le dignitaire corrompu se promène partout avec un singe qui ne quitte jamais son épaule. Puis, la réalisation de Gosha a un petit quelque chose de moderne et d’intrépide. Le montage des combats est rapide et serré — presque claustrophobe —, occultant la lisibilité spatio-temporelle de la bataille au profit d’une impression d’urgence et de chaos. Enfin, tout cela est raconté de manière très économe, puisque le film ne dépasse pas 75 minutes. Malgré son caractère modeste, Samurai Wolf constitue donc un solide divertissement de genre, truffé çà et là de bonnes idées. (Antoine Achard)

prod. Blueprint Pictures, Film 4, Metropolitan Films International, Searchlight Pictures
THE BANSHEES OF INISHERIN
Martin McDonagh | Royaume-Uni/Irlande/États-Unis | 2022 | 108 minutes | Les incontournables
Le dernier long métrage de Martin McDonagh s'ouvre sur un idyllique tableau pastoral : sur la côte d'une île fictive nommée Inisherin, dans l’Irlande de 1923, des pêcheurs ramènent candidement leurs prises, les montagnes verdoient, la mer brille et un arc-en-ciel complète cette paisible création de Dieu en surplombant les croix érigées çà et là. On sent presque la brise fraîche et l'air salin, tandis que des notes de musique folklorique ponctuent la promenade de l'allègre protagoniste incarné par Colin Farrell. L'exposition, elle, ne traîne pas : Pádraic Súilleabháin arrive chez son ami Colm Doherty (joué par Brendan Gleeson), qui l'ignore et finit par lui annoncer qu'il a décidé de mettre fin à leur amitié. Pétrie d'humour anglais, la querelle qui s'amorce perdurera jusqu'à la fin du film en accumulant les silences inconfortables et les remarques abrutissantes par leur simplicité ou leur brutalité, soutenant un comique de situation mû par des personnages rocambolesques et bornés. Leurs interjections, mâchouillées avec un fort accent irlandais (et uniquement compréhensibles, la moitié du temps, grâce à des sous-titres salvateurs), produisent le rire à elles seules — on ne se lasse pas des « feckin' hell » et autres jurons prononcés par Farrell.
C'est néanmoins la profondeur des réflexions suscitées par The Banshees of Inisherin qui persiste en nous après le visionnage. Malgré son absurdité, la querelle des anciens amis gagne en nuances pour assumer une portée humaniste, existentialiste et même politique. La logique friable la sous-tendant nous invite à combler le vide par nos propres expériences et enjeux, nous confrontant aux impératifs du civisme que nous imposent nos relations interpersonnelles, à notre mortalité et au poids de notre libre arbitre, à nos ambitions et à l'indécrottable sentiment de solitude que nous cherchons tous et toutes à étouffer. Se profilant régulièrement en arrière-plan, la guerre civile irlandaise a malheureusement l'air d'un ajout de dernière minute pour enrichir l'œuvre, formant un parallèle trop évident et opportun avec le duo qui en vient bientôt à la violence pour régler ses comptes. Qu'importe : l'animosité grandissante entre les anciens comparses soulève avec justesse la futilité de l'adversité qui mène trop souvent les humains à s’entredéchirer pour de simples différences. La conception sonore accentue cette tension en isolant les personnages de leur environnement, feutrant le son réconfortant des vagues ou l'animation du pub pour mettre en évidence le climat obsessif des idées arrêtées et l'isolement dans lesquels s'emmurent Pádric et Colm. L'ennui représenté aurait vite pu s'installer en nous, mais il est endigué par la maîtrise du dialogue et de la mise en scène de Martin McDonagh, ainsi que par le talent des acteurs — la chimie opérant entre Farrell et Gleeson est aussi forte que dans In Bruges (2008), et l'excellente galerie d'acteurs de soutien colore l'ensemble, particulièrement Kerry Condon en sœur exaspérée, Barry Keoghan en idiot du village et Gary Lydon en violent policier masturbateur. A feckin' good movie. (Anthony Morin-Hébert)
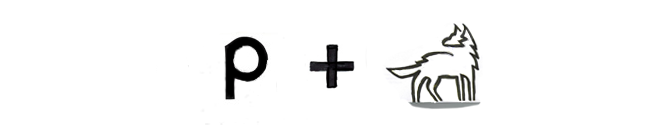
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
