
prod. Bombonierka
KILL IT AND LEAVE THIS TOWN
Mariusz Wilczyński | Pologne | 2020 | 87 minutes | Compétition internationale
Dans la chambre de la maison de poupée, la grand-mère redevenue bébé suce sa tétine tandis que les parents fêtent Noël sans toucher au poisson triste qui trône sur une assiette au centre de la table. Pour distraire le bambin, le géant offre aux parents une lanterne magique qui vient transformer l’image en une projection de cette forme rudimentaire d’animation. Cette scène de Kill it and Leave This Town semble agir comme condensation des intentions de cette étrange œuvre polonaise. D’abord, parce que la description qui en est fait ici peine à produire un discours clair, embrouillé par une image qui ne répond à rien d’autre qu’aux mouvements fiévreux débarrassés des règles de vraisemblance, ensuite parce que l’apparition de cette lanterne et son comportement explicitent un rapport primaire à l’animation. Alors que les parents actionnent le mécanisme, le projecteur s’enraye et ne parvient pas à passer à l’image suivante, brisant le défilement du récit et exacerbant ainsi la dimension plus technique que magique de la lanterne. De ce cafouillage naît une dispute qui vient commenter la vacuité du conte de fées qu’ils essayent de raconter.
Si cette séquence est la seule clairement réflexive, elle permet d’éclairer le reste du long métrage de Mariusz Wilczyński qui agit comme un collage de scènes absurdes et un amalgame de techniques diverses qui proposent souvent au sein du même cadreune diversité de représentation des corps et des espaces : papier découpé, croquis à peine esquissés, mouvements tremblants de caméra. Ainsi Kill it and Leave This Town est avant tout un festin visuel, un essai décomplexé qui rappelle par certains aspects les propos révolutionnaires du Manifeste du futurisme qui espérait voir à l’écran : « une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l’haleine explosive ou encore “un homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite ». Et c’est donc au service de cette créativité qu’est dédiée la dimension primaire de la technique, plus impressionnante par ses mouvements et ses transformations que par ses traits.
Mais à l’inverse du futurisme, le film est loin de l’exaltation enthousiaste de la modernité. Au contraire, à l’image de la lanterne, le train déraille sans cesse, les cadavres s’amoncellent et le dessin n’offre de détails que dans ses scènes les plus morbides. Il propose ainsi une fresque de la Pologne faisant signe vers une mémoire traumatique de l’enfance du réalisateur. Les parents mentionnés plus tôt associent d’ailleurs le dysfonctionnement de l’appareil à sa fabrication en RDA, donnant l’un des rares indices du film qui permette d’expliquer partiellement la dimension résolument lugubre des saynètes qui le composent. Si ces dernières sont source d’un plaisir malsain et accordent par leur caractère fragmentaire une dimension hallucinatoire qui donne toute son identité au film, le cynisme qui s’en dégage est un peu éprouvant et donne parfois le sentiment d’une noirceur consciente d’elle-même, effaçant l’intimité qui semblait pourtant à l’origine du projet. Malgré ce relatif manque de profondeur, Kill it and Leave This Town n’en reste pas moins une belle illustration de ce que peut proposer l’animation d’Europe de l’Est dans tout ce qu’elle a de plus inspiré et désordonné. (Samy Benammar)

prod. Zik Zak Filmworks
LAST AND FIRST MEN
Jóhann Jóhannsson | Islande | 2020 | 70 minutes | Les nouveaux alchimistes
De la science-fiction à sa plus pure expression de transcendance sensorielle et spéculative. Un ovni onirique dans un monde où Star Wars (1977) passe encore pour de l’anticipation, et où Brave New World (2020) fait désormais figure d’Epsilon au cerveau désoxygéné. Adapté du roman éponyme de 1930 signé par Olaf Stapledon, Last and First Men se présente à la fois comme un essai poétique et un documentaire prophétique, où la voix langoureuse et froide de la glorieuse Tilda Swinton évoque simultanément celle d’une présentatrice du National Geographic et d’une matrone extra-terrestre. C’est cette voix qui nous berce doucement tout au long du film, ainsi que la musique grisante du réalisateur, au gré d’images argentiques abstraites, composées dans un noir et blanc énigmatique, amplificateur du caractère étrange des Spomenici yougoslaves, découpés par la caméra de Sturla Brandth Grøvlen en un lexique visuel foisonnant.
Tandis que Swinton narre l’histoire de la dix-huitième espèce humaine et de ses individus immortels, menacés par la mort imminente du soleil deux milliards d’années après notre ère, l’objectif effectue des translations épidermiques sur la surface pierreuse et des rotations hypnotiques près de l’architecture brutaliste des monuments, abandonnés dans des champs nimbés de brume. Voici en somme la nature de l’offre que nous fait aujourd’hui de manière posthume le célèbre compositeur Jóhannsson, dont il s’agit malheureusement de l’unique long métrage (son court métrage de 2014, End of Summer, sorte de travelogue antarctique lumiérien semi-onirique, étant présentement disponible sur MUBI). Offre à prendre ou à laisser, mais dont la simplicité n’a d’égale que son efficacité en tant qu’expérience cinématographique mystique, mais aussi d’amalgame audiovisuel. En effet, s’il semble exister a priori un décalage entre le foyer neptunien des « derniers hommes » et les vestiges de l’empire titiste, la mise en scène des bâtiments en fait vite des mondes-miroirs, alors que ceux-ci glissent sous nos yeux tel des nefs spatiales faites de déchets recyclés ; l’image du Nostromo plane sporadiquement. Cet effort de juxtaposition rappelle d’ailleurs le fin travail de Salomé Lamas qui, dans Extinction (2018) transformait déjà les ruines brutalistes de la Transnistrie en halls fantastiques, question de promouvoir une forme de narration expérientielle où le matériau vulgaire d’un idéal socialiste désuet devient, par prestidigitation visuelle, l’art vibrant d’un ailleurs insaisissable. D’autres comparaisons « soviétiques » abondent. On n’a qu’à penser au Hard to Be a God (2013) d’Alexeï Guerman, On the Silver Globe (1988) d’Andrzej Zulawski ou à la science-fiction tarkovskienne, qui tous télescopent le présent et le futur par simple cadrage créatif du réel. (Olivier Thibodeau)

prod. Tiger Cinema
MOVING ON
Yoon Dan-bi | Corée du Sud | 2019 | 105 minutes | Panorama international
Fidèle à son titre (qui, en français, signifie « passer à autre chose »), Moving On est un film sur le thème du deuil, envisagé dans la perspective du récit initiatique. Habile correspondance pour une jeune autrice qui signe ici un premier long métrage d’une grande maturité, vainqueur de trois prix au festival de Busan et du Bright Future Award au festival de Rotterdam. Fort d’un scénario raffiné, qui capture avec perspicacité les subtilités émotionnelles d’une famille engagée dans un processus fragile de réunification, l’œuvre bénéficie en outre d’une mise en scène ad hoc, subtile également dans ses efforts de narration, secondée dans sa tâche par un travail sonore et lumineux exquis qui donne un relief inespéré aux vignettes domestiques que le film collectionne avec une douce amertume. Animé par un esprit humaniste poignant, qui envisage l’anthroposphère dans les aspects prosaïques de la quotidienneté, celui-ci privilégie en effet l’atrophie dramatique aux élans tragiques, brossant un portrait parfaitement tangible et vraisemblable de ce que cela signifie d’être Coréen dans la période actuelle de télescopage des traditions et du « progrès » (entendu comme le bulldozer luciférien de l’industrie immobilière).
Le film débute avec un plan de la jeune protagoniste Okju (Choi Jung-un, délicatement ambiguë) debout, désemparée dans un appartement vide. Son sentiment de deuil devient dès lors intelligible par simple addition des spectacles de l’absence et de sa moue. Mise en contexte concise qui se poursuit à l’extérieur de l’édifice, lors d’un travelling savamment chorégraphié et d’allure spontanée où la caméra cadre Okju, son père et son petit frère alors qu’ils embarquent dans une camionnette dont l’objectif suit le parcours à travers un quartier déliquescent où les murs des habitations sont marqués de croix rouges. Marqués pour la destruction par des forces économiques irrésistibles, maîtresses de la destinée des pauvres, instrumentalisés pour satisfaire leur voracité capitalistique. Il n’aura fallu que quelques paroles, quelques allusions à l’impératif de quitter et à la maison du grand-père pour comprendre le lot des personnages, évincés de chez eux par les zélotes du développement urbain, puis forcés d’emménager dans une demeure devenue intergénérationnelle par la force des choses et où les individus doivent (ré)apprendre à se connaître. Tout le reste de la narration est à l’avenant : succincte et allusive, constituée d’un florilège de vignettes discontinues visant à capturer une collection d’impressions fugaces et de détails biographiques pertinents, lesquels nous permettre de brosser tranquillement les contours des personnages et d’effleurer le noyau élusif de leurs cœurs meurtris. (Olivier Thibodeau)

prod. Bando à Parte

prod. Areosa
OUR KINGDOM
Luís Costa | Portugal | 2020 | 15 minutes | Compétition internationale court métrage
+
RAIN HUMS A LULLABY TO PAIN
Leonardo Mourameteus | Portugal | 2020 | 28 minutes | Compétition internationale court métrage
=
PORTUGAL : DES PROJETS DE L’ESTHÉTISME
Our Kingdom (O Nosso Reino) du Portugais Luís Costa et Rain Hums a Lullaby to Pain (A Chuva Acalanta a Dor) du Brésilien Leonardo Mourameteus semblent quelque peu se regarder en chien de faïence, car tout en présentant une ligne narrative, un style et un ton diamétralement opposés, ces courts métrages ont néanmoins quelques étonnants points en commun qui stimulent la comparaison et mettent de là en évidence leurs antagonismes. Ils présentent en effet tous deux une photographie picturaliste portée vers le clair-obscur, réfléchissent à quelques formes d’archaïsmes et misent sur le contraste entre scènes d’intérieur et d’extérieur. Mais tandis que le premier aborde la disparition du mode de vie paysan avec une solennité toute tragique, le second recadre une courte fiction inspirée par la vie de Lucrèce en exploitant la dissonance et la théâtralité.
Sur fond de trame sonore continue et exponentiellement dense, Our Kindgom parcourt lentement un monde à l’agonie, par le biais d’une caméra flottante, à la fois distante et descriptive, qui pose sa conscience sur quelques points de pénétration concrets de ce qu’une économie tournée vers la rentabilité massive fait aux modes de vie traditionnels. Non sans rappeler la sensibilité d’un Kiarostami, ce quatrième court métrage de Costa, dont les premiers font également montre d'un attachement à la ruralité portugaise, met en scène la solitude de personnages vivant dans des confins de campagne à l’abandon, en s’attachant plus particulièrement au regard d’un enfant. Semblant autrement seul que tous les autres, car engoncé dans l’innocence empathique des premiers temps de vie, ce garçonnet contemple son père mélancoliquement absorbé par l’image du feu qui brûle devant lui, sa mère nettoyant le corps moribond de sa grand-mère, ou bien, il marche avec un oiseau mort entre ses mains et tente de comprendre, en discutant avec son frère, les paroles des adultes. Il n’y a pas de démon, il n’a que la faim, lui a dit sa mère. Le corps vivant de l’enfant, si petit, si ramassé sur lui-même, si inquiet, devient ainsi le contrepoint infiniment triste de tout ce qui meurt, de tout ce qui se consume inéluctablement, de tout ce qui ravage la petite parcelle de ce qu’il aura déjà appris à connaître, là où le feu longuement contemplé finit par métaphoriser la destruction sans merci de ce qui, autrefois, existait paisiblement, là où les vieilles pierres des maisons ne protégeront plus personne. Ici, la beauté de l’image, de toutes les natures mortes soigneusement composées dans cette ambiance crépusculaire et gothique, magnifie des affects absolument pessimistes, et nous sensibilise de la sorte à la perte des mondes que l’on ne voit pas forcément. Et cela nous donne à penser que l’esthétisme porte en son sein un projet qui peut s’avérer productivement politique.
Est-ce que la pluie parvient à nous consoler de la douleur ? La proposition de Leonardo Mourameteus n’apporte pas vraiment de réponse à la question qu’elle pose ni même ne fait tout à fait comprendre le sens de cette question par rapport à ce qu’elle déploie. Et si l’idée d’adapter la vie de Lucrèce tirée des Vies imaginaires (1896) de Marcel Schwob attise d’abord grandement la curiosité — Schwob n’est pas parmi les écrivains les plus discutés et de fait semble être désormais plus connu pour être l’oncle de Claude Cahun que l’auteur symboliste, figure d’inspiration du surréalisme qu’il a été — , la promesse que renfermait ce choix est plutôt déçue, dans la mesure où l’on ne comprend guère ce que le film espère actualiser ou désactualiser, dans son opération de transfert de la littérature au cinéma et dans l’anachronisme qu’il exploite non sans malice.
L’espièglerie s’invite en effet de Rain Hums a Lullaby to Pain, comme pour mettre en évidence ce que la vie d’un poète et philosophe du 1er siècle av. J.C. pourrait offrir de ludisme aux temps actuels. Le premier tiers de ce (long) court métrage met d’abord en scène une série d’échanges entre Lucrèce et son ami Mêmio (campée ici par une femme), habillés de vêtements contemporains, allant de la spéculation sur le poids des nuages à une sorte de poésie sauvage consistant à dire bonne nuit à tout (« Goodnight anus, good night knees, good night bony shoulders, god night cock », etc.). La dimension impudique du langage va de pair avec la présence de nudité, celle dans un premier temps d’un personnage nommé Nemestrino, peut-être divinité, peut-être simplement fou, qui, au travers d’une nature forestière à la riche gamme de nuances photographiques, s’évertue à la danse ; celle, dans un second temps, de Lucrèce. Dans cette seconde partie tournée à l’intérieur, c’est maintenant la relation de Lucrèce à Lélia, la « belle Africaine » dont il est tombé éperdument amoureux, qui constitue le nœud narratif. Or, les amants se butent contre un problème sexuel, ce qui motive Lélia, avec l’aide de la cuisinière, à faire boire à Lucrèce un filtre qui a pour efficacité de rendre fou de désir, voire de potentiellement tuer. Entre temps, la vulgarité réitérée du langage lors d’un échange sexuel infructueux — « Do you like to cum on me ? » questionne Lélia – « I don’t like to cum while my dick is soft », répond Lucrèce — interroge : que désire-t-on nous pointer du doigt au juste? L’antinomie soi-disant provocante entre ce registre bas de langage et les exquis détails saisis, telle cette orange sanguine posée sur un plateau dont les rehauts de lumière retiennent l’œil à la manière d’un tableau hollandais du 17e siècle ? La différence de classe que l’on suppose entre Lucrèce et sa maîtresse ? Une relation amoureuse entre personnes blanche et noire ? La distance au passé ou au contraire, une certaine ressemblance rapprochant les deux temporalités ? Je n’ai pas été en mesure de le dire avec exactitude, tant l’absence de fil conducteur de cette vie de Lucrèce fantasmatiquement livrée à elle-même, et ainsi privée de ce qui construit une cohérence dans le recueil de Schwob, c’est-à-dire la juxtaposition avec d’autres vies imaginaires, interloque sans forcément offrir de sens, fût-il abstrait. L’exercice d’estrangement auquel s’attèle Rain Hums a Lullaby to Pain laisse ainsi une impression de vanité, de gratuité, d’une trop grande permissivité dans la manipulation du récit et de l’image, et d’un certain opportunisme esthétique. (Maude Trottier)

prod. DASH CO., LTD / Chromarhythm Inc.
SHELL AND JOINT
Hirabayashi Isamu | Japon | 2019 | 154 minutes | Temps Ø
Titre éponyme du tome d’entomologie que dévore le tenancier de l’hôtel capsule où se déroule la plupart des péripéties du récit, Shell and Joint a trop peu à offrir au spectateur en termes de cohésion narrative, de grammaire cinématographique ou de simple inspiration humoristique pour qu’on lui suggère de souffrir ses 154 longues minutes.* Paradoxalement, puisqu’il est reconnu surtout pour ses courts métrages, le réalisateur Hirabayashi Isamu accouche en effet de l’antithèse même du court métrage, une œuvre qui s’étire indûment sans offrir de punch final au spectateur. La nature épisodique du récit et le caractère conceptuel des vignettes aboutées pourrait certes évoquer une série de courts métrages, mais là encore l’absence de punch nous suggère autrement. Cinématographiquement parlant, le film ne propose pas grand-chose à se mettre sous la dent puisque chaque vignette est filmée en plan fixe, généralement sous le même angle oblique, presque sans recours aux gros plans, de sorte que seul le pittoresque intrinsèque des décors japonais glanés pour l’occasion reste garant de son pouvoir d’évocation. Et c’est là certainement que réside tout l’intérêt du film : dans ses paysages côtiers gorgés de soleil, dans ses plans de capsules hôtelières illuminées ou de nettoyage des mollusques pour le « hot-pot ». Pour le reste, il faut se rabattre sur l’excentricité bon marché des dialogues et la surenchère de musique contrapuntique, laquelle semble conçue pour meubler désespérément l’espace vide qui entoure les personnages. Même l’hors-champ est presque inexistant, sauf pour la présence de quelques insectes imaginaires que le scénario fait participer au leitmotiv douteux de l’anthropo-entomologie, auquel on croirait presque, si seulement les personnages diégétiques semblaient dotés d’un véritable dessein social… (Olivier Thibodeau)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival international du film de Rotterdam 2020

prod. Shanghai Tao Piao Movie & TV Culture
WISDOM TOOTH
Liang Ming | Chine | 2019 | 104 minutes | Panorama international
Gu Xi (l’étonnante Lu Xingchen) est une sans-papier du Nord de la Chine. Ses dents de sagesse poussent et l’une d’entre elle commence à lui faire mal. On comprendra que cette dent – qu’elle finira par s’arracher elle-même en mangeant une pomme (!) – est une affliction réelle, mais fort symbolique : une porte vers le récit initiatique qui suivra (le mot-clé ici étant sagesse). Balade hivernale à la fois tragique et douce dans le décor d’un village dépressionnaire typique de la Chine du tournant du siècle (l’intrigue est campée à une époque incertaine, bien qu’on devine les années 90 à l’enregistreur-cassette rudimentaire que trimballe l’héroïne), Wisdom Tooth ne rayonne pas d’originalité, mais cerne néanmoins à merveille son personnage principal. Au fil d’une performance riche de détails et de maniérismes crédibles, Lu incarne Gu qui apprendra à négocier sa possessivité envers son demi-frère– les deux vivent ensemble, tel un couple fusionnel –; son attirance croissante envers la copine de celui-ci, et le spleen grandissant qu’accompagne l’absence d’horizon dans une telle ville évidée et désormais sous le joug d’un gangster invisible, qui y contrôle l’hôtellerie et la pêche locale (industrie qui souffre, au demeurant, des conséquences d’un déversement de pétrole – décidément, tout va mal). La mise-en-scène naturaliste se prête bien à l’étude de personnage et ainsi, l’intrigue un peu molle laisse plutôt place à une cartographie des lieux et du cœur – celui qui bat d’un amour potentiellement dangereux, à tous le moins nouveau (incestueux, lesbien), comme celui qui s’éveille à la vie adulte. Liang tourne son premier film dans l’Heilongjiang de son enfance (à proximité de la Russie et de la Corée, où plusieurs personnages vont d’ailleurs chercher prospérité) et montre une affection particulière pour la texture enneigée et rugueuse des lieux. Wisdom Tooth se revendique ainsi pleinement de ce régionalisme ravivé du cinéma chinois de la 8e génération (voir Kaili Blues de Bi Gan pour le Guizhou ou encore Dwelling in the Fuchun Mountains de Gu Xiaogang pour la ville de Fuyang à l’Est de la Chine) : un cinéma de la mémoire évanescente, cherchant à capturer ou reconstruire les lieux et les états d’âmes, avant que ceux-ci ne disparaissent. (Ariel Esteban Cayer)
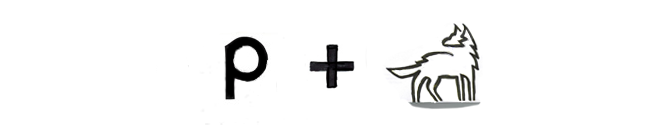
PARTIE 1
(The Cloud in Her Room, Desterro, Topside,
Tout simplement noir, Violation)
PARTIE 2
(Kill it and Leave This Town, Last and First Men,
Moving On, Our Kingdom, Rain Hums a Lullaby to Pain,
Shell and Joint, Wisdom Tooth)
PARTIE 4
(Êxtase, Maggie's Farm, Night Has Come,
Poissonsexe, Saint-Narcisse, Thalasso)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
