REWRITE
Daigo Matsui | Japon | 2025 | 127 minutes | Sélection 2025
« Le jour est enfin arrivé », murmure Miyuki (Elaiza Ikeda), romancière dans la fin vingtaine, de retour temporairement dans sa demeure familiale éloignée de sa vie de Tokyoïte à l’occasion d’une réunion scolaire. Si ce moment est pour elle tant attendu, c’est que dix ans auparavant, l’adolescente alors écolière avait fait la rencontre d’un étudiant mystérieux, Yasuhiko (Kei Adachi), qui lui avait vite révélé être un voyageur temporel du futur. « J’avais l’impression d’être l’héroïne de cet été-là », avoue une Miyuki nostalgique se remémorant les développements de ce timide amour fantastique. Mais avant qu’il ne disparaisse aussi rapidement qu’il ne soit apparu, Yasuhiko avait tendu à Miyuki une pilule lui permettant de faire un bond de dix ans dans le futur, après quoi cette dernière avait rencontré sa contrepartie plus âgée, qui lui avait demandé d’écrire un roman racontant l’histoire de ces quelques semaines partagées avec le garçon du futur. C’est donc, ce livre écrit entre les mains, que l’adulte Miyuki attend patiemment dans sa chambre d’adolescente sa propre arrivée qui confirmerait la boucle temporelle prédéterminée. Mais les minutes s’écoulent, et Miyuki reste seule, sans que le passé ne puisse se boucler dans le présent.
Dans son récit complexe multipliant les flash-backs et les aller-retour temporels, Rewrite n’emprunte ni l’adresse subtile de Just Remembering (Fantasia 2022), précédent film de Matsui jouant lui aussi d’une structure antichronologique, ni le charme lo-fi des récits de boucles temporelles de Junta Yamaguchi (Beyond the Infinite Two Minutes, Fantasia 2021 ; River, Fantasia 2023) auxquels a collaboré son scénariste Makoto Ueda. Il faut au contraire accepter ses quelques maladresses scénaristiques et les incongruités caractérielles de certains de ses personnages pour observer la richesse de son procédé de réécriture. Travaillant depuis la matière d’une nouvelle de Yasutaka Tsutsui ayant généré plus d’une adaptation cinématographique, dont l’excellent The Girl Who Leapt Through Time de Nobuhiko Obayashi (1983), Rewrite reconfigure l’innocente romance mythifiée du récit originel en dépliant deux belles séquences de déception mélancolique qui déposent un voile d’amertume sur le désir adolescent d’un amour provenant d’un autre monde, d’un autre temps.
C’est d’abord le souvenir faisant défaut, alors que l’adulte Miyuki fait face à une forme de trahison de soi à soi, et où se fragilise le déterminisme prophétique caractéristique des récits de voyage temporel. Que faire d’une vie menée dans le but d’une rencontre promise, alors que s’effrite le moment où celle-ci pourrait se confirmer ? Puis plus tard, revisitant ses ancien·n·es camarades, Miyuki prend conscience que son récit d’exception la liant à Yasuhiko est en réalité une expérience commune, qu’a vécu chaque autre membre de sa classe. Tou·te·s avaient vécu une romance aux côtés du garçon, avaient pris contact avec leur versant du futur, et en avaient obtenu l’injonction d’écrire leur histoire commune. Comment comprendre la valeur de ce temps amoureux, s’il n’est pas celui, privilégié, de l’instant partagé ? Car ici, les parcours désirants des un·e·s miroitent celui des autres, et dans la vie choisie par chacun·e·s se devine finalement la même question ressassée en silence : que faire de cette demande d’écrire, de raconter une histoire que l’on croyait à soi ? L’une devient journaliste, une autre coiffeuse rédigeant un blogue littéraire, alors que plusieurs semblent simplement avoir oublié ou ont tenté de taire cette destinée obligée. Et bien que Rewrite se dégonfle quelque peu dans la succession de ses renversements narratifs, c’est dans ces deux moments où la forme classique du sci-fi temporel prend l’allure d’une vie qui perd ses balises que Matsui parvient à infuser son récit d’une angoisse toute quotidienne, l’impression de ne plus être l’héroïne d’une vie partagée. (Thomas Filteau)
Prochaine projection : 27 juillet à 11h20 (Salle J.A. De Sève)

prod. Embuscade Films / Miyu Productions
LA MORT N’EXISTE PAS
Félix Dufour-Laperrière | Québec | 2025 | 72 minutes | Les fantastiques week-ends du cinéma québécois
La mort n’existe pas est le film d’animation le plus maîtrisé qu’ait signé Félix Dufour-Laperrière. C’est peut-être même le long métrage d’animation le plus impressionnant, le plus techniquement achevé, qu’on ait produit au Québec. C’est donc une fierté de le voir compétitionner à la Quinzaine des cinéastes, cette section dédiée aux expérimentations plastiques, aux films à la signature singulière. Le film est de toute évidence né d’un exceptionnel travail, porté par une esthétique pétaradante, un propos politiquement enflammé, une charge passionnément explosive. Chaque ligne du film semble porter en elle cette énergie du désespoir, celle de sa protagoniste Hélène qui prépare dans la forêt un coup de violence assassine contre des bourgeois crapuleux. Les révolutionnaires crinquent leurs armes, courent vers leur cible, le cadre tournoie autour de ces corps qui s’élancent en flottant dans la forêt vers la mort. C’est la détente qui claque comme un fouet, du doigt qui appuie, des balles qui fusent, des têtes éclatées, de la richesse qui se défend bec et ongles dans une tuerie sans aucune pitié pour ses bijoux ni même pour sa fragilité — même la cible est une dame en chaise roulante. Pour un film qui dit que la mort n’existe pas, celui-ci nous la fait voir partout, mur à mur, nous enveloppant d’un nihilisme froid qu’on imagine d’abord sans issue… jusqu’à ce que, tout à coup, le film s’ouvre sur lui-même, de l’intérieur, une fois passé ce prologue monté en forme de prémonition.
La suite du métrage montre Dufour-Laperrière se livrer à ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire transcender le nationalisme québécois en un conte cinématographique immensément poétique, avec des loups sortis du Mononoke (1997) de Miyazaki et des boursouflures balistiques empruntées au Akira (1988) d’Ôtomo. Il empile la rage militante, historicisée, sur les injustices contemporaines. Il mixe par une animation transformatrice les réminiscences du printemps québécois de 2012 avec les velléités de la nation qui se reflètent dans les plans de fleuve infini et de clochers qui émergent de la forêt, jusqu’à ce que l’imaginaire laurentien puisse faire poindre à l’horizon une nostalgie qui s’imbrique parfaitement au désespoir des protagonistes.
Mais si la mort n’existe pas ici, c’est aussi parce que le cinéaste nous la raconte à travers un récit national censé immortaliser les sacrifices individuels, faisant virevolter les enjeux du film autour d’une série de possibles que les personnages sont pris à regretter, face à eux-mêmes, face à celleux qu’ils ont tant aimé·e·s. C’est l’éternel sujet de la figure révolutionnaire, confrontant l’utopie à la violence, refusant de considérer l’un comme le versant de l’autre tout en se poussant vers l’excès. À l’usure, ces paradoxes finissent par plomber l’élan poétique du film, qui se frotte de plus en plus au moralisme avant de finir par s’enorgueillir d’un lyrisme nationaliste envers lequel nous ne pouvons qu’être foncièrement sympathiques, tout en nous demandant discrètement dans quelle mesure ses références seront comprises ailleurs et, de manière bien plus importante, s’il n’y a pas une sorte d’aveuglement volontaire qui finit par plomber l’anticapitalisme du film.
À trop vouloir leur propre terre à soi, les idéalistes armés finissent par oublier la part capitaliste, exclusiviste, de leurs rêves d’indépendance territoriale. C’est à la fois la force et la faiblesse du nouveau film de Dufour-Laperrière, cette malédiction de l’émancipation dichotomique (« juste nous autres contre tous les autres », pourrait-on dire) et qui ne parvient pas à aller au-delà du système qui enferme les personnages, qu’il soit question du régime esthétique qui les porte (et qui exploite la violence souvent pour impressionner et faire plaisir à l’œil) ou du nationalisme territorial qui ne semble s’adresser qu’à une forme très classique, pour ne pas dire normative, de terrorisme romantique.
Ainsi La mort n’existe pas rappelle que la nécessité est la mère de toutes les vertus, sans pour autant se souvenir qu’il n’y a guère de nécessité sans contexte ni complexité pour la voir émerger, et qu’à force de vouloir rendre poétique le politique, on risque de se perdre en slogans plutôt que de s’y retrouver. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival de Cannes 2025

prod. Caballo Films / Setembro Cine / et al.
THE WAILING
Pedro Martín-Calero | France / Argentine / Espagne | 2024 | 107 minutes | Sélection 2025
Il est difficile de ne pas éprouver un brin de cynisme devant The Wailing tant il est facile de résumer sa prémisse à un pitch d’influences (The Entity + It Follows, saupoudré d’un peu d’horreur technologique), et tant sa structure en trois chapitres dans trois pays épouse de façon un peu trop commode son financement international. Cette histoire de fantôme hantant trois femmes d’une même famille sur plusieurs décennies est pourtant bien intrigante, et au départ la mise en scène est plutôt habile : sans être particulièrement original, le film est efficace, dans sa manière de piger dans ce large répertoire d’effets de mise en scène déjà bien éprouvés visant à faire apparaitre un spectre telle une ombre cachée au fond d’une image captée par un cellulaire.
Mais quand le premier chapitre se clôt et que nous nous déplaçons du Madrid de 2022 vers La Plata à la fin des années 1990, la minceur de la proposition commence à se deviner. D’abord parce que nous passons à une protagoniste, étudiante en cinéma, brandissant une caméra vidéo au lieu d’un cellulaire, et que la différence entre les deux médiums n’a pratiquement aucune incidence sur notre fantôme, sur sa mise en scène. Et surtout parce que cette deuxième section se contente de nous montrer ce qu’on nous avait déjà raconté dans la première partie, sans complexifier notre compréhension de la hantise. Notre intérêt envers le mystère se dilue graduellement, et au final il n’y a pas grand-chose de plus à en dire que ce qui se retrouve dans le synopsis.
Mais surtout, The Wailing utilise le fantôme d’une manière évidemment métaphorique (on ne peut pas y échapper en 2025), et en même temps beaucoup trop vague pour que le propos s’avère consistant : trois femmes, toutes hantées par un vieil homme, une présence invisible qui les suit partout, les guette dans leur sommeil, les propulse peu à peu vers la folie alors qu’elles se mettent aussi à entendre les pleurs d’autres femmes, on n’a pas besoin d’en rajouter pour comprendre de quoi le film veut traiter. L’idée est porteuse, et profite des performances solides des actrices qui peuvent distinguer leurs personnages malgré le peu que nous savons sur elles, mais s’échoue rapidement dans des silences et un désir d’ambiguïté mal calibré. Car si l’irrésolution pointe vers la notion d’un drame qui se perpétue, nous en ressortons surtout avec l’impression qu’il s’agit d’une façon pratique de demeurer en surface, et de ne pas s’engager envers son sujet. (Sylvain Lavallée)

prod. Fela / When We Were Kids
SWEETNESS
Emma Higgins | Canada | 2025 | 96 minutes | Septentrion Shadows
Pour rendre neuve une prémisse bien usée, il suffit de lui donner assez de spécificité : c’est ce que fait Emma Higgins pour son premier long métrage, sur une adolescente qui kidnappe un chanteur qu’elle adule dans le but de « l’aider » à se sortir de sa dépendance. On peut penser au nombre de fans détraqué·e·s que le cinéma a déjà mis·e·s en scène, le point de référence le plus évident ici étant la Annie Wilkes de Misery (Rob Reiner, 1990). Mais Sweetness s’intéresse à une forme d’obsession typiquement contemporaine, nourrie par les réseaux sociaux, le flot constant de reels, de stories, et engendrée par le mal-être et l’anxiété sociale d’une jeune femme solitaire, dans une morne banlieue canadienne, qui ne trouve sa place ni à son école ni dans sa famille. La première partie du film est très réussie, brossant un portrait complexe de Rilee (superbe Kate Hallett), sa naïveté pouvant cohabiter avec son intelligence, et sa détresse avec son sens de la répartie. En même temps, le ton maintient un juste équilibre entre l’empathie et l’humour, pour que la protagoniste nous demeure sympathique jusque dans ses comportements les plus extrêmes, sans tomber non plus dans la condescendance.
Nous sommes alors prêt·e·s à suivre Rylee jusqu’au bout, peu importe si elle menotte son idole, Peyton Adler (Herman Tømmeraas), qui s’avère de toute façon détestable (comme il se doit). Mais le scénario finit par se perdre, d’abord en s’étirant sur plusieurs jours et en abandonnant des pistes prometteuses, entre autres les efforts pour retrouver la mégastar disparue : au-delà du problème de vraisemblance, le récit souffre surtout de se départir de cette pression externe, qui aurait pu peser sur les agissements de la protagoniste. Et surtout, le film se retrouve tendu entre le cinéma d’exploitation et le drame psychologique, deux pulsions contradictoires qui placent l’ensemble dans une position inconfortable : ni vraiment satisfaisant du point de vue de l’escalade de violence attendue, et ni vraiment crédible tant Rylee se rend trop loin trop rapidement, et avec trop peu de conséquences. C’est le cynisme qui finit par prendre le dessus, alors que la finale refuse le plaisir cathartique d’une cruauté qui pourrait être libératrice pour le personnage (et pour nous), le regard posé se faisant subitement plus détaché, plus en hauteur, ce que Higgins avait évité auparavant. Cela dit, la performance de Hallett soutient bien notre attention, tant elle est émouvante dans son mélange de candeur et de conviction, de vulnérabilité et de détermination, et le tout est suffisamment prenant pour que nous soyons curieux de découvrir ce que fera la cinéaste par la suite. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : 22 juillet à 13h45 (Salle J.A. De Sève)
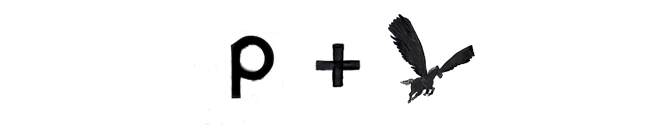
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(Occupy Cannes, Queens of the Dead,
Lurker, $POSITIONS, LifeHack, Stuntman)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
