
prod. Arte France Cinéma / Les Films du Bélier / et al.
LA BÊTE
Bertrand Bonello | France / Canada | 2023 | 146 minutes | Les incontournables
Dès que se dévoile La Bête, par sa scène d’ouverture dans laquelle Seydoux se tient devant un écran vert et reçoit les instructions d’un réalisateur, on comprend que Bertrand Bonello essaie ici de réaliser un film sur le cinéma, et sur la mise en récit. On peut imaginer, par la description d’une voix, le lieu pour l’instant absent (ici une table, puis sur elle un couteau), le lieu peut-être d’une scène à venir, puis la venue d’une menace potentielle : « C’est là que va apparaître la marque de la Bête. »
En 2044, Gabrielle (Seydoux) habite un futur dystopique où l’avènement des intelligences artificielles a pu asseoir la pure rationalité comme valeur première, en opposition à une sentimentalité désavouée. Elle hésite à compléter un processus de purification génomique, qui supprimerait en elle toute émotion indésirable et lui promettrait du même coup la possibilité d’un emploi dignifié. La manœuvre consiste à revivre ses vies antérieures, pour purger la marque des évènements passés ayant inconsciemment marqué de leurs traumatismes sa biologie individuelle. Mais la protagoniste doute, car si elle porte en elle une inexplicable angoisse qui depuis toujours l’accable — l’anticipation d’une catastrophe, la conscience que son rôle s’imbrique toujours dans un récit tragique — cette crainte est aussi la seule chose qui la rattache à l’existence humaine. Adapté (très, très librement) d’une nouvelle de Henry James, le nouveau film de Bonello trace la rencontre de Gabrielle et de Louis (George MacKay), un homme apparaissant dans chacune de ces vies passées, de même que dans cet apocalyptique futur, où il s’apprête à traverser la même procédure.
À travers trois temporalités habilement tressées, La Bête brosse le portrait de l’inquiétude présente dans la rencontre, et réfléchit toujours la vulnérabilité en tant que premier affect. Il y aura Gabrielle, en 1910, mariée à un mondain fabricant de poupée, et Louis, vague connaissance rencontrée à nouveau au hasard, puis Gabrielle en 2014, mannequin à Los Angeles, seule dans une grande maison moderne, et Louis, incel solitaire en mal de violence. Le caractère didactique de la trame narrative de Bonello génère parfois une froideur, une vision théorique de la rencontre comme dévoilement de solitudes sous-jacentes (sous le signe des adages : l’homme est un loup pour l’homme ; l’enfer, c’est les autres, etc.). La question se répète, dans chaque mouvement d’une vie antérieure à la prochaine, quant à savoir si ce doux maniérisme — conceptuel, dialogique — peut permettre les conditions d’apparition, justement, d’un affect, ou si le projet n’est pas en soi contradictoire. Peuplé d’humains-machines (poupées, robots, l’occasion d’un caméo de Guslagie Malanda, incroyable dans Saint Omer, dans le rôle d’une cyborg chargée de faciliter le processus de purification de Gabrielle), le futur de La Bête est enfermé dans une dichotomie entre apathie et sentimentalité. Pourtant, il y a toujours comme ultime gagnante la Bête titulaire : la peur, si bien travaillée par le réalisateur, aussi lynchéenne ici que dans son film précédent, Coma (2022). (Thomas Filteau)
Prochaine projection : 15 octobre à 16h30 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 10)

prod. JK Film / Potocol / et al.
INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL
Thien An Pham | Viêtnam / Singapour / France / Espagne | 2023 | 178 minutes | Compétition internationale
Il y a quelque chose qui force l’admiration chez Thien An Pham, ce cinéaste au talent inné qui après deux courts métrages d’une quinzaine de minutes rafle aujourd’hui la Caméra d’Or avec un opus spirituel de trois heures. Non seulement sa maîtrise technique du médium est-elle particulièrement impressionnante, mais sa maîtrise du temps également et l’élégante subtilité de son discours métaphysique. Pham est un magicien, à l’instar de son protagoniste qui, pour amuser son neveu, effectue des tours de passe-passe avec des cartes à jouer. Sauf que c’est avec ses images que le réalisateur nous leurre, en effectuant des raccords et des rembobinages confondants qui nous forcent à questionner la nature même de la réalité qui s’offre à nos sens, mais aussi les dogmes religieux qui viendraient lui plaquer un sens extrinsèque à son expérience vécue.
Inside the Yellow Cocoon Shell nous accroche dès le premier plan, révélant d’emblée toute la maestria de son auteur. Il s’agit d’un long et envoutant travelling qui nous invite à suivre une mascotte de soccer vers une terrasse adjacente au terrain de jeu, là où trois jeunes hommes discutent de foi mais sont éventuellement brisés dans leur élan par un accident de la route qui se produit à une centaine de mètres, poussant alors la caméra à poursuivre son mouvement jusque vers les corps gisant sur l’asphalte. L’accident fait deux morts, auxquels survit un jeune garçon qui devient dès lors orphelin et dont devra s’occuper son oncle Thien, un célibataire qui travaille comme monteur, et chez qui l’événement déclenchera une quête spirituelle qui l’amènera de Saïgon vers la campagne de son enfance. C’est là où, suite à l’enterrement de sa défunte belle-sœur, mère du garçon, le protagoniste se mettra à errer à la rencontre des paysan·e·s, tentant tant bien que mal de renouer avec son ex-copine devenue nonne et de traquer son frère qu’il n’a pas revu depuis des années.
Si l’expérience du film s’apparente à la navigation d’un long fleuve tranquille, il s’y greffe de manière subreptice différentes strates de réalité, mais aussi différentes philosophies, dont la présence vient enrichir le discours candide autour de la foi que recèlent les dialogues. On passe donc soudainement de l’éveil au rêve, alors que l’image se gorge de symbolisme et vient métaphoriser la quête du héros, qu’on assimile à la traversée d’une route mystérieuse, au bout de laquelle l’illumination surgit violemment ou avec la grâce aérienne des papillons d’or titulaires. On note d’ailleurs que, s’il s’intéresse principalement au personnage de Thien, le cadre n’est pas exclusivement anthropocentrique, et en cela, il supplée à la chrétienté ambiante, dont les icônes encombrent les décors, une aura bouddhiste délicate et duveteuse qui contribue à l’expérience sereine de l’œuvre. Les seuls moments où l’on s’extirpe de la diégèse, où l’incrédulité nous ramène sur le plancher des vaches, correspondent aux séquences où la virtuosité technique s’impose comme une merveille devant laquelle se pâmer (je pense au mouvement de caméra extrêmement complexe qui nous fait pénétrer dans la demeure du vieux soldat et en longer les murs à sa recherche). Or, ces séquences complémentent parfaitement la posture inquisitive du héros, auscultant la profondeur de champ et les marges du cadre avec une patience monastique en quête d’une vérité transcendante qui se trouve toujours un peu plus loin, appréhensible mais élusive à la fois. Même la référence visuelle à l’Incrédulité de Saint Thomas du Caravage appuie cette correspondance thématique et mystique, au sein d’un film aussi finement tissé qu’il est spirituellement captivant. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 14 octobre à 18h15 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)

prod. Ceroma Films / Experimental Forest Films / Hamilton Moving Pictures
SEAGRASS
Meredith Hama-Brown | Canada | 2023 | 115 minutes | Compétition nationale
Le savoureux Seagrass de Meredith Hama-Brown évoque en quelque sorte une version canadienne d’Aftersun (2022), non seulement dans le rapport intime qu’entretient la caméra avec les personnages, dans la banalité du quotidien diégétique, dans les performances empathiques des jeunes Nyha Huang Breitkreuz et Remy Marthaller, mais aussi dans l’utilisation du lieu de villégiature comme théâtre d’un conte initiatique parallèle pour adultes et pour enfants. Mais là où le mal qui rongeait le personnage de Paul Mescal dans le film de Wells n’était pas clairement nommé, celui qui accable le couple flétrissant de Judith (Ally Maki) et Steve (Luke Roberts) est amplement détaillé, dans le texte, mais aussi à travers divers jeux spéculaires et une exploitation métaphorique des décors naturels. Ce lieu de villégiature où atterrissent les personnages après un voyage en traversier héberge en effet une retraite pour ménages en crise, où, durant la journée, les jeunes jouent entre ielles à la piscine ou sur la plage tandis que les adultes s’adonnent à de la thérapie de groupe.
Le film a beau intégrer certains éléments d’horreur surnaturelle — c’est bien connu, le cinéma d’épouvante contemporain est désormais ancré dans le trauma émotionnel — grâce à des plans aériens spectraux du point de vue de la mère décédée de Judith, la véritable horreur est beaucoup plus prosaïque. Elle réside dans la couverture tricotée par cette défunte et omniprésente aïeule, symbole de son asservissement au rôle de mère, mais que la protagoniste chérit tout de même comme une relique, et que Steve finit par éclabousser avec du vin rouge après un accès de colère. L’horreur réside dans la désintégration progressive de l’union formée par les deux parents, au gré d’une chronique douce-amère où les rares percées de soleil ne viennent jamais à bout des ténèbres grandissantes qui finissent par les absorber. Car au-delà du récit touchant et banal de leurs deux jeunes filles, dont la plus vieille apprend l’étiquette sociale adolescente tandis que la plus jeune se lie d’amitié avec un ballon en caoutchouc, c’est le récit des parents qui constitue ici le noyau dramatique, et confère au film la plus grande part de son intensité émotionnelle.
Malgré, ou peut-être grâce à la nature archétypique des personnages, le drame de Judith et Steve nous apparaît d’autant plus palpable. En effet, la constipation émotionnelle de ce dernier, son refus obstiné à travailler sur soi, ses passions pour le hockey, la bière et les chars ainsi que sa jalousie envahissante à l’égard d’un autre homme, Pat (Chris Pang), avec qui Judith développe un lien affectif, ont beau constituer des traits caricaturaux d’une certaine masculinité anachronique, ceux-ci n’en forment pas moins un personnage parfaitement vraisemblable à l’écran. Et c’est d’ailleurs son intransigeance qui est source de l’aliénation constante des protagonistes, laquelle culmine lors d’une scène mémorable au bar où, l’alcool aidant, la jalousie de Peter et l’insatisfaction de Judith s’expriment avec un venin vinaigré parfaitement embarrassant. En fait, ce sont justement les stéréotypes qui tranchent ici, et qui subtilement, abîment les personnages : la masculinité très traditionnelle de Steve, mais aussi tout le parfum de racisme ambiant (les allusions à l’exotisme des petites, au mythe de l’insuffisance phallique des hommes asiatiques, les comptines désobligeantes chantées par les enfants, etc.). Et c’est là, véritablement, que réside l’horreur, dans une série de microagressions qui, à la longue, finissent par percer la carapace des êtres et dévoiler leur carence d’amour. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 15 octobre à 15h45 (Cinéma Moderne)

prod. Art et essai
VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT
Ariane Louis-Seize | Québec | 2023 | 90 minutes | Compétition nationale
Sacha est une vampire adolescente (d’à peine 68 ans donc…) qui refuse de tuer pour s’alimenter. Dans sa quête d’alternatives au meurtre, elle rencontre Paul, éternel suicidaire et souffre-douleur des camarades de son école secondaire, qui accepte de mettre fin à sa vie et d’offrir son sang pour résoudre du même coup le dilemme moral de sa nouvelle amie.
C’est depuis un anniversaire s’étant soldé par un événement traumatique — la mise à mort d’un clown, événement censé festif organisé par les membres de la famille — que l’empathie de Sacha l’empêche de faire des victimes. Qu’on se rassure cependant : si les clowns crèvent en ouverture du premier long métrage d’Ariane Louis-Seize, l’humour, lui, est loin d’être mourant. Peut-être est-il tout au plus mort-vivant, comme les personnages, c’est-à-dire toujours entre deux états, faisant osciller le film entre la comédie et le drame. Souvent utilisée pour métaphoriser le passage à l’âge adulte et les affres de la puberté, l’horreur — peu corporelle ici cependant, comme c’est fréquemment le cas dans les films de même facture — rencontre quant à elle le trivial du quotidien des banlieusard·e·s dans une scansion équilibrée (dont l’exemple le plus frappant reste sans doute la tentative de suicide par poutine).
On sent que Louis-Seize a fait ses devoirs — et ce non sans amour pour ses prédécesseur·e·s. Rappelant des relectures contemporaines du mythe vampirique telles que What We Do in the Shadows (Jemaine Clement et Taika Waititi, 2014), Snaggletooth (Colin Bishopp, 2018) ou A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014), Vampire humaniste cherche suicidaire consentant sait s’en distancier assez pour créer un objet distinct. À l’image des adolescent·e·s que le film met à l’honneur, la réalisatrice négocie habilement la tension entre appartenance et émancipation, revendication d’indépendance et difficile autonomie. Louis-Seize fait donc elle aussi l’expérience, par les vertus de ce premier long métrage, d’une sorte de moment initiatique, de coming of age cinématographique qui fait écho à celui que Sacha et Paul passent à l’écran. La jeune cinéaste nous fait cependant le plaisir de ne pas succomber à la tentation de faire de son opus initial un film total, un film fourre-tout. Ainsi, quoiqu’assez simple et prévisible sur le plan structurel, le scénario livre de belles perles que seule une écriture maîtrisée est en mesure d’offrir. Jamais le surnaturel n’empiète sur l’authenticité des dialogues ni sur la composition soignée des rôles ou le rythme du montage. Tourné dans l’obscurité propre aux créatures nocturnes tout comme au spleen adolescent, le film de Louis-Seize sait mettre à profit les éclairages artificiels pour jeter la lumière avec tendresse sur les premiers émois de cette relation naissante : celle — amoureuse, amicale ou familiale, on l’ignore et c’est très bien comme ça — qui bourgeonne entre Sacha et Paul ; mais également celle qui l’unit, elle, à un public ravi de rencontrer son cinéma. (Laurence Perron)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 12 octobre à 18h30 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)
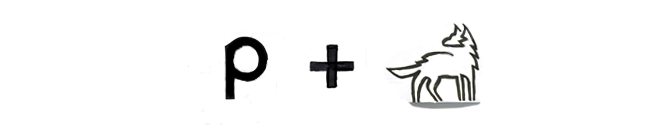
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
