
prod. Mam Film
#MITO
Daisuke Miyazaki | Japon | 2023 | 78 minutes | Panorama international
L’habitué du FNC Daisuke Miyazaki revient cette année au festival avec une nouvelle fable inscrite dans la continuité de son Videophobia (2019), en s’intéressant encore une fois à une protagoniste subissant les contrecoups du vol de son image numérique, puis s’attardant au délitement subséquent de son identité réelle. Cette image volée, elle appartient à Mito (glaciale Tina Tamashiro), influenceuse ultracélèbre, proclamée dans la scène d’ouverture (tournée à la manière d’un vox pop donnant la parole aux fans de la star) comme la représentante des vingtenaires japonais·e·s. « Bien que Mito ne semble même pas réelle, je ressens une véritable proximité avec elle », déclare un jeune garçon. Il faut dire que Mito est elle-même à peine tangible, et qu’elle apparaît davantage comme une marchandise malléable, une sorte de pantin dont les yeux peuvent seulement s’illuminer devant l’objectif d’une caméra. Miyazaki déploie dans les premières séquences une suite de mises en abyme joueuses, nous présentant par exemple la protagoniste en larmes, avant de nous révéler que ces images sont loin d’être des accès à une vie intérieure dissimulée, mais plutôt des séquences publicitaires projetées à la cime des gratte-ciels. Dans #Mito, toute image de soi, fictive ou réelle, relève d’une façade savamment fabriquée, et ce qui semble à première vue relever d’une vie intime ou routinière n’attend finalement qu’à être retransmis dans l’espace public sous la forme d’un faux-semblant.
Lorsqu’on offre à l’influenceuse un imposant contrat visant à créer un filtre à l’image de son visage, disponible mondialement à travers une application téléphonique et permettant du même coup à quiconque de se glisser dans sa peau, on s’attend à ce que le film tende vers l’horreur d’une impossible distinction entre Mito et ses doubles, à la manière du Perfect Blue de Satoshi Kon (1997). Au contraire, les masques numériques sont ici clairement factices, et la menace relève moins d’une éventuelle erreur sur la personne que d’une perte de contrôle sur une image de soi devenue image de marque. Ce qui frappe finalement chez Miyazaki, c’est son inventivité esthétique et son exploration narrative qui favorise le fragment à la linéarité classique. Les séquences épisodiques font progressivement tomber #Mito dans un monde étrange, peuplé de fans dangereux, de rôles interchangeables, et surtout d’une tendance constante à composer des images de soi. Loin d’être cynique ou moralisateur, Miyazaki refuse toute forme de réalisme, en employant lui-même des modélisations 3D et des environnements digitaux clairement factices. Comme dans le dernier film de Radu Jude, Do Not Expect Too Much from the End of the World, présent lui aussi à la programmation du FNC cette année, on déploie ici une esthétique hybride du masque, du filtre, de la superposition des visages comme ouverture potentielle de nouvelles avenues formelles où l’usage quotidien de transformations numériques s’intègre à un cinéma en quête de nouvelles grammaires. (Thomas Filteau)

prod. Homemade Films / Nabis Filmgroup / et al.
ANIMAL
Sofia Exarchou | Grèce / Autriche / Bulgarie / Roumanie / Chypre | 2023 | 116 minutes | Panorama international
J’ai beaucoup repensé à Triangle of Sadness (2022) en regardant le délicat Animal de Sofia Exarchou. Parce qu’il prend le contrepied de ce film à succès, en mettant ici en lumière non pas la « société de provocation » (concept développé par Dahlia Namian dans son livre éponyme) à travers l’opulence des touristes, mais en filmant plutôt les corps enivrés, fatigués, usés, objectivés des animateur·ice·s d’un célèbre complexe hôtelier grec. La réalisatrice part ainsi dans une quête différente d’Östlund, en se consacrant uniquement au monde prolétaire. Au fil du récit, on suit Kalia, sorte de matriarche quarantenaire qui travaille depuis toujours, dans cet établissement notoire. C’est elle qui accueille les animateur·ice·s qui sont de passage pour la période estivale et dont le travail consiste, comme elle, à danser et à performer des spectacles pour les touristes.
L’œuvre se déroule sur une île grecque, mais n’a rien d’idyllique. On aurait pu exploiter ce décor vaste, sa lumière, ses paysages lacustres et ses plages bucoliques, mais Sofia Exarchou fait le choix de s’en tenir au cadre restreint et sombre des intérieurs qui constituent les espaces de vie des animateur·ice·s : sous-sols où ielles se préparent pour les spectacles, logements minuscules et délabrés où ielles vivent, scène où ielles performent leurs chorégraphies, etc. Il n’y a rien de lumineux dans ce film, qui d’ailleurs ne cherche pas à dialectiser la misère des travailleur·euses·s. En effet, on ne met pas en contraste la gravité du travail avec la légèreté du tourisme ni la richesse des uns avec la pauvreté des autres. C’est, au reste, la force de cette œuvre de ne pas s’être pris au jeu du manichéisme. On explore ainsi sincèrement la réalité affective et psychologique des employé·e·s.
La cinématographie du corps qui caractérise le film (citons les nombreuses scènes de danse et de sexualité) permet d’exploiter toute l’amplitude du jeu des actrices, notamment de Dimitra Vlagopoulou (Léopard de la meilleure interprétation féminine) et Flomaria Papadaki, qui valent à elles seules le détour, pour leurs performances qui reposent beaucoup sur l’expressivité du regard.
Long métrage sans véritable récit, qui enchaîne les scènes sans lien explicite, Animal donne l’impression d’un flottement, d’une vague ressassée. La forme lancinante de l’œuvre donne ainsi à éprouver ce quotidien répétitif, lassant, étouffant des travailleur·euses·s pour qui il ne semble y avoir aucun horizon, aucune alternative, aucune sortie possible sinon la fuite dans l’ivresse : « Party everyday. » L’œuvre réussit puissamment à nous faire éprouver le désœuvrement et l’errance de ces personnages festifs et malheureux, qui ont quelque chose de ducharmien dans leur absence totale de quête. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)
Prochaine projection : 12 octobre à 20h30 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)

prod. Kaijyu Theater
SHADOW OF FIRE (HOKAGE)
Shin’ya Tsukamoto | Japon | 2023 | 95 minutes | Temps Ø
La violence est de moins en moins métaphorique chez Tsukamoto, de moins en moins fantaisiste, de sorte qu’elle est d’autant plus troublante, surtout que la violence de sa mise en scène demeure. On est loin de son époque cyberpunk, où la technologie était source de variations monstrueuses et ludiques ; depuis que le réalisateur revisite l’histoire de la guerre au Japon, la fusion indue de la chair et du métal, de l’humain et de son appareillage mortifère, possède des échos sociologiques terrifiants. À ce titre, Shadow of Fire constitue réellement un film crépusculaire en ce sens où la mécanisation des corps n’est plus du tout de l’ordre du fétichisme (même dans Killing [2018], on se permettait encore de faire glisser des lames entre les dents des personnages), mais du traumatisme pur.
Se déroulant dans le Japon d’après-guerre, au sein d’un monde décharné rempli d’âmes en peine, l’œuvre débute par un intense huis-clos dans un bar délabré entouré de ruines, où une veuve devenue travailleuse du sexe dépérit, jusqu’à l’arrivée d’un jeune soldat traumatisé et d’un garçon chapardeur de légumes, avec qui elle formera une famille de fortune le temps d’un songe. Jusqu’à ce que s’immisce chez eux la maladie (mentale), résultat indirect de la guerre. Malmenée par un objectif insistant et un montage qui multiplie les fondus fiévreux, le visage suant, le corps projeté contre les bruyants panneaux vitrés du restaurant, tenaillée par la faim et les coups, titubant dans des pièces à moitié brûlées, le regard entre la férocité et le désespoir, la femme ressemble à un fantôme, puis renaît au contact de l’enfant. La lumière commence à pénétrer dans le bar, à conjurer les ombrages qui menacent d’engloutir les personnages, mais elle s’éteint aussitôt, à l’instar de la flamme que fait naître un instant le soldat avant de retourner à l’état de gibelotte hébétée qu’en a fait la conscription forcée.
La deuxième partie a beau se dérouler dans des grands espaces aérés, où le cadre respire abondamment, elle est également au service d’une histoire d’obsession morbide, menée par des automates vengeurs. Plutôt que de constituer un portrait ténébreux où s’immisce la lumière, il s’agit d’un portrait lumineux où s’immisce les ténèbres, alors que le jeune voleur de légumes du début traverse la campagne avec un soldat mutilé, à qui il doit fournir un pistolet afin qu’il puisse punir les responsables de son instrumentalisation en tant que machine de guerre. Encore une fois, le traumatisme s’immisce brutalement dans le paysage, tel qu’en témoigne le spectacle de cet homme délirant, prisonnier d’une ferme familiale, que l’on nourrit à travers les barreaux d’une fenêtre en prenant soin qu’il ne nous attrape pas la main et nous invective à propos d’enfants imaginaires se promenant sur le toit. L’interprétation de ce dernier est d’ailleurs emblématique du film, et de ses performances hyper intenses, névrotiques, comme désespérées, qui dénotent toujours une âme rongée tout entière par l’horreur. L’insistance de l’objectif atteint même des sommets de tension dans cette deuxième partie, alors qu’elle vient incarner l’expression déchirante de ce névrotisme traumatique au moment de savoir s’il vaut mieux tuer ou se tuer.
Au début de Dirty Harry (Don Siegel, 1971), lors de la scène du vol de banque, on nous invite à compter les balles (Callahan a-t-il tiré cinq ou six fois ?), et il s’agit là d’un exercice amusant puisque la violence est toujours de l’ordre du spectaculaire. Et bien ici aussi, il importe de compter les balles, mais pour des raisons différentes… Parce que le spectre de la Faucheuse est omniprésent et qu’un projectile de plus signifie un être cher de moins selon la logique belliqueuse dans lequel le pays entier est enlisé. (Olivier Thibodeau)

prod. Sacher Film / Fandango / et al.
VERS UN AVENIR RADIEUX
Nanni Moretti | Italie | 2023 | 96 minutes | Les incontournables
Dans la tradition classique du métacinéma (8 ½ [1963] de Fellini est encore aujourd’hui l’exemple le plus marquant), le métier de cinéaste est souvent représenté comme un travail maudit. Vers un avenir radieux, le nouveau film de Nanni Moretti, ne fait pas exception à la règle. Moretti, qui nous a déjà habitué à ce genre de fable autobiographique (Aprile [1998], Mia Madre [2015]) y interprète le rôle de Giovanni, un réalisateur qui peine à terminer son dernier projet, une tragicomédie qui raconte l’histoire d’une troupe de cirque hongroise invitée par le parti communiste local, et qui reste coincée en Italie pendant les événements de l’insurrection hongroise de 1956. Malheureusement pour ce nouveau projet, Giovanni est dans une sorte de crise de la soixantaine et perd chaque jour de plus en plus le contrôle de son film. Son actrice principale se prend pour Gena Rowlands et veut improviser chacune de ses scènes. Les éléphants, censés apparaitre dans la séquence finale, sont en chicane (deux sont allemands et deux sont français après tout). Surtout, son producteur (charmant Mathieu Almaric) se fait arrêter par la police, mettant instantanément fin aux espoirs de Giovanni de terminer son long métrage. Cerise sur le sundae, sa femme, avec qui il avait jusqu’alors produit tous ses films, lui demande le divorce.
Narcissique, aigri et fermé sur lui-même, le personnage de Giovanni nous rappelle au départ Larry David dans Curb Your Enthusiasm, et, tout comme dans la série américaine, Vers un avenir radieux utilise abondamment l’autodérision pour provoquer le rire, et ce de manière la plupart du temps très efficace. Si le film est donc très drôle, il donne aussi parfois l’impression d’être une inside joke, que Moretti est le seul à pouvoir comprendre. Ce n’est pas tant que le film ne veut pas inclure le public dans sa folie, puisqu’il le fait avec succès à plusieurs reprises. C’est plutôt que, sous ses multiples couches d’ironie, le message que le réalisateur veut nous transmettre se dissipe quelque peu, et il n’est pas tout à fait clair si Vers un avenir radieux est une œuvre autobiographique dans laquelle Moretti nous fait part avec franchise de ses insécurités et de ses anxiétés face au monde d’aujourd’hui, ou finalement une grande farce, une pure satire, qui a pour intention de gentiment ridiculiser le monde du cinéma contemporain avec une insolence typique italienne. Il faut dire qu’en utilisant sa tribune pour défendre de façon très cavalière sa vision du cinéma face aux dangers de l’ère du streaming, Moretti nous rappelle un peu Don Quichotte en train de combattre ses moulins.
Dans l’une des scènes les plus marquantes du film, Giovanni tente de sauver son projet en allant le proposer à contrecœur chez Netflix, où il est accueilli par trois imbéciles qui ne comprennent pas pourquoi celui-ci ne contient pas de « what the fuck moment ». Si la scène est comique, cette attaque contre la plateforme de streaming nous laisse un peu pantois tant elle est mesquine et bornée. Et même si Moretti s’efforce de se présenter en tant que fou du roi, pour qui toute cette histoire de cinéma n’est pas vraiment sérieuse après tout, il est aussi parfaitement clair qu’il se complait quelque peu dans son rôle de grand défenseur de l’ordre classique du Septième art. Bien que les fans de l’auteur risquent certainement d’apprécier l’humour pince-sans-rire et l’univers souvent irrévérencieux, mais toujours très sobre, de Vers un avenir radieux, le reste d’entre nous risque malheureusement de se retrouver un peu assommé par les ruminations d’un cinéaste, qui, comme le héros de Cervantes, semble parfois vouloir s’attaquer à des démons imaginaires. (Dominic Simard-Jean)
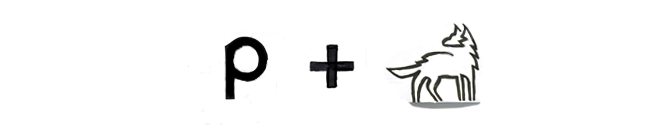
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
