1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. FF Films, Medium Density Fibreboard Films
THE MAIDEN
Graham Foy | Canada | 2022 | 117 minutes | Compétition nationale
Graham Foy (August 22, This Year, 2020), autrefois connu sous le pseudonyme Fantavious Fritz, se fait remarquer comme artiste canadien émergent; il serait plus juste de dire qu’il est un cinéaste de grand talent à suivre résolument. Sa mise en scène minimaliste, poétique et intimiste, touche une part de vérité et s’inscrit dans une dimension désarmante, authentique, vulnérable. Avec The Maiden, son cinéma exprime avec candeur le confluent des grandes prises de conscience : celle de la valeur de l’amitié, de la gravité de la vie, de sa fatalité, des ressources intérieures que l’on doit développer souvent à sa propre déconvenue, de la solitude viscérale à l’humain, du sentiment d’être un imposteur au sein même de sa communauté, et encore du sens du mot survie loin du giron maternel, quand soudain sont expérimentés les premiers sentiments d’exclusion nés des marginalités plurielles et subjectives de chacun.
C’est ce moment de transition puissant, excessif, breveté dans l’imaginaire collectif sous le mot adolescence — bassin dense, ayant inspiré tant de cinéastes, souvent sans grande originalité — qui se distingue ici, enfin, du simple « statement de l’adolescence » pour s'incarner dans une méditation de « l’être » au présent. Non sur la spécificité de la période et ce qu’elle éveille ou non en empathie empirique chez le spectateur, ni même sur ce qu’elle représente comme potentiel de stylisation cinématographique — venue de sa confusion et de sa nonchalance établie, toutes deux souvent disparues avec l’âge —, l’adolescence n’est plus le sujet du film, mais ce sont ses sujets qui sont adolescents. Différence fondamentale.
Whitney (Hayley Ness), la jeune fille disparue, prétexte au titre de l'œuvre, tout comme les deux inséparables skateborders que sont Colton (Marcel T. Jiménez) et Kyle (Jackson Sluiter), font partie d’un écosystème complexe et fragile, au même titre que la nature ambiante qui les entourent et les accueillent au quotidien lors de leurs flâneries vitales. The Maiden devient en quelque sorte un film écologique, en mettant en abîme un ensemble composé par une communauté d'êtres vivants, en interaction avec leur biotope, dans une interdépendance noble, permettant ou non l’équilibre, dans le maintien et le développement de la (sur)vie.
Porté par le travail incantatoire de la directrice photo Kelly Jeffrey, la caméra réussit à atteindre le réel. Ses magnifiques images, tournées en pellicule 16mm Kodak 500 Tungsten, créent un espace de contemplation et de ressourcement, dans lequel s’installe le spectateur avec ravissement. Un bel exemple de cette philosophie du moment présent, qui transpire dans chaque plan du film, est sa photo puissamment naturaliste tournée presque exclusivement en lumière naturelle; une résolution rare, nécessitant lenteur et attention alors que le temps est une ressource communément inexistante dans l’industrie. La trame son (Ian Reynolds et Graham Foy) crée une ambiance tout aussi admirable. On ressent, par leurs intermédiaires, l’atmosphère des lieux et les émotions des protagonistes, à un degré qui dépasse habituellement la 2e dimension plastique de l’écran plat. Oui, on peut dire que la proposition, bien qu’imparfaite, est anormalement envoûtante, tant elle se met en danger, sans y perdre au change. Ses faiblesses y sont en effet aussi justes et essentielles que ses forces : dans ses errances, sa dispersion, ses redondances, qui sont soumises au même affranchissement, celui d’un cinéma qui ne cherche pas à entrer dans les conventions, mais à se déployer et à se mettre seul en exergue pour mieux trouver sa place dans le lot, pour éprouver sa force dans le flot. (Anne Marie Piette)

prod. Articolture, Nocturnes Productions, Istituto Luce Cinecittà
ITALIA, LE FEU, LA CENDRE [ITALIA. IL FUOCO, LA CENERE]
Céline Gailleurd et Olivier Bohler | France/Italie | 2021 | 95 minutes | Histoire(s) du cinéma
Dans nos cours d’histoire, on étudiait l’Égypte, puis la Grèce, puis Rome, puis la France, puis l’Amérique. Une question me turlupinait : les Égyptiens n’avaient-ils plus d’histoire quand commençait celle des Grecs et celle des Grecs se terminait-elle quand s’amorçait celle des Romains... ? Ne se passait-il rien en France pendant que nous étions dans l’Antiquité ni rien dans l’Amérique pendant que nous étions en France... ? Comme si le temps était lié à l’espace. À force de revoir les ouvriers sortir de l’usine et les trains arriver en gare, on a fini par occulter que, un peu partout dans le monde, au même moment, de semblables scènes étaient tournées, et notamment en Italie, à quelques détails près : les ouvriers travaillent et les trains déraillent.
Vieilles images : regard neuf
Gailleurd et Bohler, qui enchaînent les extraits de films muets italiens, n’hésitent pas à ralentir le mouvement de leur manivelle pour nous permettre de jouir de la beauté cristalline des images et de prendre la pleine mesure de leur usure. De plus, le montage (chronologique) propose non seulement un parcours éminemment didactique à travers l’histoire — dans les dédales de laquelle les sporadiques intertitres (presque des poèmes) et les témoignages d’époque (lus par Fanny Ardant) nous accompagnent —, mais constitue, en lui-même, une histoire, laquelle sera conduite du début (le train sorti de ses rails) jusqu’à sa fin (le train transportant des kilomètres de bobines vers l’Allemagne, où elles sont destinées à être brûlées).
Récit d’une histoire : histoire d’un récit
Chemin faisant, c’est également à une réflexion sur la valeur du 7e art que nous convie le duo, un art qui, bien qu’arrivant après l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie et le théâtre, n’en finit pas moins par les contenir tous. À cet égard, le cortège funèbre transportant Giuseppe Verdi vers son dernier voyage semble servir de préface. Il est même éclairant de constater le regard curieux des badauds tourné vers cette caméra plutôt que vers l’événement qu’elle est venue filmer. Même les acteurs de théâtre, apprend-on, seront séduits par l’appel de la pell’.
Un art : une arme
Enfin, les rapprochements effectués par Gailleurd et Bohler nous permettent de voir comment le cinéma — dès ses débuts, comme aujourd’hui — aura tour à tour été utilisé à des fins de divertissement, d’enseignement et de propagande. Mais cette histoire « parallèle » nous rappelle surtout que, de tout temps, les Italiens ont eu le sens du cadrage, de la composition et de la mise en scène de même qu’un respect quasi religieux pour leur culture, n’hésitant pas à puiser dans leur propre mythologie — L’Énéide, La Divine Comédie... — pour les réactualiser, les présentifier, les démocratiser, voire les dépasser.
Ensuite : Rossellini, Visconti, Antonioni, Fellini, Pasolini...
(Jean-Marc Limoges)

prod. Les Films du Fleuve, Archipel 35, Savage Film
TORI ET LOKITA
Jean-Pierre et Luc Dardenne | Belgique | 2022 | 88 minutes | Les incontournables
Ça va mal finir : le premier plan l’annonce d’emblée, serré sur un visage soumis à la question par une voix sans visage, et qui finit par suffoquer. Lokita, jeune femme clandestinement débarquée en Belgique en provenance du Cameroun, est cernée par une série de figures qui l’entravent : la justice qui, en lui refusant son permis de séjour et de travail, la contraint à transiger avec la pègre locale ; le dealer et pourvoyeur de faux-papiers qui l’enferme pour la faire travailler ; les passeurs qui l’obligent à verser tout ce qu’elle gagne pour rembourser son acheminement ; jusqu’à sa propre mère qui la presse d’envoyer de l’argent au pays pour scolariser ses frères. Chacun de ces marchandages s’accompagne de violence physique et morale : coups, prostitution forcée, accusations de vol, de mensonge ou de déloyauté, rien ne lui est épargné. La manière propre à Jean-Pierre et Luc Dardenne de filmer au plus près ce grand corps un peu gauche et encombré de lui-même, les nombreuses séquences nocturnes et la multiplication des lieux claustrophobiques poussent le personnage dans les retranchements d’un destin scellé.
Si les Dardenne sont généralement reconnus pour leur réalisme d’une grande sobriété, ce film trouve par moments une tonalité curieusement rocambolesque confinant à l’invraisemblance, qui donne à cette tragédie à la fois la candeur et les accents cruels de la comptine ou du conte pour enfants. Cela n’est pas sans lien avec le second personnage du titre : le jeune garçon Tori, plein de ressources et souple comme une anguille, persécuté comme enfant-sorcier au Bénin et sauvé par Lokita, dont il est devenu inséparable. Et c’est au fond cela que la société ne pardonne pas à Tori et Lokita : le lien inconditionnel, purement électif, qui les unit à la vie à la mort et que nul autre ne reconnaît car il refuse et met en péril la valeur monnayée, fonctionnelle, des formes institutionnelles, contractuelles et hiérarchiques de l’être-ensemble sur lequel repose et compte le monde capitaliste, dans ses tournures légales aussi bien qu’illégales. Au-delà de la charge très actuelle portée contre le racisme et l’arbitraire des politiques d’immigration, le film travaille ainsi en profondeur, suivant de fines variations, la question des fondements et des implications du lien et de tout son cortège d’obligations, de désobligeances et de déliaisons. (Marie Eve Loyez)

prod. L'Embuscade Films
CETTE MAISON
Miryam Charles | Québec | 2022 | 74 minutes | Compétition internationale
Le point de départ du premier long métrage de Miryam Charles est une tragédie d’une horreur indicible. En 2008, à Bridgeport au Connecticut, Tessa, la cousine adolescente de la réalisatrice est retrouvée pendue dans sa chambre. Le coroner révèle cependant qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’une agression sexuelle suivie d’un meurtre. Sur la table de la morgue, Tessa nous informe en voix off qu’elle refuse cependant la mort pour continuer à vivre avec sa mère (Florence Blain Mbaye). 14 ans après les évènements, la cinéaste prolonge la vie de sa parente par le truchement du cinéma, imaginant ce qu’elle aurait été sans la tragédie, alors qu’elle renaît sous les traits adultes de Schelby Jean-Baptiste pour nous raconter son récit depuis aujourd’hui.
Perpétuer l’existence d’une cousine assassinée n’est pas une mince tâche. L’exercice porte en lui tout un défi lié à la reconstitution. Reconstitution du crime, bien sûr, mais également reconstitution d’une vie précocement écourtée et des personnes réelles impliquées dans l’affaire. Il faut d’abord préciser que Cette maison n’a rien d’un film d’enquête. Si Miryam Charles recrée les lieux du crime et emploie des acteurs pour incarner les membres de sa famille, elle n’accorde aucune attention au tueur. Heureuse décision, qui fait d’ailleurs remarquer à quel point il n’est pas nécessaire d’en parler, lui sur qui se braquent d’ordinaire les projecteurs. Plutôt, la cinéaste prend le pari de faire intervenir tous les outils du cinéma dans la ressuscitation de la victime, glissant de la fiction à l’expérimental. À titre d’exemple, l’autopsie de Tessa est une assez longue scène, scénarisée et jouée par des acteurs dans une morgue, mais dont le décor est constitué d’une simple table disposée devant un fond noir. L’aveu de l’artifice prend ici une dimension éthique, puisqu’elle déjoue toute impression de voyeurisme, mais sans pour autant amortir l’émotion.
Sauts dans l’artifice, mais aussi sauts dans l’espace et dans le temps : Cette maison se disperse sans cesse pour brouiller la frontière entre le fantasme et la réalité. Ainsi des images d’Haïti (qui ne sont pas tournées en Haïti) alternent avec celles de banlieues du Connecticut (dont les intérieurs sont reconstitués à Montréal). En multipliant les va-et-vient, la trame narrative est parfois difficile à suivre. Mais cela ne s’éprouve pas comme un défaut, mais comme une preuve de l’honnêteté totale de la proposition. En tant que spectateur, on sent que cette situation gardera toujours sa part d’inaccessible pour la réalisatrice également. En effet, comment espérer rentrer dans un deuil familial sans se heurter à des souvenirs ou des impressions qui nous restent insaisissables ? La mobilisation de toutes les ressources de l’imaginaire cinématographique est nécessaire ici — quitte à devoir basculer dans l’ésotérique —, parce que le sujet ne peut jamais s’appréhender autrement. Une grande sensibilité parcourt finalement le film, comme une hésitation à savoir si on fait bien les choses ou non, et c’est ce qu’il y a de plus touchant : on sent que le fil narratif est brodé par Miryam Charles avec un respect et un amour sincère pour sa famille. (Antoine Achard)
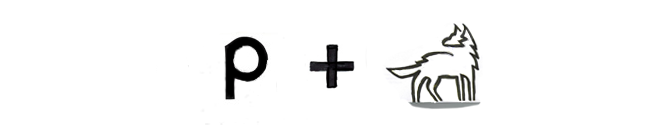
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
