SO SURREAL: BEHIND THE MASKS
Neil Diamond et Joanne Robertson | Canada | 2024 | 88 minutes
Au cœur de la collection permanente du Centre Pompidou à Paris, une installation ne manque pas d’étonner : derrière une vitre, embaumé, le bureau d’André Breton est reconstitué. La surprise vient du fait qu’une pièce entière est exposée à la manière d’une œuvre, mais aussi de l’omniprésence d’artefacts autochtones et africains. Dans leur plus récent long métrage documentaire, Neil Diamond et Joanne Robertson élucident une partie de cette énigme en sondant l’intérêt des artistes surréalistes pour la culture autochtone, et en retraçant le parcours des masques qu’ils ont importé en Europe.
Celleux qui s'intéressent au travail de Diamond se retrouveront en terrain connu puisque So Surreal reprend la formule éprouvée des précédents films du cinéaste cri — on le suit dans une enquête le menant à visiter différents endroits du globe, rencontrer des expert·e·s et redresser certains pans omis, oubliés ou négligés par les livres d’histoire (ceux de l’Occident, bien sûr). Cette fois, il est question d’un riche collectionneur américain et d’un antiquaire allemand, d’Hitler et d’expatriés français, d’une mystérieuse héritière et d’un masque de transformation ; la mise en perspective de l’histoire coloniale et postcoloniale qui nous est présentée reste solidement documentée, et le ton ludique, ouvert, encore empreint d'une douce ironie, contribue à l’efficacité de la rhétorique développée par Diamond. Cela dit, s’il en reprend les traits, le film est moins ambitieux que Reel Injun (2009) et accentue la dimension didactique qui alourdissait Red Fever (2024), jusqu’à parfois verser dans le reportage formaté (des fondus au noir scindent même régulièrement l’écoulement des images, structurant l’œuvre en chapitres commodes et laissant présager l’irruption de publicités sur les plateformes de diffusion en continu). Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose car ce qu’il perd en poésie, en capacité à produire un choc esthétique, So Surreal le gagne en limpidité et en accessibilité. Face à l’amoncellement de monographies et d’articles scientifiques ayant mythifié le génie créateur des surréalistes, Diamond et Robertson proposent leur propre document par lequel ils démontrent en sons et en images l’influence considérable qu’ont eue les Yup’iks et les Kwakwaka'wakw sur ce mouvement artistique, le respect et l’affection qu’entretenaient Breton et sa bande pour leur sensibilité, et surtout, l’importance spirituelle des masques pour ces deux peuples. (Anthony Morin-Hébert)
KÜĪ
Kahu Kaiha | Nouvelle-Zélande | 2024 | 11 minutes
Küī commence dans le soleil, à l’extérieur, et se termine dans la nuit noire, à l’intérieur. Plus encore, le récit s’amorce sur un flash-back déguisé, se poursuit immédiatement dans le présent et se termine dans le passé, par le même flash-back, structure scénaristique en boucle reflétant le cercle vicieux qui enserre le personnage principal et sa famille. Les premières images prennent place dans le rire des jeux et des bousculades d’enfants, sous la lumière éclatante du jour et d’un ciel radieux. Mais il est clair que tout n’est pas joie et perfection dans ce monde pourtant magnifique. Par un plan rapproché du visage de la jeune Küī, qui donne son nom au film, on distingue clairement ses préoccupations.
Le réalisateur Kahu Kaiha annonce d’emblée que ce film de fiction est inspiré d’une histoire vécue. Et, si son récit donne davantage dans la tranche de vie et le témoignage que dans l’intrigue classique et la recherche de résolution, on sent bien le soin avec lequel il construit cette évocation d’une enfance interrompue par des parents absents et par le besoin impératif pour une adolescente de prendre des responsabilités qui n’auraient jamais dû échoir sur ses épaules. Les cadrages très précis de l’ouverture montrent des ciels qui mangent tout l’écran et des lieux remplis d’une réalité saine, dite normale (l’école, la rue commerciale colorée, le champ avec les vaches tranquilles). Ce choix de composition d’images est délibéré, pour mieux créer un contraste avec la vie coincée — physiquement et mentalement — de Küī. Une fois la jeune fille et ses frères réuni·e·s avec leur père imprévisible et négligent, qui a oublié ses enfants à l’école, les plans serrés s’enchaînent, dans l’espace exigu de la camionnette, dans les pièces étroites de la maison familiale, dans la chambre et le lit occupés par les trois garçons.
Cette existence nocturne, sourde et désenchantée, reste pourtant le refuge de Küī, enfin libérée de la lourdeur de ses tâches une fois tout le monde endormi, enfin seule avec elle-même et ses souvenirs de sa mère (le fameux flash-back annoncé), dont elle se remémore la présence et les promesses en enfilant les souliers que celle-ci a laissés en quittant le domicile familial. Ces ballerines noires sont un symbole puissant (celui qui ouvre aussi vraiment le film, sur la voix off de la mère parlant d’une vie meilleure). Ainsi chaussée, dans l’intimité de sa chambre, Küī esquisse un sourire à la fois lointain et infiniment personnel. Ces chaussures sont la clé qui l’emmène loin de ses problèmes — en pensée, pour le moment, mais peut-être bien pour vrai aussi, un jour. C’est un espoir doux-amer pour Küī, et une fin aigre-douce pour ce court métrage modeste, mais non moins émouvant, qui évoque ce qui pourrait être un cousinage éloigné, d’une violence moins physique que psychologique, avec le grand Once Were Warriors de Lee Tamahori (1994). (Claire Valade)
FORMAS DE ATRAVERSAR UN TERRITORIO
Gabriela Domínguez Ruvalcaba | Mexique | 2024 | 73 minutes
De sa jeunesse passée dans la ville de San Cristóbal de Las Casas, la réalisatrice mexicaine allochtone Gabriela Domínguez Ruvalcaba fait d’abord le constat d’une certaine proximité inavouée et d’une absence de contact avec la communauté Tsotsil habitant les montagnes non loin de la métropole. C’est précisément depuis l’interrogation de ce territoire dit « partagé » mais des vies restées en retrait les unes des autres que le film se déploie à la fois en tant que vecteur et résultat d’un désir de rencontre. Ruvalcaba s’attarde aux mouvements routiniers demandés par le travail d’élevage, et discute, toujours derrière la caméra, avec les femmes qui s’affairent à la tonte des moutons, à la cuisine quotidienne ou au tissage des textiles.
Au-delà de la beauté plastique de ses images, de son rythme habile qui fait se succéder ses séquences d’observation filmées en numérique à des segments poétiques de poses théâtrales captées en 16 mm, Formas de atraversar un territorio trouve son sens par sa manière, quoique parfois timide, de négocier activement avec la dimension coloniale qui sous-tend les pratiques ethnographiques. Dès l’une de ses premières scènes, lorsqu’une enfant se bat joyeusement mais un peu durement avec un mouton, et que sa mère lui demande de faire attention, parce qu’« elle est en train de filmer », il devient tout de suite clair que Ruvalcaba souhaite rendre visible ce que sa démarche cinématographique génère en tant que dynamiques relationnelles et collaboratives. Et je repensais alors à la voix de Trinh T. Minh-ha, cinéaste par excellence de la critique ethnographique, qui dans Reassemblage (1982), proposait comme ligne directrice « I do not intend to speak about, just speak nearby ».
Ainsi les savoirs se lient et s’interrogent, et face au travail de soin des animaux et aux pratiques artisanales des femmes Tstotsil, la pratique filmique de Ruvalcaba se présente elle aussi comme une technique d’habitation du territoire, une manière de se lier, un travail et une expertise à partager. On pourra regretter que ces questions ne soient que peu abordées dans le discours explicite du film, mais devant son emploi économe de la parole, c’est peut-être davantage aux images qu’il faudrait s’attarder, alors que se distinguent les archives personnelles et collectives, photographies d’enfance et plans cartographiques qui signalent à leur tour les proximités closes qui intéressent ici Ruvalcaba. Il demeure une image, peut-être plus révélatrice que la voix : celle d’une main, glissant à l’avant-plan des panoramas du village et s’approchant au plus près des ornements de tissu placés dans les cheveux des femmes Tsotsil. La main tient entre deux de ses doigts une très petite loupe, seule partie du plan qui reste au foyer, et par son léger mouvement de va-et-vient, la main semble s’amuser avec le moment de bascule inévitable où, lorsque la loupe atteint une certaine distance entre son objet d’observation et la caméra, l’image renvoyée se voit renversée. (Thomas Filteau)
SEEDS
Kaniehtiio Horn | Canada | 2024 | 82 minutes | Clôture imagineNATIVE
C’est un lourd défi que surmonte Kaniehtiio Horn avec Seeds, son premier long métrage. En plus de le produire, le scénariser et le réaliser, l’artiste Kanien’kehá:ka campe également le rôle principal de Ziggy, une jeune « Urban Indian » qui doit retourner chez elle, en communauté, pour prendre soin de la maison familiale pendant que sa mère est en vacances. Néanmoins, Ziggy ne peut pas se permettre de prendre une pause de son métier d’influenceuse, car elle vient de signer un contrat lucratif avec la compagnie Nature’s Oath.
Ce récit de jeune protagoniste qui revient de la ville après avoir quitté la maison traditionnelle ne présente rien de bien nouveau ou de particulièrement original. Ziggy se plaint de la mauvaise connexion internet et subit les constantes taquineries de son cousin Wiz (Dallas Goldtooth). En revanche, si la prémisse de l’histoire est éculée, sa perspective autochtone demeure rafraichissante et fait plaisir à voir dans sa manière de mettre de l’avant la culture mohawk. Dès les premiers instants de son retour, Ziggy retrouve les référents typiques de la vie en communauté, accompagnée par les émissions de radio communautaire et les subtilités de son slang. De manière plus substantielle, l’autochtonie s’affiche éventuellement à partir du centre même de l’intrigue. Alors que Ziggy s’éduque sur la compagnie homéopathique qui l’engage, elle en apprend davantage sur les méfaits environnementaux et humains dont elle est coupable. Le film montre alors par la bande que le colonialisme est loin d’être chose du passé, mais qu’il prend d’autres formes pour exercer son pouvoir à travers les structures modernes (et numériques) du capitalisme.
Malgré un premier acte qui prend son temps à s’installer, la courte durée de 82 minutes finit par rattraper le développement de l’intrigue qui se précipite. Alors que nous avons appris à apprécier Ziggy et Wiz, nous ne pouvons pas en dire autant des autres personnages. Bandit (Meegwun Fairbrother), par exemple, l’intérêt amoureux de Ziggy et Drake (Patrick Garrow) l’antagoniste principal, auraient gagné à ne pas être aussi unidimensionnel. De plus, le film cherche souvent le bon ton avec des scènes qui vacillent dangereusement entre le burlesque et le suspense. Or ces faux pas finissent par se faire oublier pendant l’acte final qui ne laisse pas indifférent, alors que Kaniehtiio Horn assume pleinement un virage gore vers le thriller. Encore une fois, la perspective autochtone élève l’ambiance d’horreur de belle façon. Alors que les films de genre ont tellement emprunté à la culture autochtone dans le passé, il fait grand bien d'en voir un revêtir une perspective autochtone bien intégrée, tout comme c’est un plaisir de voir Kaniehtiio Horn être mise en valeur dans un rôle de femme « badass » capable de prendre les choses en main afin de sauver son héritage familial. Enfin, impossible de passer sous silence les interventions du grand Graham Greene qui vient ponctuer le film avec humour dans les rêves de Ziggy tout en complétant une distribution réussie qui suffit à nous satisfaire pleinement malgré les imperfections. (Vincent Careau)
*Texte originellement publié dans notre couverture du festival ImagineNATIVE 2025
KÎSÎS MÎGÎZÎ — LE SOLEIL DE L'AIGLE
Dayven Kish Papatie | Québec | 2025 | 8 minutes
Kîsîs mîgîzî — Le soleil de l’aigle porte toutes les marques d’une production du Wapikoni mobile, qui accompagne des jeunes de communautés autochtones québécoises à faire leurs premiers pas au cinéma. Ces marques comprennent bien sûr certaines maladresses, mais le cinéma n’est pas toujours là pour nous éblouir avec des valeurs de production hollywoodienne, des stars, des effets spéciaux et de l’action.
En laissant aller le poids des secrets d’une vie de violence et d’abus qu’il ne nomme pourtant jamais avec précision, en se confiant à la caméra sur les non-dits les plus déchirants de son enfance, y compris des pensées suicidaires, Dayven Kish Papatie se libère enfin de tout ce qui pouvait encore le retenir dans la réalisation de ses désirs et projets actuels, porteurs d’espoir non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa collectivité. Sa fierté d’être le premier sensei autochtone de sa communauté (le premier maître de karaté), son soulagement d’être parvenu à triompher du passé par ses efforts et sa réflexion sur lui-même sont visibles à l’écran. Les images lumineuses qu’il nous montre, non seulement de lui-même, entre autres pratiquant sa passion du karaté dans la mousse de la forêt, mais aussi celles d’un garçon qui représente à la fois le jeune Dayven troublé d’avant et la jeunesse actuelle de Lac Dozois que Dayven cherche aujourd’hui à accompagner et à influencer positivement, sont impressionnantes d’un symbolisme qui n’a rien de cliché. S’il y a beaucoup de candeur chez ce jeune réalisateur, le but de son film est d’écouter. Écouter les témoignages qui affranchissent. (Claire Valade)
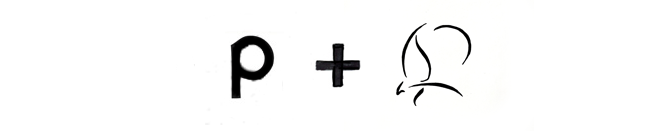
Partie 2
(So Surreal: Behind the Masks,
Küī, Formas de atravesar un territorio,
Seeds, Kîsîs mîgîzî — Le soleil de l’aigle)
Partie 3
(Alien Weaponry, Endless Cookie,
Pidikwe, Ka Whawhai Tonu,
The Dim)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
