
prod. Fotocine Film Production Limited
DANGEROUS ENCOUNTERS OF THE FIRST KIND
Tsui Hark | Hong Kong | 1980 | 96 minutes | Temps Ø
De la schizophrénie du scénario de Dangerous Encounters of the First Kind, on retire une sorte d’historiographie préfiguratrice du cinéma hongkongais, mais on s’amuse surtout follement à éprouver la mise en scène survitaminée d’un jeune Tsui Hark, que catalyse un montage brillant qui contribue à quelques scènes d’anthologie. Pamphlet antiviolence qui se complait dans le spectacle de la violence — commerce oblige — le film trouve ses racines dans un embrouillamini d’influences diverses. Naviguant subrepticement entre le giallo, le cinéma d’action, le film d’enquête policière, la comédie satirique et le portrait dramatique d’une jeunesse désabusée — on n’est jamais complètement sûr s’il s’agit d’une œuvre anarchiste ou paternaliste — on finit par se laisser aller au rythme enlevant du récit, qui malgré les ponts chancelants qu’il établit entre ses différents filons, se déploie néanmoins de façon extrêmement dynamique.
Les choses commencent lors d’une nuit pluvieuse, dans un appartement hongkongais sur lequel on multiplie les prises de vue angoissantes, alors qu’une psychopathe non-identifiée perce le dos d’une petite souris sur un morceau de Goblin tiré de la bande sonore de Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978). On s’imagine d’emblée un giallo façon Billy Tang, mais ce serait sans compter sur les constantes ruptures de ton qui caractérisent le film. À commencer par la révélation de l’identité de cette psychopathe tortionnaire de souris, qui nous apparaît comme une jeune femme indomptable tirée tout droit du film de rébellion adolescente, chez qui l’on retrouve finalement un certain charisme et une belle énergie insoumise. On pourrait même dire qu’il s’agit du personnage le plus intéressant du film, plus en tout cas que les trois fils de riche qu’elle transforme en malfrats par chantage (après les avoir vu tuer un quidam au volant d’une bagnole), que les militaires occidentaux psychopathes impliqués dans une affaire de trafic de fonds japonais ou que les policiers en carton qui sont à leur trousse.
Il n’y a pas vraiment de catharsis dramatique ici, ou de trame narrative solide, mais une série de filons plus ou moins aboutis, dont on apprécie les surprenantes jonctions pour peu qu’elles s’inscrivent dans un rythme soutenu de part en part, lequel transforme l’œuvre en expérience de pur cinétisme et de fougueuse ingéniosité. Le lexique visuel est particulièrement impressionnant, alors qu’on multiplie ici les angles de caméra inusités dans la quête constante d’une forme d’évocation renouvelée — Hark est particulièrement bon pour tourner à l’intérieur et à l’orée des minuscules réduits où vivent les protagonistes. Le cadre mobile, qui balaie incessamment les décors, énergise chacune des scènes, et les raccords soudains sur des objets tranchants contribuent à une violence, du moins à un sentiment de menace constante. On peinerait en fait à nommer un seul plan ennuyeux dans tout le film, surtout que le montage amplifie toujours le potentiel d’engouement des images. Il n’y a qu’à penser à la scène de l’accident, où le parcours parallèle d’un piéton, d’un motocycliste et des trois idiots en bagnole contribuent à alimenter un suspense haletant, ou à la scène, mémorable et singulière, où Wan-chu verse de l’essence sur les trois garçons avant de les poursuivre avec un linge enflammé qu’elle tient dans sa main gantée. La bande sonore bordélique, qui mêle indistinctement des extraits de Dawn of the Dead, de l’électro française, du funk et du pop rock ne fait que contribuer au réjouissant chaos ambiant. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 14h30 (Cinéma du Parc - Salle 1)

prod. Marc Goyens
HERE
Bas Devos | Belgique | 2023 | 82 minutes | Panorama international
Le récit semble d’abord anecdotique : Stefan part en vacances, s’apprête à quitter Bruxelles et à fuir un emploi en construction pendant quelques semaines afin de retourner dans sa Roumanie natale. Ou pense-t-il quitter la ville plus longtemps, comme il semble le signaler discrètement à ses proches ? Il vide son frigo, prépare une soupe avec les quelques légumes restants, et propose de la partager avec diverses connaissances dispersées ci-et-là dans la capitale. Ses déplacements le mènent à une rencontre fortuite avec Shuxiu, une doctorante en botanique spécialisée dans l’étude des mousses végétales, qui ouvre dans le décor urbain une brèche forestière où les deux personnages partagent une promenade d’observation florale. « La mousse pousse partout, mais la plupart des gens ne la remarque même pas. » De cette collision, le réalisateur belge Bas Devos développe un superbe portrait des mouvements citadins, un film de marche où toute rencontre s’imbibe d’une touchante générosité, et où les déplacements utilitaires dans la ville s’évanouissent pour laisser place à une méditation à l’affut de tendres soubassements poétiques.
Ce qui sous la plume d’un·e autre pourrait ressembler aux balbutiements d’une rencontre amoureuse apparaît ici sous la forme d’un simple chemin partagé, d’un lien inopiné soulagé de ses lendemains préécrits. Et si, au premier abord, la marche conjointe entre Stefan et Shuxiu pourrait sembler pour certain·e·s trop ténue ou quelconque, il faudrait aussi observer avec attention comment Devos se permet de dévêtir la rencontre de toute prescription. Loin d’être un récit d’apprentissage, où deux vies se retrouveraient provisoirement rapprochées le temps d’un partage qui ferait trace, Here compose plutôt une diégèse basée sur un altruisme dénué d’attentes. C’est dans cet état de pure disponibilité à la rencontre que baigne chaque séquence, en créant un espace public qui ne se base jamais sur la tension ou l’inconfort mais sur une contiguïté des corps toujours propices à communiquer. Tôt dans le film, Stefan effleure le bras d’une dame assise dans le bus à ses côtés alors qu’il retire son téléphone de sa poche. Il la regarde, puis s’excuse rapidement, bien qu’elle n’ait à peine remarqué son mouvement et qu’elle questionne son geste de pardon. « Je m’excuse parce que je vous ai touchée. » C’est un instant minime, et Devos ne s’y attarde qu’un instant, sans l’appuyer à l’excès. Mais il pointe pourtant vers le cœur d’une dynamique cruciale à Here, une politique de la tendresse, sous-tendue par une conscience de l’autre subtile et inspirée. C’est un film d’une douceur utopique que signe ici l’auteur, un récit-baume en cette fin de festival qui nous rappelle qu’un cinéma riche ne carbure jamais nécessairement au drame ou à la tension, mais plutôt à une forme d’investissement du regard où chaque pan des images nous enjoint à devenir sensibles. (Thomas Filteau)

prod. Studio Canal UK / Sixteen Films / et al.
THE OLD OAK
Ken Loach | Royaume-Uni | 2022 | 113 minutes | Panorama international
Regarder aujourd’hui les films de Ken Loach et de son scénariste Paul Laverty, c’est l’équivalent de mettre ses vieilles pantoufles et de se recroqueviller devant l’âtre par un jour d’hiver mordant. C’est comme retrouver une parcelle d’espoir salutaire dans un monde « that’s going to shite », pour citer les personnages parfaitement rugueux, parfaitement habités de The Old Oak. Or, on pourrait sans doute reprocher aux deux auteurs de faire la même chose depuis dix ans, moyennant quelques changements thématiques et géographiques, mais force est toujours d’apprécier la chaleur humaniste de leur cinéma. Or, s’il s’agit peut-être ici de leur film le plus émouvant, c’est aussi parce qu’ils forcent un peu la note, jusqu’à verser dans le mélodrame — nous tirant presque indûment les larmes des yeux. On s’éloigne ainsi du kitchen sink realism des débuts du réalisateur, mais sans pourtant sacrifier son attachement à la réalité prolétarienne, ici celle d’un village de mineurs désaffecté où s’établissent, non sans une certaine controverse, nombre de réfugié·e·s syrien·ne·s. Et si le scénario du film, plus anecdotique que linéaire, s’éparpille un peu, on sent aussi que c’est par humanisme, question de bien énumérer les écueils auxquels font face les protagonistes dans leur quête de bonheur pourtant si simple.
Le film débute par une chorale de voix câlines qui s’adressent à une famille migrante au moment d’emménager dans une petite maison de briques rouges encastrée typique des villes ouvrières du nord-est de l’Angleterre. Puis, des voix discordantes s’y ajoutent en faisant pleuvoir les injures d’usage : « pas encore de maudits turbans ». La tension entre la générosité de certain·e·s habitant·e·s et le racisme vinaigré d’autres perdurera d’ailleurs jusqu’à la fin du film, même si l’empathie gagnera beaucoup de terrain et que la haine sera toujours à portée de rédemption. Le catalyseur du changement ici, c’est un protagoniste du nom de T. J. Ballantyne, un ex-mineur devenu tenancier de taverne qui ressemble à un mélange entre Daniel Blake et Jimmy Gralton. Il s’agit en effet d’un héros malgré lui, un homme brisé qui trouve un sens à sa vie dans le rapport d’entraide qu’il entretient avec une jeune photographe syrienne nommée Yara. Mais c’est aussi un pilier social en devenir, potentiel qu’il démontre en conduisant une camionnette à travers la ville pour aider les organismes de charité, mais aussi en décidant, après moult hésitations, à réouvrir la salle communautaire, tapissée de photos d’époque, attenante à son bar.
Tout le récit et tous ses thèmes gravitent en effet autour de la réouverture de ce lieu, sorte de noyau symbolique où toutes les pistes scénaristiques viennent s’ancrer : l’idée d’un collectivisme perdu qui s’exprimait autrefois par le simple fait de partager un repas ; l’importance de la photographie comme art humaniste, capable de rassembler la population autour d’une identité prolétaire commune et d’immortaliser la vie des sans-le-sou, de voir l’espoir à travers la misère ; et finalement l’urgence de s’organiser localement, indépendamment des grands systèmes de pouvoirs nationaux. À ce titre, les quelques trames, fécondes mais inabouties, qui parsèment la narration (à propos de la spéculation immobilière notamment, du cyberharcèlement et de la destruction des infrastructures syriennes) s’imposent malheureusement comme des éléments superflus en marge des flots tumultueux d’un récit parfaitement empathique, mais un poil familier, qui, loin de constituer le chef-d’œuvre de Loach, représente néanmoins un admirable chant du cygne pour cet artiste vénérable. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 15h00 (Cinéma Impérial)

prod. Les Films du Poisson / Arte / 24 Images
ORLANDO, MA BIOGRAPHIE POLITIQUE
Paul B. Preciado | France | 2023 | 98 minutes | Compétition internationale
Je m’appelle _____ et, dans ce film, je serai l’Orlando de Virginia Woolf. Dans ce (premier) film biographique, Paul B. Preciado prend le parti de se raconter à travers le roman de Woolf, mais aussi par le biais d’une pluralité d’acteur·ice·s non-cis qui, tour à tour, vont interpréter le héros de la grande écrivaine. Le ton, que le film prend un moment à trouver, sonne toutefois juste : affublé·e·s de collerettes qui évoquent parodiquement l’origine aristocratique du personnage, chacun·e est invité·e à raconter son histoire et son expérience personnelle de la transidentité en mélangeant ses mots à ceux de Woolf — sans que la suture ne soit manifeste. Les intervenant·e·s passent ainsi de personne à personnage sans préavis, nous invitant à penser le rapport entre genre et jeu (toute expression genrée, qu’elle soit normative ou non, est après tout une performance). Le résultat, aussi acéré que mutin, nimbe le film d’un humour décalé.
Il y a dans l’œuvre de Preciado une volonté de montrer ce que l’identité a de pluriel, mais aussi de collectiviser l’interprétation du roman — et du vécu à travers lui. Apparaissant tout au long du film comme des talismans, les livres nous rappellent que les corps sont pour Preciado des somathèques, des archives vivantes. Il faut croire que c’est aussi le cas du film, dont la matière est elle aussi travaillée en ce sens : ainsi l’auteur choisit-il de faire constamment dévoyer la trame biographique, qui implique d’ordinaire une linéarité relativement stricte. En cela, son déroulement demeure fidèle au vécu trans tel que le conçoit le philosophe, c’est-à-dire non pas comme une trajectoire menant d’un genre de départ à un genre d’arrivée, mais bien une expérience de la traversée et de la transformation perpétuelles. Le choix assumé de donner à voir la fabrique du film (micros visibles, équipe technique à l’écran, interventions du réalisateur, etc.) participe de ce même refus face à la naturalisation de l’image (son passing, pourrait-on dire, pour reprendre le lexique queer).
Si le film comporte quelques éléments qui font sourciller (omniprésence des t-shirts à slogan qui, pour judicieux que soient les mots d’ordre, rappelle trop bien la réappropriation capitaliste des luttes queers ; scène exaltante de distribution de passeports sans mention de genre présentée comme l’apogée de la libération trans…), s’il reconduit en outre des éléments de réflexion avec lesquels sont déjà familier·ère·s les lecteur·ice·s de Preciado, on se réjouit néanmoins de voir cette pensée se déployer avec autant d’aisance et d’espièglerie dans un nouveau médium, qui lui sied à merveille.
Au sortir de la salle, j’avais le cœur plein, mais la vessie aussi, et ça n’a pas raté : à moins de douze mètres de l’entrée, je dois choisir dans quelles toilettes genrées je pisserai. Le monde qu’a fantasmé le film, la communauté qu’il vient de créer s’arrête aux limites de la porte de cinéma. Et pourtant, je n’ai pas envie d’être découragée par ce constat ; il me dit la laideur grise du monde binaire, oui, mais il me rappelle aussi le pouvoir du cinéma, peut-être le même que celui attribué au rêve par Preciado, de faire bourgeonner des utopies politiques. En voix off, la narration, menée par l’auteur lui-même, nous rappelle que la poésie est la forme de métamorphose la plus révolutionnaire ; j’ai envie d’ajouter que la révolution, quand on la retrouve dans l’œil de Preciado, peut aussi être la forme la plus poétique de métamorphose. (Laurence Perron)

prod. Señor y Señora
SAMSARA
Lois Patiño | Espagne | 2023 | 113 minutes | Panorama international
Avec Samsara, il est permis de croire que Lois Patiño, dont j’avais bien aimé les Red Moon Tide (2020) et Sycorax (2021), vient de se dégager pour de bon de ses obsessions parfois trop formelles pour proposer enfin une émotivité tendre, complexe, brodée à travers des personnages à l’âme esseulée et aux destins impossibles à croiser, qu’il invite à entrer dans son univers pour y déployer tout ce qu’il faut pour s’affirmer grand cinéaste. Le réalisateur espagnol vient ici puiser dans le manuel de la narration éthérée d’Apichatpong Weerasethakul, se montrant studieux face aux édits de la réincarnation bouddhique, mais pas seulement. En empruntant le chemin de cette vision cyclique de la vie, il met en scène un parallélisme des univers et des enjeux qui provoquera l’émoi autant que la réflexion critique. Entre ses moines bouddhistes du Laos et le détour africain au Zanzibar de sa deuxième partie (sans en dire plus…), il compare des conditions à la fois économiques et spirituelles, des états d’être au monde on ne peut plus différents, mais qui se rejoignent finalement dans le rapport très humain qu’il dresse face à une Nature qui englobe et relie dans la causalité des sens, des couleurs et des sons. La magnifique photographie Kodak 16 mm, chargeant chaque image d’une lumière hyper perméable, ennoblissant toutes les surfaces et surexposant le moindre éclat du soleil, produit un film qu’il fait plaisir à observer, à toucher d’un regard qui, en en suivant les formes texturées et les gestes tendres, apprend à nous repérer dans des lieux moins exotiques qu’ils finissent par être liminaires les uns des autres.
D’une limite à l’autre, tendus entre des opposés culturels et continentaux, la jungle et le désert se répondent par-delà des oppositions d’économies cosmiques : échanges spirituels, échanges d’empathie, les moines qui vivent au creux de la forêt le font ici souvent parce qu’il n’y a guère d’autre opportunité dans le village rural d’où ils viennent, sans écoles avancées, sans perspectives d’avenir. Ils se recentrent alors sur une théologie vitale qui leur enseigne à exister en paix avec leur environnement et à s’accomplir dans le don de soi, par l’aide des autres. Le service rendu est ici mère de toutes les grâces, d’un rapport altruiste que Patiño construit patiemment, dans la traversée de la rivière comme dans les gouttelettes qui tranquillement tombent sur la main ridée d’une vieille femme à qui l’on rend visite comme au sage au fond de la jungle.
Entre l’économie spirituelle et celle du recyclage du biologique qui nous attend éventuellement en Afrique, c’est tout un éthos du vivant que Samsara développe, produisant un alliage d’une émotion profonde entre la subsistance matérielle et la subsistance mystique, s’articulant autour d’un point milieu venant transcender ces dimensions d’apparences éloignées avec une originalité aussi cinématographiquement rare qu’elle s’avère d’une géniale sensibilité. L’année 2023 est jeune, mais Samsara est sans aucun doute l’un des meilleurs films qu’on pourra y voir sur un écran, parce que le tour de magie qu’il opère en son centre est, en plus d’une réflexion transnationale et théologique formidable, un éloge à la salle de cinéma comme antre de la réincarnation où le public s’engouffre afin de s’approcher des grands Autres qu’il ne soupçonnait pas si bien connaître. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 13h30 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)

prod. A24 / Access Entertainment / et al.
THE ZONE OF INTEREST
Jonathan Glazer | Pologne / États-Unis / Royaume-Uni | 2023 | 106 minutes | Les incontournables
Un couple badine en allant se coucher, planifie un voyage en Italie, leurs enfants jouent, l’emploi du mari l’oblige à déménager, sa femme ne veut pas perdre leur maison familiale à laquelle elle est trop attachée — tout cela pourrait être parfaitement banal s’il n’y avait pas, juste derrière ce mur couvert de vignes, dans leur jardin, le camp d’extermination d’Auschwitz. Lorsque le père sort la nuit, pour profiter du bon air dans sa luxurieuse cour arrière, une longue cheminée, d’où sortira bientôt un feu ardent, se profile à l’horizon. Nous ne verrons jamais ce qui se trouve derrière les remparts et les clôtures, et de même les personnages ne font nulle mention de ce qui se déroule à deux pas de leur logis, même si nous entendons, en arrière-fond, un concert permanent de coups de feu, de cris et de hurlements.
Le dernier film de Jonathan Glazer repose sur cette idée, et cette seule idée : voici le quotidien ordinaire d’un officier nazi et de sa famille, apparemment aveugles au génocide en cours. Il est tentant alors de parler de la banalité du mal, et il est difficile de ne pas penser que c’est à quoi songe le cinéaste, en particulier dans les scènes où l’on discute des difficultés opérationnelles pour que le réseau de train et les fours crématoires atteignent un plein rendement (une bureaucratisation du génocide à laquelle renvoie d’abord l’expression). Mais Glazer n’est pas Hannah Arendt, et là où celle-ci expose son concept à partir d’une étude attentive, fouillée et extrêmement précise du travail d’Eichmann, le cinéaste préfère une approche distanciée, une caméra dont la perspective nous rappelle celle de l’extra-terrestre d’Under the Skin (2013), observant l’humanité d’un regard détaché. Cette posture est particulièrement pratique, en ce qu’elle permet au moins deux choses : d’abord, elle est fort confortable, car en empêchant toute forme d’identification, nous pouvons nous rassurer, en bon·ne·s spectateur·rice·s avec le cœur à la bonne place, en nous disant « moi, je n’aurais pas pu vivre comme ça » ; ensuite, elle est aussi bien pratique, car Glazer n’a pas besoin de creuser la psychologie de ses personnages, de se demander comment on peut en arriver là, à être aussi indifférent·e·s à cette violence absolue, à s’aveugler à ce point à la réalité des gestes que nous posons, à leurs conséquences. Ce qui est, finalement, l’envers total de la réflexion d’Arendt.
Peut-être est-il injuste de comparer Glazer à celle-ci : dans ses trois derniers films, il braque sa caméra sur des corps habités par ce qui semble être une conscience étrangère, que ce soit celle d’un mari décédé que l’on croit ressusciter dans un enfant (Birth, 2004), celle d’un·e extraterrestre qui prend forme humaine (Under the Skin) et maintenant des nazi·e·s, aux comportements dont l’extrême familiarité nous angoisse tant leurs gestes nous semblent absurdes dans les circonstances. Il s’agit d’une autre manière de nous déshabituer de notre humanité, de nous la rendre étrange sous une caméra qui se veut neutre, dénuée d’affect, renforçant ainsi le sentiment d’aliénation. En ce sens, The Zone of Interest apparait comme un nouvel exercice de mise en scène, fort efficace et maîtrisé, certes, mais vu le sujet, il est impossible de n’y voir que cela (ce serait indécent). Et si Glazer cherche à traduire visuellement Arendt, force est de constater que son film échoue sans même avoir réellement essayé. Une lecture généreuse pourrait stipuler que le cinéaste interroge précisément ce réflexe de distanciation que nous avons lorsque nous sommes confronté·e·s à des agissements qui nous apparaissent inhumains, alors qu’ils ne sont que trop humains — mais à aucun moment la mise en scène ne se retourne sur elle-même pour réfléchir à ses fondements, pour remettre en question sa propre posture de distanciation.
Il ne reste alors qu’un film des plus banals, c’est le mot, qui finit par glacer le sang moins par ce qu’il représente que parce qu’il réduit à l’état de stéréotype simpliste l’un des concepts de philosophie les plus fructueux, et les plus terrifiants, du vingtième siècle. La banalité de la banalité du mal, voilà de quoi faire des cauchemars, sur notre propension à répéter des expressions apprises sans les explorer, pour ainsi éviter de s’engager humainement dans l’Histoire et dans ce qu’elle nous révèle sur qui nous sommes. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 15 octobre à 21h00 (Cinéma Impérial)
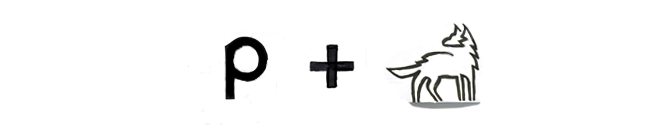
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
