JOUR 1

prod. Black Frame
HEAD SOUTH
Jonathan Ogilvie | Nouvelle-Zélande | 2024 | 98 minutes | Section Harbour (Film d’ouverture)
J’étais vraiment content de voir Ed Oxenbould à l’écran — je l’avais oublié depuis que je m’étais dit qu’il méritait mieux que The Visit en 2015. J’étais délecté de le voir avec ses cheveux de David St. Hubbins, puis avec ceux de Paul Simonon, fixés avec du KY. Et même s’il n’interprète pas ici un personnage très complexe, soit l’alter-ego du réalisateur dans le Christchurch de 1979, le jeune acteur maîtrise néanmoins parfaitement le timing comique nécessaire pour rendre justice à l’irrésistible humour pince-sans-rire du film ; il incarne aussi parfaitement toute la gaucherie adorable d’un protagoniste qui cache une puissance secrète derrière ses maniérismes de nerd. En cela, Head South constitue un conte initiatique très standard, dont le message est d’inciter les jeunes à conjurer la peur, à se jeter à l’eau, et à ne pas craindre de montrer aux autres ce qu’ielles sont capables de faire — c’est comme ça qu’on finit en couple avec la fille d’ailleurs, mais la bonne fille, celle qui est gentille mais pas trop sûr d’elle, plutôt que la sexy Jézabel.
Ce qui distingue le film, et ce qui rend sa conclusion si satisfaisante, c’est l’esprit punk, ou plutôt post-punk, qui l’habite, et lui inculque un souffle rebelle débordant d’authenticité, emblématisé par une bande sonore fantastique qui réunit certains icônes du genre, comme Siouxsie and the Banshees et Public Image Ltd. Parce que le post-punk, selon le réalisateur Ogilvie, c’est un mouvement plus inclusif que le punk, mais c’est surtout un type de musique que « tout le monde peut faire ». C’est le style parfait pour la brillante finale communautariste de l’œuvre, où tout le monde participe à la performance des Daleks d’Angus, incluant Kirsten, la fille de la pharmacie, dont c’est l’une des compositions originales qui pourvoit au film son titre — parce que, malgré l’opposition symbolique traditionnelle entre la « bonne » et la « méchante » fille, malgré l’apprentissage au machisme chevaleresque que promeut le scénario, c’est vrai que celui-ci recèle quand même de bons personnages féminins (« Quit looking at my cunt », dira Holly à un Angus penché au-dessus de son bain alors qu’elle lui crêpe les cheveux ; « I’m sorry, it’s just that I haven’t seen one before »).
Le post-punk, c’est aussi une façon postmoderne de réfléchir à son sujet, comme le film lui-même, qui derrière des images et des décors vintage irrésistibles, couplés à une utilisation constante de scratch pour marquer les raccords, cache une mise en scène moderne, hyper énergique et référentielle, dotée d’un montage comique à la Edgar Wright. Head South, c’est l’énième incarnation de cette esthétique nostalgique et hyper bichonné qui caractérise désormais tout le cinéma populaire, au sein d’un récit qui joint harmonieusement le spécifique et l’universel, c’est-à-dire le message central voulant qu’il importe d’être soi-même et la touchante, quoiqu’élusive éloge aux parents du réalisateur, dont la présence fantomatique confère au climax une saveur étrange et doucereuse.

prod. No Saint & Bloom
REI
Toshihiko Tanaka | Japon | 2024 | 189 minutes | Tiger Competition
La ligne est mince entre l’excès mélodramatique et l’expression d’un humanisme mélancolique, entre la candeur et la naïveté, entre le quotidien et l’anodin, et Rei titube un peu dans toutes ces démarcations qui distinguent parfois le bon goût du mauvais, le ridicule du tragique ; Toshihiko Tanaka démontre néanmoins un certain talent de réalisateur, tirant des performances empathiques d’une distribution non-professionnelle dont la mise en scène subjectivante permet de bien cerner le spleen, mais aussi les joies quotidiennes de leurs personnages. D’ailleurs, le monumental récit du film, qui se déploie sur plus de trois heures, s’avère toujours excitant, s’épanchant parfois de manière bordélique dans un romantisme burlesque ou un drame familial hystérique, mais parvenant toujours à maintenir notre intérêt pour sa ménagerie d’êtres meurtris.
On aurait parfois préféré que les sous-trames narratives entretiennent des liens plus probants — l’infidélité de Ko occupe une place presque anecdotique dans l’histoire, recoupant la trame centrale en termes surtout symboliques. Heureusement, les sentiments exacerbés des personnages demeurent toujours parfaitement intelligibles et incandescents. Qu’il s’agisse du désir d’être « vue » par autrui qu’entretient Hikari, une travailleuse de bureau vieillissante, ou du désir de connexion de Masato, un photographe muet dont elle requiert les services pour immortaliser sa beauté naturelle, c’est toujours une humanité à fleur de peau que Tanaka montre à l’écran, envisagée avec une honnêteté entière. Le titre du film, qui réfère à un kanji qui n’a de sens que lorsqu’il est combiné avec un autre, est d’ailleurs assez brillant d’un point de vue scénaristique, laissant présager de façon élégante l’apprentissage nécessaire de l’ouverture à l’autre que devront effectuer les protagonistes. Le film revêt en outre une certaine dimension sociologique en recoupant de nombreux traits chers au cinéma japonais : la rage muette d’une masculinité inadéquate, la solitude urbaine, l’impératif social d’enfantement et d’accouplement, pesant tous sur de beaux personnages qui, malheureusement, ressemblent eux aussi parfois à des symboles.
Hikari s’ennuie, et fréquente le théâtre par elle-même, s’entichant d’un acteur passionné qui lui parle de son métier dans les termes vagues d’un tombeur en pilote automatique. Puis, pour l’accompagner dans ses sorties, elle invite son amie Asami, qui doit faire garder sa fille handicapée, Hina, par son mari, Ko. Or, c’est finalement dans les bras de Masato, le photographe responsable de l’image figurant sur le programme de la pièce qu’Hikari parviendra à se libérer, développant avec lui une bonne entente tacite mais fragile qui se reflétera dans le choc symbolique entre l’écrasante urbanité de Tokyo et l’immensité périlleuse d’Hokkaido, où habite Masato. Or, entre la solitude d’Hikari et celle d’Asami, entre le handicap de Hina et celui de Masato, entre l’infidélité de Ko et celle d’Hikari, il existe de minces corrélations qui participent d’une sorte de parallélisme subtil, mais jamais complètement prolifique, cantonnant certains personnages à des rôles rigides, presque monocordes — le « je suis la mère d’une fille handicapée » d’Asami sera répété comme un mantra fataliste, presque monolithique. Et si le film rappelle à la fois la métaphysique domestique d’Hamaguchi, la sensibilité dramatique de Kawase, voire le romantisme déjanté d’Ôku, c’est peut-être justement qu’il mériterait de trouver une voix plus distincte.
*
JOUR 2

prod. ONF
A MAN IMAGINED
Melanie Shatzky et Brian M. Cassidy | Québec | 2024 | 62 minutes | Short & Mid-length (Programme Finding Shelter)
Je profite de mon voyage à Rotterdam pour voir des films montréalais en première mondiale. Et pourquoi pas ? C’est toujours réconfortant de déambuler dans sa ville à l’étranger, et puis, c’est exactement ce que propose le captivant documentaire de Melanie Shatzky et Brian M. Cassidy : se promener dans la ville, emboitant le pas à leur sujet itinérant, Lloyd, avec qui le duo a vécu la pandémie. Habitué du IFFR, où a été projeté son premier court métrage, The Delaware Project en 2007, le duo nous revient aujourd’hui avec un autre film qui traite de paysages mentaux et de l’attachement des gens à certains lieux. On croirait d’abord à un film d’errance, alors que la caméra s’affaire principalement à suivre le parcours elliptique de Lloyd dans des espaces disjoints, entre les raffineries de Montréal-Est, où il zigzague entre les camions pour quêter un peu d’argent, et le Chinatown, où il tente de vendre des pouliches à des passants, entre la Plaza St-Hubert, où il mire les robes de mariées en vitrine, et les toilettes du Ultramar près du viaduc Van Horne, où il se lave. Mais c’est faux. Et c’est l’un des mythes que le film œuvre à déconstruire, au même titre que la notion d’objectivité.
Qui mène qui ? Qui profite de qui dans le rapport entre les cinéastes et leurs sujets ? On projette, on projette. On se dit que Shatzky et Cassidy s’achètent la gloire sur le dos de Lloyd. Mais quelle gloire ? On est loin de Sean Penn qui se filme en habit militaire sur un train ukrainien, en tout cas… Et si le processus tenait plutôt à une forme de commensalisme ? Au miracle de la rencontre ? Car contrairement au reportage social, au « film sur l’itinérance », il n’existe pas ici de distance analytique entre l’intervenant et les cinéastes, pas plus qu’il n’existe de statistiques en intertitres, de portrait « plus vaste » de l’itinérance au Québec, ou de musique extradiégétique incitant au misérabilisme. Il n’y a que Lloyd, le plaisir de filmer Lloyd et le plaisir d’être filmé. « Qu’est-ce qui te rend heureux ? », demande Shatzky en voix off ; « Parler à des gens », dit Lloyd. Et que répond Shatzky lorsqu’on l’interroge à propos du film, dédié à sa sœur décédée en 2020 ? « Lloyd a été notre sanctuaire, notre guide à travers le deuil et la pandémie. »
Et si c’était effectivement Lloyd qui guidait ses biographes, à l’instar d’écrivains fantômes ? Et si le caractère postapocalyptique des décors industriels qu’il arpente, la violence inouïe de la rue Notre-Dame qu’il sillonne, la rudesse des paysages hivernaux qu’il traverse n’étaient liés qu’à « un point d’honneur de naviguer des espaces que d’autres ne peuvent pas » ? Et si Lloyd était responsable du choix des lieux de tournage, de sa propre représentation, dans la construction d’une hyperréalité construite pour mieux exacerber son expérience vécue — la scène de campement sous les pigeons sur la rue St-Hubert, avec le vernis à ongles et la cigarette est imbue d’une véracité mystique qu’il est dur de répliquer ? Là, où le contrôle de Lloyd lui échappe, c’est dans les séquences plus expérimentales (montages de nature et d’impressions passagères), qu’on croirait servir à révéler son paysage mental. Or, Cassidy se défend bien de réfléchir à la place de son sujet, affirmant créer des images « poétiques ouvertes » et « richement ambiguës » qui correspondent vaguement à son intériorité. Évidemment, on pourrait penser que la vue des images publicitaires d’intérieurs douillets et des produits de consommation en vitrine provoqueraient chez lui un sens d’incomplétude, comme les photos de fille nues sur les stylos, mais est-ce que c’est encore nous qui projetons ? Voilà la question à laquelle le film nous confronte sans cesse, mais sans jamais pourvoir de réponse définitive. Et paradoxalement, même si l’ambiguïté d’A Man Imagined constitue l’une de ses plus grandes forces, j’ai le mauvais pressentiment qu’elle finira par le desservir…

prod. Filmika Galaika / Tasio
LA PARRA
Alberto Gracia | Espagne | 2024 | 90 minutes | Tiger Competition
J’ai longuement hésité avant d’écrire sur La Parra plutôt que sur le réjouissant La Luna (2023) de M. Raihan Halim. J’ai même rédigé un texte complet sur ce dernier avant de réaliser qu’il n’y avait pas grand-chose à ajouter à son sujet qui n’avait pas déjà été dit à propos du Chocolat (2000) de Lasse Hallström, surtout qu’il s’agit d’un autre film sur l’émancipation féminine qui passe par le regard d’un homme… La Parra d’Alberto Gracia mérite au contraire qu’on parle de lui, et ce pour toutes les bonnes raisons, à commencer par sa délicieuse ambiguïté, par l’impression trompeuse qu’il nous donne à regarder un film de fiction banal, voire inabouti, alors que sa belle production cache en fait une rare sensibilité. Il y a quelque chose d’un peu lynchéen dans l’œuvre, mais surtout dans cette Ferrol mystérieuse où est forcé de retourner le pauvre protagoniste madrilène du récit, dont l’indigence est décrite grâce aux images d’usage (les piles de facture sur le bureau, l’épicerie faite de bières et d’oranges et le vieux téléphone cassé), mais avec un excès caractéristique de la subtile excentricité du film — l’état de déliquescence avancée de son téléphone participe en effet d’une plastique pittoresque particulièrement étudiée qu’on retrouvera tout au long du film.
Suite au suicide de son père Cosme, immortalisé par une séquence d’ouverture tragique teintée d’étrangeté — le geste semble lié ici à une condition sociale plutôt que psychologique — Damián doit revenir dans sa Galicie natale pour assister à sa crémation (par écran interposé), puis disperser ses cendres dans la mer. Il pénètre pour l’occasion dans un monde légèrement décalé, à mi-chemin entre le prosaïsme du désœuvrement social et le mythe désespéré d’une mer nourricière, entre les récits des retraités et la musique house, entre le comique des hymnes locaux, chantés par de fiers habitants dans des travellings qui passent de tête en tête jusqu’à cadrer une statue, et l’horreur des itinérants décédés, entre le passé (de la catastrophe du Discoverer Enterprise) et ses contrecoups d’aujourd’hui, alors que Ferrol demeure isolée du monde.
C’est un lieu qui existe dans un genre d’espace onirique, au sein d’une temporalité incertaine que cadre à merveille la mise en scène subjectivante du film, experte dans l’art de représenter des états altérés, l’ébriété du protagoniste ou le monde secret des aveugles abandonnés par Cosme au sommet de la montagne, et dont les déambulations deviendront un leitmotiv tout au cours du récit. Une mise en scène qui s’intéresse aux détails pittoresques afin de décrire un lieu rempli d’une une sorte de brouillard (symbolique, éthylique, narcotique), où les espaces, mais aussi les visages portent en eux la marque d’un temps ingrat qui creuse, mouille, et pousse vers l’oubli. Ici, même les plus récentes politiques municipales sont au service d’amusantes digressions vers un cinéma de genre qu’on sent toujours palpiter sous la surface, à l’instar de cette altérité que le film ne cerne jamais totalement pour mieux la suggérer ; dans les dents du vieux voleur de montres peut-être, les traces de moisissure sur le plafond de la chambre de Cosme ou le néon de la maison de retraite qui pourvoit au film son titre…
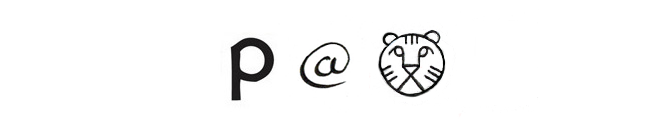
PARTIE 1
(Head South, Rei,
A Man Imagined, La Parra)
PARTIE 2
(Blackbird Blackbird Blackberry, So Unreal,
Confidenza, Slide)
PARTIE 3
(Explanation for Everything, She Fell To Earth
King Baby, It is Lit)
PARTIE 4
(Blue Imagine, Natatorium,
The Parangon, Songs of All Ends, Nécrose)
PARTIE 5
(Maia - Portrait with Hands, A Spoiling Rain,
Krazy House, Los delincuentes)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
