1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. F comme Film, Trois Brigands Productions, Le Pacte, Wild Bunch International, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
LES CINQ DIABLES
Léa Mysius | France | 2022 | 96 minutes | Film de clôture
Après avoir (co)écrit chez Arnaud Desplechin, André Téchiné, Jacques Audiard et Claire Denis, puis raflé la Louve d’Or pour Ava en 2017, la scénariste et cinéaste française, Léa Mysius, revient avec Les Cinq Diables, son deuxième long métrage en tant que réalisatrice, un mélodrame fantastique au résultat galvaudé qui avait pourtant, au départ, quelques atouts favorables dans son jeu.
Son maillon central est sa relation mère-fille passionnée, instrumentalisée à travers une fillette vouant à sa génitrice un amour possessif inconditionnel proche du culte. Vicky (Sally Dramé) est cette enfant-sorcière polarisante, aux pouvoirs mystiques, capable de voyager dans le temps au moyen de potions de sa décoction à base d’odeurs corporelles. On la suit dans son obsession à chercher puis trouver les pièces manquantes du puzzle lui permettant de démystifier l’amour de sa vie, sa mère Joanne (Adèle Exarchopoulos). La rencontre de sa tante Julia (Swala Emati), précédée par sa réputation de folle à lier, offrira à l’enfant un prétexte olfactif pour voyager à travers le brouillard de visions du passé et percer à jour le secret de sa matrice. On est loin du chef-d'œuvre des Bons Débarras (1979) dans ce récit de polyamour filial dont la sensibilité en clair-obscur était au départ prometteuse.
L’imbroglio sentimentaliste, trop souvent exacerbé, quelquefois risible, ne nous épargne pas de certains clichés d’un cinéma complaisant dont cette longue scène de karaoké sur thème d’amour lesbien. Le duo Exarchopoulos-Emati parvient en effet à nous laisser croire à leur idylle passée. On peut dire sans blague que « la magie » opère, mais pas sans y perdre quelques plumes au change.
Du côté des déceptions, Les Cinq Diables nous impose également son lot de plans aguicheurs superflus, gonflant davantage les attraits déjà naturellement et sensuellement présents de l’actrice Adèle Exarchopoulos, non pas pour la sublimer, mais jusqu’à en devenir vaguement grossiers. Fort heureusement, l’actrice se laisse emporter par le rôle de Joanne, cette femme dépassée par la tournure de son existence et par la puissance de l’amour de sa progéniture, en gardant le cap sur une interprétation sincère, constamment ancrée dans le réel et semblant complètement indifférente à la manière dont est représenté son physique à l’écran.
Les inserts surnaturels et chamaniques apportent du reste un souffle au film, une dimension nouvelle qui oxygène et équilibre l’ensemble en regard à ses emportements, en les acceptant comme une autre excentricité dans l’invraisemblable. Le résultat reste un film à la fantaisie racoleuse et sans grande conséquence. (Anne Marie Piette)

prod. ONF
THEODORE USHEV : UNSEEN CONNECTIONS [LIENS INVISIBLES]
Borislav Kolev | Bulgarie/Canada | 2022 | 78 minutes | Présentations spéciales
Theodore Ushev est de retour en Bulgarie pour y tourner un premier film en prises de vues réelles (Phi 1.618, 2021). Entre les scènes, il déambule dans Sofia et sa ville natale de Kyoustendil, redécouvrant les lieux de sa jeunesse accompagné par la caméra de Borislav Kolev. Alors que le réalisateur de Vaysha, l'aveugle (2016) nous livre ses réminiscences et rend visite à sa famille et ses vieux amis, des extraits de ses œuvres sont mêlés à des images d’archives.
Si Theodore Ushev : liens invisibles sonne comme un documentaire assez conventionnel, c’est parce qu’il l’est. L’intérêt du film ne réside pas dans son audace, mais dans la force de son sujet et de l’attrait naturel de ses souvenirs concernant la Bulgarie communiste. Il est évident que le cinéaste bulgaro-canadien, récipiendaire de tous les prix qui existent pour le cinéma d’animation, est bourré de talent. Mais ici, ce talent doit nécessairement trouver une association à des événements survenus dans l’enfance. Ainsi, le film se profile comme un récit d’origine psychanalytique, voire marvelien, où le génie du cinéaste dérive directement du trauma infantile, où la puissance affective des informations biographiques que l’œuvre contient s'émousse bientôt au vu de leur caractère anecdotique et de leur accumulation systémique. À cela s’ajoutent les images récurrentes d’une conférence animée par le cinéaste, en visite dans une classe et dans une salle de cinéma pour expliquer l’inspiration derrière son travail. Par moments, on a un peu l’impression de voir l’équivalent cinématographique d’un C.V. et d’une lettre de motivation, expliquant ce qui a poussé Ushev à immigrer au Canada pour faire de l’animation — d’autant plus que cette partie de sa carrière n’occupe que les dix dernières minutes du documentaire (pandémie oblige, les scènes censées être tournées à Montréal ont sauté, et brillent malheureusement par leur absence). Or, c’est quand on laisse l’artiste délirer avec la caméra de son téléphone ou un crayon à l’encre invisible — en somme, quand on le laisse mettre à l’exécution son adresse créatrice — que le film est le plus révélateur du personnage. Comme il le dit lui-même : « À 53 ans, je suis encore comme un enfant. » Et donc, le fait que Theodore Ushev soit encore jeune d’esprit fascine davantage ici que la mise en contexte rétrospective du jeune Theodore Ushev. (Antoine Achard)

prod. Catherine Dussart Productions
EVERYTHING WILL BE OK
Rithy Panh | France/Cambodge | 2022 | 98 minutes | Temps Ø
Avec Everything Will Be OK, le cinéma de Rithy Panh opère un virage fictionnel. Il glisse doucement du musée de la catastrophe, ressassement nécessaire des traumatismes de son Cambodge natal, vers une fable d’anticipation dont la prémisse scénaristique se calque volontairement sur le Level 5 (1997) de Chris Marker. Dans un monde ravagé par les guerres entre les hommes et les bêtes, séparés et réunis par leur nature belliqueuse commune, des écrans font défiler Les 120 journées de Sodome. Le futur dépeint ici devient non pas le résultat des péchés à venir contre lesquels le cinéaste nous mettrait en garde, mais bien l’inéluctable sépulture née des atrocités déjà commises. Si cette perspective peut sembler excitante et offrir la possibilité d’une réflexion englobante qui poursuivrait son travail de mémoire, la critique « humaniste » se noie dans sa propre ambition. Là où les figurines d’argile faisaient écho à L’Image manquante (2013) des Khmers rouge en servant de contrepoint à l’indicible et l’immontrable tout en construisant un univers d’autant plus violent qu’il revêtait une allure enfantine et surréelle, elles deviennent ici un triste apparat qui instrumentalise la douleur des autres pour les biens de sa thèse.
Les séquences s’enchainent ainsi, amalgamant la violence des abattoirs de Franju avec celle de l’exploitation animale contemporaine tout en glissant des images du Cambodge qui se perdent dans ce pot-pourri de mises à mort. Surchargé de références, le film de Rithy Panh semble appartenir à une autre époque, se construire autour d’un rapport désincarné à l’histoire dont le ton quasi-godardien tranche sincèrement avec la sensibilité essentielle dont a su faire le cinéaste dans ses précédents films. Par moments, alors que les petits cochons sculptés érigent des iPhones et réduisent en esclavage des humains masqués par la COVID, le film tend dangereusement vers une pensée réactionnaire au cynisme aussi vieillissant qu’écrasant. Enfin, même les plus beaux tableaux de ce maître de la mise en scène qui, malgré la faiblesse du propos, parvient à construire des atmosphères et des mouvements de caméras qui contiennent tout un monde dans un morceau de terre peint, sont gâchés par une voix off insupportable de bout en bout. Le texte pseudo-intellectuel dévore le film en essayant de construire une poésie suffisante, un soliloque mortifière qui redouble inutilement le propos de l’image dans ses meilleurs moments, l’étouffe et nous empêche de s’y plonger dans les pires.
Qu’on ne s’y trompe pas, le travail de Rithy Panh est toujours aussi singulier, mais dix ans après son chef d’œuvre, et alors que son esthétique en a inspiré plus d’un, participant à légitimer l’animation comme une forme majeure du documentaire contemporain, on attendait beaucoup plus de finesse pour échapper au plus grand écueil du documentaire sur la violence : faire de la mort un motif. (Samy Benammar)

prod. Toei Tokyo
VIOLENT STREETS [BÔRYOKU GAI]
Hideo Gosha | Japon | 1974 | 96 minutes | Histoire(s) du cinéma
Une toute-puissante famille yakuza de Tokyo met fin à ses activités criminelles pour se convertir en entreprise légale. L’un de ses plus téméraires lieutenants, Egawa (Noboru Andô) se voit ainsi contraint à une retraite précoce. Pour le remercier, la famille le fait gérant d’un bar de flamenco que fréquentent des petits voyous. Egawa boit son whisky et fume ses cigarettes, amer et résigné. Cependant, certains de ses anciens soldats ont les idées larges : ils veulent déclencher une guerre criminelle totale dans l’espoir de se venger et se remplir les poches. Ils kidnappent une étoile montante de la télévision, dont la carrière est manigancée par un cartel criminel, puis s’organisent pour que soit blâmée leur ancienne famille. Quand tout éclate, Egawa se retrouve au milieu d’un conflit clanique. « Just when I was out, they pull me back in », comme disait Michael Corleone dans The Godfather Part III (1990).
L’acteur principal, Noboru Andô, ancien yakuza avec une longue et terrifiante balafre qui lui traverse la joue gauche, a la bouille et le C.V. de l’emploi. Sa performance, ainsi que la garde-robe de smokings et de trench-coats noirs de son personnage, sont les points forts du film. Ses yeux foncés et profonds laissent deviner une dangerosité latente. Dans la première scène du film, Egawa se fait harceler par des truands de bas étage qui cherchent à lui extorquer un peu d’argent. Il joue d’abord au petit tenancier terrifié, mais quand il se met à embrocher des billets sur un pique-note avec une attitude moqueuse, les crapules saisissent qu’il n’est pas du genre à courber l’échine. Ils attaquent, mais Egawa en perce un dans le front avec le pique-note, fracasse le crâne d’un autre avec un combiné de téléphone qui éclate en miettes, puis retourne s’asseoir et boire son whisky, pénard. On comprend d’emblée que le titre ne ment pas : Violent Streets est violent, très violent. Hideo Gosha tire visiblement plaisir à étirer la sauce, avec des duels aux rasoirs qui durent cinq minutes Cette attitude libérale envers les moeurs s’applique aussi à la représentation des femmes, qui sont ici prostituées ou effeuilleuses, et sur les corps desquelles la caméra s’attarde de manière insistante. Les assassinats sont réalistes, graphiques, voire choquants, mais ceux qui les perpétuent sont presque toujours excentriques, comme ce surineur onnagata qui n’atteint le plaisir que par l’homicide ou ce marchand d’armes qui participe à une fusillade avec ses écouteurs sur les oreilles et une incompréhensible envie de faire la sieste. Pourtant, Violents Streets semble vouloir nous convaincre que son point de vue sur ces activités illicites est critique, comparant notamment les yakuzas à des chiens en cage. Cette posture n’est pas très crédible. Une scène dans laquelle des chefs criminels s’amusent de leur mainmise sur l’économie japonaise semble même forcée. En vérité, le film est à l’image de ses personnages : c’est quand il s’abandonne tout entier dans la démesure et l’excès sanguinaire qu’il réussit le mieux. (Antoine Achard)

prod. Institut national de l'image et du son
IL N'Y AVAIT RIEN
Alexandre Lavigne | Québec | 2022 | 15 minutes | RPCÉ
Succédant au documentaire Paradoxe (2022), le meilleur court métrage de fiction parmi les projets des finissants de l'INIS (présentés à la Cinémathèque le 12 octobre) relate lui aussi une expérience de mort imminente, cette fois sur un ton radicalement différent. Mélangeant avec brio les registres de l'humour noir et du drame, Il n'y avait rien assume dès le départ un décalage singulier et cohérent, autant sur le plan narratif que visuel, ce qui en fait une œuvre étonnamment maîtrisée. Dans un couvent, des sœurs dans la fleur de l'âge laissent percevoir leur grande complicité en nettoyant l'église au rythme de chansons religieuses et d'allègres pirouettes. L'une d'entre elles tombe et quitte le cadre; on entend alors les autres sœurs affolées, puis une coupure nous projette brutalement à la convalescence de sœur Gabrielle, de retour de l'hôpital après avoir subi un malaise et entrevu l'au-delà. La vérité aperçue la mène sur le chemin de l'apostasie : de l'autre côté, il n'y a aucun paradis, seulement le vide. Le trouble que cette vision instigue en elle est l'occasion d'échanges tragicomiques jouant sur la discordance entre la gravité de la situation et la vivacité de la réaction des personnages. La stupeur burlesque du visage de sœur Gabrielle, l'ingénuité de son effarement, est exacerbée par la balourdise de sa meilleure amie, sœur Marie, qui surprend par son excessive franchise — « Si t'as pas vu le Seigneur, c'est peut-être que t'es allée en enfer... » Cette solennité a quelque chose de triste, mais elle est déjouée par le langage familier et la candeur de ces vieilles amies qui se saluent à coups de fist bumps. La musique exagérément dramatique renforce le sentiment d'absurdité, que la direction photo, l'étalonnage et la lumière léchés supportent par d'exquises images en noir et blanc découpant le visage des personnages de manière mélodramatique. Cerise sur le sundae, le générique est l'occasion de perpétuer la blague jusqu'au bout pendant que les noms défilent : dans un plan fixe, sœur Marie reste sur le parvis de l'église à regarder son amie s'éloigner de sa voie religieuse, la saluant et la guettant pendant de longues secondes qui n'en finissent plus de s'étirer, et provoquent chez nous un dernier gloussement bien mérité. (Anthony Morin-Hébert)
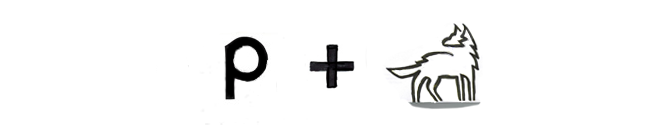
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
PARTIE 10
(Les Cinq Diables, Theodore Ushev : Liens invisibles,
Everything Will Be OK, Violent Streets, Il n'y avait rien)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
