1 | 2

prod. Deep Forest Foundation
THE LAND OF FORGOTTEN SONGS
Vladimir Nikolouzos | Grèce | 2024 | 93 minutes
Divisé en chapitres consacrés à six peuples autochtones de la forêt amazonienne, les Huni Kuin, les Awá, les Kayapo, les Matis, les Enawenê Nawê et les Shipibo, The Land of Forgotten Songs atteste de la vie de ces gens dans leur élément naturel : la forêt et la rivière. Le synopsis du film dans le catalogue du Festival Présence autochtone annonce : « Un mythe ancien nous permet de nous imprégner de leur culture et de découvrir leur cosmologie et [leur] mode de vie contemporain. » Et c’est exactement cela — ni plus, ni moins — que le cinéaste grec Vladimir Nikolouzos nous propose, avec la collaboration de la Deep Forest Foundation et des communautés concernées.
Lumineux et fascinant, ce film est ce qu’on pourrait appeler un documentaire à l’état le plus pur du mot lui-même, soit un ouvrage de documentation et de témoignage. Articulé autour d’une mythologie de création essentiellement commune entre ces peuples racontée par quelques-uns de leurs membres et à travers certains intertitres, le film présente leur quotidien actuel qui fait encore écho aujourd’hui à la légende au cœur de leur existence. Vivant presque nus dans la nature, dans des villages en huttes de pailles ou de boue de construction incroyablement précise, le corps peint de motifs complexes et orné de vêtements fabuleusement confectionnés en feuilles, en joncs, en perles et en plumes, ils font un avec la forêt qui les entoure. Pas étonnant lorsqu’on comprend que leurs croyances disent qu’ils ont été créés à partir des arbres. C’est aussi cette origine mythique qui les porte à défendre la forêt contre l’exploitation. Les quelques images d’archives parsemées ici et là servent uniquement à confronter cette existence actuelle à un passé essentiellement identique enregistré une cinquantaine d’années plus tôt. Le temps bouge lentement dans ce monde tropical d’eau et de bois.
Le cinéaste n’offre aucun commentaire explicatif ou justificatif, ce qui s’avère parfois un peu frustrant parce qu’il n’est pas toujours parfaitement évident de faire la différence entre Maíra-père et Maíra-fils, les deux Créateurs originels de la légende. Le film n’est appuyé par pratiquement aucun artifice extérieur, outre ceux du langage cinématographique — cadrages travaillés, musique atmosphérique artificielle utilisée comme pour suspendre des moments dans le temps, montage opportun d’images collant au mythe raconté, mouvements de caméra au ralenti, couleurs vibrantes. Si Vladimir Nikolouzos a adopté le parti pris de montrer ces peuples dans leur vérité la plus crue et leur réalité la plus authentique, c’est bien parce que la parole leur appartient entièrement dans cette approche. Et ils occupent magnifiquement chaque centimètre du cadre, au cœur de leur environnement moite et foisonnant. (Claire Valade)

prod. Dublin Films / Selva Cine
DIÓGENES
Leonardo Barbuy La Torre | Pérou | 2023 | 106 minutes
Dans un coin reculé des Andes, Diógenes élève seul ses jeunes enfants, Sabina et Santiago, dans la tradition quechua. Un grand mystère entoure la famille. C’est une vie sauvage et aride, au milieu des cactus et du roc, comme celle de naufragés isolés de tout. Si ce n’était des absences occasionnelles du père qui descend au village, on pourrait les croire seul·e·s au monde, tou·te·s les trois. Après le décès soudain de Diógenes, les enfants sont laissés à eux-mêmes.
Il y a quelque chose du portrait photographique du XIXe siècle dans les cadrages des personnages, mais surtout quelque chose de Béla Tarr dans le noir et blanc très contrasté et le dénuement absolu de l’ensemble, évoquant entre autres Le Cheval de Turin (2011). Ce contraste se retrouve aussi dans l’alternance entre les scènes de jour, d’une luminosité extraordinaire, et celles de nuit, profondes, toutes en clair-obscur digne de Rembrandt. Il y a une précision extrême dans le choix et la composition des plans et des cadrages. Rien n’est inutile, même les inserts sur les mains et les objets qui accentuent l’importance de chaque geste posé par la famille et l’austérité de leur environnement.
La bande sonore crue et dépouillée, parcourue essentiellement de bruits naturels, est ponctuée de rares dialogues. Quelques notes d’une mélodie antithétique au clavecin appuient le côté incongru de ce monde intemporel, en marge de la société, dont la contemporanéité est indéfinissable. (En fait, c’est uniquement à la fin du film, lorsque Sabina visite enfin le village — clairement contemporain, avec ses rues bien définies, ses poteaux électriques et ses produits d’épicerie actuels — qu’on comprend que l’action se situe bien de nos jours.) Aussi, la bande sonore suggère plus qu’elle ne décrit, comme à la mort du père lorsque le bourdonnement des mouches laisse entendre que l’homme est maintenant cadavre. La respiration et les sanglots étouffés de Sabina sur le très lent mouvement de caméra qui suit, examinant la maison à l’envers comme s’il s’agissait du regard de la fillette sur son espace, renforcent la solitude et l’isolement des enfants. Le son ambiant, assourdissant parfois dans son absence de définition précise — est-ce le vent, un avion lointain, un orage qui approche, une autoroute en contrebas, un peu tout cela à la fois ? — contribue aussi à accentuer cet isolement, comme si les personnages vivaient littéralement en vase clos, séparés du monde par une paroi invisible qui assourdit toute présence du monde extérieur.
Le cinéaste préconise le non-dit. Que s’est-il passé ? Quel drame a pu contraindre Diógenes à s’exiler avec ses enfants ? Rien n’est explicite, mais on comprend en filigrane qu’un conflit ancien a pu le séparer du monde actuel, représenté par cette malédiction qui aurait été jetée sur lui selon les villageois. L’incursion de scènes déconnectées du fil narratif, souvenirs, visions ou présages — comme la taverne, les femmes qui chantent un chant traditionnel ou la séance de photo de mariage de Diógenes — laisse entrevoir d’autres possibilités. Remarquables de charisme et de profondeur dans ce silence volontaire, les trois comédien·ne·s quechuas non professionnel·le·s — Jorge Pomacanchari, dans le rôle du père, Gisela et son frère Cleiner Yupa dans ceux des enfants — expriment avec une extraordinaire économie de moyens le poids de cet énigmatique passé qui pèse sur eux. Un premier long métrage impressionnant de beauté et d’ampleur, qui annonce quelque chose comme une grande œuvre en devenir. (Claire Valade)

prod. Jonathan Olshefski / Elizabeth Day
WHITOUT ARROWS
Jonathan Olshefski et Elizabeth Day | États-Unis | 2024 | 95 minutes
Voilà un sujet qui bénéficie sans conteste de l’approche du cinéma direct. Without Arrows n’aurait pas à pâlir devant un grand scénario de fiction, car le sien nous tient en haleine du début à la fin, d’autant qu’il réussit, sans pathos, à se tracer un chemin vers le cœur.
Là où le documentaire dépasse la fiction, ou « dit mieux » qu’elle, c’est dans le choix des intervenants. On suit ici Delwin Fiddler Jr., champion de grass dance, sujet central de ce long métrage qui prend d’abord des airs de road movie. Fiddler a quitté très tôt sa réserve sioux pour se rendre à Philadelphie, espérant ainsi se construire une vie meilleure, loin des traumas intergénérationnels et de la dépendance. Or, plusieurs années plus tard, il décide de revenir dans sa communauté de Cheyenne River dans le Dakota du Sud. On suit donc son retour au pays. Là où le projet est ambitieux, c’est qu’il accompagne le protagoniste sur une période de treize ans (de 2011 à 2023).
La réalisation de Jonathan Olshefski et d’Elizabeth Day s’approprie cette histoire dans un tel dénuement que la caméra semble quasi absente, bien qu’on sente une véritable proximité avec la famille Fiddler. Le long métrage fait rarement appel à de la musique extradiégétique, et ne contient ni voix off ni effets de styles.
On imagine bien tout ce que ce retour à la réserve porte comme charge (émotive, économique, etc.). Or, au-delà de la dimension autochtone, c’est plutôt par une réalité universelle que ce documentaire nous saisit : la fuite du temps. On observe les traces des années qui passent sur cette communauté, alors que les possibilités se rétrécissent et que le travail semble de plus en plus rare et éreintant. Les ellipses sont d’ailleurs vertigineuses, bouleversantes. On retient notamment ces deux scènes symétriques, où Delwin Fiddler Jr. parle avec son petit frère, qui disait plus tôt vouloir voyager, partir explorer le monde, et qui se présentait comme « un bon garçon ». Dans la scène subséquente, le visage du jeune homme a beaucoup vieilli et il semble avoir perdu presque tout espoir en l’avenir, ravagé par la dépendance. Le montage de Lindsay Utz est génial, alternant des images en accéléré qui accentuent le passage du temps et des arrêts sur images : une scène de chasse, une conversation, un enterrement.
Si l’on constate ici les injustices raciales et économiques qui sévissent dans les réserves autochtones, on retient surtout l’immense résilience de leurs habitants, leur sens de la famille et de la joie, cette joie rieuse qui célèbre à la fois la vie et la mort. Without Arrows sait manier ses flèches. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)

prod. Cine Aymara Studios
YANA-WARA
Óscar et Tito Catacora | Pérou | 2023 | 104 minutes
Feu Óscar Catacora nous livre une épitaphe sublime avec Yana-Wara, œuvre dure et magnifique à la fois, qui allie la beauté lumineuse des Andes péruviennes à la noirceur expressionniste de l’existence vécue par la jeune Aymara titulaire. Le réalisateur de Wiñaypacha (2018), décédé tragiquement d’une appendicite lors du tournage, a été remplacé par son oncle Tito (réalisateur de Pakucha, 2021) à la barre du film, qui n’exhibe néanmoins aucune couture, offrant au public un flot onirique envoutant axé sur les thèmes de la solitude et de l’innocence souillée. Une expérience particulièrement immersive au vu de la qualité sensorielle de la mise en scène et du grandiose de la photographie noir et blanc, qui nous amène subrepticement dans les retranchements folkloriques d’une communauté autochtone isolée et dans l’intimité d’une famille d’éleveurs maudite.
« Née pour souffrir », la protagoniste pré-adolescente du titre est morte d’entrée de jeu, tuée par son grand-père, qui raconte rétrospectivement son existence miséreuse, marquée par la poisse et les abus, aux leaders de la communauté chargés de son procès. Orpheline dès son jeune âge, après la mort en couches de sa mère et le décès soudain de son père, Yana-Mara est une enfante muette, cruellement esseulée, même après son adoption par son grand-père, Don Evaristo. Cette solitude s’exprime grâce à diverses techniques narratives, à commencer par le contraste visuel entre la petitesse des êtres et l’immensité des paysages environnants, mais aussi par la présence insubstantielle d’un hors-champ peuplé de joies inatteignables et d’horreurs rampantes. Parmi ces dernières se trouve son professeur, un étranger qu’on aperçoit initialement à moto, lorgnant la fillette dans son rétroviseur, qui la viole et la met enceinte, la catapultant dans un monde cauchemardesque d’angoisse, de douleur et de tentatives d’exorcisme terrifiantes.
Loin d’un mélodrame misérabiliste, Yana-Wara pourvoit aux spectateur·ice·s une expérience traumatique dans la tradition du cinéma d’horreur classique. Les plans rapprochés qui servent d’introduction à la plupart des séquences évoquent une mise en scène qui obéit à une logique affective plutôt qu’à la logique spatiale traditionnelle du cinéma hollywoodien, tandis que le travail sonore exquis qui accompagne les images imprègne ces plans d’une rare puissance sensorielle. L’utilisation expressionniste du montage et des éclairages nous coince dans la psyché meurtrie de la pauvre héroïne qui, après son viol et sa fausse-couche, se retrouve prisonnière d’un monde ténébreux, où son visage se détache de l’obscurité à la manière des figures torturées d’un certain cinéma allemand. La main et le poignard noircis de sang, le fœtus émacié, les viscères du cochon d’Inde, toutes ces visions dantesques participent d’une épouvante crue, à mi-chemin entre le prosaïsme des abus sexuels et l’excentricité des mythes entretenus par les compatriotes de la jeune fille. Tout cela culmine dans une séquence hallucinante d’exorcisme du démon Anchanchu, sous l’égide de Mère Nature, dont les humeurs sont en symbiose avec celles des personnages, conséquemment avec la vérité spirituelle aymara selon laquelle « tout est vivant ». (Olivier Thibodeau)

prod. Firefly Films / Caravan Carpark Films
UPROAR
Paul Middleditch et Hamish Bennett | Aotearoa (Nouvelle-Zélande) | 2023 | 110 minutes
Uproar a définitivement le cœur à la bonne place, même si le flot du récit n’est pas particulièrement organique, empilant un peu maladroitement les enjeux narratifs, les personnages accessoires et les scènes mélodramatiques obligées sur musique archi-appuyée. On se délecte néanmoins des bons sentiments qui dégoulinent de partout et de l’impressionnante distribution réunie pour l’occasion. Trônant au milieu de l’affiche, Julian Dennison (vedette de Hunt for the Wilderpeople [2016] et Deadpool 2 [2018]), avec derrière : James Rolleston (Boy, 2010), découvert également chez Taiki Waititi, Minnie Driver dans le rôle de la mère monoparentale éplorée et Rhys Darby, dans une composition dramatique à l’excentricité parfaitement mesurée. On compte aussi Erana James (We Were Dangerous, 2024), excellente dans la peau du personnage clé de l’activiste inspirante, qu’on écarte malheureusement à mi-chemin du récit.
Sur fond d’émeutes provoquées par la tournée de rugby des Springboks sud-africains dans la Nouvelle-Zélande de 1981 (en plein apartheid), on assiste ici au quotidien tumultueux du jeune Josh Waaka (Dennison), un adolescent au père maori qui peine à s’intégrer dans une école blanche élitiste où son frère Jamie (Rolleston) est entraîneur adjoint de rugby et où sa mère (Driver) travaille comme concierge. Conscientisé par son amie samoane Grace (Jada Fa’atui) et la charismatique militante Samantha (James), il apprendra à se tenir debout face au racisme ambiant et à son directeur tyrannique (Mark Mitchinson) tout en jonglant avec son rôle au sein de l’équipe de rugby de l’école et son désir de percer dans le monde des arts dramatiques, insufflé par son professeur (Darby).
Malgré l’enchevêtrement maladroit de ses (trop) nombreuses sous-trames, qui laisse beaucoup de personnages derrière, et certaines contradictions tonales et symboliques, entre l’aspect lumineux du film et la solennité de l’arrière-plan historique par exemple, ou entre sa critique de l’aliénation provoquée par le sport et la représentation cathartique de la victoire sportive, le film aborde de façon frontale plusieurs questions sociales pertinentes. Qu’il s’agisse de l’importance d’élargir le concept de collectivité au-delà de la famille nucléaire et de lutter contre toutes formes de racismes institutionnels, ou de la critique du sport organisé comme opium nationaliste et vecteur de pratiques hypocrites selon lesquelles les groupes minoritaires ne sont toujours valorisés que sur le terrain de jeu, le film soulève beaucoup d’interrogations urgentes. Et même si certains fils narratifs semblent plutôt ténus, même si le film se termine sur une finale très consensuelle, qui évacue certains éléments plus politiques du récit, force est d’apprécier son message antiraciste et communautariste, de même que le caractère inspirant de son conte initiatique, qui fait presque poindre une larme au coin de l’œil. (Olivier Thibodeau)
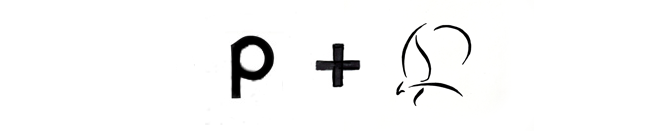
PARTIE 2
(The Land of Forgotten Songs,
Diógenes, Without Arrows,
Yana-Wara, Uproar)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
