
pord. Essential Filmproduktion GmbH
DAS MELANCHOLISCHE MÄDCHEN (AREN'T YOU HAPPY?)
Susanne Heinrich | Allemagne | 2019 | 80 minutes | Panorama international
Quand l’irrévérence déborde dans la prétention, quand l’esthétique se transfigure en publicité, cela doit donner un film aux allures de Das Melancholische Mädchen, « La fille mélancolique » (ou Aren’t You Happy? de son titre international), le premier long métrage de cette romancière allemande, jeune vedette littéraire (un premier roman primé à 20 ans) et féministe engagée (son film la célèbre)*.
On y découvre d’abord Marie Rathscheck, actrice charismatique qui joue la désinvolture avec beaucoup de talent comique, et qui occupe ici la place centrale, indélogeable, de la quinzaine de chapitres d’un film en pièces détachées. Les saynètes sympathiques qu’elle habite s’en prennent au masculinisme endormi des gentils garçons, aux dialogues creux des intellos trop sûrs d’eux, aux séances de yoga postnatal des yuppies, au machinisme sexuel des rencontres Tinder, à la désinvolture attirante des vieux restés si jeunes qu’on les découvre pathétiques, bref, à une série de stéréotypes sectaires auxquels les différents personnages se moulent sans la moindre résistance possible.
Das Melancholische Mädchen est un film bonbon au discours impitoyable (et donc pratiquement pitoyable), à l’esthétique léchée, immensément soignée, comme très peu de premiers films peuvent se vanter d’être des réussites plastiques aussi frappantes (à ce titre, le nom de la directrice de la photographie Ágnes Pákózdi est à retenir), parvenant à concevoir autant de dispositifs scéniques qu’il y a de chapitres. Le hic, c’est qu’au-delà de l’allure et du dire, le film de Heinrich refuse catégoriquement toute forme de vie sentimentale à ses personnages, à la pauvre fille mélancolique du titre en premier lieu, prenant le pari de livrer un film-objet qui utilise les codes publicitaires les plus éculés afin de critiquer la marchandisation du féminisme contemporain et les vanités liées aux discours de la libération sexuelle. Certes, Heinrich a souvent raison, certes, le progressisme niais qu’elle pourfend avec cynisme mérite quelques claques anarchistes, mais qu’il faille un tel encodage du réel et des émotions, émotions qui sont toutes prisonnières de la plasticité du film, rappelle que la déconstruction du cinéma narratif s’arrête aux limites des formes qu’il subtilise pour s’en échapper.
Autrement dit, les plus beaux moments de liberté que s’offre Heinrich ont souvent plus à voir avec le vidéoclip et l’exercice de style qu’avec un quelconque souffle cinématographique, tellement qu’on en vient à se demander de quelle réalité la cinéaste parle-t-elle, de quelle suffisance individualiste se fait elle la critique autoproclamée sinon celle qui a justement inspiré son film. Étonnement, on remarquera le nom de Philippe Bober au générique, important producteur européen au travail très, très sélectif (il produit Ruben Östlund, Gaspar Noé, Ulrich Seidl et Roy Andersson) et dont les productions partagent aussi cette esthétisation outrancière qui finit souvent par cannibaliser leur discours. Reste que, à l’instar de ces autres productions, Das Melancholische Mädchen est esthétiquement fascinant, bordé par des tons pastel à la douceur réconfortante, par un sens de la beauté et du style qui font de Susanne Heinrich une réalisatrice qu’il faudra talonner de près, le jour où elle se réconciliera avec la narration. (Mathieu Li-Goyette)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Semaine de la critique de Berlin 2019

prod. Ulrich Seidl Filmproduktion
DIE KINDER DER TOTEN
Kelly Copper et Pavol Liska | Autriche | 2019 | 90 minutes | Les nouveaux alchimistes
La subversion doit toujours ajuster sa violence à celle du climat social qu’elle souhaite secouer*. C’est, assez rapidement, ce que l’on saisit de Die Kinder der Toten, gagnant du prix FIPRESCI de la section Forum, qui s’évertue avec beaucoup de charme macabre et grotesque à croiser la tradition d’un cinéma muet pittoresque, fait de cartes postales et de communautés qui réagissent en chorale, à la réalité autrichienne d’aujourd’hui (à savoir que le FPÖ, parti d’extrême droite nationaliste, islamophobe, a passé à quelques maigres pourcentages d’être élu au pouvoir en 2017). Film muet tourné dans un super 8mm couleur qui lui confère une esthétique de film de famille, avec une bande sonore faite de bruitages grinçants et d’une musique de parade collectiviste, il sculpte dans les vieilles formes un calvaire (anti)raciste qui commence en Styrie, comté du sud-est du pays, où un groupe de migrants syriens se rendent dans un restaurant de cuisine styrienne traditionnelle en croyant qu’ils y trouveront un bon repas syrien. Au-delà du glissement langagier qui pourrait rebuter, les arrivants découvrent bien vite toute l’hostilité des locaux, habillés des costumes les plus stéréotypés qui soient (chapeaux à plumes, salopettes à pattes courtes, carreautés verts et robes blanches à dentelles).
S’enfonçant dans une réflexion brillante sur les racines provincialistes de la xénophobie, Die Kinder der Toten ponctue ses intertitres de la prose d’un narrateur d’un cynisme incurable, qui ausculte les visages des habitants autant que des migrants, soulignant la méchanceté systémique des uns (qui sont des brutes germaniques baveuses et ringardes) et la fragilité des autres (qui sont des poètes arabes armés de stylo Bic). Fonctionnant par rimes visuelles et culturelles, le film se complaît dans un didactisme qui frôle la grossièreté qu’on retrouve parfois dans les œuvres d’Ulrich Seidl, producteur de ce film et dont l’influence est ici omniprésente. Or les réalisateurs Kelly Copper et Pavol Liska, qui sont d’abord des artistes performatifs, metteurs en scène de la troupe américaine radicale The Nature Theater of Oklahoma, s’en sortent justement grâce à la distance instituée par cette voix, tout droit hérité du style d’Elfriede Jelinek (la grande autrice, entre autres, de La Pianiste), dont le roman Enfants des morts sert de base au film.
Comme il est coutume de le lire chez Jelinek, ce cynisme acide a la capacité dans Die Kinder der Toten d’élargir jusqu’à l’os les brèches psychosociales présentes d’emblée dans le tissu ordinaire qui y est examiné. Cette douleur, qui est d’abord moins celle des migrants, bouillonne plutôt dans le cœur des villageois qui s’enfoncent dans l’émoi provoqué par un tragique accident de voiture semant un cloaque vengeur au sein de la communauté. Tandis que cette dernière assiste impuissante à une projection illicite de films de famille projetés à la mémoire des disparus (programmés par la veuve d’un nazi qui les collectionnait), les spectateurs se débattent, se lèvent et cherchent à enlacer l’écran, voire s’exclament qu’eux aussi aimeraient mourir pour être à leur tour adulés au cinéma. C’est là, dans ce cinéma miteux baptisé Cinema 666 (le roman de Jelinek fait 666 pages), que l’écran s’ouvre et s’enflamme, que les morts du film en sortent, zombifiés, semant le chaos dans la communauté qui s’adapte peu à peu à ce cirque anarchique. Gifles à coups de poisson, empalements sur des broches de kebab, subversion du resto styrien en resto syrien, le film sombre dans une autodévoration mémorable, qui ne connaît malheureusement de limites que dans celles des formes cinématographiques qu’il parodie ; Die Kinder der Toten n’est pas un grand film muet, ni un grand film de genre, ni un grand film subversif, mais il a le mérite d’essayer d’être les trois à la fois, même s’il le fait en ridiculisant toutes les formes auxquelles il s’essaie. C’est dans cet épuisement formel qui fait feu de tout bois, particulièrement saillant dans cette scène au cinéma, que le film impose sa radicalité comme une attaque en règle contre la suffisance formelle du cinéma, pointant du même geste son insuffisance intrinsèque, ainsi que celle de ceux qui se contentent des images pour construire leur rapport au monde. (Mathieu Li-Goyette)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2019

prod. Coop99 Filmproduktion
LITTLE JOE
Jessica Hausner | Autriche/Royaume-Uni/Allemagne | 2019 | 105 minutes | Les incontournables
À deux moments durant Little Joe, deux personnages conversent, l’un à gauche, l’autre à droite du cadre, alors que la caméra s’avance mystérieusement vers l’avant jusqu’à faire disparaître la figure humaine, ainsi reléguée à l’hors-champ ; il ne reste à l’écran que l’énigme d’un mur vide. Sans doute ne s’agit-il pas de l’intention de Jessica Hausner, mais difficile de ne pas lire ce mouvement comme une déclaration d’indifférence envers ce qui est pourtant le sujet de son film, l’authenticité des émotions, la reconnaissance de l’humanité de l’autre. À partir d’une prémisse empruntée à Invasion of the Body Snatchers (une plante génétiquement modifiée, destinée à procurer du bonheur, transforme plutôt les humains en des créatures que leurs proches ne reconnaissent plus), le film d’Hausner brasse une foule de thèmes demeurant à peine esquissés : la définition du bonheur, les questions d’empathie, la responsabilité d’une scientifique envers les conséquences de ses actions, ou celle d’une mère envers son fils, l’importance de la reproduction dans la définition de ce que nous entendons par le vivant, les interrogations éthiques autour des manipulations génétiques, etc. Mais rien ne peut s’accrocher à la surface lisse et stérile du film, qui vide a priori toute humanité dans un récit portant sur la perte de l’humanité, et qui est censé, imaginons-nous, allégoriser l’état du monde actuel — qu’est-ce qui a été perdu, au juste, pour Hausner ? Comment le savoir si la caméra interroge les murs plutôt que les êtres humains, ou ce qu’il en reste ? Peut-être que je suis trop insensible aux murs, mais les questions que semblent poser le film — celles du moins que j’aurais eu envie de lui poser — n’ont trouvé comme seule réponse que mon ennui. (Sylvain Lavallée)

prod. Just Sayin' Films
MA NUDITE NE SERT A RIEN
Marina de Van | France | 2019 | 85 minutes | Temps Ø
Marina de Van est une cinéaste qui a changé ma vie, et en cela, j’aurai toujours envers elle une dette de sang*. D’ailleurs, je dois avouer qu’en personne, elle m’a semblé parfaitement égale à elle-même, d’un flegme, d’une froideur et d’un détachement rafraîchissants, sans faux enthousiasme et sans sourire factice, totalement dénuée de cet instinct de promoteur qui anime généralement les cinéastes lors de leurs passages en festival. De Van est une grande artiste, une artiste intègre et sous-estimée, pour qui mon amour a débuté il y a un peu plus de cinq ans, avec la découverte fortuite et fort tragique de son chef-d’œuvre d’horreur corporelle Dans ma peau (2002), un film qui a transformé jusqu’à ma topographie corporelle, et m’a inspiré à inscrire, dans ma propre peau, les traces de nos troubles communs. Et bien que je considère que Ma nudité ne sert à rien propose finalement une vision plus superficielle et littérale des enjeux abordés dans ce film mémorable (c.-à-d. le corps et ses insuffisances esthétiques, l’autoérotisme et le sentiment d’aliénation), ne serait-ce que dans leurs titres respectifs (la première traitant d’hypoderme, la seconde d’épiderme), il s’agit néanmoins ici d’une œuvre profondément cohérente, puisque profondément honnête et personnelle, premier panneau d’un triptyque biographique dont la suite est extrêmement prometteuse.
Tournant la caméra vers son quotidien prosaïque d’écrivaine recluse, et vers son corps, inutile au vu de son célibat prolongé, De Van dévoile tout, les moindres replis de sa peau, complètement dénudée pour une portion considérable du film, mais aussi la gamme des sentiments qui accaparent son esprit, rendus par une voix off d’une littérarité savoureuse, emblématique de ses incroyables talents romanesques. Face aux descriptions précises et évocatrices qu’elle fait de sa vie intérieure et de son environnement immédiat, on se demande parfois où réside l’intérêt des images, ce bien sûr, juste avant de réaliser que tout ici est une question de regard, des sentiments que nous inspire la vue de notre propre corps, de ses défauts et de ses splendeurs, mais aussi de sa mortalité, d’où le besoin d’en préserver le souvenir via le processus diégétique de consignation mémorielle. Processus dont la réalisatrice discute d’ailleurs dans l’évocation de la fascination qu’elle éprouve pour l’évolution de sa forme physique à l’écran, miroir déformant qu’elle scrute ici avec un flegme craquelé qui cache à peine son amertume. Car s’il s’agit ici d’un film sur la solitude, il s’agit aussi d’un film sur le passage inexorable du temps, et les meurtrissures que celui-ci laisse sur notre peau. Ces meurtrissures, de Van en fait même l’inventaire spécifique lors d’une courte séquence où j’aurais juré voir la cicatrice rectangulaire laissée par Esther à la fin de Dans ma peau. Est-ce là un fantasme qui accapare mon esprit enfiévré, ou s’agit-il plutôt d’un autre des habiles mélanges de fiction et de réalité dont elle parsème le film ? Dur à dire puisque ces deux entités font ici bon ménage, se pénétrant l’une l’autre comme l’imaginaire dans le quotidien de l’autrice. Et bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait, malgré l’égotisme du propos, du film égoïste prescrit par Germaine Dulac, ou par le regretté Jonas Mekas, Ma nudité ne sert à rien pourrait tout aussi bien l’être, ne serait que grâce à l’intégrité émotionnelle totale qui le caractérise. (Olivier Thibodeau)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival international du film de Rotterdam 2019
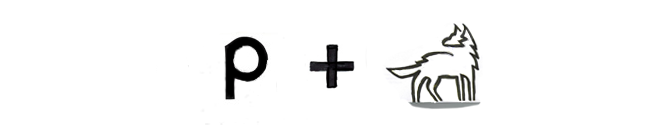
PARTIE 1
(Aren't You Happy?, Die Kinder Der Toten,
Little Joe, Ma nudité ne sert à rien)
Dieu existe, son nom est Petrunya
PARTIE 2
(Acid, Liberté, Serpentário, Soylent Green,
The Vast of Night, Wind Across the Everglades)
PARTIE 3
(Diner, 37 Seconds, Guest of Honour,
J'ai perdu mon corps, Videophobia)
PARTIE 4
(Ma nudité ne sert à rien, Bacurau,
Family Romance, LLC, , Monument, Parasite)
PARTIE 5
(A Hidden Life, Atlantique, The Halt,
Marriage Story, Raining in the Mountain,
Zombi Child)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
