
prod. The Conch
A BOY CALLED PIANO
Nina Nawalowalo | Fidji, Samoa, Aotearoa (Nouvelle-Zélande) | 2022 | 57 minutes
Basé sur la pièce autobiographique éponyme écrite par Fa’amoana Luafutu, A Boy Called Piano raconte avec une saine dose d’amertume le passé trouble de ce dramaturge et musicien d’origine samoane dans les institutions de réhabilitation juvénile de la Nouvelle-Zélande. Le film est surtout empreint d’une douceur salutaire, célébrant avec une joie de vivre infectieuse l’émancipation de son sujet, mais sans jamais perdre de vue les épreuves qu’il a vécues aux mains d’un système disciplinaire qui rappelle douloureusement les pensionnats canadiens. Il cultive à ce titre un art raffiné de la superposition visuelle, où le souvenir de l’horreur côtoie constamment diverses images de liberté (qu’il s’agisse de panoramas naturels ou d’instruments de musique), pourvoyant une constante échappatoire imaginaire à l’incarcération. Ce genre de superpositions permet également de cristalliser l’idée centrale d’innocence brisée, telle que démontrée dans la séquence d’ouverture, où un enfant immergé dans un liquide amniotique symbolique se retrouve simultanément emprisonné dans l’une des cellules d’isolement réservées aux pensionnaires indisciplinés des maisons de réhabilitation. Là où la candeur de l’enfance s’évapore et que lui succède une colère dévorante, dirigée contre une institution sociale pour qui le « care » est synonyme de châtiment. Luafutu nous propose d’ailleurs une perle de sagesse à ce sujet lorsqu’il déclare que « dans chaque homme endurci se trouve un bébé blessé »…
Bénéficiant d’une mise en scène astucieuse, qui déploie de façon créative le travail de recherche minutieux effectué en amont, le film offre à son sujet un large éventail expressif pour matérialiser son récit, incluant des images d’archives et des recréations dramatiques se déroulant dans les ruines de l’institution disciplinaire dont il nous fait éventuellement la visite commentée. Or, non seulement le retour sur les lieux de son incarcération permet-elle de substancier à nos yeux l’histoire de son calvaire (que les images de la commission royale d’enquête disséminées çà et là tendent plutôt à abstraire), mais il constitue aussi pour lui une forme d’exorcisme, un peu à la manière de celle d’un Joe Buffalo dans le court métrage éponyme qui nous avait été présenté l’an dernier au Festival. C’est aussi une façon pour la réalisatrice de garder la trace des exactions subies par les premiers peuples dans un effort généalogique plus large. En effet, par-delà la catharsis individuelle de l’intervenant titulaire, le film implique aussi deux de ses contemporains, Wheels et Piwi, qui nous livrent des témoignages frontaux particulièrement troublants à propos de leur tolérance aux abus et de leurs désirs suicidaires, provoqués par leur triste éducation. On nous présente finalement toute la lignée des Luafutu, des parents de Fa’amoana, évoqués en voix off, jusqu’à son fils, emprisonné lui aussi dans sa jeunesse, et son petit-fils, dont l’avenir semble plus lumineux grâce aux efforts déployés par ses aînés pour lui éviter le parcours tortueux réservé aux autochtones en terres conquises. C’est une histoire de résilience que Nawalowalo finit donc par cadrer, une histoire de survivance et de talent sauvé in extremis des mains d’un système qui privilégie toujours l’obéissance à l’expression de l’individualité et de la différence, jugées néfastes à la pérennité du statu quo…

prod. ONF
HEARTBEAT OF A NATION
Eric Janvier | Canada | 2022 | 21 minutes
C’était la deuxième fois que je croisais l’attachant Heartbeat of a Nation sur mon parcours festivalier (après son passage à Regard) ; il fallait bien que j’en fasse une critique ! Ce court métrage soigné d’Eric Janvier la mérite bien après tout, pour sa simplicité, sa concision et pour le travail de mémoire inestimable qu’il effectue en s’accrochant si déféremment au geste ancestral et en cadrant si généreusement les enseignements traditionnels des membres de la nation dénée (dans le nord de l’actuelle Alberta). Focalisant sur un cours de fabrication de tambour donné par un père à son fils dans une clairière paisible et ensoleillée, le film s’affaire à nous renseigner d’une manière à la fois didactique, sensuelle et culturelle sur chacune des étapes qui entre dans la confection de cet instrument sacré. De l’offrande de tabac à la rivière dans laquelle mouille la peau de caribou jusqu’au travail précautionneux de celle-ci autour du cadre en bois, son attache avec la babiche et son retentissement sous la baguette du papa et de son fils, nous apprenons tous les détails techniques qui entrent dans sa composition. Mais nous en apprenons bien plus encore, au fil de l’exposé d’un homme charmant qui, loin de simplement léguer des connaissances pratiques à son fils, le renseigne aussi sur les rites cérémoniels et les croyances mystiques de sa nation (évoquant le choix de peau optimal pour l’utilisation des tambours dans les huttes à sudation, par exemple, et la symbolique de l’étoile formée par les cordes transversales de l’instrument). C’est surtout l’occasion pour le réalisateur Janvier de mettre en scène l’importance de la transmission intergénérationnelle qui permettra à sa famille et à sa nation de prospérer, nous faisant simultanément cadeau de cet enseignement en favorisant la propagation interculturelle des fascinantes pratiques de son peuple.

prod. Ellen Gabriel
KANATENHS – WHEN THE PINE NEEDLES FALL
Ellen Gabriel | Québec | 2021 | 22 minutes
Après Alanis Obomsawin, avec son terrifiant et magistral Pluie de pierres à Whiskey Trench (2000) et Tracey Deer avec Beans (2020), son compte rendu fictionnel de ce sombre épisode de l’histoire locale, c’est désormais au tour de la réalisatrice mohawk Ellen Gabriel d’ajouter sa voix à la description des coulisses de la crise d’Oka de 1990. Elle livre pour l’occasion une œuvre ouvertement revendicatrice, visant à « se réapproprier le récit d’un génocide qui perdure depuis plus de 500 ans ». Pour ce faire, elle relativise l’image monolithique des warriors de Kanehsatà:ke disséminée par les grands médias de l’époque, rappelant notamment l’importance et le pacifisme des femmes impliquées dans les manifestations initiales, insistant en outre sur l’absurde mesquinerie des promoteurs immobiliers responsables du drame et sur le racisme systémique qui a permis à celui-ci de s’envenimer.
Au gré d’une production artisanale, aux images alternativement sublimes et banales, Gabriel parvient surtout à développer une subjectivité spécifiquement mohawk. Cadrant les membres de sa famille dans des adirondacks, elle s’abreuve à la source de leurs souvenirs, nous ramenant au tout premier jour du conflit, durant lequel des manifestantes pacifiques ont été gazées par l’escouade tactique. Privilégiant une perspective féminine, elle nous rappelle ainsi le rôle privilégié des femmes autochtones comme défenseuses de la terre, mais aussi comme victimes privilégiées d’un appareil de répression lâche et misogyne, vérités occultées auquel le Festival s’intéresse particulièrement cette année. Les plans sensuels et déférents sur la nature, particulièrement sur les pins titulaires, participent aussi de cette subjectivité, évoquant le rapport privilégié, mais évanescent de la nation mohawk à son territoire, érodé par le trauma intergénérationnel vécu lors de cet événement, issu lui-même du racisme intergénérationnel des Blancs (à qui l’on enseigne le mépris des peuples iroquoiens dès leur jeune âge).
Le film bénéficie en outre, dans ses efforts de subjectivation, d’un montage parfois raboteux, mais assez astucieux, capable de créer une sorte de simultanéité entre le présent et le passé, utilisant des séquences contemporaines pour illustrer les propos des intervenant·e·s et nous partager leurs impressions. Les nuages d’aujourd’hui tiennent ainsi lieu de gaz lacrymogène, les hélicoptères qui traversent le ciel rappellent la présence de l’armée canadienne, les plans subjectifs de corps dissimulés derrière les troncs d’arbre émulent le repli stratégique des corps mohawks de l’époque, au sein d’un processus métonymique à la fois économe et évocateur, symbolique de la pernicieuse persistance mémorielle des événements. Ce principe de simultanéité permet en outre aux documents d’archives de se profiler comme des vues de l’esprit des sujets, chez qui les images de foule en colère brûlant leurs compatriotes en effigie participent à ce jour d’un profond stigmate…

prod. Mídia India / Highly Flammable / Appian Way
WE ARE GUARDIANS
Chelsea Greene, Rob Grobman, Edivan Guajajara | États-Unis | 2023 | 82 minutes
C’est un triste état de fait que relate We Are Guardians, qui, en plus de nous mettre en garde contre les dangers de la déforestation amazonienne, s’intéresse aussi aux frictions entre les différentes victimes, économiques et idéologiques, du système capitaliste mondialisé qui sous-tend ce type d’exploitation. Plutôt que de bâtir une chambre d’écho, où l’on se concentrerait sur les revendications territoriales des autochtones du Brésil et sur les avertissements des climatologistes, le film laisse également la parole aux bûcherons illégaux et aux fermiers ambitieux dont les terres empiètent sur le poumon de la Terre. Or, c’est en privilégiant cette chorale de voix qu’il parvient à cerner la nature du problème, soit l’enfermement systématique des gens dans la logique économique actuelle. Les défenseur·euse·s de la forêt ont beau s’armer pour préserver ce qui reste de la végétation luxuriante où vivaient leurs ancêtres, les philanthropes ont beau acheter des parcelles de forêt pour en faire des lieux protégés, tous les rouages de la machine (politiciens corrompus, fermiers opportunistes et industries esclavagistes) leur seront toujours opposés. Il n’y a qu’à voir la séquence où les gardien·ne·s confrontent un groupe de pilleurs d’açaï miséreux, qui ne travaillent rien que pour nourrir leur famille, afin de comprendre l’impasse de l’univers social contemporain, où les pauvres sont forcés de se battre contre des pauvres pour leur survie.
De belle facture et d’excellente construction, avec un montage narratif qui rappelle alternativement le cinéma d’action et le document didactique, We Are Guardians est doté d’un souffle épique qui seul semble pouvoir prendre la mesure du cataclysme planétaire que représente le viol de l’Amazonie. Multipliant les séquences alarmantes, évocatrices des grands films catastrophes — cartes électroniques où l’on voit la déforestation progresser comme un virus ou séquences d’archives où se déploient de terrifiants brasiers — le film accuse un système parasitaire, mais sans jamais compromettre son humanisme. Même le montage astucieux qui sert d’introduction, où la quiétude enchanteresse de la forêt cède au bruit lancinant des tronçonneuses et où l’on assiste à l’abattage d’arbres centenaires, recèle une réalité beaucoup plus complexe que la simple opposition entre les forces traditionalistes et les zélotes du progrès. C’est le problème du nationalisme que le film met en exergue, à travers les images de Jair Bolsonaro et de ses partisans, présentés en parallèle des manifestant·e·s autochtones qu’ils considèrent comme des ennemi·e·s à la nation. C’est l’hypocrisie politique de la communauté internationale qu’il condamne, à l’occasion d’une triste séquence à la COP26 de Glasgow. C’est la pauvreté des travailleur·euse·s qu’il pointe du doigt, lors d’une série de séquences directes où, après avoir donné la parole aux groupes de défense autochtones, qui relatent l’assassinat systématique de leurs membres, la caméra partage le quotidien des bûcherons indigents qui travaillent à la solde des exploitants. D’ailleurs, c’est précisément face à l’humanité de toutes les personnes à l’écran (défenseur·euse·s comme pilleurs) que brille l’inhumanité de ceux qui n’y apparaissent que par logos interposés, les compagnies d’exploitation et les banques qui profitent de leur misère.
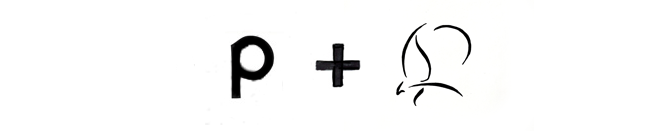
PARTIE 2
(A Boy Called Piano, Heartbeat of a Nation,
Kanatenhs - When The Pine Needles Fall,
We Are Guardians)
PARTIE 3
(Courts métrages Maoris - Programme #2,
Demon Mineral, Kawa,
Wochiigii Io End of the Peace)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
