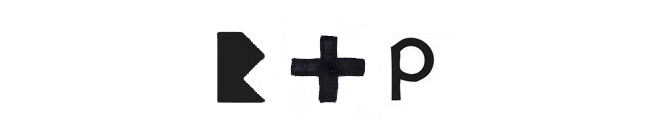à propos de
BROTHERS IN THE NIGHT
Un film de Patric Chiha (Autriche, 2016) de 88 minutes.
Présenté en Compétition internationale longs métrages.
(Julie Delporte)

GATEKEEPER
Yung Chang | É-U/Japon/Québec | 2016 | 39 minutes | Compétition nationale courts et moyens métrages
UZU
Gaspard Kuentz | Japon | 2015 | 27 minutes | Compétition internationale courts et moyens métrages
Le programme
Gatekeeper /
Uzu n’est certes pas novateur (on le reverra au festival IDFA d’Amsterdam la semaine prochaine), mais il n’est pas moins pertinent, proposant au spectateur une éclairante plongée dans la psyché japonaise, où les palanquins shintoïstes et les falaises acérées sont source d’un étrange fanatisme. Attaquant de front le problème endémique du suicide chez les Japonais,
Gatekeeper est un documentaire plutôt conventionnel, amalgame de têtes parlantes et de travellings mimétiques. S’ouvrant et se closant à la manière d’un roman, usant à cette fin d’un contraste graphique entre les flots gris de la côte fukuienne (symbole du désespoir suicidaire) et leurs lumineuses contreparties (ouverture optimiste sur l’avenir), le film suit la trace d’un ex-policier devenu protecteur des âmes perdues. Yukio Shige se rend au travail chaque matin comme des millions de ses compatriotes, mais plutôt que de s’y tuer à petit feu, il y œuvre plutôt au salut de ses pairs, s’éreintant à exorciser les désirs suicidaires des cœurs troublés venus visiter les falaises Tojinbo. Arpentant chaque jour les alentours de ce promontoire basaltique avec ses jumelles, il identifie et intercepte les plongeurs potentiels, s’érigeant comme un idéaliste excentrique face à la masse de touristes indifférents venus mitrailler l’endroit du clic des diaphragmes. Profitant de la candeur inouïe de ses intervenants dans leur évocation du suicide, accompagnés dans leurs révélations héroïques par une subtile bande sonore instrumentale, Yung Chang nous rappelle ici tout l’humanisme et la solennité de son fabuleux
Up the Yangtze (2007), récit jumeau d’une eau happeuse des pauvres âmes asiatiques. Sis à l’autre bout du spectre cinématographique,
Uzu est un film autrement plus accompli et évocateur que le précédent. Fruit d’un impeccable travail de mise en scène et de montage (gracieuseté du même Gaspard Kuentz), celui-ci nous plonge au cœur d’un rituel absolument fascinant, mais totalement incompréhensible à nos yeux. Voilà pourquoi l’apport du regard étranger ici porté sur le phénomène, celui des combats de palanquins au festival d’automne de Dogo, est si indispensable à son affect en milieu occidental. Montrant l’entraînement spartiate, et le dévouement fanatique des participants pour une cause désespérément élusive, l’œuvre nous garde en haleine jusqu’à la dernière scène, où l’objet enfin dévoilé de leurs passions se meut en fascinant spectacle cinématographique, orgie d’étranges contre-plongées et de plans de foules sursaturés montés tambour battant. Structurant son film à la manière d’un thriller, intensifiant sans cesse le suspense par accumulation d’indices flous issus de plans serrés sur les activités fébriles, mais mystérieuses des participants, réservant son seul plan d’ensemble pour la révélation finale de leurs desseins, Kuentz parvient ici à nous hypnotiser complètement. Dans la plus pure tradition soviétique, il nous présente en effet une réalité fragmentée, scrupuleusement agencée pour mieux garantir son pouvoir de suggestion, culminant à la manière d’
Alexandre Nevski (1938) par le portrait d’une guerre tonitruante et musicale à la fois, évocation savante de la passion indélogeable des hommes pour les violentes confrontations martiales. Un film absolument savoureux.
(Olivier Thibodeau)
 THE GREAT THEATER
THE GREAT THEATER
Slawomir Batyra | Pologne | 2016 | 30 minutes | Compétition internationale courts et moyens métrages
Des ouvriers qui graissent des pistons, des machinistes qui tendent des cordes, des menuisiers qui découpent des planches, des ébénistes qui poncent des surfaces, des peintres qui enduisent des murs, des dessinateurs qui enjolivent des toiles, des électriciens qui actionnent des leviers, des soudeurs qui assemblent des tringles, des affûteurs qui aiguisent des armes, des cordonniers qui collent des semelles, des couturières qui taillent des vêtements, des blanchisseurs qui étuvent des draps, des balayeurs qui aspirent des tapis, des cireurs qui lustrent des parquets… on se croirait à l’usine et pourtant, nous sommes au théâtre. Tout ce beau monde, humble et dévoué, est mis au service de l’illusion que vivront, pantois ou ennuyés, les bourgeois qui rempliront le théâtre de Varsovie. Batyra lève le rideau sur les coulisses qui constituent la scène sur laquelle chacun jouera, attentif et consciencieux, son rôle pour que l’illusion puisse prendre corps et la catharsis les purger. La caméra, toujours discrète, que l’on croirait parfois même cachée, prélève opiniâtrement, à l’aide d’une petite profondeur de champ, des milliers de gestes concis et répétitifs qui permettront aux plus grands interprètes, jouant les plus grands textes, de récolter les applaudissements. Amusé par son sujet, le réalisateur semble même poursuivre, côté cour comme côté jardin, la grande illusion. Filmant ingénieusement tous ces travailleurs de l’ombre qui se déplacent silencieusement derrière pendant que s’égosillent, sous les feux, les acteurs, il s’évertue à nous confondre. Observant avec admiration tous ces artisans, nous nous demandons par moment si ce sont eux qui bougent ou le décor qui se meut. Sont-ce les murs qui montent ou l’ascenseur qui descend ? Sont-ce les rideaux qui baissent ou la passerelle qui s’élève ? Ce drap que nous croyions pendu et sur lequel marchent soudainement les graphistes était plutôt couché au sol et non suspendu au plafond. Ces innombrables lieux, sombres et aseptisés, permettent paradoxalement d’illuminer et de donner vie au spectacle. Le documentaire pratiquement silencieux de Slawomir Batyra – qui nous donne accès à ce monde grouillant en silence sous les planches pendant que, sur elles, ne cessent de parler ceux à qui il ne donnera pas la parole – nous invite à faire de l’aphorisme de Shakespeare – «
All the world’s a stage! » – une éloquente antimétabole : «
All the stage’s a world! »
(Jean-Marc Limoges)
 SPEAKING IS DIFFICULT
SPEAKING IS DIFFICULT
AJ Schnack | États-Unis | 2016 | 14 minutes | Compétition internationale courts et moyens métrages
LONG STORY SHORT
Natalie Bookchin | États-Unis | 2016 | 45 minutes | Compétition internationale courts et moyens métrages
Du Japon (voir
Gatekeeper /
Uzu), on passe ici aux États-Unis, où les caméras de AJ Schnack et Natalie Bookchin s’efforcent de décrire une société autrement sclérosée, paradoxale surtout, dans son exaltation simultanée de la sécurité et du port d’arme, de la prospérité et du laissez-faire étatique. On le sait bien, ce sont les cow-boys et les «
angry white men » qui ont tout gagné le 8 novembre dernier, or il n’aura jamais semblé plus pertinent de parler des turpitudes intestines chez nos voisins du sud. S’affairant à la tâche, Schnack nous offre ainsi un court pamphlet intitulé
Speaking is Difficult, œuvre simple et concise qui ne prend aucun détour pour arriver à son humble objectif. Juxtaposant des poignées de plans fixes des différents lieux de massacres perpétrés sur le territoire étasunien depuis 2011 et des extraits
ad hoc d’appels d’urgence et de communications policières, l’auteur prend surtout soin de nous rappeler les chiffres correspondant à chacune des tragédies. Il réduit ainsi les victimes des tireurs à de simples statistiques, et à quelques couronnes de roses disséminées çà et là, démontrant d’une façon froide et lucide le processus de déshumanisation inhérent à la pensée guerrière, à la logique malsaine du laiton et de la poudre. Mais dans ce processus de déshumanisation bilatérale, rien de plus effroyable que les voix désincarnées de victimes paniquées, prisonnières de lieux mesquinement assiégés, implorant des sauveurs qui courront toujours moins vite que les balles... Quoique moins morbide,
Long Story Short s’intéresse quant à lui à un problème social encore plus pernicieux, mais beaucoup moins publicisé, celui de la pauvreté crasse des classes pauvres de la Californie, prisonnières d’une utopique « terre d’abondance » où ils font figure d’indésirables. Structurellement conceptuel, le film multiplie les
split screens pour mieux créer une mosaïque de visages, panorama des nombreux orphelins de l’État doré venus conter leur drame quotidien à la caméra. Cette technique de mise en scène est particulièrement pertinente puisqu’elle permet non seulement de faire dialoguer les nombreuses têtes parlantes ici présentes, impliquées dans une discussion essentielle sur la réalité de l’itinérance, mais aussi de les faire communier. En provoquant l’écho démultiplié de leurs voix, qui scandent à l’unisson les mots «
hungry » (affamé), «
liquor store on every corner » (débit de boisson à chaque coin de rue) et «
shoot us for no reason » (nous tirer dessus sans aucune raison), Bookchin nous rappelle sans cesse la généralisation du phénomène de la pauvreté. Et bien que ce soit finalement le fascinant contenu des différentes entrevues ici menées qui accapare notre attention, c’est l’incroyable travail de montage effectué par l’auteur qui mérite nos plus chaleureuses louanges, vecteur d’un percutant humanisme qui parvient héroïquement à restituer les voix trop nombreuses des êtres invisibles tapis dans l’ombre des manoirs hollywoodiens.
(Olivier Thibodeau)
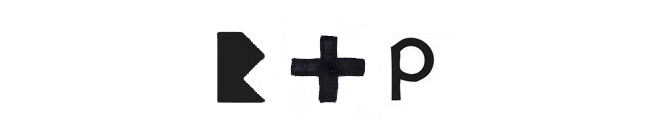
PRÉSENTATION
OUVERTURE : FUOCCOAMARE : PAR-DELÀ LAMPEDUSA
JOUR 1
(David Lynch: The Art of Life, Ta'ang)
JOUR 2
(Angry Inuk, Hier à Nyassan, Kate Plays Christine, Il Solengo)
JOUR 3
(Aim for the Roses, Fuocoammare : par-delà Lampedusa,
Dark Night, S.E.N.S., We Can't Make the Same Mistake Twice)
JOUR 4
(The Botanist, Brothers in the Night,
Manuel de libération, Territoire perdu)
JOUR 5
(Austerlitz, Combat au bout de la nuit, He Who Eats Children
Quebec My Country Mon Pays, Les tourmentes)
JOUR 6
(Brothers in the Night, Gatekeeper, The Great Theater,
Long Story Short, Speaking is Difficult, Uzu,)
JOUR 7
(A Train Arrives at the Station, Andrew Keegan déménage,
Animals Under Aneasthesia, Dialogue(s), Gulistan, terre de roses,
Isabella Morra, Manuel de libération, Non-contractual)
JOUR 8
(Calabria, Le goût d'un pays)
JOUR 9
(Le concours, The Dreamed Ones, Swagger)