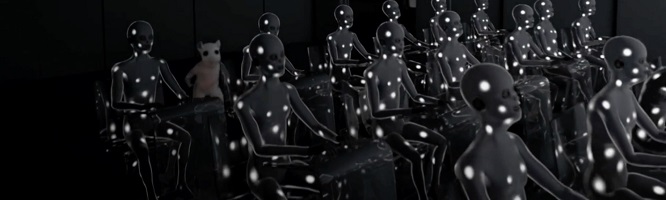Partie 1 |
Partie 2

Compétition internationale de films très courts
Si le premier et le dernier film de cette soirée d’ouverture –
L’empire des sens en une minute animée et
Short cuts - 2001, L’odyssée de l’espace – résumaient efficacement, chacun à sa façon, deux grands classiques du cinéma (pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?), d’autres proposaient, en revanche, des histoires originales qui nous convainquaient comment, en moins de deux minutes, il était possible de bien ficeler un récit :
Le Ramoneur (sortant d’un nuage de suie, un brigand, un père noël et un génie offrent chacun un souhait au besogneux personnage),
A Single Rose Can Be My Garden... A Single Friend, My World (l’amitié doucereuse entre un personnage esseulé et un canard envahissant est menée à son point de non-retour),
Mars 3752 (un voyage dans l’espace vu par les yeux d’un enfant qui tombe nez à nez avec une bibitte tentaculaire),
Tekkol (un sympathique basset, voulant aider des poussins à traverser un cours d’eau, devient prisonnier d’un chat qui profite de sa posture pour faire payer tous les animaux qui veulent lui passer sur le corps). Trois de ces films « narratifs » se terminaient par des renversements nous permettant de nous rendre étrangers à notre propre monde :
I am so tired (… et si c’était les moutons qui, pour s’endormir, comptaient les humains),
Infestation (… et si c’était les insectes qui, plus grands que nous, pouvaient nous écraser) et
Vivir (qui, après nous avoir montré un personnage rudimentaire peiner sur son tremplin, nous dévoilait l’atelier de l’artiste et révélait ainsi l’artifice dont nous avions été dupes).
Par contre,
Stems — un de nos coups de cœur de cette compétition — relevait le pari inverse : nous présentant d’abord l’atelier de l’artiste, il nous permettait de voir comment celui-ci confectionnait son monde, à partir notamment d’objets recyclés, tout en réussissant à nous en faire oublier la facticité. Expliquant, en voix off, de quelle façon il grappille ici et là divers objets « ayant eu une première vie » afin de leur en donner une seconde, il entreprend de sculpter sous nos yeux des figurines qui prennent peu à peu vie grâce à la magie du
stop motion et qui parviennent même à jouer, à mesure que le groupe augmente, une pièce musicale diablement rythmée et entraînante. Ces êtres animés sont si moches… et pourtant si attachants. À la fin, on s’attriste même de les voir perdre soudainement la vie que l’artiste venait tout juste de leur insuffler et cesser, pour de bon, de se dandiner. La grande force de ce court métrage : révéler ses trucages et les ficelles tout en réussissant à nous émouvoir.
 :: Stems
:: Stems (Ainslie Henderson, 2015)
Certains films reléguaient cependant le récit au second plan afin de nous offrir de véritables poèmes visuels. L’animation, parfois abstraite, parfois figurative, donnait souvent corps à une trame musicale traversant l’ensemble :
Net (une entrée dans l’univers informatique à partir de l’indicatif de Windows),
Rivage (une exploration de la faune et de la flore aquatique),
Personal Growth (une espèce de saucisse jaune sur fond rose croit et croît au son des synthétiseurs),
Tête-Mêle (des traits blancs sur fond noir donnent corps à quelques segments phatiques anglo-saxons),
Somewhere in Between (deux femmes et des formes),
Tour (un ensemble de taches « à la Borduas » dont se détachent des cyclistes coursant dans un vélodrome),
Walking the Cow (un sympathique vidéoclip en
stop motion donnant vie aux délires de Daniel Johnston),
Jazz Orgie (un endiablé Django Reinhardt sur des formes « à la Kadinsky ») de même que
Aftermath et
The Junebugs (adaptés de poèmes). Mais ce sera
Fatigue, une vivifiante animation 3D dont les formes électriques ou émoussées sortaient de l’écran, qui nous aura le plus séduit.
D’autres films exploraient quant à eux des thématiques — tantôt du corps, tantôt de l’espace. D’un côté,
Euphoria nous apprenait que tout pouvait se vendre à la télé, même l’espace,
It’s All Connected nous apprenait, par la bouche d’un enfant allumette, que « tout était connecté » et
I Need My Space nous apprenait que, même dans l’espace, l’aliénation nous guettait. De l’autre,
Ninfa nous montrait s’esbaudir deux corps glacés qui juraient avec l’érotisme latent,
Adam, tout de glaise raconté, modelait à sa façon le récit de la Genèse et
Kosmos nous offrait un sublime dérapage nous faisant passer d’une goutte d’eau humaine à des dildos dans l’espace.
Plutôt que récits, plutôt que poèmes, plutôt qu’explorations thématiques, certains courts-métrages se voulaient surtout des explorations formelles :
1960 :: Movie :: Still recyclait, en peu à la façon des sérigraphies d’Andy Warhol, une image de Monica Vitti,
RotoJam : Winter Edition enveloppait avec fluidité un même solo de danse par des esthétiques les plus diverses,
Let’s Play Like It’s 1949 complétait à la craie des images télévisuelles des années 1940 et
Saigo nous offrait une combinaison de
stop motion et de lumière filmée en longue exposition.
Enfin, quelques courts-métrages jetaient un regard oblique et amusé sur la vie. Sur des dessins épurés se détachant d’un fond blanc,
La dernière minute offrait une leçon de jean-foutisme temporel aux grands stressés de ce monde tandis que
Poupons, en ajoutant des gloussements de bébés sur des personnages rudimentaires suintant dans une salle de musculation, mettait le doigt sur le besoin d’attention dont nous sommes tous mus.
Vous avez deux minutes ?
(Jean-Marc Limoges)
 SAMT (silence)
SAMT (silence)
Chadi Aoun | 2016 | Liban | 15 minutes | Compétition internationale 1
Évoquant le caractère combatif des personnages la bande dessinée
Habibi de Craig Thompson ainsi que leur récit,
SAMT (Silence) dresse avec brio et tact le portrait d’une société sclérosée, figée dans un silence imposé où toute forme d’expression, quelle qu’elle soit, est contrecarrée par le retranchement de la vie prenant la forme d’une exécution publique hâtive — pareille aux pelotons d’exécution en temps de guerre. Aux mains d’une armée sans visage dont l’apparence emmitouflée ne laisse apercevoir aucun bout de peau, la cité de Ghabra aux allures grisâtres et cafardeuses dénuée de la lumière du soleil, est sur le point de s’écrouler sous le poids de son inhumanité et de sa déchéance. Les bâtiments en ruines réverbèrent le délabrement latent, les antennes qui jonchent les toits ne sont maintenues que par un fil, les panneaux de propagande louent les prouesses d’un monde meilleur qui ne peut éclore.
Le personnage principal, un jeune homme (le réalisateur lui-même ?) cherche à s’extraire de ce monde étouffant et aliénant tout en refusant d’abdiquer. Déprimé, cerné, il reste à l’affût du moindre signal, appel qui lui allouerait une échappée vers la liberté et lui rétrocéderait la volonté de vivre. Au cours d’une nuit, il fait la rencontre fortuite d’un autre homme qui l’invite à danser avec lui et à partager quelques instants magiques au cours desquels les barrières tombent tout comme le masque blanc dont le port leur est imposé, révélant les traits du visage, les couleurs des apparats et du ciel, la légèreté et la volubilité des mouvements du corps. Lors de la seconde rencontre, les amis de l’inconnu exécutent des chorégraphies au clair de lune, le comblant d’un bonheur inattendu et suscitant chez lui l’envie d’appartenir à cette faction qui n’a pas froid aux yeux et qui questionne l’ordre établi par le biais de l’art tout en s’exposant aux dangers de la répression. Si ces âmes courageuses tentent de se faire entendre malgré la répression annihilante, elles ne sont que les balbutiements d’un renversement de pouvoir au profit du peuple. Chad Aoun traite ici du statu quo réprobateur et destructeur imposé par les gouvernements arabes cloisonnant la liberté d’expression dans une société dysfonctionnelle qui n’attend que son sauvetage par le peuple — comme lors du Printemps arabe —, détenteur du pouvoir d’action et décisionnaire d’un futur différent.
(Claire-Amélie Martinant)
 :: The Phone Card
:: The Phone Card (Brenda Lopez, 2016)
Si, dans la soirée
Panorama étudiant Québec, on met de côté les animations aqueuses dans lesquelles nageaient d’innombrables poissons –
Drifted,
Last summer, in the garden,
No Boundaries,
Un été sur le Lac Ouareau –, les petits films noyés de bons sentiments –
Ton anniversaire,
Obsolescence,
Seen Through the Eyes of Children, Serio, The Star Inside –, les métamorphoses psychédéliques – Mongoose, Temporary Comfort, Shapeshifter – et les récits primaires dessinés à gros traits – Good Book, Hey Mom –, quelques films sortaient du lot. D’abord, Ceci n’est pas une animation qui ouvrait le bal et Animation (According to Children) qui le fermait, offraient tous deux d’amusants retours réflexifs. Le premier personnifiait, dans des esthétiques et des moyens de reproduction différents, quatre outrecuidants animateurs rabâchant, dans des plans peu inventifs, leur désir de réaliser un film sublime, tandis que le second donnait littéralement forme aux propos d’enfants qui tentaient de définir ce qu’était, pour eux, l’animation. Ensuite, trois films se sont démarqués par leur esthétique franche, leur sens de la narration et leur montage maîtrisé. Récit autobiographique sans prétention, The Phone Card racontait l’arrivée d’une jeune mexicaine de 11 ans à Montréal, pendant l’hiver, sa peur paranoïaque des étrangers et son comique choc linguistique ; puisque, pour la fillette, les Québécois caquettent, tous les personnages de son univers adoptaient le profil du canard – rien de plus simple, ni de plus efficace. Bien plus qu’une élémentaire juxtaposition d’images en noir et blanc au trait vif et précis – goutte d’eau, ligne à pêche, radar, horloge, briquet, mécanisme, pistons, quille, ballon, cuvette, guitare, machine distributrice, immeubles qui s’effondrent, revolver, piles, chronomètre, instrument d’optique, œuf, poêle, balle et batte de baseball –, Genesis était une audacieuse course contre la montre qui nous laissait, notamment grâce à la puissance croissante de sa trame musicale, à bout de souffle. Le désopilant The Commute ! mettait en images le calvaire quotidien que vit l’usager des transports en commun : gens à l’hygiène douteuse dont on s’éloigne illico, bébés qui hurlent et qui vous arrachent littéralement le cœur, chats qui miaulent et que l’on dévore (littéralement aussi) à pleine croquée, gens qui pissent par les oreilles, poteaux qui tombent et vous scient en deux, etc. Cette anarchie ordinaire, dessinée à traits fins, rigoureusement cadencée, poussant chaque situation à l’absurde, n’en jetait pas moins un démoralisant regard sur notre monde… tout en lui permettant de rire aux éclats. (Jean-Marc Limoges)
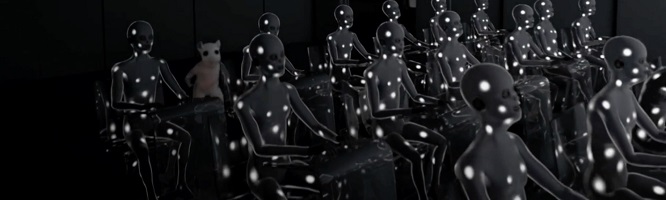
:: Time Rodent (Ondrej Svadlena, 2016)
Le Programme 1 de la Compétition internationale se présentait comme un pot-pourri de courts-métrages aux thématiques, aux esthétiques et aux tonalités toutes plus différentes les unes que les autres. Si certains se voulaient sérieusement engagés – SAMT (qui peint une intraitable police de l’ordre en noir et blanc, entretenant sans doute quelque lien de parenté avec Big Brother, laquelle conduit à la peine de mort tous ceux qui osent danser… en couleur) ou Beast! (qui dresse un portrait peu flatteur d’une société encageant et malmenant autant les clochards que les bêtes venues de l’espace) –, d’autres n’avaient pour prétention que d’amuser – Un plan d’enfer (qui raconte l’histoire haute en couleur de deux brigands drôlement balourds s’empêtrant dans un cambriolage se terminant un peu… en queue de poisson), We Drink too Much (deux pigeons qui s’aimaient d’amour tendre, règlent leurs comptes et concluent, dans une surprenante et abrupte finale, qu’ils boivent trop) – sans toutefois exclure la critique sociale comme dans Vocabulary 1 (qui, à partir d’un naïf livre pour enfants, juxtapose des images sans liens aucun, afin de révéler la morbide jalousie qu’entretient une libellule à l’égard de son serpent de voisin) ou Golden Egg (qui nous montre un couple, enfermé dans les vignettes d’une bande dessinée, adoptant un petit poussin qu’il tente, poussé par la cupidité, de booster aux stéroïdes afin de le transformer en poule aux œufs d’or). Enfin, pendant que divers films exploraient le passé — I Am Here (un clodo refait, pour les clients d’un fast-food, l’histoire de l’univers) — ou le présent — Simulacra (qui tente une illustration des thèses de Baudrillard) — d’autres nous peignaient, comme le captivant Time Rodent, un avenir complètement hallucinatoire.
Ce dernier film fut sans aucun doute le moment fort de ce programme. Premier plan : une rue piquée de lampadaires et, à droite, bordée de maisons modestes et de voitures sans prétention. Un homme promène son chien. Des éboueurs collectent les poubelles. Timelapse. Secousses cataclysmiques. Tout s’écroule et se noircit. Un mutant — sorte d’engageant rat translucide — apparaît dans un halo de lumière, comme s’il arrivait d’ailleurs, armé d’un simple caméscope. Il entreprend, avec une débonnaire curiosité, de visiter ce monde post-apocalyptique qui s’écroule sous ses pas. L’univers qu’il filme alors — et que nous découvrons avec lui — s’avère le fruit d’une imagination extraordinairement débordante. Tout est noir. Atrocement noir. Bienvenue à Light City ! Et tout est sens dessus dessous. Il entre sans frapper dans les appartements aseptisés et baignés de lumière artificielle où il surprend des gens — sorte de personnages filiformes vêtus d’habits en latex blanc — qui le regardent horrifiés (pour autant qu’on puisse lire des expressions sur leur visage livide). Il leur pique de la bouffe (un cube de gélatine rose), sort prestement, parcourt les stationnements fétides, rentre de nouveau dans un appartement, observe, intrigué, un poupon jouant avec des boules de lumière, lui en pique une, sort derechef. Il entre ensuite dans ce qui a tout l’air d’une salle de classe où des dizaines d’étudiants, dont les corps sont ponctués de petites boules lumineuses, suivent passivement, sur un écran géant, ce qui semble être un cours de biologie. Si on arrive nous même à suivre — à travers les zooms intempestifs et les mouvements gauches du caméscope (à travers lequel on assiste à ce moment) —, il nous faudrait comprendre que ces androgynes sont vêtus d’une enveloppe corporelle qui peut être retirée d’un seul coup afin de produire les fameux cubes de gélatine rose (on se croirait dans Soylent Green) et que les boules lumineuses qui logent dans leurs perforations revêtent une valeur monétaire. Joignant ensuite l’exemple à l’explication, le réalisateur nous montre ces curieux personnages se faire succionner l’enveloppe et déboulonner les lumières (qu’ils conservent ensuite précieusement dans un pot transparent) devant un auditoire qui applaudit chaque fois à tout rompre, pour des raisons qui nous échappent toutefois. Le mutant quitte ce lieu. Le jour est toujours noir, sale, sombre. Des rats dévorent avidement un liquide rosâtre qui s’échappe des buildings lumineux par une glauque tuyauterie. Il pénètre dans ce qui semble maintenant être une usine. Là aussi, les androgynes se font succionner l’enveloppe et retirer les boules, sans recueillir d’applaudissements ni repartir avec un pot ; ils doivent se pencher et ramasser ce qui est tombé par terre. Après avoir visité l’intelligentsia bien traitée, serions-nous avec les vulgaires ouvriers maltraités ? Plus ça change… Qu’importe ! Les enveloppes servent, là aussi, à faire des cubes de gélatine rose dont on se nourrira. Puis, ce monde s’écroule (de nouveau). Nous sommes dans le post-post-apocalyptique. Les androgynes se font toujours succionner l’enveloppe et retirer les boules, mais cette fois, les lumières sont conservées dans des capsules, et leurs corps exsangues sont livrés aux rats. Poursuivant sa course, notre mutant découvre une fourmilière géante dans laquelle ces androgynes s’amalgament (plutôt que s’accouplent) afin de former des corps tentaculaires (on se croirait dans The Human Centipede) qui combattent pour ces sphères de lumière. Ce monde s’effondre de nouveau. La finale, sympathique sans être trop éculée, nous montre la famille du mutant venant le rejoindre et à laquelle il dévoile la petite vidéo qu’il leur a concoctée. L’idée brillante de ce court-métrage : un personnage énigmatique venant d’un monde énigmatique tâchant de comprendre les personnages énigmatiques d’un monde énigmatique. (Jean-Marc Limoges)

:: Le fil d'Ariane (Claude Luyet, 2016)
Le Programme 2 de la Compétition internationale nous offrait, quant à lui, des histoires intimistes – Le fil d’Ariane (l’Histoire vue à travers l’histoire d’Ariane, depuis le balcon où elle suspend son linge), Plein été (l’éveil érotique d’un jeune adolescent pour sa maman), J’aime les filles (quatre jeunes lesbiennes, en voix off, racontent avec humour leur première expérience) et Parle-moi (un ex-couple se retrouve et passe une nuit à baiser sauvagement) –, des récits expérimentaux – Neck and Neck (un récit inspiré d’Othello de Shakespeare), La bêtise (un récit inspiré des Désastres de la guerre de Goya), AM/FM (un récit inspiré par la syntonisation d’une radio) et Wednesday With Goddard (un récit tout simplement inspirant) – et des légendes folkloriques – Tres moscas a medida (mettant en scène une sorcière de Lituanie), Among The Black Waves (mettant en scène un chasseur de Russie) et Silmadeta jahimees (mettant en scène une sorcière et un chasseur d’Estonie).
Le fil d’Ariane— petit coup de cœur de la soirée — commence sur le gros plan d’une sonnette (qui a tous les airs d’un mamelon). Un homme, de dos, sonne, des fleurs à la main. Les bruits hors champ — que le court métrage exploitera joliment, tout comme les gros plans d’ailleurs — nous permettent de croire que nous nous situons dans un bloc à plusieurs appartements. Dans l’un d’eux naît Ariane, que nous verrons grandir, grandir encore, s’épanouir, se marier, avoir des enfants, vieillir un peu, se courber, se courber beaucoup, puis mourir. On entendra prononcer son nom, ponctuellement, depuis la pièce de la maison où nous n’entrerons jamais, sur des tonalités différentes, selon les étapes de la vie que traverse, elle aussi, sa mère (qui passe son temps à coudre sur une machine dont on entend le ronronnement) ou les humeurs de l’homme qui deviendra, quand celle-là calanchera, son mari (qu’on entend parfois gueuler devant un match de foot). Le touchant personnage, aux traits épais, aux couleurs franches et à la texture pigmentée, très souvent cadré de face, en plan pied, se découpe sur des décors plus sobres et réalistes, qui pourraient bien représenter une petite ville de Suisse. Le brio de ce film, c’est de nous montrer Ariane effectuant sans cesse et recommençant jour après jour (comme son cousin Sisyphe) la même besogne — étendre le linge sur la corde (sur son fil) — tout en nous faisant comprendre le temps qui passe par des fondus sur un ciel nuageux et des indices essentiellement vestimentaires : gaine et bas de nylon (années 1930), veste et caleçons militaires (années 1940), pantalon de toile et chemise blanche (années 1950) — sans parler de la robe de mariée et des bavoirs de bébé —, jeans et t-shirt psychédélique (années 1960), minijupe et collants roses (années 1970)… Il nous montre aussi, sporadiquement, la ville qui se métamorphose sous son nez et, accessoirement, une plante qu’elle arrose et qui croît de la belle façon. Aussi, on se demande s’il était nécessaire d’insister sur des événements historiques marquants et « signalétiques » — la Seconde Guerre mondiale, le premier voyage sur la lune — pour nous faire comprendre l’époque à laquelle nous nous situions, ou de recourir à des symboles un peu appuyés — une cigogne, un corbeau — pour signifier la naissance et la mort. Qu’importe, si Ariane est née avec un ballon rouge dans les mains, elle mourra avec un ballon vert sur le ventre. À la fin, nous revoyons l’homme aux fleurs (le même ?) sonner… en vain. Ainsi fut la vie d’Ariane dont le fil fut bêtement coupé.

:: Wednesday with Goddard (Nicolas Ménard, 2016)
Wednesday With Goddard — notre second coup de cœur de la soirée, mais différent en tous points du premier — s’ouvre, dans un ratio 4:3 très carré, sur des cartons pastel et des images pastorales crayonnées au plomb (montagne, fleur, oiseau). Dans cet univers bucolique et lénifiant se découpe soudain une esthétique plus sommaire et colorée qui jurera avec le ton établi. Un personnage tout de rouge vêtu, au corps fortement géométrique et aux membres disproportionnés, profite de la pluie pour sortir, monter sur le toit de sa maison angulaire et avouer d’une voix feutrée que tout cela lui fait croire en Dieu, tout en s’empressant d’ajouter qu’il ne peut pas croire en quelque chose qu’il ne voit pas. Il n’en fallait pas plus pour qu’il se lance dans sa quête. Une suite de plans fixes (dans lesquels notre homme semble toujours petit) nous le montrera questionnant des quidams, consultant l’annuaire, tâchant de creuser un trou jusqu’au centre de la terre, à la recherche d’un signe, en vain. Les deux esthétiques — personnages grotesques vivement colorés dans des décors finement dessinés à la mine — sont toujours présentes, soulignant en quelque sorte le décalage entre sa quête absurde et le monde pâlot dans lequel il la mène. Au bord du gouffre, attristé par les moqueries, déprimé par les échecs, il s’en remettra à une femme, toute de bleu vêtue, à la voix suave mais au corps, lui aussi, disproportionné. Elle lui apprendra savoir où trouver Celui qu’il cherche : au sommet d’une montagne. Après plusieurs jours de marche — et autant de décors traversés (plaine, vergé, désert, forêt, toujours signalés par un ou quelques objets finement dessinés) — pendant lesquels la caméra effectue des travellings vers la droite (nous indiquant que quelque chose semble enfin avancer), le couple arrive au sommet de ladite montagne et se repose, quand vient la nuit (bleue), dans une tente (verte). Le lendemain, notre homme a une révélation, qu’il criera à sa compagne de fortune, d’un bout à l’autre du cadre, à travers les vents violents : il est amoureux. Impassible, elle le conduit néanmoins au sommet où Dieu leur apparaît aux sons de synthétiseurs criards et qui les décoiffera joliment : une sorte de long serpent rouge au bout duquel se trouve un masque anonyme et derrière lequel se cachent les étoiles. Apeuré, il rentre chez lui en courant, gagne sa salle de bain grisâtre et pleure sous une douche dont l’eau lui rappelle sans doute la pluie illuminatrice du début. C’était un mercredi. C’était désopilant. (Jean-Marc Limoges)
Page suivante >>