JOUR 9

prod. Anchor Films / Weltfilm gmbh / et al.
MAIA – PORTRAIT WITH HANDS
Alexandra Gulea | Roumanie / Allemagne | 2024 | 90 minutes | Section Harbour
Je ne connaissais pas le travail de l’artiste aroumaine, peintre et réalisatrice, Alexandra Gulea, mais maintenant, mes yeux sont grand ouverts. Je me suis présenté à la projection de Maiaen espérant retrouver le génie du Self-Portrait Along the Borderline (2023) d’Anna Dziapshipa, un autre film où l’identité individuelle recoupe l’identité familiale et ethnique dans un documentaire à la première personne où le passé répond au présent. Or, j’y ai trouvé beaucoup plus : une profondeur et une complexité inattendues, presque insondables, certainement inestimables, dans la narration d’un récit de soi dont les racines s’étendent loin en amont, à travers les lieux et les époques, mais aussi les médias artistiques, résultant en un document à la fois puissant et hypnotique, évocateur et foisonnant de symbolisme. Une œuvre où le spécifique s’épanche dans l’universel à la façon liquoreuse de l’éther, où l’épaisseur stratigraphique révèle un exercice de spéléologie ethnographique et généalogique qui frise sans cesse le sublime tout en restant solidement ancré dans la réalité prosaïque d’un peuple traqué, apatride, dépossédé, dont il importe de narrer le récit. Portrait with Hands est certainement le meilleur film que j’ai vu cette année, et il demeurera sans doute l’un des meilleurs films que je verrai cette année, ne serait-ce que pour sa capacité à faire mémoire en créant l’histoire vivante, vibrante, palpable d’un peuple qu’il aide ainsi à se prémunir contre l’oubli que voudraient lui imposer ses ennemis.
Le tout commence par l’entrevue vidéo d’une aïeule mourante tournée en 1995 ; c’est la grand-mère de la réalisatrice, qui porte également le nom d’Alexandra Gulea. Or, cette correspondance nominale sera exploitée de manière particulièrement féconde par la réalisatrice, qui en fera la pierre d’assise d’une structure narrative axée sur la simultanéité et les renvois historiques. « Je suis Alexandra Gulea », dit-elle souvent (un peu à la manière de Dziapshipa lorsqu’elle répète son patronyme, question de réitérer et de revendiquer son identité), permettant ainsi de se connecter au passé en narrant de façon subjective l’époque de sa grand-mère et en maillant les temporalités présentes et passées. Alexandra hérite également d’une robe d’Alexandra, qu’elle fera se promener dans le décor à la manière d’un fantôme, comme l’empreinte indélébile laissée par son ancêtre lors du processus d’élaboration de l’œuvre. L’autrice établit ensuite un lien entre les habits mortuaires de la défunte et ses propres habits de mariage, entre les cérémonies matrimoniales de la grand-mère et les siennes, entre les enfants d’hier et les enfants d’aujourd’hui, entrouvrant les portes de l’Histoire jusqu’à plier complètement cette dernière sur elle-même. Elle retrace ainsi le récit de sa famille et de son peuple d’une façon antichronologique qui s’apparente presque à une forme d’évocation chamanique, où l’anecdote révélatrice, la sensation, la douleur, le souvenir deviennent artéfacts historiques. Le résultat est une riche courtepointe de superpositions visuelles, narratives, sonores, voire eisensteiniennes, qui combinent différents témoignages et différents types de documents d’époque avec des recréations dramatiques et conceptuelles, incarnées dans une gamme impressionnante de manifestations artistiques (théâtrales, picturales, sculpturales, performatives) qui se mêlent subrepticement au récit, faisant de la vérité d’un peuple un spectacle tout aussi déchirant qu’envoûtant.

prod. Toei Video Co.
A SPOILING RAIN
Haruhiko Arai | Japon | 2023 | 137 minutes | Section Harbour
On aime vraiment ça le pinku à Rotterdam — j’y ai vu deux des trois derniers Hisayasu Satô, The Eye’s Dream (2016) et Dear Kaita Ablaze (2023) — mais, là, on est dans quelque chose de complètement différent, dans le pinku réflexif, dans le pinku nostalgique, qui rêve à l’amour et aux actrices perdues à son service. Le pinku sérieux, tourné dans en noir et blanc neurasthénique, qui rappelle avec fierté le rapport étroit qui existe entre l’art et la pornographie dans l’histoire du cinéma japonais — on évoque même Kôji Wakamatsu, l’un des grands maîtres du softcore de répertoire, dans l’une des premières scènes. C’est d’ailleurs la mention de son nom qui enflamme les passions par un soir de neige mélancolique aux allures crépusculaires, lors de la veillée funèbre d’un célèbre pornographe diégétique, décédé dans les bras de sa muse.
Le récit subséquent sera presque entièrement rétrospectif, détaillant la rencontre fortuite entre un scénariste et un réalisateur du milieu qui racontent en flashbacks leur relation avec la muse en question, qu’ils ont chacun fréquentée à une époque distincte de sa vie, une femme qu’ils ont aimée, baisée, avec qui ils ont frôlé la parentalité, mais qu’ils ont perdue en la tenant pour acquise comme les adolescents attardés qu’ils sont. Et même si l’un d’eux déclarera que « l’amour tue le sexe », le film s’évertuera à nous prouver le contraire, soit que l’amour est la mise en contexte du sexe. Celle du viol anal également — le fantasme de viol étant l’un des nombreux lieux communs de la pornographie japonaise abordés ici. Car ça a beau être un pinku romantique où on te sort l’occasionnel poème à thématique florale, où l’on effectue la chronique domestique d’un couple, ça reste tout de même un pinku, et en cela un film à la moralité discutable, qui réfléchit d’une façon tordue à cette moralité discutable en examinant de manière frontale la primauté du désir masculin dans le genre. Même l’autre problème le plus saillant du film, soit l’adoption d’une perspective entièrement masculine sur les femmes, qui existent uniquement par le prisme du regard mâle, pourrait s’inscrire dans un processus réflexif visant à décrire un monde dans lequel les hommes créent des femmes uniquement pour se conformer à leurs propres désirs.
Qu’à cela ne tienne, c’est la grande qualité de la narration qui finit par primer, laquelle se déploie dans le parallélisme fécond entre les récits des deux hommes et la réflexivité inhérente de la mise en scène des artisan·e·s du milieu pornographique, dans la pertinence dramatique des scènes de sexe, alors que les balades idylliques sous la pluie sont suivies d’ébats sous la douche, le passage évocateur entre le noir et blanc et la couleur, le caractère pittoresque des deux narrateurs, qui se lubrifient à la bière de malt et aux concombres trempés dans le soju, et finalement dans le pouvoir ultime de ceux-ci de « modifier le script » et d’imaginer une fin plus heureuse pour leur égérie commune. Malgré la minute de contenu douteux, que d’autres sensibilités auraient pu simplement ignorer, ce fut pour moi un 137 minutes très agréable passé en bonne compagnie — je pense bien sûr à mon verre de Triple Karmeliet, pas aux filles nues !
*
JOUR 10

prod. Kaap Holland Film
KRAZY HOUSE
Steffen Haars et Flip van der Kuil | Pays-Bas | 2024 | 90 minutes | Section Limelight
C’est vraiment débile, mais en même temps, c’est tout un trip, une expérience qui te laisse pantelant·e de violence absurde et de surenchère blasphématoire, servie de cette façon viscérale et infantile qui fait s’esclaffer et applaudir un peu malgré soi — comme quand le héros transperce le crâne de Jésus-Christ avec une épingle à tricoter. Filmé à Amsterdam par le duo comique Steffen & Flip, connu pour la série New Kids (2007-2011), Krazy House est une parodie grossière des États-Unis qui appuie gaiment sur tous les boutons sensibles : la religion, la famille, la drogue, le puritanisme, la rectitude politique, même le maccarthysme indécrottable qui nourrit l’impérialisme américain depuis les années 1950. Et quelle meilleure façon que d’y arriver qu’en s’attaquant et en souillant l’un des fanions de la culture américaine que constitue la famille parfaite de sitcom ?
Le procédé est éculé, certes — John Waters s’y était attelé avec son mordant habituel dans Polyester en 1981 — et j’étais plutôt sceptique à l’idée de me retrouver face à une énième parodie de Papa a raison (1954-1960), mais mes doutes furent vite dissipés devant l’amusant et minutieux travail de caricature audiovisuel. Dur, en effet, de ne pas apprécier la fabuleuse chanson-thème élaborée pour le film et la direction artistique méticuleuse, qui réplique à merveille les décors pastel de maison de sitcom des années 1990, mais avec une couche de raillerie supplémentaire — les Christian ont un orgue à la maison et portent des chandails d’agnus dei tricotés à la main. Ça fait aussi plaisir de voir Nick Frost cabotiner à mort dans le rôle d’un patriarche particulièrement carnavalesque (casque de vélo vissé sur la tête et brosses accrochées aux pieds). Et c’est surtout rafraîchissant de voir un papa qui, d’emblée, n’a pas raison.
L’irruption d’une famille de prolétaires russes exagérément rustauds, qui, après avoir détruit le décor de studio où habitent les personnages et avoir fait taire les rires en canne, transforment la mise en scène théâtrale en thriller glauque d’invasion domiciliaire, sert ainsi à souiller davantage l’image de bonheur superficielle emblématique du rêve américain. Les envahisseurs servent en outre de catalyseurs aux désirs profanes cachés de la famille Christian : la luxure, les désirs homosexuels et adultères refoulés, la propension à la toxicomanie… En plus d’incarner les étrangers du récit national maccarthyste, ils sont aussi les étrangers de Teorema (Pasolini, 1968), dont l’influence provoque plusieurs scènes dantesques pour l’imaginaire puritain du pays de l’oncle Sam. C’est ce qui force d’ailleurs l’inévitable retour du refoulé associé au thriller de vengeance à la Wes Craven, soit la barbarie secrète de la société américaine et, dans ce cas-ci, la violence cachée du christianisme, à l’occasion d’une fin hyperviolente, où on se lance des cadavres de bébés enflammés et où l’on fait exploser la tête du chien. Et même si le film semble vouloir se refermer sur un encensement des valeurs familiales traditionnelles, il nous rickroll, et nous rappelle qu’il faut toujours prendre les dogmes sociaux avec un grain de sel, trempé dans le sang, le sperme et la dope.

prod. Les Films Fauves
LOS DELINCUENTES
Rodrigo Moreno | Argentine / Luxembourg | 2023 | 189 minutes | Section Limelight
À part la vue de Laura Paredes en méchante investigatrice corporative, Los delincuentes contient pas mal tout ce qu’on aime du cinéma argentin : un récit minutieusement ficelé qui se déploie langoureusement dans le temps, misant sur de surprenants renvois narratifs, de brillantes digressions et de charmant·e·s interprètes, mais surtout sur un art immaculé de la narration qui, dans un souci d’humanisme, parvient à ramener les poncifs du cinéma de genre à des considérations prosaïques et quotidiennes. C’était le cas dans le Trenque Lauquen (2022) de Laura Citarella, le La flor (2018) de Mariano Llinas, le Murder Me, Monster (2018) d’Alejandro Fadel ou le Clementina (2022) de Constanza Feldman et Agustín Mendilaharzu. Le film de Moreno, qui atterrit à Rotterdam après un long parcours festivalier, amorcé dans la section Un certain regard de Cannes, s’intéresse quant à lui au film de braquage, mais à petite échelle, sans le glamour des films de Soderbergh, mais surtout sans le fétichisme de la cupidité capitaliste que ceux-ci impliquent.
Morán est le responsable de la trésorerie d’une banque, et il décide un jour de voler son employeur. Son objectif n’est pourtant pas de devenir riche, mais de se soustraire au monde aliénant du travail. Sur sa vieille machine à calculer, il multiplie donc son salaire annuel par 25, soit le nombre d’années avant sa retraite, puis dérobe le double de cette somme, question d’accommoder un complice forcé, Román — tous les noms étant ici des anagrammes de « roman » — à qui il intime de cacher l’argent pendant qu’il purge sa peine de prison. Le film s’ouvre d’ailleurs sur une séquence où le protagoniste subit son train-train avec une étrange bonne humeur, laissant présager le plan qu’il compte bientôt mettre à exécution. Le reste de la première partie s’intéresse surtout à faire le récit parallèle des deux hommes — alternés grâce à de fantastiques volets sur l’allumage simultané de cigarettes, exutoires de leur stress partagé… On assiste ainsi au quotidien de deux prisonniers, l’un, littéral, qui, à la pointe du couteau, tombe sous le joug d’un caïd brésilien ; l’autre symbolique, de plus en plus paranoïaque, coincé entre les griffes d’une institution anthropophage et revancharde qui jure de rendre la vie dure à tous les collègues de Morán, qu’elle suspecte sans preuve d’avoir contribué au crime.
La deuxième partie, elle, se déroule à Alpa Corral, où les deux protagonistes se retrouvent tour à tour pour des raisons relatives à la dissimulation du butin, et où l’on s’intéresse à une autre manière de vivre, à une autre façon de voir s’écouler le temps, dans la nature, vaste, invitante, féminine, incarnée par un troisième personnage au nom anagrammatique, Norma, dont Morán et Román tomberont amoureux l’un après l’autre. On oublie alors vite l’esthétique carcérale qui régnait dans la première partie en se perdant dans des grands espaces où Pappo’s Blues nous chante la liberté, au gré d’une succession de superpositions visuelles liquoreuses, de travellings exploratoires ou de scènes alternées qui se répondent brillamment via une préfiguration subtile et organique dont seul·e·s nos ami·e·s argentin·e·s ont le secret.
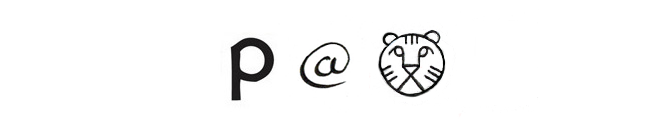
PARTIE 1
(Head South, Rei,
A Man Imagined, La Parra)
PARTIE 2
(Blackbird Blackbird Blackberry, So Unreal,
Confidenza, Slide)
PARTIE 3
(Explanation for Everything, She Fell To Earth
King Baby, It is Lit)
PARTIE 4
(Blue Imagine, Natatorium,
The Parangon, Songs of All Ends, Nécrose)
PARTIE 5
(Maia - Portrait with Hands, A Spoiling Rain,
Krazy House, Los delincuentes)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
