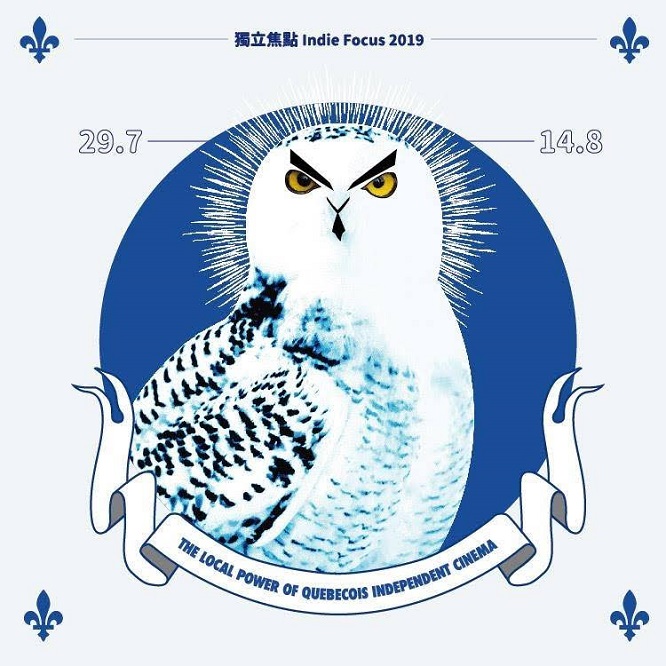
香港,一位影迷的旅行日誌
Prologue – Hong Kong countdown
Invitée à prendre part au Hong Kong Independent Film Festival (HKIndieFF), consacré cette année au cinéma québécois, je n’ai pas pu résister à la tentation d’aller découvrir la métropole chinoise. Chinoise? Pas encore tout à fait, comme nous l’ont rappelé, depuis la fin avril dernier, les milliers de manifestants prodémocratie qui militent pour garder à Hong Kong le principe « Un pays, deux systèmes ». En vigueur depuis la rétrocession de l’ex-colonie britannique à la Chine, ce principe permet à Hong Kong de bénéficier d’un système juridique distinct de celui de Beijing, et ce, normalement jusqu’en 2047.
Les semaines passent et les manifs augmentent, les affrontements avec la police aussi. Bien sûr, je pense à notre Révolution érable de 2012, même si les enjeux semblent bien plus dramatiques pour Hong Kong. Les programmateurs du Festival y pensent aussi : en conclusion de l’événement, après avoir consacré la moitié de leurs projections aux classiques de notre cinéma, de Pour la suite du monde (1963) de Michel Brault et Pierre Perrault au Déclin de l’empire américain (1986) de Denys Arcand, ils ont programmé le sidérant Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau (2016) de Mathieu Denis et Simon Lavoie.
Les semaines passent et je me prépare. Les gens du Festival m’ont demandé de faire une présentation sur notre industrie du cinéma et sur le cinéma d’auteur québécois. L’invitation m’est arrivée comme un cadeau surprise que je n’avais jamais vu venir et je dois celle-ci à mon éminent collègue Peter Rist, professeur à l’université Concordia, critique pour Offscreen et spécialiste du cinéma asiatique. C’est lui qui a fourni mon nom (et je l’en remercie) aux gens de Ying E Chi (YEC), une organisation vouée aux arts fondée en 1997 par un groupe de cinéastes indépendants hongkongais dont la mission est d’unir les entités du cinéma indépendant local afin d’en faire la promotion de diverses façons. YEC est l’initiateur du Festival, qui existe depuis 2008 dans le but de promouvoir et d’offrir aux spectateurs de la ville un répertoire de films indépendants provenant d’ailleurs dans le monde.
Vincent Chui, directeur de YEC et du Festival ainsi que son programmateur principal, et le collaborateur invité à la programmation, Nose Chan, ont jeté leur dévolu en 2019 sur le cinéma québécois. Ils prévoient aussi deux séminaires, le premier avec Peter qui parlera d’histoire et de politique québécoises ainsi que de parallèles avec le cinéma hongkongais; le second avec moi. On me demande de parler une heure ! Kaiu Choy, la femme et collaboratrice de Vincent, coordonnatrice du Festival, me demande si je souhaite présenter quelques extraits de films en sortant du cadre strict de ceux qui sont déjà programmés. Il faut donc chercher, visionner, choisir, histoire de brosser un portrait le plus exact, mais aussi le plus succinct possible des mille et une pistes qui pourraient être abordées pour décrire notre système de production, au Québec, mais aussi notre cinématographie depuis ses origines. Le champ est vaste et j’ai peu de temps pour moissonner…
Les semaines passent et le jour du départ approche. Car je pars vraiment, malgré les manifs. Enfin.
Jour 0 — Hong Kong in transit (31/07-01/08)
Me lever à 5 heures pour attraper mon avion…
Ledit avion est à 9 h 10 et, normalement, j’aurais beaucoup de temps pour me rendre sans problème. Pour les vols intérieurs (je m’envole d’abord vers Vancouver), on ne doit être à l’aéroport qu’environ une heure et demie à l’avance. Mais c’est sans compter mon genou arthrosé, mes chevilles qui perdent l’équilibre et les corridors interminables à traverser pour me rendre à ma porte de départ. Vaut mieux partir plus tôt… D’autant plus que j’ai tendance aux rêves récurrents où je pars en voyage — ou plutôt, j’essaie de partir en voyage — sans jamais réussir à me rendre à mon avion. Ou mon train. Ou mon bateau. (J’ai beaucoup de choix de moyens de transport dans mes rêves.) Disons que la phobie de rater mon avion ajoute un stress dont je n’ai pas besoin.
L’autre raison de partir si tôt? Depuis quelques années, les compagnies aériennes visent souvent les personnes comme moi, c’est-à-dire les personnes corpulentes. La discrimination est bien réelle, les compagnies aériennes pouvant forcer les gros à acheter un deuxième siège ou carrément leur refuser l’embarquement sous prétexte de « risque à l’équilibre du poids de l’avion ». Bien sûr, les lois de la physique sont indéniables, mais si on examine la situation à rebours, la vérité est bien plus simple : il est beaucoup plus facile de blâmer les gros dont les corps ne se moulent évidemment pas très bien à la classe économique, que de rééquilibrer le poids d’un avion autrement — ou d’imaginer une classe économique qui n’entasserait pas un maximum de personnes dans un espace restreint. Il faut le dire, comparativement à celle de mon tout premier voyage international, il y a 30 ans, la classe économique d’aujourd’hui est de moins en moins faite pour accueillir des êtres humains, peu importe leur dimension… Forcément, pour moi, le stress de passer l’embarquement est bien réel… Mais je réussis. Ça y est, je suis assise dans l’avion en route vers la première étape, Vancouver. Le confort est loin d’être idéal, mais ça va, je file enfin vers Hong Kong.
Entre les siestes et les goûters peu ragoûtants, le seul but d’un trajet en avion, c’est bien connu, est de regarder des films à loisir. Mais sur le vol Montréal–Vancouver d’Air Canada Rouge, on doit désormais posséder un appareil iPhone ou Android, ou encore un iPad, et télécharger l’application pour avoir accès aux divertissements. La logique veut que de plus en plus de gens possèdent de tels appareils. Soit, mais qu’en est-il de ceux et celles qui n’en ont pas, ou qui ne veulent pas de cette application? Pas de films, alors ! Laissés à eux-mêmes tout au long de près de 6 heures de vol, avec le dépliant sur les sorties de secours et les articles bilingues de la revue En route. Ah ! il est bien loin, le temps idyllique des voyages en avion comme on les voit au cinéma, avec la gentille agente de bord Pan Am tout attentionnée dans son costume bleu poudre, l’écran qui descend du plafond et l’impression de bien-être luxueux associé à l’exotisme du voyage. De nos jours, bien peu d’exotisme et beaucoup de boîtes à sardines. Tout ça augure bien mal pour le vol Vancouver–Hong Kong…

:: Une colonie (Geneviève Dulude- De Celles, 2018)
Mais non. Appréhensions inutiles. Tout d’abord, je passe de nouveau l’embarquement comme une lettre à la poste (eh ! oui, l’angoisse se répète à chaque embarquement) et me voici installée dans une section à mi-chemin entre l’Économique et la classe Affaires, l’Économique Privilège. Le luxe d’antan n’est pas exactement au rendez-vous, mais on récupère quelques centimètres d’espace et, surtout, l’accès à un écran individuel ! Avec 13 heures et demie de vol devant moi, c’est quand même plus encourageant. L’avantage d’Air Canada, c’est que, au milieu des gros machins hollywoodiens comme Avengers: Endgame, il y a aussi des films canadiens — ou plutôt, québécois, la denrée canadienne de langue anglaise se faisant particulièrement rare. Bien sûr la petitesse de l’écran n’est peut-être pas idéale, mais pourquoi bouder le plaisir de redécouvrir Une colonie (2018) de Geneviève Dulude-De Celles et Impetus (2018) de Jennifer Alleyn ? Je m’y abandonne, entre deux siestes et deux repas. La beauté des images, la force fragile d’Émilie Bierre et l’aplomb d’Irlande Côté transcendent le petit écran; je suis seule avec elles dans la campagne québécoise, à essayer de naviguer le secondaire et l’incertitude familiale. De son côté, c’est la voix de Jennifer elle-même qui me guide dans « les errances émotionnelles répondant aux aléas de la création », pour emprunter la description si juste de mon collègue Charles-Henri Ramond de Films du Québec; la scène finale, avec sa ride de taxi comme je les aime, contemplative et envoûtante, me plonge dans un état second, à mi-chemin entre le regret et l’espoir.
Mais je n’ai pas le temps de me prélasser bien longtemps dans cette sensation, car l’avion amorce enfin sa descente vers Hong Kong, après une heure d’approche à tourner autour de la ville. Je jette un coup d’œil par le hublot pour découvrir l’océan à quelques centaines de mètres en dessous; la circulation maritime, aux abords de Hong Kong, ressemble à l’heure de pointe au carrefour de la Métropolitaine et de Décarie, à Montréal. Rarement vu autant de navires de toutes les tailles en direction du même port. Dehors, le temps est bien moche et les turbulences qui secouent l’avion en témoignent haut et fort. Mais j’essaie de ne pas trop y penser, me concentrant plutôt sur le miracle du voyage dans le temps qui s’est opéré alors que j’étais au-dessus du Pacifique, quelque part entre Anchorage et Kyoto, à courir après la lune et le soleil, effaçant 12 heures de la chronologie de ma vie comme si elles n’avaient jamais existé. L’avion touche le sol. Me voici à Hong Kong.
Bonnie Chiu, mon intrépide correspondante responsable de l’accueil, m’accueille, justement, dans la moiteur étouffante et entre deux orages. Bonnie est surprise d’apprendre que le mercure était plus élevé à Montréal à mon départ qu’il ne l’est actuellement à Hong Kong; mais l’humidité, pourtant réputée touffue à Montréal, est tout simplement accablante ici. Entre les trombes d’eau intermittentes qui nous tombe dessus, la route vers la ville depuis le gigantesque aéroport en banlieue de Kowloon me révèle une infime partie de l’Asie, pour la première fois de ma vie, dans le contre-jour de la pénombre qui s’abat doucement sur les montagnes et sur la ville au loin. Au bout du tunnel reliant le continent à Hong Kong Island, les lumières des gratte-ciels clignotent autour de nous. Même si je me sais en Asie, j’ai plutôt l’impression de me retrouver à Los Angeles dans le décor de Blade Runner (1982). On est bien en 2019 et la réalité a pris le dessus sur la fiction, semble-t-il. Il ne manque que les voitures volantes.

photo : Claire Valade
Jour 1 — Hong Kong by day (02/08)
En croisant Peter au petit-déjeuner à l’hôtel, le lendemain de mon arrivée, il me révèle que son atterrissage a été bien plus éprouvant que le mien. C’est que, me dit-il, nous arrivons en pleine saison des typhons ! En apprenant tout ça seulement aujourd’hui, je me réjouis de n’avoir rien su en vol, l’angoisse de l’atterrissage dans le mauvais temps en aurait certainement été décuplée. D’autant plus que le typhon qui sévissait (et qui est maintenant presque totalement essoufflé) avait atteint le stade de catégorie 8 — une alerte météorologique jugée suffisamment sérieuse pour forcer l’annulation de la projection de Mon oncle Antoine (1971) de Claude Jutra, le soir du 31 juillet, au Festival, et son report à la mi-août. Les Hongkongais pourront donc quand même découvrir le film qui trône depuis longtemps vers les sommets des palmarès des meilleurs films canadiens.
Peter doit donner sa propre présentation ce soir, mais il me propose de jouer au guide, en début d’après-midi, pour me faire un peu découvrir la ville, avant de plonger dans ses préparatifs. C’est sa douzième visite à Hong Kong et il a forcément ses coins préférés. Mais avant de me lancer dans la ville, je remplis une obligation envers le Festival, espérant faire honneur tant à mes hôtes qu’à mes collègues du milieu cinématographique québécois : on m’a demandé une entrevue, pour la publication interne du Festival. Ma nervosité tombe devant l’enthousiasme de Timmy Chen, mon intervieweur, même si je ne me réjouis pas outre mesure du photographe qui papillonne autour de nous. Il me parle de nos festivals, demande ce qui se passe avec le Festival des films du monde — que peut-on en dire encore, diplomatiquement? Que ce fut un grand et un beau festival, vraiment, qui a accompli beaucoup pour notre cinéphilie et pour la circulation internationale de cinématographies étrangères méconnues en Occident, dont le cinéma chinois. Mais qu’il reste malheureusement bien peu, aujourd’hui, de cette gloire d’antan. Je parle du Festival du nouveau cinéma, de Fantasia, des Rendez-vous Québec Cinéma, des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, de la notion d’indépendance dans notre cinéma québécois alors que tous nos films sont subventionnés par les gouvernements. J’essaie de brosser un état des lieux actuels, alors que l’on forme de plus en plus de cinéastes dans les écoles spécialisées et les universités, alors que les moyens pour financer la production et la diffusion de leurs films, une fois ces cinéastes sortis de leurs écoles, ont si peu changé depuis le tournant du millénaire, ou sont carrément restés déficients ou inexistants. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à couvrir, et je n’ai pas la moindre idée de ce qui restera, demain, de cette longue conversation dans le bref article qui en sortira. Je ne pourrai pas le lire non plus, puisqu’il sera en cantonais. Mais qu’importe, le reporter et son lectorat sont intéressés par le sujet et c’est ce qui compte.
Peter et moi tentons de nous diriger vers Victoria Peak, dont Peter me vante la vue surplombant la ville. Mais le tram, en réfection pendant trois mois, vient à peine de rouvrir et la file qui semble faire des kilomètres nous décourage. Qu’à cela ne tienne, si on ne peut admirer la ville en hauteur, alors on l’admirera d’en bas, avec du recul, depuis la baie, par le traversier aller-retour vers Tsim Sha Tsui, au bord de l’eau du côté de Kowloon. Peter m’explique qu’il y a trois parties à Hong Kong : Hong Kong Island, où nous logeons et où se déroule le Festival; la péninsule de Kowloon, sur le continent; et au-delà, lesdits « nouveaux » territoires, dont la « nouveauté » remonte à leur annexion en… 1898. Là où nous nous trouvons, au cœur d’une forêt de gratte-ciel, l’histoire coloniale de la ville est bien peu visible.
En descendant en autobus dans les rues tournicotantes depuis la base de Victoria Peak jusqu’au quai du traversier, je réalise qu'on passe juste au pied du fameux gratte-ciel d’I.M. Pei, dont le récent décès à 102 ans est encore tout frais à ma mémoire. Ça m'émeut. J’ai une affection un peu étrange pour les gratte-ciels fabuleux, que je trouve émouvants. Passer si près, l’admirer en personne, par hasard, alors que je ne pensais jamais pouvoir venir ici un jour et le voir de visu, provoque une sensation de reconnaissance troublée chez moi… Suis-je vraiment ici, de l’autre côté de la planète, dans une ville dont je n’ai fait que rêver jusqu’ici, que construire dans mon imaginaire de cinéphile? La longue descente en autobus vers le quai me plonge dans ce même état contemplatif qu’en regardant Pascale Bussières dans son taxi new-yorkais, dans le film de Jennifer Alleyn, sur l’avion. Un état possible uniquement lorsqu’on peut se laisser porter. Finalement, malgré le regret de savoir qu’il m’est désormais impossible de découvrir une ville à pied, comme à vingt ans, en l’arpentant de long en large en marchant des kilomètres pendant des heures, je me réconcilie avec le fait que les balades en taxi et en autobus plongent dans un autre état d’esprit, un état qu’on pourrait dire quasi-cinématographique, qui permet des découvertes d’un autre angle, comme si on était le protagoniste de son propre film.

:: Impetus (Jennifer Alleyn, 2018)
Une fois sur le traversier, voir la ville se déployer, de loin, avec les nuages qui défilent à une vitesse folle au sommet des montagnes qui bordent les gratte-ciels, s’avère tout aussi émouvant. Un instant, le dessus de la ville est dans la soupe; l'instant après, tout s’est éclairci. Alors qu’on nous annonçait une grisaille généralisée et constante pour la durée de notre séjour, la saison des typhons semble tout à coup vouloir s’apaiser un peu, comme si Hong Kong voulait nous faire la promesse que, le temps de notre séjour, elle ferait de son mieux pour nous éviter les pires pluies pour mieux l’explorer. Reste à voir si elle arrivera à tenir cette promesse…
C’est toujours dans cet état second, sans doute alimenté aussi par le décalage horaire qui commence à se faire sérieusement sentir, que je rencontre réellement pour la première fois nos hôtes hongkongais, Vincent et Nose, plus Christopher Hoi Wong, l’interprète cantonais de nos communications. Kaiu est restée au Hong Kong Arts Centre pour assurer la bonne marche de la projection en cours et préparer le terrain pour la présentation de Peter. Après un repas Shanghai-style le midi avec Peter, l’expérience est cette fois-ci Cantonese-style, avec force pattes de poulet bouillies, qui me laisse plutôt dubitative, et flanc de porc rôti, qui me réjouit. C’est un bonheur d’essayer tous ces plats, ce mérou entier en sauce, ce bouillon si clair et pourtant si goûteux. Voyager, c’est aussi par la nourriture que ça se passe.
Nous discutons de l’histoire politique du Québec — les esprits sont forcément plutôt axés sur la chose en ce moment à Hong Kong et les luttes indépendantistes du Québec les fascinent. Comment pourrait-il en être autrement? Impossible de ne pas sentir de rapprochement, d’atomes crochus. Vincent et Nose, les deux programmateurs, ont d’ailleurs choisi de nombreux films sur la période clé de la Révolution tranquille au Référendum de 1980, à commencer par Les Ordres (1974), le chef-d’œuvre de Michel Brault. Je ne peux m’empêcher d’évoquer pour eux la scène où Jean Lapointe déguste un sac de chips qu’on lui a apporté, unique luxe inattendu au cœur de son enfer : elle reste pour moi l’une des scènes les plus puissantes de notre cinéma, qui exprime toute l’absurdité et toute la détresse non seulement de la situation propre au personnage, mais de tout ce Québec sous l’emprise de la Loi sur les mesures de guerre a vécu. Quelques heures plus tard, Peter élaborera, au cours de son séminaire, sur ces rapprochements entre nos cultures : un passé colonial sous autorité britannique, une dualité de langues parlées dans une région plongée dans une langue dominante, une compréhension sophistiquée des enjeux politiques par les résidents tant du Québec que de Hong Kong.
Le lendemain, on annonce une nouvelle manif.
Jour 2 – Hong Kong by night (03/08)
Aujourd’hui, je me prépare pour ma communication et je dors. Ma présentation n’est qu’en fin de journée. Je suis épuisée et je dois être présentable. Dehors, il pleut. J’essaie de regarder la télé, mais je ne comprends rien des lecteurs de nouvelles. Je ne sais pas ce qui en est des manifs.
Bonnie vient de me chercher pour mon séminaire et, au Hong Kong Arts Centre où se déroule les projections du Festival, on m’emmène par les coulisses. On me dit que la projection a pris du retard et que je devrais avoir le temps de regarder la matière avec Christopher, l’interprète cantonais (à qui l’on doit d’ailleurs la traduction du titre de cet article). Mais une fois sur place, je découvre avec effroi que la projection est terminée et que le rideau qui s’ouvre sur la scène dégagée et bien éclairée me force à plonger sur-le-champ dans ma présentation. Heureusement, Christopher et ses acolytes aux projections sont aussi préparés que je le suis et l’expérience s’avère non seulement moins angoissante qu’anticipé, mais aussi plutôt agréable. Je parle des débuts de notre cinéma et je leur montre un extrait légendaire de La petite Aurore, l’enfant martyre (1952), illustrant toute la subtilité de la méchante marâtre. Je parle de nos institutions et de notre cinéma « indépendant », qui n’a d’indépendance que l’état d’esprit. Je parle de ceux qui ont commencé chez nous et qui font leur carrière maintenant à Hollywood, et je leur montre l’extrait de l’autobus dans Incendies (2010) de Denis Villeneuve. Je parle de tous ces cinéastes, jeunes et moins jeunes, qui sortent aujourd’hui notre cinéma de Montréal et du Plateau Mont-Royal, et je fais d’une pierre deux coups en leur montrant une réjouissante scène de voiture dans la blancheur de l’hiver abitibien dans La Chasse au Godard d’Abbittibbi (2013) d’Éric Morin, qui évoque avec tellement d’adresse et de connivence le Gina (1975) d’Arcand. Je leur parle de toutes ces extraordinaires jeunes femmes qui s’imposent actuellement, en bloc, chez nous et sur les scènes internationales, de Sophie Dupuis à Sophie Deraspe en passant par Chloé Leriche et Geneviève Dulude-De Celles, et je leur montre la bande-annonced’Une colonie qui m’a tant touchée sur l’avion. Je leur parle de Xavier Dolan, parce qu’il le faut bien, parce que quoi qu’on pense de lui, il est devenu incontournable, et parce qu’il a fait avec Mommy (2014) une œuvre majeure et bouleversante, et je leur montre la plus belle scène de cinéma mettant en scène une chanson de Céline Dion, Titanic (1997) compris (l’auditoire hongkongais, appréciatif quoiqu’assez discret depuis le début, laisse alors échapper un petit rire généralisé).

photo : Vic Shing
:: De gauche à droite : Christopher Hoi Wong (interprète cantonnais-anglais, Nose Chan (programmateur), Claire Valade, Peter Rist (professeur titulaire à l'Université Concordia et critique de cinéma), Vincent Chui (directeur-fondateur du HKIndieFF, programmateur et directeur-fondateur de Ying E Chi)
Christopher, mon interprète, m’emmène souper. Il me traduit le bulletin de nouvelles diffusé à la télé accrochée au mur du restaurant. Ici, en ce moment, la télévision est allumée en permanence dans les petits restaurants de coins de rue, les commerces. Tout le monde suit l’évolution des manifs et la riposte de plus en plus violente des forces policières. Hong Kong jouit toujours d’un accès à la presse et aux médias sociaux occidentaux, contrairement à la République populaire de Chine, et la télévision ne semble pas encore régurgiter la ligne officielle de Beijing. Mais peut-être que je me trompe et que c’est simplement Christopher qui teinte son interprétation des mots de la speakerine par ses propres convictions prodémocratie. Les manifestants ont bloqué le tunnel menant à Kowloon et les abords de la baie sont à éviter à tout prix. On annonce une nouvelle manif pour le lendemain et une grève générale pour le lundi.
Je suis partagée devant ces images. Chez moi, avant mon départ, je regardais tout ça et je lisais les nouvelles dans les journaux, me demandant égoïstement si le voyage pourrait bien avoir lieu. Et je me sentais aussi mal à l’aise de me préoccuper de cela alors que mon cœur était avec les manifestants et leurs revendications. Maintenant, je me sens moins coupable en sachant que les organisateurs du Festival partagent mon ambivalence : espérer des salles pleines pour leurs projections alors que leur public cible est plus susceptible de descendre dans la rue, ou se contenter avec bonheur de quelques spectateurs en remerciant secrètement les autres qui auraient pu être là et qui sont plutôt en train de risquer leur peau pour préserver les droits de toute la population? L’équation semble bien inadéquate et bien ingrate. Après tout, que pèse dans la balance le sort d’un petit festival de cinéma alors que c’est celui de tout un peuple qui se joue dans les rues? Et pourtant, si on ne défend pas le succès de ces petits festivals, c’est leur existence qui est mise en jeu et, avec elle, tout le pouvoir que ces événements ont de diffuser des œuvres importantes, de partager des idées, d’initier toujours plus de gens à d’autres univers, d’autres cultures, d’autres opinions, d’ouvrir un petit auditoire local au monde entier, d’encourager les questions, les débats, le respect de l’autre et de la différence. N’est-ce pas là justement, au moins en partie, l’une des raisons de ces manifestations, rester ouvert à l’autre !? L’équation a beau sembler inégale, il y a parfois des combats qui ne se mesurent pas en termes comparables avec simplicité, l’importance de l’un et de l’autre n’étant pas incompatible, l’un n’empêchant pas l’autre.
Au cœur de Wan Chai, le quartier de mon hôtel, on ne saurait dire, ce soir, que le monde immédiat qui nous entoure se détraque. La vie bat son plein dans la moiteur de la nuit. Christopher m’emmène au sommet d’un gratte-ciel qu’il aime, quelques rues plus loin, où la vue sur la ville est spectaculaire. D’ici, la ville palpite. Nous prenons un verre autour de Wong Kar-Wai et Xavier Dolan, chacun conscient de son manque d’originalité vis-à-vis de la cinématographie nationale de l’autre. Christopher est un grand fan de Dolan, particulièrement Laurence Anyways (2012), et il est content que j’aie choisi Mommy comme extrait, plutôt que J’ai tué ma mère (2009) le film programmé par le Festival. Je m’étonne que tous ces films aient circulé jusqu’à Hong Kong, et puis non, ce n’est pas si étonnant. Dolan est devenu incontournable, je le disais bien. Pour ma part, je ne peux pas être ici sans évoquer mon amour infini pour In the Mood for Love (2000) même si le Hong Kong du film est bien loin de celui que j’ai rencontré jusqu’ici, avec ces tours modernes aux lumières multicolores clignotantes qui se déploient dehors sous mes yeux. Christopher m’explique qu’une des histoires de Chungking Express (1994) a été tournée dans un quartier proche d’où on se trouve en ce moment. Instantanément, l’air de California Dreaming résonne à ma mémoire. Et aussi un film que j’avais complètement oublié jusque-là : Away With Words (1999), premier long métrage comme réalisateur de Christopher Doyle, chef opérateur de Wong Kar-Wai, découvert au Festival des films du monde en 1999. Je me souviens que j’aurais tant voulu l’aimer à l’époque, mais le film s’était avéré un incroyable fouillis d’images psychédéliques et de tableaux très prétentieux. En aurais-je une opinion différente aujourd’hui, avec 20 ans de plus dans le corps et dans la tête, mais aussi 20 ans de plus à aimer et à décortiquer le cinéma? Une petite visite rapide sur YouTube, où je découvre le film disponible dans son intégralité, me confirme que non. Je m’endors ce soir-là en pensant à la photographie de Doyle, d’une élégance et d’une émotion feutrée si bouleversantes, dans In the Mood for Love, ces images s’entremêlant aux rues nocturnes du Hong Kong contemporain que je viens de quitter, vives et allumées, lourdes d’humidité, comme un rideau voilé suspendu dans l’air, pleines de bruit et du va-et-vient des taxis et des tramways.
Jour 3 — Hong Kong in the sunshine (04/08)
C’est une journée libre un peu lente et flâneuse, sous le soleil qui est enfin vraiment au rendez-vous. Suivant le conseil de Christopher, Peter et moi nous embarquons dans un taxi vers Tai Kwun, l’ancien quartier général de la police coloniale reconverti il y a un an à peine en centre culturel. Pour y arriver, il faut traverser l’un des quartiers ultrachics de la ville, rouler dans les rues escarpées, toujours monter plus haut. Pour la première fois depuis mon arrivée, me voici dans un lieu qui a non seulement de l’histoire, mais qui est aussi plutôt bas : les bâtiments formant Tai Kwun font pour la plupart à peine quatre étages. Mais le centre est entouré de toute part, comme partout ailleurs, par des gratte-ciels, certains traditionnels, d’autres en verre bleu qui miroite au soleil, même si les gouttes de pluie ne sont jamais bien loin en cette saison.
Tai Kwun est un exemple exceptionnel de revitalisation architecturale, historique et culturelle. À la fois musée, lieu de rencontre avec ses restaurants et son immense square dégagé au centre des bâtiments, et espace culturel et artistique ouvert aux artistes locaux et étrangers, tant pour les arts de la scène que les arts visuels, Tai Kwun est tout ce qu’on espérerait ici d’un lieu rassembleur donnant vie à notre histoire et à notre culture. La restauration des lieux est impeccable; la programmation, inspirante tous azimuts; et que dire de la cuisine servie à au moins un de ses restaurants, sinon qu’elle est spectaculaire. Assis tous les deux à une table du suprêmement raffiné Chinese Library, Peter et moi découvrons encore une nouvelle forme de dumplings, Singapore-style, cette fois-ci — un repas royal. Plus tard le soir, je suis de nouveau avec Peter à une autre table sophistiquée, celle du Peninsula à Kowloon, l’hôtel le plus chic de Hong Kong, à goûter une autre expérience royale. Au sommet de l’hôtel, le restaurant révèle Hong Kong Island dans toute sa splendeur de l’autre côté de la baie, la ligne des gratte-ciels bordée des montagnes, le ciel éthéré déclinant doucement vers la nuit. Dans une heure et demie, ce même ciel sera zébré de lasers bariolés et ces mêmes gratte-ciels se donneront en spectacle dans une cacophonie de façades colorées aux projections ondoyantes. Je me croirais dans un son et lumière, sans la cathédrale et le recueillement, mais plutôt dans une discothèque façon Studio 54.

photo : Claire Valade
Après tant de beauté ahurissante, le retour à l’hôtel se révèle moins éblouissant et plutôt épique. Cette fois-ci, ce sont les policiers qui bloquent l’accès au tunnel, par crainte de voir celui-ci envahi à nouveau par les manifestants qui se déplacent vers l’ouest depuis Causeway Bay. Sur le traversier à nouveau, la fraîcheur de l’air sur l’eau fait un bien fou au milieu de la moiteur incessante et les jonques illuminées qui circulent me rappellent que je suis bien en Asie. Au quai, nous devons nous rendre à l’évidence et nous diriger vers le métro. Le trajet est long, je marche lentement, Peter est très patient. Nous croisons sur les trottoirs, aux abords de la route, les plus grosses coquerelles jamais vues de ma vie. J’espère secrètement ne pas rapporter de voyageuses clandestines dans mes bagages… Mais je m’en fais pour rien. Mon hôtel est impeccable. La nuit est calme; les manifestants sont ailleurs, mais les rues de la ville semblent désertes autour de nous, outre le rare autobus qui rentre au terminus ou le taxi qui passe en trombe, hors service. Sur les passages aériens qui s’enchevêtrent partout dans la ville, les derniers piétons se hâtent de rentrer chez eux pour la nuit. Et Peter et moi marchons ce qui m’apparaît des heures — vers le métro, dans les couloirs du métro, sur les interminables tapis roulants, dans la rue vers l’hôtel, enfin, où je m’abîme dans le sommeil, pieds et chevilles en lambeaux.
Demain, Peter repart pour Montréal et on annonce une grève générale. Personne ne sait vraiment ce que cela signifie…
Jour 4 — Hong Kong in the « manifs » (05/08)
Au restaurant où l’on doit rejoindre nos hôtes du Festival pour un dernier repas en leur compagnie, Nose est déjà là, mais Vincent et Kaiu arrivent de loin et sont pris dans les soubresauts de la grève générale qui ralentit les transports. Pourtant, à voir ce restaurant plein à craquer, le va-et-vient des autobus à deux étages et des tramways dehors, les gens qui entrent et sortent des commerces ouverts, rien ne se laisserait deviner de cette grève. Tout semble, au contraire, au beau fixe. Présent tout au long du Festival, l’ancien directeur artistique du Hong Kong International Film Festival, Li Cheuk-to, également ami de Peter, se joint aussi à nous. Un homme passionnant et passionné de cinéma, Cheuk-to est maintenant conservateur cinéma et média au futur M Plus Museum, le nouveau musée de la culture visuelle de Hong Kong qui doit ouvrir ses portes au bord de l’eau, à Kowloon, d’ici 2021 — une autre institution culturelle qui promet d’être spectaculaire et dont on trouve peu d’équivalents chez nous, du moins, à grande échelle. Alors qu’on déguste notre riz cuit dans une feuille de lotus et notre canard rôti, Hong Kong-style (non pas laqué Peking-style), nos hôtes nous disent que les manifestants occupent une partie du réseau du métro et qu’on parle aussi de possibles manifestations à l’aéroport. J’espère que le vol de Peter, tard ce soir, ne sera pas perturbé…
Mais avant tout ça, aller au cinéma et attraper un film. Parasite (2019), la Palme d’or coréenne du mois de mai dernier est à l’affiche ici, alors que la date de sortie montréalaise n’a pas encore été annoncée chez nous, en ce 5 août. Peter et Cheuk-to m’assurent que tous les films sont présentés avec sous-titres anglais à Hong Kong. Et le film est projeté dans une salle sur Hong Kong Island, alors que je le croyais seulement présenté dans une salle de Kowloon pratiquement inatteignable en ce jour de grève. Peter et moi passerons donc l’après-midi en compagnie de Bong Joon-ho, l’homme de l’incroyable The Host (2006) du complètement dingue Snowpiercer (2013) et de l’écologiquement amusant Okja (2017), par lequel le scandale Netflix avait débarqué sur la Croisette en 2017. Évitant cette fois-ci la plateforme numérique controversée et en revenant en sa terre natale après deux films internationaux, le réalisateur a frappé fort cette année à Cannes et la Palme lui était pratiquement attribuée par l’opinion publique des jours avant la clôture. Le cinéma où nous allons voir le film a beau appartenir à la chaîne américaine AMC, celui-ci n’a rien à voir avec même les salles les plus chics de Montréal. Je pense au regretté Excentris, jadis la salle la plus sophistiquée de Montréal, d’une architecture pourtant grandiose et noble, mais d’une austérité de granit tout en hauteur. À côté de lui, ce cinéma commercial bien ordinaire, installé de surcroît dans un centre commercial, le Pacific Place (un centre commercial très chic, soit, mais un centre commercial quand même!), affiche une splendeur chaleureuse difficilement exprimable en mots, avec ses murs en lattes de bois blond et ses corridors incurvés aux plafonds bas tout en volutes du même bois blond, comme si une mer de vagues ambrées s’était figée au-dessus de nos têtes.

photo : Claire Valade
En contraste, le film nous plonge dans un enfer indescriptible peuplé de monstres masqués, de cachettes, de mensonges et de faux-fuyants, un enfer gouverné par l’envie et le déséquilibre social où deux familles de milieux diamétralement opposés s’affrontent : les Kim, marginaux, et les Park, ultrariches. Song Kang-ho, l’acteur fétiche de Bong Joon-ho, y livre une performance magistrale, subtile, drôle, désespérée et désespérante dans le rôle du père de la famille Kim, mais c’est la jeune actrice Park So-dam, 28 ans, qui m’apparaît une véritable révélation dans le rôle de Ki-jung, la fille des Kim, qui manie la nonchalance allumée comme une arme de combat. En vérité, tous les acteurs y sont remarquables, de Cho Yeo-jeong, qui incarne avec une crédulité fragile totalement déconnectée de la réalité la mère de la famille Park, jusqu’à Jung Hyeon-jun, le gamin manipulateur et pourtant tout simplement en manque d’affection des Park. Le choix des noms de famille « Kim » et « Park » n’est pas du tout innocent non plus : ceux-ci sont parmi les quatre noms les plus courants au pays. Selon l'Office national coréen de la statistique, le nom « Kim » était porté par pas moins de 21,6 % de la population et le nom « Park », par 8,5 % de la population (selon le recensement de l'an 2000). Ces deux familles sont donc emblématiques de l’ensemble de la population coréenne et de ses inégalités.
Ces iniquités sont d’ailleurs illustrées dans une scène d’anthologie qui marque le tournant du film, alors que la famille Kim fuit la maison des Park en plein déluge. Bong Joon-ho les filme se défilant dans la nuit, comme des voleurs, courant sous les trombes d’eau, dans les rues vides de la ville. Ils descendent vers leur misérable logement dans la basse ville, dévalant les pentes en pavés des quartiers huppés haut perchés, dans la verdure, et dégringolant les escaliers interminables menant toujours plus bas, les tirant vers le fond, jusqu’aux entrailles de la ville. L’eau tombe en cascades des hauteurs, toujours plus violente, menaçant d’emporter les Kim avec elle. Chez eux, un sous-sol à hauteur d’égout dans la dernière des rues au plus profond de la ville, les canalisations refoulent et évacuent leurs boues fécales et nauséabondes jusque dans les moindres recoins de leurs armoires, souillant leurs effets personnels et leur vie entière. La scène est d’une efficacité saisissante. Les odeurs jouant aussi un rôle primordial dans le film, la finale de la scène n’en est que plus redoutable d’intelligence incisive, dépassant les simples images pour nous plonger dans un ailleurs imaginaire, là où tous les sens sont mis à profit. Cent trente et une minutes évaporées plus tard, j’émerge du film, éblouie et étourdie, à la fois ragaillardie comme on peut l’être au contact d’un cinéaste majeur et troublée comme on peut l’être lorsqu’on est confronté à une œuvre implacable qui nous force à regarder les vérités du monde en face.
Depuis le taxi, sur le chemin du retour qui serpente depuis les hauteurs exquises où est niché l’ultrachic Pacific Place vers les quartiers plus populaires tout en bas, l’ironie de la situation ne m’échappe pas. Plutôt que de retourner directement à l’hôtel, je décide de prendre une chance, malgré la grève, et d’arrêter au Hong Kong Arts Centre pour dévaliser la boutique de produits culturels locaux pour mes nièces. Erreur fatale… Si la récolte est belle et si famille et amis risquent d’apprécier les petites attentions, j’ai malencontreusement compliqué le retour au bercail à l’extrême — du moins, pour moi. Peter, qui m’accompagne toujours, insiste pour rester avec moi et trouver un taxi, même si l’hôtel est à une vingtaine de minutes de marche pour lui. J’insiste, au contraire, pour qu’il me laisse et qu’il évite de perdre son temps avec moi, mais non, c’est un homme galant et il reste. Il semblerait qu’aucun taxi ne veuille nous prendre. Même au Centre des congrès à deux pas, les deux-trois taxis qui se montrent le bout du capot ne veulent rien savoir d’aller vers Wan Chai. Nous comprenons rapidement pourquoi, en voyant des dizaines de manifestants en noir passer au loin, visiblement en route vers quelque chose de plus gros, sur la rue où l’on se trouvait quelques minutes plus tôt. J’appelle Bonnie à la rescousse, qui quitte elle-même la manif et appelle à son tour un Uber pour me sauver. Je me confonds en excuses, je voudrais bien pouvoir marcher jusqu’à l’hôtel, mais c’est impossible. Peter nous laisse à notre voiture, alors que, à la vue de tous ces manifestants, j’aurais bien voulu au contraire qu’il reste maintenant avec nous.
Et nous voici partis, Bonnie, le chauffeur Uber et moi, en route vers chez moi, mais le retour s’avère tout aussi épique, quoique plus confortable, que la veille. Le chauffeur nous dit que les manifestants sont en plein Wan Chai, que la police a bloqué un immense périmètre et qu’il nous faut contourner celui-ci pour arriver à bon port. Bonnie et le chauffeur discutent en cantonais, je ne comprends rien, mais je me laisse porter, aussi inquiète qu’étrangement envoûtée par le périple. Le chauffeur tournicote dans les rues de plus en plus désertes, prend les rampes des voies élevées, contourne les gratte-ciel au bord de l’eau et, à la sortie d’une voie rapide, tombe directement sur la manifestation. Des centaines, sinon des milliers de Hongkongais, tous en noir, des masques au visage, sont massés devant nous. Aucune issue possible. Nous sommes obligés d’avancer vers la foule monumentale. La scène est quasi surréaliste. Nous voici, dans notre VUS Mercedes ultraluxueux, unique véhicule mobile visible dans les environs, arrêtés à un carrefour pour laisser passer des centaines de manifestants, très calmes. Bonnie et le chauffeur ne semblent pas inquiets outre mesure, mais mon cœur bat très fort tout à coup. Un manifestant s'approche de nous. Je pense qu'il va nous envoyer paître ou appeler du renfort pour brasser la voiture, mais non ! Il demande gentiment à Bonnie où nous essayons de nous rendre. Il nous suggère de continuer tout droit, vers le haut, pour éviter la foule et la police, puis il bloque le passage des manifestants brièvement pour que nous puissions continuer notre chemin. Politesse, calme, détermination,tout l'inverse de ce que la plupart des médias nous montrent — exactement comme chez nous, en 2012. C’est à se décourager.
Et nous voilà qui remontons vers la montagne, toujours plus haut, là où la vie semble suivre son cours comme si de rien n’était. Les autobus ramassent des passagers aux arrêts, des gens promènent leur chien, les rues sont étroites, tout en haut, mais notre chauffeur est habile. Les flancs de montagne à notre gauche sont parcourus d’escaliers en fer filiformes et d’une végétation luxuriante, comme partout ailleurs à Hong Kong, là où une parcelle de terre, une fissure dans un trottoir ou un trou dans un mur est disponible pour laisser le vert subtropical pousser. À nouveau, je ne peux m’empêcher de me laisser porter et de m’imprégner de la ville qui défile, une dernière fois. Toujours cette autre façon de voyager en m’abandonnant aux bercements de la route. Je ne suis pas mécontente que le détour soit très long. Je repars demain midi.
La rue de notre hôtel a été fermée par la police. Et les manifestants ont envahi l’aéroport, dans le calme.
Mais Peter réussit à prendre son avion comme prévu. Il est arrivé à l’hôtel à pied, 40 minutes avant nous, sans avoir été importuné.

photo : Claire Valade
Jour 5 — Hong Kong, goodbye! (06/08)
Lam, une collègue de Bonnie, me récupère à l’hôtel le lendemain. La grève est terminée, les manifestants sont rentrés à la maison et au travail. L’aéroport, vidé des protestataires, a repris ses activités normales. La pluie est de retour pour mon trajet vers l’aéroport. Le ciel est gris, mais je peux voir la ville qu’on laisse derrière nous, à partir du Stonecutters Bridge, puis le tunnel dans la montagne nous happe. À l’aéroport, Lam me tient compagnie et m’aide généreusement à comprendre ce qu’on me raconte en cantonais. L’embarquement, à nouveau, s’effectue sans problème.
Le vol vers Toronto dure 15 heures et j’arriverai le même jour, plus tôt… Toujours ce voyage dans le temps… Engoncée mon siège Privilège, j’examine les films qui s’offrent à moi. Pas de nouveaux titres québécois, malheureusement. Vox Lux (2018), l’étrange objet de Brad Corbet avec Natalie Portman, me laisse une curieuse sensation de fraîcheur, de prétention et de ratage noble. Je suis crevée. Il est difficile d’imaginer ce que représentent 15 heures entre ciel et terre, avec le bruit sourd et constant des moteurs, les turbulences épisodiques, le dossier rabaissé du passager devant dans le nez, tant qu’on ne l’a pas vécu soi-même. Fame (1980) d’Alan Parker, qui avait tant secoué mon adolescence, tient étonnamment bien la route, 37 ans plus tard.
Entre deux siestes, je me résous à Aquaman puisqu’il le faut. Malgré mon extrême fatigue et mon manque d’attention, plusieurs constatations me viennent à l’esprit. Tout d’abord, les techniques de dé-vieillissement sont plutôt à la mode à Hollywood, ces jours-ci — et certains résultats sont plus heureux que d’autres. Le film aurait aussi pu s’appeler « Histoire de cheveux » : l’incroyable perruque rouge d’Amber Heard prend tellement de place qu’on perd de vue l’actrice, très correcte, alors que Patrick Wilson, un acteur autrement formidable, est aussi lisse et raide que son chignon pratiquement imperturbable par mer et par terre, qui semble être la véritable superpuissance du personnage. En effet, c’est tout un exploit que de réussir à garder des cheveux aussi soigneusement laqués sous l’eau alors que tout le monde autour de lui arbore des mèches flottantes au gré des courants. Enfin… tous le monde sauf Willem Dafoe, dont la coiffure demeure tout aussi laquée — mais ça ne veut rien dire, Willem Dafoe sait tout faire… En somme, mis à part Dafoe, les seuls comédiens qui semblent véritablement savoir quoi faire dans un film comme celui-là sont Jason Momoa (heureusement que le film lui appartient totalement, sinon ce serait un Aquaman bien mièvre) et Dolph Lundgren. Le reste? Cent fois meilleur que Justice League, très en dessous de Wonder Woman.
À Toronto, les douaniers zélés par la paperasse me valent la perte de ma bouteille d’alcool de riz.
À Montréal, mon chum est là, dans la fraîcheur enfin tombée sur la ville.
Épilogue – Hong Kong back home (04/09)
Quelques jours après mon retour, l’aéroport de Hong Kong est occupé par 5 000 manifestants pacifiques qui investissent les lieux et s’assoient dans le grand hall des départs internationaux. Tous les vols sont annulés.
Deux semaines plus tard, à la maison, en défaisant ma valise (j’étais bien occupée dans les jours suivant mon retour), je retrouve les copies de deux documentaires indépendants produits par Ying E Chi, la maison de production de nos hôtes : Yellowing (2016) de Chan Tze Woon, sur la Révolution des parapluies de 2014, et Lost in the Fumes (2017) de Lam Tze Wing Nora, sur Edward Leung, étudiant ordinaire et candidat vedette aux élections législatives surveillé par le gouvernement. Je me souviens que Vincent m’avait souligné que Leung avait été arrêté peu après la sortie du film et demeurait incarcéré à ce jour. Je les ajoute à ma pile de films à visionner.
Le 30 août, Nose écrivait sur Facebook : « La situation à Hong Kong est maintenant près de celle des Ordres, du réalisateur québécois Michel Brault. » Sachant ce qui a inspiré le film, on peut craindre le pire pour nos amis hongkongais…
Aujourd’hui, 4 septembre, je lis dans les journaux que la cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, annonce le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions vers la Chine, à l’origine de la crise. Est-ce que ce sera suffisant pour apaiser la colère des manifestants? Seul l’avenir le dira. Mais je ne suis pas très optimiste…
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
