
THE END
Guillaume Nicloux | France | 2015 | 81 minutes | Temps ø
Après Valley of Love (2015), retrouver Gérard Depardieu sous la direction de Guillaume Nicloux dans un film produit par Sylvie Pialat tient du rendez-vous irrésistible. Projet inédit, destiné au e-cinéma, The End sortira presque exclusivement en VOD, l’occasion de le voir sur grand écran en festival est par le fait même encore plus précieuse. Film impulsif, inspiré d’un rêve de Nicloux tirant au cauchemar, la mise en scène minimaliste laisse toute la place — gargantuesque — à son acteur. Depardieu y est, plus encore qu’à l’habitude, un corps, une présence massive et trapue. Dès les premières images, il dévoile ce corps haletant, ce corps dormant et difficilement mobile. Au réveil du cadran, l’aube accueille une journée de chasse pour Gérard et Yoshi, son chien. En 4x4, tous deux se rendent en forêt de Fontainebleau, mais très vite, la situation se dégrade ; Yoshi disparaît, et la forêt habituellement familière se dédouble vers un extrême incommensurable, d’une densité inhospitalière. Gérard est perdu. Bientôt à court de schweppes aux agrumes et de petits bretons, affamé, déshydraté, et las de traîner en boucle ses 120 kilos, il fume cigarette sur cigarette. Les visions fantasmagoriques improbables se multiplient à leur tour et se heurtent au raisonnement de Gérard qui, halluciné, n’en croit pas ses yeux, il réfléchit à haute voix, blasphémant tout à la fois. Ce corps devient voix, le discours d’une personne qui parle seule pour affronter le pire. Ce qui donne toute la dimension inquiétante et anxiogène à l’histoire est d’abord cette atmosphère à la fois si recluse et si vaste, contraste entre l’isolement complet dans un espace infini. Les recoins inexplorés de la forêt sont omniprésents et les sons de la nuit expriment avec violence cette infinité de « possibles ». Au fil de rencontres inexistantes ou antipathiques, le voilà plus seul que jamais, plus brave que jamais, et plus humain que jamais au contact d’une jeune femme en détresse, nue et muette, et probablement victime d’un viol collectif dans le sous-bois. La forêt de The End évoque le clair-obscur entre beauté bucolique et sauvagerie terrifiante au sein même de la nature. Un naturalisme dépravé, imprévisible, dont le charme féérique invite à la fusion, à l’assimilation, à la crainte et au respect. En vouvoyant l’étranger, Gérard s’incline devant cette nature farouche, tandis qu’en embrassant la fille, il dérape avec elle. Pour le cinéaste ayant « désappris à écrire un scénario » et s’étant adonné à ce qui ressemble à de l’écriture automatique pour élaborer celui de The End, la démarche, plus proche de son inconscient certes, implique des ratés. Tourné chronologiquement dans une certaine improvisation, l’introduction expéditive bouscule le rythme global, et les interventions initiales cherchent leurs marques. The End nous laisse témoin de la montée progressive du jeu d’acteur de Depardieu, qui, une fois réchauffé, fait réellement « décoller l’histoire », et qui, mis en scène dans les grands espaces verts et la lumière du jour, procure un moment d’enchantement. Le personnage de la nymphe effarouchée, bien qu’il génère un changement de ton, fomente une tension, et apporte certaines scènes joliment amenées — dont les monologues de Gérard autour de leur solidarité réciproque, et leur nuitée désabusée autour du feu — déprécie l’histoire à terme en devenant maniéré et risiblement prévisible. The End est le fruit d’un rêve impérieux qui voulait prendre forme dans les bois, et avoir Depardieu pour roc. (Anne Marie Piette)

ÉVOLUTION
Lucile Hadzihalilovic | France/Belgique/Espagne | 2015 | 81 minutes | Temps ø
On avait envie de ne jamais ressortir des premières images : la caméra sous l’eau, la surface de l’écran qui devient la surface de la mer, c’est la salle tout entière qui est plongée dans un autre monde, dans une apesanteur amniotique, bercée par les courants marins balayant les algues comme le vent joue dans les champs de blés malickiens. Mais il faut émerger, et ce sera le choc de la mort, d’un cadavre entraperçu sous les étoiles de mer, qui nous force à sortir la tête de l’eau pour prendre une première respiration, avec déjà cette conscience de la mort qui nous tourmente ; naître, c’est savoir que l’on va mourir (on naît dans l’eau, on s’y noie), alors la vie qui s’ensuit aura tout du cauchemar éveillé. La beauté de ce prologue (l'une des plus belles séquences de tout le festival, on ne le dira pas assez) n’a donc rien d’anecdotique : on ne pense qu’à s’y replonger pendant que Lucile Hadzihalilovic s’affaire, dans le film qui suit, à mettre en scène une maternité nouveau genre, à faire éprouver à la chair masculine les souffrances de l’enfantement, à instrumentaliser le corps de l’homme, à l’empêcher de se développer (l’évolution ne concerne pas les hommes) pour en faire une simple machine de reproduction, dénuée de sexualité. Un renversement fascinant, qui n’est pas sans rappeler Alien (la maternité imposée, faisant de l'hôte une victime, le fœtus comme parasite, les textures jouant sur la viscosité et les viscères, etc.), soutenu tout du long par un travail formel impeccable (il n’y a pas dix lignes de dialogue), mais qui réduit quelque peu la portée de ce prologue, en restreignant ses résonnances universelles par une allégorie plus ciblée. La dernière image achève de refermer le film sur lui-même, on ne sortira pas du cauchemar, au mieux il faut choisir dans lequel on préférerait naître, dans celui féminin d’Évolution ou dans le nôtre, masculin il va sans dire : fatalisme un peu facile, certes, mais on se rappellera de ce prologue, de la gentillesse d’une sirène, de l’imagination d’un jeune garçon, et on pourra se dire que tout n’est pas encore perdu. (Sylvain Lavallée)

THE GIANT
Johannes Nyholm | Suède | 2016 | 90 minutes | Compétition internationale
La vie c’est comme la boxe ? La vie c’est comme la bicyclette ? La vie c’est comme une boîte de chocolats ? Non. La vie c’est comme une partie de pétanque : quand tu as une tête de cochonnet, tu risques de recevoir des coups. Et il suffit de voir The Giant pour être convaincu de ce nouvel adage. Rikard (Christian Andrén), un autiste de 30 ans de vie et de 3 pieds de haut, au visage atrocement bubelé, orphelin de père (il est mort) et de mère (elle est à l’asile), n’a que ce sport pour tout salut. Or, dès les premières secondes du film, il recevra une boule de métal sur son crâne déjà notoirement déformé, ce qui le conduira à l’hôpital. Pour sa « sécurité », son équipe lui refusera la possibilité de participer au grand concours nordique. Qu’à cela ne tienne ! Lui et Roland (Johan Kyléndu) — le meilleur meilleur-ami-du-monde que le cinéma ne nous ait jamais donné l’occasion de voir —, fonderont leur propre team et parviendront à affronter ces indélogeables adversaires, les Carl Carmoni du Danemark. Foin des films à deux cennes construits pour les cours de moral ! Voilà LE film sur l’intimidation et l’estime de soi le plus efficace et le plus touchant qu’on ait projeté sur nos écrans. Essayez d’assister à la scène où notre attendrissant nabot se fait narguer par d’obèses soûlards sans serrer les poings. Jamais larmoyant, toujours loin des bons sentiments, drôle aussi, le film de Nyholm va droit au but et droit au cœur. Le moment où Roland offre à Rikard des boules de pétanque plaquées or sur lesquelles est gravé son nom vous donnera des frissons jusque dans les genoux. Et c’est en passant par un savant dosage d’émotion que vous serez conduits à la grande finale, si riche en rebondissements. Si le film remporte, lui aussi, une victoire, c’est parce qu’il demeure d’une audace plastique et scénaristique assumée. Imaginez le personnage d’Elephant Man (oui, ça, on l’a déjà dit), intégrant l’univers de Freaks (1932) et de King Kong (1933), sur un scénario inspiré de Karate Kid, filmé par l’équipe du Dogme, avec des plans piqués à Koyaanisqatsi, sur de la musique d’un Ennio Morricone shooté aux stéroïdes, et vous aurez une idée de ce petit film gigantesque. (Jean-Marc Limoges)

YAMATO (CALIFORNIA)
Daisuke Miyazaki | Japon | 2016 | 119 minutes | Panorama international
Au cinéma japonais contemporain qui alterne mécaniquement entre le drame de mœurs et l’hybridation générique des genres, Daisuke Miyazaki propose un nouvel état de la question — un état radical. Un état qui ne trouve plus dans les situations du cinéma un théâtre d’oppositions contrastées (l’éternel cliché d’un cinéma japonais fait de fortes dichotomies stylistiques a fini par le dominer) mais plutôt les moyens d’élever à bout de bras, sur la pointe des orteils, l’existence fragile d’une seule personne, Sakura, jeune femme de Yamato qui rêve de hip-hop. Héroïne qui n’en a pas l’allure, elle émerge avec une désinvolture touchante d’un cinéma où l’individualité se voit généralement estompée par la structure d’un récit soumis à ses codes. Deux heures durant, après ce premier plan qui la capte dans un geste ascendant, on la suit pendant qu’elle apprend à marcher, à s’individuer par la parole qui porte en elle sa condition. S’élever, partir, saisir sa place dans le monde face à une nouvelle venue dans la famille qui vient de Californie et qui recèle, dans son japonais parfois hésitant, les traces les plus accessibles d’une Amérique qui pour Sakura est toujours demeurée inaccessible. Car l’Amérique, placée-là déjà dans le titre en porte-à-faux des ambitions d’un pays qui s’est reconstruit après la guerre dans l’ombre de son adversaire, hante Yamato (California), ses chansons, ses démarches, ses vêtements, comme le fantôme véritable d’un nouveau cinéma de fantômes japonais. Sa silhouette plane toujours, puisque Yamato est une bourgade qui entoure une base américaine à la légitimité extraterritoriale, ce qui n’empêche pas ses nombreux avions de provoquer un boucan oppressant, rouleau sonore qui compresse les dialogues du film à toutes bonnes occasions. À l’observateur lointain, cette impression de nouveauté pourrait simplement cacher des influences et même des reprises nostalgiques (celles d’Easy Rider, d’un jeune Spike Lee ou, plus près du décor, de bon nombre des films des années 60 de Nagisa Oshima et de Koreyoshi Kurahara), mais le talent solitaire de Miyazaki est bien à la hauteur de cette époque qui est la nôtre : à l’opposition contre-culturelle qui frappait jadis ces films d’un dédain assumé envers la culture dominante, le jeune cinéaste traduit cet assujettissement comme un mode d’existence, comme le dur fait d’apprendre à agir dans une société de facilités (on remarquera que malgré son faible revenu, ce qui dérange Sakura lorsqu’elle considère sa famille n’est pas la pauvreté de la situation, mais leur résilience qui transpire par un sourire niais). Ainsi, la vérité cathartique de son cinéma a cette même capacité qu’avaient ses prédécesseurs à prendre les moyens du bord pour aboutir à des variables exponentielles, à la différence qu’ici, cette vérité projetée dans l’écho de l’Amérique atteint des dimensions universelles, altermondialistes, hissant de facto Daisuke Miyazaki au rang des nouveaux auteurs révolutionnaires du cinéma. (Mathieu Li-Goyette)

X QUINIENTOS
Juan Andrés Arango Garcia | Canada/Colombie/Mexique | 2016 | 104 minutes | Focus Québec/Canada
Sans être particulièrement mémorable, X Quinientos est un film indéniablement honnête. Doté d’une mise en scène intime et lucide, le jeune réalisateur Juan Arango y narre le récit d’un million de personnes, des pauvres âmes pour qui le crime n’est pas un choix, mais une nécessité. Sélectionnant comme sujets trois jeunes personnages déracinés et endeuillés, il les suit à la trace dans leurs errances individuelles, évoquant avec éloquence la violence tentaculaire qui règne dans leurs différents milieux de vie. D’abord, il y a David, travailleur mexicain ayant quitté son village du Michoacán pour l’étouffante Mexico, où il sera contraint de joindre le gang de son nouveau quartier, puis Alex, pêcheur de palourdes colombien devenu homme de main du boss local afin de pouvoir se payer un moteur de bateau. Finalement, il y a Maria, Philippine transplantée à Montréal dont la rage intérieure est cause d’une violence antisociale incontrôlable. De façon platement alternée, nous découvrons ici les aléas de leurs quotidiens, assistant à trois crescendos de violence qui étrangement se résolvent par trois happy ends consensuels, preuves simultanées de l’optimisme de l’auteur ou de sa simple candeur. Maintenant malgré tout une facture extrêmement réaliste, celui-ci utilise l’immédiateté de la caméra à l’épaule pour pénétrer profondément dans l’espace vital de ses protagonistes, mais surtout dans les milieux exclusifs qu’ils fréquentent. Nous assistons ainsi de façon privilégiée à des tranches de vie inédites, qu’il s’agisse de danses punks dans les bars sombres de la capitale mexicaine ou d’ébouage de cadavres dans les rivières kaki de la Colombie. La flexibilité de la caméra est également propice à la logique exploratoire du film, permettant des travellings énergiques sur différents véhicules et personnages, gardant toujours la trace des trois protagonistes, même dans leurs plus inaccessibles retranchements. Outre un surplus de réalisme, cette flexibilité contribue à une impressionnante fluidité narrative, laquelle est garante de l’intérêt soutenu du spectateur. Au final, bien qu’on puisse regretter le scénario conventionnel du film, force est d’admettre que X Quinientos constitue une expérience parfaitement immersive, fruit du style naturel de la mise en scène et des interprètes (tous excellents), mais aussi de sa somptueuse bande sonore, laquelle contribue tout autant à nous faire voyager que les magnifiques décors exotiques capturés par la caméra. (Olivier Thibodeau)
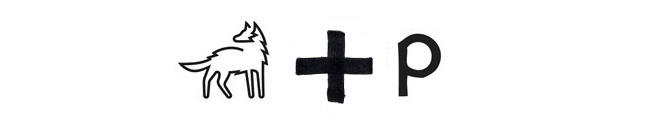
PRÉSENTATION
OUVERTURE : TWO LOVERS AND A BEAR
JOUR 1
(Alipato, Death in Sarajevo, Diamond Island, Je me tue à le dire,
Safari, Sixty Six, The Death of J. P. Cuenca, Welcome to Iceland)
JOUR 2
(Déserts, Late Shift, Lost and Beautiful,
Maquinaria Panamerica, The Last Family)
JOUR 3
(Daguerrotype, Director's Cut, Sur les nouveaux alchimistes,
Happy Times Will Come, Life After Life, Pacifico)
JOUR 4
(A Quiet Passion, Apnée, Aquarius, Autre part,
Fallow, Sadako vs. Kayako, Sunrise, Werewolf)
JOUR 5
(A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Bitter Money,
La Chasse au collet, Lampedusa, Sand Storm, We Make Couple)
ENTREVUE
Xavier Seron et Julie Naas (Je me tue à le dire)
JOUR 6
(A Decent Woman, Belgica, Lily Lane,
Mes nuits feront écho, Notes on Blindness, The Untamed)
JOUR 7
(Les arts de la parole, Dogs, L'effet aquatique,
I Had Nowhere to Go, The Ornithologist, Spark)
JOUR 8
(The End, Évolution, The Giant, Yamato (California), X Quinientos)
JOUR 9
(Maudite poutine, One Week and a Day, Prank,
La tortue rouge, Weirdos)
ENTREVUE
Felix Van Groeningen (Belgica)
JOUR 10 + PALMARÈS DE LA RÉDACTION
(Invisible, Mademoiselle, Stealing Alice,
Le vertige des autres, Yourself and Yours)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
