
1 | 2

prod. ONF
LE MATELOT VOLANT
Amanda Forbis et Wendy Tilby | Québec | 2022 | 8 minutes | Compétition canadienne 1
Le générique d’ouverture nous laisse déjà entrevoir la nature réflexive de ce film d’animation primé en affirmant que son récit est tiré d’un fait vécu. En effet, il fallait bien que Charlie Mayers, le marin du titre, carré fumant des caricatures d’antan, survive à l’explosion d’Halifax pour raconter son histoire. Sa mort annoncée, par un dispositif hitchcockien de révélation subreptice des 3000 tonnes d’explosifs dans la cale du Mont-Blanc, se solde ainsi par une résurrection instantanée, qui contribue à une méditation élégante et perspicace sur l’ambiguïté mortuaire inhérente au médium animé.
Métaphysique de la création et de la destruction, le film débute par un spectacle de bulles et de poissons primordiaux avant de passer à l’univers de Chuck Jones, où deux bateaux, le Mont-Blanc et l’Imo, entrent en collision et provoquent une déflagration dans le port de la capitale néo-écossaise le 6 décembre 1917, oblitérant les immeubles environnants et propulsant Mayers dans un vol plané d’apparence mortelle. Or, plutôt que de revêtir d’emblée les propriétés caoutchouteuses de Wile E. Coyote, la victime ne porte bientôt plus que sa fragile humanité. La bande sonore orchestrale abandonne alors la guillerette bonhomie des Looney Tunes pour un gravitas aérien, et la figure amorce sa trajectoire ultime vers les étoiles, perdant en chemin ses vêtements et sa forme… qu’elle finit par retrouver lors de son retour sur terre, amarrée aux traces physiques qui lui servent d’ancrages mémoriels (représentés conséquemment par des supports photographiques matériels). Les mérites artistiques du film dépassent ainsi la générosité du trait ou de l’éclectisme postmoderne, égayant de façon héroïque le cadre glauque de la nature morte au profit d’une nature vivante.
*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival Regard 2023

prod. Mel Hoppenheim School of Cinema - Université Concordia
ÉVICTION
Alexandre Paquet | Québec | 2022 | 2 minutes | Grand angle 1
Ça commence avec une scène anodine tournée en prises de vues réelles où un jeune homme traverse son appartement pour aller cueillir une lettre dans la fente de sa porte d’entrée. Il s’agit, vous l’aurez deviné, d’une notice d’éviction. C’est alors que l’on pénètre dans un monde de papier animé, dont les innombrables et incessantes permutations dénotent un lexique narratif impressionnant au vu de la simplicité apparente de la technique. À l’écran, la notice d’éviction cède sa place aux factures et aux relevés bancaires qui ont précédé. Ceci explique cela, mais beaucoup plus encore, soit la fonction accablante de la paperasse dans une économie capitaliste où les ultimatums doivent se faire par courrier recommandé et où chaque aspect de notre existence est chiffré sur quelque monstrueux registre. L’acte de déchirement, qui constitue ici l’un des principaux vecteurs du mouvement, est également lourd de conséquences. Il marque non seulement la rupture symbolique du sujet avec son chez-soi, mais il permet en outre d’esseuler chaque élément de décor, chaque objet qu’il possède, même sa personne tout entière, que l’auteur « arrache » à son actuel domicile pour les transposer, non sans un certain humour noir, dans une boîte en carton. Plus encore, et c’est là que le film revêt un caractère libérateur malgré la triste réalité du déracinement, Éviction dénature les documents officiels responsables de ce déracinement, dont l’auteur supplée un pouvoir créatif à la fonction platement destructrice, une fécondité à la stérilité. Par accumulation et par superposition, il donne aussi une nouvelle dimension au papier, tel qu’en témoignent ses panoramas urbains aux multiples strates, emblématiques d’une œuvre dont toute la profondeur émane de la nature anodine de son récit et de son matériau de travail.

prod. Sixpackfilm
OCCHIOLINO
Michaela Grill | Québec / Autriche | 2022 | 11 minutes | Programme Grand angle 1
Tiré de l’italien pour « petit œil » — c’était le nom affectueux donné par Galilée à son microscope composé —, occhiolino est un film de found footage expérimental créé à partir d’extraits de films scientifiques des années 1920. On y voit des images diffuses de division cellulaire qui s’enchaînent au rythme d’une piste électronique saisissante doublée de chœurs épiques signée par Sophie Trudeau, collaboratrice de longue date de la réalisatrice. Proposant une expérience synesthésique envoutante, leur film se dérobe constamment à notre désir de faire sens du contenu écranique, qu’on assimile tour à tour à une réflexion entoptique, une abstraction pittoresque et une entité biologique indéfinissable. Après un moment, on se résout donc invariablement à apprécier l’œuvre sur une base purement expérientielle, de sorte qu’on la laisse subrepticement incarner la friction immémoriale entre le désir humain de savoir, de faire sens du monde qui nous entoure, et celui d’en savourer la beauté mystique pour sa simple transcendance. Car c’est bien d’une expérience mystique dont on parle ici, une expérience où la forme s’efface devant ses contours sensoriels, où l’immédiat nous apparaît désespérément lointain, où la simplification extrême de l’être révèle une complexité ahurissante, où la forme réplique organiquement le mouvement de pulsation propre à la vie animale. Il s’agit en outre d’un rafraîchissant écho au cinéma expérimental des premiers temps qui, dès l’avènement des images microscopiques animées, avait su intégrer celles-ci à son arsenal de vues exotiques. On note d’ailleurs que, contrairement à des films comme The Problem of the Hydra (Maija Tammi, 2020), qui incluait aussi des séquences documentaires traditionnelles, occhiolino conserve toute la pureté de ce type de cinéma, misant avant tout sur le potentiel d’émerveillement inhérent au médium pour produire l’affect.

prod. Raquel Sancinetti
MADELEINE
Raquel Sancinetti | Québec | 2023 | 15 minutes | Compétition canadienne 2
Ce qu’il y a de magnifique avec les documentaires d’animation — c’est aussi le cas pour Letter to a Pig (Tal Kantor, 2022), Strange Beasts (Magalie Barbé, 2022), It’s Nice in Here (Robert-Jonathan Koeyers, 2022) et La Grande Arche (Camille Authouart, 2023) —, c’est qu’ils permettent aux cinéastes de transcender le réel, de lui injecter un surplus de subjectivité, d’en exacerber la teneur dramatique, d’en contourner les règles, bref de se jouer ouvertement de lui. C’est ce que fait ici la réalisatrice indépendante Raquel Sancinetti avec une ingéniosité et un humanisme irrésistibles. Mélangeant de manière subreptice les prises de vues réelles et les scènes de poupées en feutre animées, elle fait bien plus que surprendre le public, allant jusqu’à libérer son amie Madeleine de sa prison gériatrique en l’amenant à la plage dans sa voiture ovni, par-delà les grands pics sablonneux et les dunes fleuries. « Moi, je ne veux plus aller nulle part », déclare d’abord Madeleine, « la vieille par excellence » du haut de ses 103 ans, préférant rester assise sur sa chaise dans sa maison de retraité·e·s. Or, c’est par le montage que Sancinetti parvient à la convaincre, puis par la substitution qu’elle la traîne à sa suite, lui créant pour l’occasion un alter-ego à la gestuelle étudiée, animé par sa voix éraillée mais chaleureuse, qui débite à l’écran un flot constant de remarques idiosyncrasiques. Plus prosaïquement, le film constitue le portrait charmant d’une amitié intergénérationnelle inspirante, où l’intelligence créative de la jeune femme n’a d’égal que la sagesse et la répartie de son aïeule, à qui il s’agit ici d’un touchant hommage.
*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival Regard 2023

prod. Kaho Yoshida
TONGUE
Kaho Yoshida | Colombie-Britannique / Japon | 2022 | 2 minutes | Compétition canadienne 2
Dur d’ignorer l’érotisme exquis et le ludisme lingual de Tongue, dur de ne pas célébrer son potentiel libérateur pour une sexualité féminine qu’on y voit prendre plaisir avec un organe mâle sectionné de son insupportable propriétaire. L’histoire commence dans un bar, où une femme asiatique s’emmerde à écouter un énième prétendant orientaliste débiter son monologue : « Where are you from? Wait, wait, let me guess. I can tell! » L’héroïne fronce le sourcil. « I heard that you people have eye surgeries to make your eyes… ». La bouche s’active fiévreusement, révélant les gencives et les coulures de salive, la langue claque : « I think you’re either Korean or Japanese… ». Les mains gesticulent, la roue tourne, malgré le désintérêt évident de la femme, qui finit par engloutir son verre et attraper l’homme par le collet pour l’embrasser. Une accalmie salutaire s’ensuit, alors que le moulin à paroles se tarit et que lui succède le bruit goulu des langues au travail. Mieux encore, la protagoniste extrait même complètement l’organe abrasif de son interlocuteur et l’amène avec elle, laissant un billet sur le comptoir avant de quitter les lieux avec empressement. C’est ainsi que se concrétise le fantasme de l’autrice Kaho Yoshida. « Being an Asian woman in the West », raconte-t-elle sur son site web, « I have been fetishized and objectified while my needs and desires were dismissed. As I sat across men who talked at me, often explaining things I already knew, I fantasized about pulling their tongues away. » Mais le fantasme ne se termine pas là…
Une fois rendue à la maison, dans le monde pastel hyper doux d’un appartement aux allures de sanctuaire, l’héroïne place la langue, animée en stop motion, dans un bocal où se dandinent déjà trois autres langues, qu’elle nourrit et appâte à l’aide d’une sucette glacée pour mieux les convier à des jeux onanistes qui s’épanchent dans une sorte de délire psychédélique. C’est alors que se déploie tout cet érotisme enivrant qui caractérise le film, dans des ballets de langues volantes, de langues rampantes, qui glissent langoureusement sur sa peau, et se muent en glissoires humectées, puis en larges mains qui viennent bercer son corps nu. L’iconographie décomplexée de fluides rosis et la bande sonore émoustillante (composée d’obsédantes viscosités et de réconfortants soupirs) nous happe généreusement ; elle nous ouvre surtout la porte vers un monde où la source d’un racisme ordinaire se transforme subitement en source de plaisir pour sa victime, où l’homme, dans le silence de sa langue conquérante, s’efface complètement à l’ombre de la jouissance féminine. Débarquant à Montréal après un impressionnant parcours festivalier, qui inclut le festival d’Ottawa et d’Annecy, où il était projeté en compétition officielle, Tongue est une petite merveille de cinéma intime à portée universelle, dont je vous invite dès aujourd’hui à découvrir les coulisses, dans lesquels nous convie si généreusement l’autrice sur son site web. Et à savourer pleinement sa louchée providentielle de Pepto Bismol pour l’âme corrodée par la bullshit des mâles.

prod. McCarron Productions
CORVINE
Sean McCarron | Colombie-Britannique | 2022 | 11 minutes | Compétition canadienne 2
Un peu quétaine, mais somptueusement conçu, ce court conte initiatique sur le thème de la différence et de l’acceptation de soi possède tout le pouvoir d’évocation du film disneyien classique, particulièrement dans sa bande sonore orchestrale prenante (signée Suad Bushnaq) et sa représentation chatoyante de l’univers rural où se déploie l’idylle aviaire du jeune protagoniste. Amateur d’oiseaux, comme en témoigne les jouets amoncelés dans sa chambre, celui-ci se pare de plumes et croasse gaiment en parcourant la campagne avec ses amis volages. Il est lui aussi un oiseau, et ses grands-parents, qui lui font cadeau de biscuits qu’il partage avec les corneilles, l’acceptent pleinement. Les choses se passent différemment à l’école, où il est forcé de délaisser son costume d’oisillon pour les contraignants tissus d’un uniforme, et où ses croassements se heurtent à la réprobation populaire. La fluidité du mouvement est exquise, et elle permet de prendre toute la mesure de cette liberté insouciante qui est celle du garçon avant son arrivée à l’école, mais aussi la portée du heurt qu’il vit au contact des autres enfants, dans une scène déchirante où ielles se transforment en oiseaux pour le déplumer de leurs becs acérés. Ce qui m’a le plus déchiré cependant, ce n’est pas tant le drame de l’ostracisme, la mesquinerie de cette police du conformisme qu’incarnent de facto les gangs infantiles, mais la représentation d’une famille aimante et solidaire aux visages doux, qui, plutôt que de capitaliser sur le heurt social vécu par leur fils pour lui rappeler l’importance de faire comme les autres, s’engage plutôt à célébrer sa différence. C’est la luminosité salutaire de l’œuvre qui a brûlé ma sombre carapace. Et je me suis remémoré les paroles douloureusement inspirantes de McCartney : « Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. »
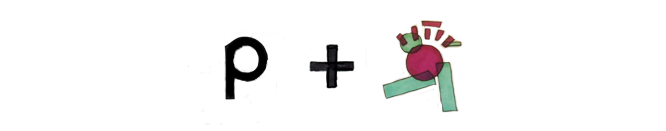
Partie 1
(Le matelot volant, Éviction, occhiolino,
Madeleine, Tongue, Corvine)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
