1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Bandita Films, Les Films du Losange, Rita Productions, Bande à part Films
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
Lionel Baier | France/Suisse | 2022 | 89 minutes | Les incontournables
Nathalie Adler (Isabelle Carré) est une officielle de l’Union européenne dont la mission est d’organiser une visite d’Emmanuel Macron et Angela Merkel dans un camp de migrants. Par pur hasard, son fils Albert (Théodore Pellerin), qu’elle n’a pas vu depuis des années, se retrouve aussi sur les lieux comme bénévole auprès d’une ONG. Sur fond d’une Europe sur le point de craquer, Nathalie doit confronter son passé de mère absente.
La dérive des continents (au sud) débute sur la mise en scène du camp. Celui-ci n’étant pas suffisamment miséreux aux yeux du délégué de Macron (Tom Villa), ce dernier décide donc de le salir un peu, instruisant au passage les Africains à « moins bien parler » français. C’est un peu facile — évidemment que les politiciens sont hypocrites et que les états européens sont racistes —, mais c’est assez drôle (et malheureusement crédible). Très vite, cependant, la crise des migrants est reléguée au second plan et l’accent est plutôt mis sur la relation de Nathalie et Albert, qui n’a toujours pas avalé que sa mère l’ait abandonné durant son enfance pour explorer son attirance envers les femmes. On se demande un peu ce que leur problème personnel vient faire au milieu de tout ça, alors qu’on mentionne à de nombreuses reprises que des cadavres d’enfants se sont échoués sur la plage. Dans l’une des scènes finales du film, une migrante prend la parole lors d’une manifestation opposant l’Union européenne à des militants, les accusant tous autant qu’ils sont de ne jamais considérer les sentiments des exilés. C’est sans doute censé être l’un des moments touchants du récit, mais puisque le film est coupable de la même chose, ayant abandonné les intrigues du camp pendant près d’une heure pour se concentrer sur des Européens, il fait figure de pétard mouillé.
La superposition des enjeux migratoires de l’Europe avec les tourments émotionnels d’Albert et Nathalie ne fonctionne tout simplement pas. En jouant sur ces deux fronts, Lionel Baier s’éparpille jusque dans la contradiction. Par exemple, comment concilier le fait qu’Albert accueille simultanément en lui l’élan progressiste d’une jeunesse ultra-politisée et des tendances réactionnaires héritées de son enfance trouble ? D’un côté, il est un bénévole humanitaire, ainsi qu’un fervent critique des politiques néolibérales de l’Union européenne qui déteste porter autre chose que des Birkenstock parce que les chaussures le font sentir prisonnier; de l’autre, il est aussi machiste, misogyne et homophobe, ne manquant pas une occasion d’insulter le lesbianisme de sa mère ou de lui lancer sans provocation des bouteilles à la tête. Comment alors se situer comme spectateur, lorsque le film semble finalement se déclarer en accord avec la vision politique d’Albert ? Quelle intention se cachait derrière le choix de donner raison au personnage le plus détestable de tous ? Sinon, pourquoi réaliser un film sur la crise des migrants, sans laisser la parole aux migrants ? La dérive des continents (au sud) est une œuvre confuse. (Antoine Achard)

prod. Jeonwonsa Film
THE NOVELIST'S FILM [SE-SEOL-GA-UI YEONG-HWA]
Hong Sang-soo | Corée du Sud | 2022 | 92 minutes | Les incontournables
Avec In Front of Your Face l’an dernier, Hong Sang-soo semblait faire le point sur sa carrière dans un film-somme, tout en douceur, qui exposait sans en avoir l’air la philosophie alimentant son cinéma. Cette dimension réflexive est présente dans nombre de ses films, la frontière entre la vie et l’art étant peu étanche chez lui, ce qui est devenu encore plus évident ces dernières années depuis son divorce et sa liaison médiatisée avec sa nouvelle actrice de prédilection, Kim Min-hee. Nous retrouvons à nouveau celle-ci dans The Novelist’s Film, alors qu’elle joue essentiellement son propre rôle, une star qui semble avoir disparu des écrans, du moins pour celles et ceux qui ne suivent pas le cinéma indépendant sud-coréen (depuis sa révélation sur la scène internationale dans The Handmaiden de Park Chan-wook en 2016, elle n’a tourné qu’avec Hong). Cet entremêlement entre le cinéma et le réel est encore ici au cœur du récit, centré sur une écrivaine (Lee Hye-young, la protagoniste d’In Front of Your Face) qui, après avoir rencontrée l’actrice dans un parc, lui demande de jouer pour elle, le film se composant d’une suite de discussions entre divers personnages croisés par hasard. Cette prémisse est des plus typiques du cinéaste, pour ne pas dire clichée rendu à ce point de sa carrière, et il n'y a effectivement rien de bien nouveau dans ce vingt-septième film, sinon l’impression que Hong regarde ses premiers essais (qui mettaient presque toujours en scène des cinéastes) avec une sérénité nouvelle, typique de ses dernières œuvres.
Quand l’écrivaine parle de son projet, en disant vouloir privilégier une narration simple, quotidienne, qui servirait d’écrin pour révéler des moments vrais, survenant naturellement entre les acteur·rice·s, nous entendons évidemment Hong décrire sa propre démarche, qu’il a déjà maintes fois expliquées au fil des années. The Novelist’s Film se regarde ainsi comme une énième variation sur les thèmes privilégiés de l’auteur, ce qui peut certes sembler redondant. Mais s’il est vrai que la ligne est mince entre la paresse scénaristique et l’exploration de la répétition, les fans du cinéaste s’attendant chaque année à peu près au même film, avec quelques nuances nouvelles; il y a aussi un plaisir et un réconfort à retrouver les mêmes acteurs, les mêmes actrices surtout (le cinéma de Hong est devenu résolument féminin depuis quelques années), et le même genre de discussions autour d’une table garnie de nombreuses bouteilles d’alcool. Et dans toutes ces nouvelles itérations du même schéma, nous trouvons presque toujours au moins un moment de pure beauté, une de ces « vérités » dévoilées sur l’âme humaine, surgissant ici à la toute fin du film, à la faveur d’une rupture formelle inattendue. La simplicité des moyens par laquelle Hong arrive encore à éveiller les émotions les plus grandes nous rappelle à tous coups que ce cinéma, aussi prévisible soit-il devenu, demeure des plus essentiels à la santé de notre cinéphilie, qui doit s’y abreuver chaque année. (Sylvain Lavallée)

prod. Arte France Cinéma, Bayerischer Rundfunk, Coproduction Office, Ulrich Seidl Filmproduktion, Essential Films, Parisienne de Production
SPARTA
Ulrich Seidl | Autriche/France/Allemagne | 2022 | 98 minutes | Les incontournables
Cela faisait un moment que Seidl ne s’était pas attelé à la fiction (même si son cinéma documentaire — voir Safari [2016] — reprenait déjà nombre de ses lubies). Or, pour un artiste chevronné comme lui, c’est un peu comme remonter à vélo, et cela se voit d’emblée, dès ce premier plan, d’un cynisme cru, où il cadre de façon frontale une chorale de vieux dans un hospice, des êtres amochés par la vie, distinctement pathétiques, dont on s’amuse un peu mesquinement de la condition déliquescente. Or, c’est au fils de l’un de ces vieillards semi-déments, aux tendances hitlériennes résurgentes, que s’attache le récit : Ewald (tendre et visqueux Georg Friedrich), frère du protagoniste de Rimini (2022) — les deux films devant originalement constituer une seule et même œuvre. Ewald est un homme timide, troublé, à la petite voix claire et cassante, torturé par un désir indicible pour les jeunes garçons qu’il finira par assouvir dans un petit village de Transylvanie, où il construira son propre Neverland (un dojo nommé Sparta), avec l’aide d’un groupe d’enfants sélectionnés parmi la populace locale.
Le réalisateur de Dog Days (2001) et de la trilogie Paradise (2012) n’a jamais fait dans la dentelle, et ce n’est pas le cas ici non plus. Il transpose ainsi subrepticement, dans des plans fixes savamment composés, le cynisme réservé aux maisons de soins autrichiennes dans la représentation d’une Roumanie aux sombres accents post-soviétiques. Cadrant son protagoniste dans des bords d’autoroutes glauques, des bars déprimants où on joue du synthétiseur en buvant sa peine, des avenues commerciales décrépites et des zones industrielles oppressantes aux couleurs vert-de-gris, l’auteur brosse le portrait d’une solitude et d’une errance que seul peut guérir l’assouvissement d’une pulsion secrète esquissée à gros traits. En effet, si Ewald observe de son véhicule des jeunes garçons qui jouent au soccer, s’il participe spontanément à des batailles de boules de neige avec eux, s’il s’amuse à la lutte avec ses beaux-frères d’âge scolaire, s’il n’arrive pas à bander au contact de sa sulfureuse fiancée roumaine, c’est qu’il doit être un pédophile, non ? Or, bien qu’on cultive une certaine ambiguïté à ce sujet, à savoir qu’on ne montre jamais à l’écran d’agression ou d’attouchement sexuel à proprement parler, l’accomplissement de la quête du protagoniste provoque moult malaises chez le spectateur. Au-delà des allégations de maltraitance lancées par le journal en ligne Der Spiegel, il faut croire que l’idylle salvatrice d’Ewald, représenté ici comme une sorte de héros tragique, implique des scènes où de jeunes garçons en caleçons mouillés s’adonnent à la lutte gréco-romaine, où ils prennent leurs douches avec leur sensei, et où ce dernier mire avec insistance des photos de leurs corps à moitié nus glanés en rafale avec son téléphone. Mais n’est-ce pas justement le malaise qui est si porteur dans le cinéma de Seidl, si révélateur des travers d’une humanité crépusculaire ? Certes, et bien que cela permette ici une étude de personnage relativement inédite, on préfère sans doute le voir cracher son venin sur ses cibles de choix habituelles, les banlieusards de Dog Days par exemple, ou les bourgeois colonialistes de Paradise : Lost ou de Safari. Pour une sorte de causticité utile, plutôt que simplement lucide. (Olivier Thibodeau)

prod. Institut national de l'image et du son
PARADOXE
Aimé Majeau Beauchamp | Québec | 2022 | 12 minutes | RPCÉ
Dans le cadre des rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant, six courts métrages produits et réalisés par les finissant·e·s de l'INIS étaient projetés à la Cinémathèque québécoise. Le documentaire s'étant le plus démarqué est Paradoxe, qui présente le cheminement d'une femme trans avec toute la douceur et l'humilité propres à sa personne. Laure/Lucas est née avec un sexe masculin et a grandi à Rimouski; le racisme suscité par ses origines asiatiques, le sentiment diffus d'inadéquation et la toxicomanie ont profondément marqué cet individu résilient pour qui une overdose a tout changé. La prise de conscience de sa transidentité s'est imposée peu de temps avant le tournage, et nous la rencontrons alors qu'elle en est à son deuxième mois de prise d'hormones. Le style posé et somme toute classique du reportage est judicieux en ce qu'il évite la spectacularisation de son sujet, qui ne concorde pas avec les clichés de l'exubérance trop souvent associés aux personnes queer. Posée, celle qui avoue avoir tenté si fort d'incarner « ce dude cool tatoué » raconte l'émancipation de sa personnalité à la caméra, admettant qu'elle continue à subir l'oppression, notamment à travers l'idée reçue du changement de sexe comme finalité, opération que Laure estime pour l'instant facultative à son processus. À quiconque n'aurait pas encore compris que les personnes trans sont des gens comme les autres et ne souscrivent à aucune case prédéfinie, ce beau film de Majeau Beauchamp constitue une leçon dont le sens est également induit par d'élégantes séquences musicales. Baignant dans le noir, éclairée d'une lumière éthérée, Laure est alors seule avec sa contrebasse, sa basse ou son équipement de DJ, se laissant aller à sa passion dans l'intimité d'un for intérieur préservé de tout impératif normatif — la musique, ses sons affranchis de la langue, ne porte aucune marque de genre, de sexe, d’ethnicité. (Anthony Morin-Hébert)
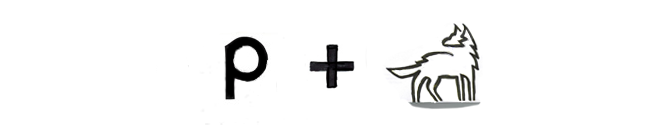
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
