
prod. Troma Entertainment / Saturday Candy Films
OCCUPY CANNES
Lily Hayes Kaufman | États-Unis | 2025 | 89 minutes | Documentaries from the Edge
On dira ce qu’on voudra, Troma sait se raconter. Certes, le « plus vieux studio indépendant américain » n’occupe plus l’espace crânien qu’il imposait dans les années 80 et 90 (nonobstant l’hommage que lui dédie Ken’ichi Ugana avec I Fell in Love with a Z-Grade Director), mais c’est précisément le passage du temps qui s’avère être le sujet souterrain d’Occupy Cannes. Il s’agit d’un film mû par un désir de préserver ces moments qu’on ne savait précieux, de même que par la mission de réinscrire la réputation des studios de Hell’s Kitchen dans la petite histoire du cinéma. Le documentaire flirte avec l’hagiographie et emprunte certains raccourcis affectifs, mais Lily Hayes Kaufman, fille de Lloyd, y admet son biais et soulève quelques questions pertinentes : son père se complaît-il dans un complexe de la persécution ? Le studio Troma a-t-il encore sa place dans la culture d’aujourd’hui ?
Composé d’images captées lors des éditions de 2013 et de 2017 du Festival de Cannes — où Troma tente de vendre Return to Nuke ’Em High Volume 1 et Volume 2 à grand renfort de tactiques de marketing guerilla nommées #OccupyCannes — l’ensemble souffre d’une narration quelque peu maladroite, mais sa qualité croquée sur le vif est sympathique. Le documentaire intéresse de par son décor qui témoigne de la transformation du Festival de Cannes depuis 2013 : l’omniprésence des majors américains sur la Croisette, la militarisation de la police en France, et un certain changement de cap dans les politiques du bon goût qui investit la présence même de Troma à Cannes d’une qualité anachronique — un vestige caoutchouteux d’une époque plus naïve. À son meilleur, le film de Lily Hayes Kaufman brosse le portrait d’une industrie face au point de non-retour quant au monopole des plateformes et des grands studios. En passant de la suite du Carlton qu’il occupait à ses débuts au sous-sol du Palais qu’il loue « comme tout le monde », il y a dans la trajectoire de Lloyd Kaufman le récit en miniature de tout un pan du cinéma indépendant, qui doit désormais se trouver une place de plus en plus ténue dans les marges d’une industrie davantage technocratique, conglomérée et consensuelle.
Certes, un œil plus critique devrait souligner l’approche bornée et rébarbative de ce Kaufman fortuné et privilégié, la culture d’entreprise pour la moins douteuse de son studio, son refus de se réinventer, son recours à des armées de bénévoles fanatiques, ou son manque de tact général. Comme dans plusieurs arènes du cinéma de genre, cette marginalité revendicatrice devient sa propre prophétie défaitiste, mais l’évidence s’impose : si ce n’est des punks de Troma, qui confronterait encore les mesures draconiennes de la police à Cannes ? Qui oserait être diamétralement opposé à tout ce luxe obscène, à cette bienséance élitiste ? À chacun sa place, pourrait-on rétorquer. « Les films devraient être meilleurs ». On s’en fout, idem ici : on n’espérait pas tant de pistes de réflexion d’Occupy Cannes. (Ariel Esteban Cayer)

prod. Independant Film Company / Shudder / et al.
QUEENS OF THE DEAD
Tina Romero | États-Unis | 2025 | 101 minutes | Sélection 2025
Alors que les morts-vivant·e·s s s’entassent dangereusement dans les rues de New York, une poignée de survivant·e·s se retrouve dans un warehouse party de Bushwick que galérait déjà à gérer Dre (Katy O’Brian, récemment aperçue dans Love Lies Bleeding [Rose Glass, 2024]) avant le tournant apocalyptique de sa nuit. Regroupé·e·s devant un téléjournal, les drag queens émérites et les nouvelles recrues qui devaient performer ce soir-là, les employé·e·s et quelques intrus (un plombier hétéro ; une Margaret Cho à l’air quasi-militaire, plutôt comique) assistent au discours d’un président états-unien fantoche qui dénie l’urgence de la situation par une phrase rapidement balancée : « Nous ne sommes pas dans un film de George Romero. » Sous l’évidence de la boutade, c’est toute une question d’hérédité, une interrogation du passage intergénérationnel des formes du cinéma de genre qui se joue dans Queens of the Dead, premier long métrage de Tina Romero, la fille du réalisateur regretté de Night of the Living Dead (1968) qui propose une ultime succession à la série de films entamée par le père.
Il y a un geste d’abord réjouissant dans cette relecture familiale de la structure conventionnelle du film de zombie, qui se présente seulement à demi-fidèle en optant ici pour un ton plus ouvertement comique, et qui resitue son action dans un espace communautaire queer, comme l’extension des huis-clos dans lesquels s’installaient la majorité des of the Dead qui l’ont précédé. Le récit de zombie a souvent été une façon d’interroger nos manières de gérer nos (demi-)mort·e·s. Ici, l’hésitation usuelle devant l’obligation d’éliminer les proches transformé·e·s prend une forme encore plus signifiante dans ce lieu qui travaille précisément à tenter de garder en vie un sentiment fragile de collectivité, comme l’énonce le personnage de Margaret Cho en découvrant la morsure sur la peau d’une amie : « You’re with us until you’re not with us. »
Il s’agit d’un film parfait pour Fantasia, qui trouvera certainement ses conditions idéales de projection devant la foule miauleuse du grand amphithéâtre du Hall. Qui plus est, Queens of the Dead a probablement besoin de ce genre de public aux réactions généreuses pour lui insuffler l’ardeur absente de sa mise en scène qui réside trop souvent elle-même à la lisière entre l’inerte et l’entrain, à l’image de ses zombies errants scotchés sur l’écran de leur téléphone. En témoigne l’usage d’une bande-son quasi-constante qui tente de soutenir le rythme boitillant d’une intrigue trop classique, qui s’affaire surtout à piger dans un répertoire de scènes coutumières — mort sacrificielle, séquence de makeover précédant la bataille — sans pour autant développer un renouvellement de ces formes. On se demande en somme ce que le film propose comme philosophie du genre : s’agirait-il seulement d’appliquer des codes répétés par centaines sur des corps neufs en attente d’y être inclus ? (Thomas Filteau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 2 août à 21h30 (Théâtre Hall)

prod. High Frequency Entertainment / MeMo Films / Twin Pictures
LURKER
Alex Russell | États-Unis | 2025 | 100 min | Sélection 2025
Sachez-le d’entrée de jeu : regarder Lurker, c’est accepter d’avoir le cœur qui pulse dans la gorge pendant 1h40. Ça n’a aucune importance, que le récit à l’écran soit une fiction, qu’il soit interprété par des acteurices. Ça n’a aucune importance, que l’histoire du film, qui porte en apparence sur la notoriété des stars, semble triviale. Si vous avez un jour fait l’expérience de l’anxiété sociale, de la peur d’être rejeté·e ou mécompris·e ; si un jour vous avez ri avec vos tortionnaires quand on vous a humilié parce que ne pas sourire signifiait sortir du régime du jeu ; si vous avez douté d’être aimé·e réellement ou craint d’être remplaçable, Lurker va vous courir sous la peau de manière insupportable. Et je vous promets que vous aimerez ça.
Lurker raconte l’histoire de Matthew, un jeune homme taciturne qui travaille dans une boutique de vêtements. Il rencontre Oliver, vedette musicale montante (prétexte diégétique qui donne au réalisateur l’occasion d’intégrer à son long métrage de magnifiques images de vidéoclips) qui l’intègre rapidement dans son cercle étroit. D’abord bizuté par le groupe, Matthew devient vite indispensable. C’est qu’il a fait ses devoirs et qu’il est prêt à beaucoup de sacrifices (au nombre desquels sa dignité) pour accéder à ce statut, et à encore plus pour le conserver.
Si j’hésite à en dire d’avantage, c’est pour préserver la tension narrative (habilement maintenue), mais aussi parce qu’au fond, ça a peu d’importance. Alex Russell pourrait nous raconter à peu près n’importe quoi qu’on s’y intéresserait. C’est dû entre autres au jeu impeccable des acteurices. Théodore Pellerin et Archie Madekwe y sont deux géants s’affrontant dans l’arène de la subtilité. Le premier arrive d’ailleurs à accomplir le tour de force qui consiste à créer un personnage à la fois tout sauf aimable et immensément attachant.
Mais Lurker ébranle aussi par le raffinement avec lequel il dissèque la nature transactionnelle des relations humaines. Ce qui en fait le sel, c’est sa capacité à mettre en lumière avec énormément de finesse tous les enjeux micropolitiques qui régissent les relations interpersonnelles et la manière dont y circule le pouvoir, même diffus, même nié. C’est d’ailleurs précisément au moment où le lien qui unit (et enchaîne ?) Matthew et Oliver se renverse et se transforme pour devenir explicite que le film gagne en profondeur. Interrogeant d’abord la ligne fine et parfois trouble qui sépare le désir d’être quelqu’un et le désir d’être avec quelqu’un, Lurker se métamorphose alors en questionnement sur les dynamiques d’interdépendances sans avoir peur de regarder ce qu’il y a de plus vulnérable, de laid et de sensible en chacun·e de nous. (Laurence Perron)
$POSITIONS
Brandon Daley | États-Unis | 2025 | 98 minutes | Sélection 2025
$POSITIONS est un film cruel qui se complaît dans un humour noir corrosif, gratuitement. À l'instar d'un petit intimidateur de cour de récréation, il ridiculise les travers de ses personnages et annihile le moindre éclat de lumière — pour le bonheur d'un certain public, probablement.
Crédule et égoïste, Mike enchaîne les mauvaises décisions motivées par une dépendance au jeu qui le mène à tout miser (et perdre) sur un marché décentralisé de cryptomonnaies. Les extraordinaires fluctuations de ses investissements en font tantôt un seigneur arrogant, tantôt une loque qui n'hésite pas à exploiter ses proches pour arriver à ses fins, aussi glousse-t-on lorsque la disgrâce s'abat sur le jeune homme ; mais les malheurs accablant les personnages vulnérables de son entourage et les blagues qu'ils suscitent dénotent bien vite l'acharnement. Le père endeuillé qui a sombré dans l'alcool se mérite la défiguration et une mort pathétique, la jeune nièce est abandonnée, le frère handicapé se fait constamment oublier (puis ne constitue finalement qu'un ressort scénaristique bien commode) et la conjointe à qui on impose un couple ouvert est dépeinte comme une traînée parce qu’elle s'abandonne au libertinage. Quant au cousin ex-toxicomane, on s'amuse beaucoup du laxisme de sa sobriété, de son combat contre la rechute et de sa rédemption dans la foi chrétienne. Bref, les femmes, les enfants, les personnes souffrant de déficience intellectuelle ou de dépendance sont malmené·e·s, privé·e·s d'agentivité et d'épanouissement, et je m'explique mal l'intérêt d'une telle violence. Sans doute prétend-on singer la rhétorique sardonique qui est celle des trolls férus de cryptomonnaies, car comme dans les communautés caustiques à la r/wallstreetbets, les échecs monétaires sont célébrés par une méchanceté carnavalesque, on s'enorgueillit de rire des interdits et on se délecte des gags poussés trop loin — plusieurs, franchement réussis, sont répétés jusqu'à l'épuisement.
De fait, la tension que le film tente d'établir tombe souvent à plat puisque les enjeux sont tellement banalisés par les railleries du cinéaste qu'on se contrefout du sort du protagoniste et de sa quête. Beaucoup comparent déjà le film de Daley au Good Time (2017) des frères Safdie, mais la ressemblance me semble s'arrêter au lâche calque du schéma narratif — car contrairement à son homologue, $POSITIONS est déshumanisant, dénué de réelle portée critique et d'intérêt formel, puis l'énervement qu'il suscite tient moins d'un talent à déranger que de la bêtise creuse et suffisante. (Anthony Morin-Hébert)

prod. Bazelevs / Screenlife Liverpool
LIFEHACK
Ronan Corrigan | Royaume-Uni, Chypre | 2025 | 93 minutes | Sélection 2025
Timur Bekmambetov a popularisé le format du « screenlife film » en produisant Unfriended (2014), Unfriended: Dark Web (2018) et Searching (2018) ; le voici qui revient à la charge en présentant LifeHack, premier long métrage du jeune Irlandais Ronan Corrigan qui tente de renouveler le screenlife en délaissant l’horreur et l’enquête pour le genre du film de cambriolage… et qui remporte son pari haut la main.
C'est donc à travers l'interface des écrans de l'ordinateur et du téléphone de Peter que l'entièreté du film se déroule. La vie du jeune décrocheur de 17 ans tourne autour de son groupe d'ami·e·s avec qui il traîne sur Discord et s'amuse à planter des honeypots pour piéger des escrocs. Par défi, et excité par une insouciance tout adolescente, le quatuor développe une petite combine qui le mène à enchaîner les vols d'identité, puis à s'empêtrer dans un plan foireux impliquant un vol de 25 millions de dollars en cryptomonnaie. Petit à petit, les codes du caper movie s'accumulent en bonne et due forme, nous laissant en terrain connu : chaque membre du groupe possède sa propre expertise (l'idéateur, le voleur, la forgeuse d'identité, l'intello) ; des cartes sont étudiées, un lieu hautement sécurisé doit être pénétré ; et un imprévu survient toujours lorsque les choses paraissent réglées. Mais cette fois, voilà, tout passe par écrans interposés, donc on écrit des courriels et fouine sur Instagram pour accumuler les informations essentielles, on épie en piratant des caméras de surveillance et on déploie tout un attirail d'applications et de logiciels pour simuler, déformer, déguiser, traquer, voler.
L'efficacité du film vient surtout de son habileté à développer une tension par l'effervescence de son rythme et des stimuli lors des séquences de vols. Le montage est alors frénétique, les impressions de travellings et de zooms (qui sont en fait des recadrages) foisonnent et les signes visuels s'accumulent — le texte apparaît et disparaît à une vitesse fulgurante, les photos et icônes en tous genres parasitent le cadre, les mouvements du curseur donnent le tournis. Et tous ces éléments se superposent dans différentes fenêtres numériques donnant à voir le visage des quatre bandits (en visioconférence) en même temps qu'une page Web défile, qu'une fenêtre de clavardage dort en arrière-plan, qu'un minuteur égraine les secondes fatidiques et que Spotify bat la cadence (avec une musique haletante, excellente, signée Two blinks, i love you).
Au fond, LifeHack réinvente moins qu'il transpose : prenez Sneakers (1992), Hackers (1995) et Swordfish (2001), passez-les à la moulinette gen-Z et vous obtenez un joli film de techno-cambriolage représentatif de notre époque et de nos rapports aux dispositifs numériques. Cette vitesse et cette saturation sont bien celles de notre culture ultra-connectée, dopée aux personnalités publiques survoltées, mais aussi marquée par d'importantes disparités de littératie numérique. Bekmambetov se présente comme le prophète d’un nouveau type de cinéma dont le screenlife (pour lequel il a forgé le néologisme et dont il a par ailleurs écrit un manifeste) constituerait l'avènement, mais j’admets rester méfiant face à cette païenne parole, m'attendant à un épuisement prochain de cette formule. Ses importantes limitations persistent dans le film de Ronan Corrigan — les contacts et l'espace physique, la profondeur émotionnelle, la lenteur et la contemplation sont difficiles à développer —, mais l'inventivité du réalisateur et de sa co-scénariste (Hope Elliott Kemp) leur permet de contourner certaines de ses lacunes pour faire perdurer la vague des films d'interfaces et, du même coup, nous livrer une œuvre électrisante. (Anthony Morin-Hébert)

prod. Stuntman Film Production
STUNTMAN
Herbert Leung, Albert Leung | Hong Kong | 2024 | 114 minutes | Sélection 2025
Nous savons bien que les séquences d’action incroyables du cinéma hongkongais des années 1980 et 1990 ont été rendues possibles au prix de nombreuses blessures, membres cassés et commotions cérébrales. Des accidents racontés généralement avec bonne humeur par les praticien·ne·s de ces films (du moins aujourd’hui, avec le bénéfice de la distance temporelle, sur nos suppléments de Blu-ray), qui les présentent tels des gages d’un dévouement entier au septième art et de la qualité supérieure de ces scènes impossibles à reproduire. Mais nous devinons à travers ces anecdotes que les conditions de tournage ne devaient pas toujours être particulièrement agréables. C’est, en partie, le sujet de Stuntman, mettant en vedette Stephen Tung, plus ou moins dans son propre rôle de chorégraphe et de vétéran de l’industrie (il a travaillé notamment avec John Woo sur A Better Tomorrow, Tsui Hark pour Peking Opera Blues et Wong Kar-Wai sur ses premiers films). Tung interprète Sam Lee, un action choreographer réputé pour mettre ses acteur·trice·s en danger, qui est engagé une dernière fois par un vieil ami pour tourner un hommage à l’âge d’or du cinéma hongkongais. La table est mise pour une confrontation entre cet art révolu et des façons de faire modernes — mais ça ne sera pas exactement le film que nous attendons.
En effet, Stuntman tient beaucoup plus du mélodrame : Sam vit avec une erreur du passé, un accident majeur dans une cascade mal exécutée, mais il s’est aussi éloigné de sa fille parce qu’il privilégiait son travail. Pour son nouveau contrat, il entame une amitié avec Lee Sai Long (Terrance Lau), un admirateur qu’il emploie pour l’aider à la coordination de l’action, mais qui se méfie rapidement des méthodes trop dures de son mentor. Le scénario multiplie ainsi les situations qui répètent un même conflit, alors qu’on nous répète encore et encore que la vie est plus importante que le cinéma. En même temps, quand Sam est confronté à des chorégraphes contemporains, c’est à peine si nous arrivons à sentir la différence entre les deux approches : pour ce que nous en voyons, ces séquences d’action ne sont pas tellement moins réussies que celles d’autrefois, seulement tournées de façon plus sécuritaire, sans exploiter l’équipe en exigeant des heures supplémentaires et des demandes impossibles. Si le résultat est similaire, il est donc difficile de comprendre où se situe le dilemme (c’est évident qu’il vaut mieux protéger les travailleur·euse·s). Bref, il faut plutôt utiliser notre mémoire de cinéphile pour combler ce que le film lui-même n’arrive pas à dramatiser, en nous rappelant de ces séquences époustouflantes toujours inégalées. Tout cela contribue à nous détourner de la dimension réflexive du sujet pour nous concentrer sur le drame humain sirupeux, d’autant plus que nous voyons très peu les scènes tournées par l’équipe de Sam (après l’introduction en pastiche de Police Story, l’action demeure souvent hors champ).
Bien que cela comporte une part de déception, Stuntman n’est pas sans charme, surtout grâce à ses interprètes, Tung en premier lieu, qui traîne avec lui une belle mélancolie et les souvenirs de cette époque glorieuse. Sa seule présence apporte à la proposition une authenticité qu’elle peine à créer autrement. Même si on insiste beaucoup (avec raison, sans doute) sur les conditions de tournage déplorables de l’âge d’or hongkongais, il se dégage de l’ensemble un amour indéniable pour cette période — au point que le film n’a pas le choix, dans sa finale, de contredire sa propre rhétorique et de célébrer « l’esprit hongkongais » par une dernière cascade qui risque tout au nom de l’art. Là aussi, la scène déçoit. Et pourtant, cet échec à filmer l’action de manière pleinement satisfaisante nous rappelle l’écart entre hier et aujourd’hui et participe à raviver notre nostalgie, à défaut de la combler. (Sylvain Lavallée)
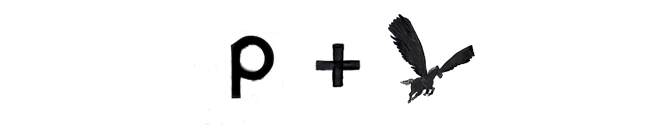
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(Occupy Cannes, Queens of the Dead,
Lurker, $POSITIONS, LifeHack, Stuntman)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
