prod. Detour Filmproduction / Cinetic Media
BLUE MOON
Richard Linklater | États-Unis / Irlande | 2025 | 100 minutes | Les incontournables
Difficile de ne pas aborder un nouveau film de Richard Linklater sans un horizon d'attente déjà solidement établi ; on anticipe de longues discussions marquées par un mélange de chaleur et de langueur, un récit intime qui prend son temps pour atteindre quelque chose de profond en nous, en toute simplicité mais avec une efficacité désarmante. Blue Moon est tout cela, même s'il peine à reproduire le charme de certains de ses prédécesseurs.
Déjà, le protagoniste est dur d'approche, caractérisé par une grande complexité qui se révèle lentement au fil des discussions. Lorenz Hart a véritablement existé : parolier de grand talent, il forma une collaboration exclusive avec le même compositeur, Richard Rodgers, durant deux décennies lors desquelles ils créèrent une foule de pièces musicales à succès. Les graves problèmes d'alcool de Hart eurent toutefois raison de la relation entre les deux hommes et Rodgers se tourna vers un autre parolier. La popularité de leur première œuvre fut écrasante et éclipsa tout le travail de Hart ; Blue Moon nous situe le soir de première de cette comédie musicale. L'auteur solitaire, malade de jalousie, se réfugie dans un bar enfumé où les rencontres heureuses comme douloureuses rythment le récit. Les discussions effrénées prennent la forme de jeux et de duels dévoilant l'ambiguïté d'un individu qui dissimule son profond mal-être par des logorrhées pétillantes d'aplomb. À coups de citations et de méditations sur l'amour, de réflexions sur l'art et d'anecdotes entrecoupées de blagues de pénis, le personnage de Lorenz Hart érige une façade d'outrecuidance qui devient vite insupportable — faites-le taire quelqu'un ! — avant de s'effondrer de manière pathétique face aux rejets et à la pitié des personnes qui comptent pour lui.
La déconfiture est poignante et bien ficelée, mais elle n'excuse pas pour autant les tares du personnage, tragique. Ethan Hawke est impeccable dans son interprétation, tout comme ses interlocuteur·ices (Andrew Scott a remporté l'Ours du meilleur acteur de soutien) ; l'ambiance feutrée établie par le décor et la musique jazzy, l'élégante mise en scène ainsi que la qualité des dialogues sont tout aussi irréprochables. Pourtant, malgré tout cela, le film peine à nous atteindre. On passe un bon moment lors de son visionnement, mais son propos semble dépassé, vieux jeu, et se dissipe vitement au sortir de la salle. Dans sa forme comme dans son fond, Blue Moon est une célébration de l'art du verbe et d'une manière révolue de toucher les publics — la complainte de Lorenz Hart, éternel amoureux décriant le succès de ses adversaires, est aussi celle de tout un pan de créateurs et critiques pleurant encore aujourd'hui la disparition d'un style d'œuvres qu'ils fétichisent au profit de nouvelles pratiques jugées inférieures car superficielles. Mais les arts, le cinéma et le monde continuent d'évoluer, imperturbablement, et le repli vers le passé n'améliorera pas leur sort. (Anthony Morin-Hébert)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2025
Prochaine projection : 17 octobre à 18h00 (Université Concordia)

prod. Rosa Filmes / Andergraun Films / BlackCap Pictures
MAGELLAN (MAGALHÃES)
Lav Diaz | Portugal | 2025 | 156 minutes | Les incontournables
D’une rive à l’autre, Magellan commence comme il se termine. D’un massacre à l’autre, Magellan porte sur l’histoire coloniale, sa pulsion de territorialisation, son extractivisme matériel et humain. D’une jungle à l’autre, nous voilà bien chez Lav Diaz, qui pour la première fois tourne avec les moyens ambitieux que lui prête Albert Serra à travers sa compagnie de production et son habituel directeur de la photographie et monteur, Artur Tort, là pour aider le maître philippin, abonné aux tournages de pauvreté où il tient lui-même sa caméra et monte seul ses innombrables heures de métrage. Dans Magellan, Diaz tourne donc avec des moyens ambitieux un film qui porte précisément sur cela, les moyens des ambitions.
Conséquemment, le cinéaste fait reposer son film sur une star, Gael García Bernal, la première vedette internationale de son cinéma, qu’il se refuse pourtant à filmer comme telle. L’unique gros plan qui lui est dédié vient d’ailleurs briser brillamment l’esthétique picturale, faite d’éloignements, de corps éparpillés, que l’ensemble du film travaille dans une sorte d’état de fait à démontrer dans toute sa splendeur morbide. Dans cet unique gros plan, Diaz vient en quelque sorte parachever le pari de sa mise en scène, qui peinture sur ces rives inconnues comme un tableau grotesque de cuirasses européennes ensanglantées, entraperçues à travers l’écume des vagues, reconnaissables à travers des dépouilles autochtones, des lances, des étoffes déchirées, de la matière et de la vie gaspillées.
Car si la survie dans un monde hostile a toujours été au cœur du cinéma de Diaz, jamais un de ses films n’a semblé aussi obsédé par la survie, celle ici en haute mer de ces marins qui prient pour leurs péchés, à espérer voir une terre en vue avant leur dernier souffle. Magellan porte sur les voyages du navigateur d’abord mandaté par les Portugais puis par les Espagnols pour trouver une nouvelle route des épices qui ne soit pas déjà surveillée. Le tour de Magellan sera la première circumnavigation, en passant par la pointe méridionale de l’Amérique du Sud avant d’aboutir aux actuelles Philippines, sur l’île de Mactan. Entre les intérieurs sobres, éclairés comme des toiles hollandaises de natures mortes, où la richesse vaniteuse du clergé scintille et vient capter le regard qui parcourt des compositions épurées, et l’extérieur luxuriant des Philippines, avec ses peuples revêtant leurs bijoux dorés, leurs étoffes aux motifs complexes et protégeant leurs idoles religieuses, Diaz signe un très grand film sur la matière coloniale de l’histoire, c’est-à-dire non seulement sur ce sujet critique mais aussi sur tout l’univers esthétique d’où il est issu (la quête des épices, des textiles, de l’emprise ecclésiale) et qu’il a ensuite engendré (l’exploitation transversale et totale des peuples rencontrés).
Magellan représente ainsi un film majeur dans une filmographie incontournable, une sorte d’œuvre charnière car le cinéaste, avec les moyens de tourner sur une caraque et de le faire avec un acteur adulé (et extraordinaire en Magellan convaincu de sa voie) n’a certainement jamais été aussi accessible, tout en n’ayant jamais été aussi près du cœur noir de tous ses films précédents, avec une clarté d’expression, une plasticité quasi didactique qui procure un authentique souffle épique à toute cette entreprise sans pour autant que son cinéma ne se perde dans ses ressources. La culpabilité des personnages, la luxure dans laquelle baignent les ordures, la lecture du roman historique philippin comme une série de traumas à exorciser, rien n’est absent de cette œuvre plutôt courte (pour Diaz) et qui sonde la folie à travers un voyage pourtant bien long, comme si le cinéaste souhaitait aussi enlever aux colons la gloire de l’insistance interminable (qui est toujours chez lui un hommage à la résilience philippine), n’en gardant que l’autodestruction, celle d’une bande d’hommes avides, prisonniers d’un navire trop petit pour leur appétence insatiable.
Quand l’équipage arrive à destination et que la matière coloniale (les drapeaux, la coque, les armures) se frotte à la culture native et ses rites, c’est comme si nous savions qu’ils étaient débarqués chez Lav Diaz et qu’à partir de cet instant nous pouvions lui faire confiance pour qu’il referme inexorablement son piège sur eux. Voilà, enfin, 127 ans après les premières actualités des Lumière tournées en terres colonisées (par l’Espagnol Antonio Ramos), la vengeance du cinéaste asservi, empêtré par cet art trop coûteux qu’est le cinéma, là à brandir sa force, à raconter le contrechamp de ces histoires qui ont fondé le cinéma et qu’il refonde à son tour, en présentant le point de vue des « ténèbres » de Joseph Conrad, la caméra sise à l’intérieure de la gueule du monstre dévoreur de colons. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival de Cannes 2025
Prochaine projection : 17 octobre à 18h15 (Cinéma du Parc)

prod. SBS Productions / Atoms & Void / et al.
TWO PROSECUTORS
Sergueï Loznitsa | France / Allemagne / Pays-Bas / Lettonie / Roumanie / Lituanie | 2025 | 118 minutes | Les incontournables
Des mains débarrent un lourd cadenas, puis deux grandes portes de fer s’ouvrent pour laisser entrer une file de prisonniers malingres dans un pénitencier russe de 1937, « au faîte de la terreur stalinienne » (je paraphrase). Le film nous invite à les suivre, au sein d’une diégèse carcérale dont nulle échappatoire n’est possible, à l’image de cette URSS d’hier qui commence à paraître étrangement familière. Les corps fragiles des détenus, qui se posent péniblement sur des billots de bois près de l’entrée, et dont le contremaître ironise qu’ils ont besoin de trois assistants pour les faire marcher, suggèrent déjà une maltraitance systémique ; l’esthétique froide, exsangue, évoque un monde drainé de son âme, asservi à l’ascétisme soviétique ; le faciès imperturbablement cruel et balafré des nombreux geôliers nous inspire un règne de terreur inextricable. Loznista multiplie allègrement les gros symboles, et, en cela, il s’approprie la caricature propagandiste de l’époque, au sein d’un film sèchement cynique sur les aléas d’un monde répressif, anthropophage, aux troublants échos contemporains.
Ce n’est pas un hasard s’il nous fait passer la première moitié de son film en prison, alors qu’un jeune procureur idéaliste, Kornev (Alexandre Kouznetsov), fraie son chemin auprès de ses pontifes intransigeants, au fil d’interminables corridors aux couleurs blafardes, à la recherche d’un docte prisonnier politique qu’il souhaite interroger à propos de mauvais traitements potentiels subis aux mains du NKVD. Le protagoniste est inspirant, rassurant, une lueur d’espoir dans la grisaille ambiante. On apprécie sa volonté de fer, sa capacité à tenir tête aux officiels corrompus, à faire respecter la loi, mais on comprend vite où son idéalisme va le mener. À le voir arpenter le labyrinthe de couloirs sales aux murs émiettés, le voir passer les innombrables cloisons de fer sous le regard désapprobateur des gardes, le voir s’attirer les foudres de trois cadres à la mine patibulaire, le voir patauger dans ce microcosme glauque de la bureaucratie disciplinaire soviétique, on sait très bien qu’il est foutu d’avance. Notre esprit rationnel le conçoit parfaitement, mais notre cœur veut croire autrement, attaché au concept suranné de foi politique, et c’est dans cette dichotomie que réside le génie du film.
Outre les balades suffocantes dans le pénitencier, Two Prosecutors est mémorable surtout pour ses quatre longues scènes de dialogue révélatrices où se déploient les assises du pouvoir stalinien. Des scènes hypnotiques et stressantes, où les victimes du système réaffirment leur foi désespérée en celui-ci, et où les représentants de l’État feignent la sollicitude pour nous y faire croire à notre tour. Confiné dans sa cellule dépouillée, le corps balafré d’ecchymoses et d’autres marques de torture, Stepniak (Alexandre Filippenko) reste convaincu qu’une intervention de Kornev auprès du Politburo pourra mettre fin au massacre ; l’homme à la jambe de bois (Filippenko également), rendu infirme lors de la révolution bolchévique, compte bien recevoir l’aumône de Staline ; le procureur général (Anatoli Bely), de sa verve anesthésiante et de sa rigueur apparente, nous laisse croire que tout finira par se régler, même si l’on est convaincu·e·s du contraire. Et c’est là que s’articule le plus important message du film, à savoir que la rigueur morale n’est plus une valeur cardinale dans un monde dirigé par des « arrivistes » et des « charlatans », mais surtout que la foi en un système prouvé absurde (celui de la révolution perpétuelle au même titre que notre improbable social-démocratie néo-libérale) est elle-même absurde. Une fois le système gangréné, il ne pourra plus être changé de l’intérieur, toute croyance contraire menant à la désillusion cruelle que cultive si froidement le film pour mieux formuler sa critique… (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 19 octobre à 17h00 (Cinéma du Parc)

prod. Saint Laurent Productions / Badjetlag / et al.
FATHER MOTHER SISTER BROTHER
Jim Jarmusch | États-Unis / Irlande / France | 2025 | 110 minutes | Les incontournables
La répétition peut être un outil très expressif dans les mains d’un artiste, mais elle n’est pas facile à maîtriser pour éviter l’impression qu’il s’agit, justement, d’une simple répétition. Jim Jamursch a souvent mis en scène des dialogues de sourds, des personnes qui ne partagent pas la même langue mais qui essaient de communiquer, d’autres qui devraient pouvoir se comprendre mais qui semblent parler dans le vide, et la répétition devient alors une manière soit de reprendre les mots d’un·e autre et d’en infléchir le sens, soit d’en ruiner la signification. Mais elle vient aussi parfois souligner l’amitié, ou lier des personnages apparemment distants, ou incapables de reconnaître ce qui les unit — autrement dit, Jarmusch sait moduler les effets de redondance, généralement à des fins comiques. Alors, devant Father Mother Sister Brother, quand des motifs et des dialogues sont rejoués dans des circonstances différentes, et qu’il ne reste que le sentiment d’un surplace, d’une rengaine qui tourne en boucle autour d’elle-même, il est difficile de ne pas être déçu. Et de ne pas se demander, au passage, comment une œuvre aussi paresseuse a pu être récompensée du Lion d’or à Venise.
Avec sa structure à sketchs en trois temps dans trois pays, Father Mother Sister Brother rappelle Night on Earth (1991), mais, cette fois, il y a très peu de variations entre les diverses parties, surtout les deux premières nous présentant le même dialogue gêné entre deux enfants et l’un de leurs parents. Adam Driver (dans la première) et Cate Blanchett (dans la seconde) jouent plus ou moins le même personnage, et il y a très peu de place pour leur personnalité respective, ce qui est d’autant plus dommage que Jarmusch avait très bien utilisé ces deux interprètes auparavant. Nous sommes loin de l’individualité des conducteur·rice·s de taxi et de leurs passager·ère·s dans Night on Earth, où chaque section s’accordait aux acteur·rice·s en vedette. La troisième histoire est un peu plus distincte au moins, avec une sœur (Indya Moore) et un frère (Luka Sabbat) qui visitent le logement de leurs parents récemment décédés. Ce sont des jumeaux, bien sûr, Jarmusch a souvent utilisé cette figure justement parce qu’elle permet d’incarner le jeu de répétitions et de différences qu’il affectionne, et on sent ici qu’il se dégage un amour franc entre ces personnages malgré la difficulté du dialogue.
Ces bribes de connexion humaine ne suffisent toutefois pas à chasser l’impression que tout le film se maintient dans un non-lieu, un espace hors du monde très peu concerné par celui-ci. C’est en partie l’intention, Jarmusch insiste sur la perte des liens, l’absence (émotionnelle ou effective) des parents. Bien que les touches d’humour soient présentes, il manque la chaleur des amitiés qui se tissaient malgré tout, le regard poétique sur le quotidien, qui venait de cette position d’une errance hors de la société, de sa « normalité », et qui n’en constituait donc pas exactement un rejet. Mais les personnages de Father Mother Sister Brother ont beau se promener en voiture, parcourir les rues de la campagne ou de la ville, on dirait que rien n’existe au-delà de leurs personnes, moins parce qu’ielles seraient isolé·e·s que parce que le cinéaste n’arrive plus à imaginer et mettre en scène ce monde qui ne l’intéresse plus. Et c’est finalement ce qui attriste, non ces portraits de familles désunies, mais l’impression qu’un auteur autrefois essentiel a abdiqué. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : 19 octobre à 15h30 (Université Concordia)

prod. Miyu Productions / Ecce Films
PLANÈTES
Momoko Seto | France / Belgique | 2025 | 76 minutes | Les nouveaux alchimistes
Les films sans paroles à saveur écolo-philosophique ont la cote actuellement dans le cinéma d’animation. Après La tortue rouge de Michael Dudok de Wit en 2016, puis le grand Flow de Gints Zilbalodis en 2024, voici Planètes de Momoko Seto, réalisatrice japonaise associée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France et spécialisée dans le documentaire scientifique. Produit dans le sillon de ses quatre courts Planet précédents (Planet A en 2008, Z en 2011, ∑ en 2014, ∞ en 2017), son premier long métrage d’animation poursuit son exploration de phénomènes naturels ou écologiques, comme l’influence de certains changements climatiques graduels ou soudains sur les écosystèmes, par l’histoire de quatre akènes de pissenlit exilés par la destruction de la Terre à la recherche d’un nouveau sol fertile dans le cosmos. Si les références à son propre travail sont évidentes et multiples, elles ne s’arrêtent pas là non plus. Planètes évoque aussi le documentaire animalier façon Microcosmos de Claude Nuridsany et Marie Pérennou (1996), ou quelque chose des deux Fantasia de Disney, et plus spécialement la séquence du Sacre du printemps avec la naissance de la Terre et de la vie dans l’œuvre originale de 1940 ou celle de L’oiseau de feu avec son hymne aux forces de la nature dans Fantasia 2000 (1999).
Ce qui distingue plus particulièrement Planètes de ces derniers, c’est son approche et son style qui tiennent à la fois du dessin animé hyperréaliste et de l’animation par pixilation de prises de vue réelles. La cinéaste a d’ailleurs eu recours à plusieurs techniques — hyperaccéléré (time-lapse), hyper ralenti, ultramacro, stackshot, robotique — pour réussir à capter les moments désirés dans l’évolution de son univers foisonnant et de son fil narratif. Le résultat est impressionnant de précision et époustouflant de vérité. Les couleurs — verts, jaunes, pourpres — sont vibrantes, les moindres détails sont appuyés par une bande sonore aussi inventive que réaliste, remplie de bruits fourmillants et de pulsations musicales axées sur l’émotion. Remarquable, cette bande sonore s’accorde aux périples des quatre akènes, avec des cuivres surgissant des tréfonds du lichen trompette ou une multitude de sons discrets associés aux insectes et aux plantes, des bruissements de feuilles délicates aux chuintements des champignons, en passant par le froufroutement d’un papillon de nuit ou le cliquetis des milles pattes… de mille-pattes.
Dans cet univers de choses minuscules, tout est amplifié au centuple. Les akènes, qui ne font que quelques millimètres en vrai, sont ici grands comme des lévriers dans un monde où les limaces apparaissent grosses comme des éléphants et où les navets et les fougères ont les dimensions d’immeubles ou de géants. Si la lenteur du récit s’avère parfois un peu trop insistante et si certaines scènes peuvent sembler légèrement répétitives, l’odyssée de ces quatre petites graines en quête d’une nouvelle terre d’accueil laisse sur un sentiment stimulant de découverte, de curiosité et d’éveil aux prodiges de la nature. Le générique nous récompense d’ailleurs en nommant tous les végétaux et les animaux apparaissant dans le film comme s’ils étaient des comédiens aux noms exotiques, de l’euphorbe à la rainette céruléenne au rhipsalis, en passant par le kalanchoë des fleuristes, les calamars lucioles, l’herbe d’amour, la limace tigrée et le blob. Cette singularité fantaisiste fort chouette permet d’apprécier l’incroyable diversité de toute la faune et la flore qui forment cette distribution des plus colorées et originales. En somme, Planètes est une œuvre atypique et intemporelle dont le côté contemplatif et abstrait ne satisfera peut-être pas tous les publics, mais dont la beauté plastique inouïe vaut la peine d’être appréciée. (Claire Valade)
Prochaine projection : 19 octobre à 17h15 (Cinémathèque québécoise)

prod. Thirteenth Tiger Films
DANS LES PINS
Shelagh Rowan-Legg | Québec | 2025 | 17 minutes | Compétition nationale
Pour la plus récente de ses œuvres (qu’elle cumule depuis 2016 à travers sa maison de production Thirteenth Tiger Films), la critique et autrice Shelagh Rowan-Legg combine ses passions pour le genre horrifique et le cinéma expérimental dans un récit astucieux, frappant et doux-amer qui évoque l’imaginaire hanté d’une certaine féminité québécoise. Réunissant une manne de sources disparates (photos d’archives, cartes postales d’époque, plans argentiques de forêts fantomatiques, séquences numériques d’hôtel abandonné), harmonisée par un travail sonore incantatoire et minutieux, sédimentée par la voix off de l’extraordinaire Larissa Corriveau, la réalisatrice nous fait partager la jeunesse tourmentée d’Esther, une jeune femme du début du XXe siècle. Engagée comme ménagère dans l’hôtel La Sapinière, récemment inauguré à Val-David sur la rive d’un lac artificiel créé pour ses client·e·s, Esther nous raconte son histoire par le truchement d’une série de lettres écrites à sa mère, dans lesquelles elle décrit sa vie dans l’établissement, mentionnant à demi-mots les agressions sexuelles perpétrées par son père ouvrier, puis détaillant sa relation trouble avec un jeune bourgeois anglophone, fils du propriétaire, et finalement son séjour parmi les fantômes de l’endroit.
Exprimant à la fois une candeur touchante et une angoisse palpable, que viennent illustrer les changements soudains de tonalités musicales, entre les rythmes enjoués de la musique de cabaret et les échos sinistres du cinéma d’horreur, Dans les pins se profile comme le conte initiatique traumatique d’une jeune femme qui s’apparente à bien d’autres. Constituant à la fois un objet de désir et un objet désirant, son épanouissement sexuel cahoteux est teinté par le spectre d’une violence sexiste et classiste qui la place dans une position toujours délicate, entre le plaisir de la découverte et la peur de la victimation. Cette dichotomie s’exprime par un travail ingénieux de subjectivation des images au fil du parcours mémoriel de la protagoniste, qui voit simultanément la forêt comme un lieu de balades romantiques avec les hommes et de sanctuaire contre leurs abus, qui envisage le lac comme une merveille d’ingénierie et un excès colonialiste, qui louange son amant tout en s’en méfiant. Le film explore en outre l’envers d’un Québec champêtre idéalisé, dans des plans exploratoires à l’aura spectrale dignes d’un Blair Witch Project (1999), symptomatique d’un monde où l’idylle touristique cache une réalité d’abus prolétaire et d’appropriation territoriale, où le culte du progrès industriel dissimule l’avilissement des hommes à son service, où le glamour des chanteuses de cabaret sert à masquer le système patriarcal d’échanges des femmes sous-jacent. (Olivier Thibodeau)
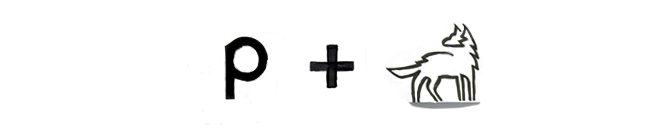
Partie 3
(L'arbre de l'authenticité,
Wrong Husband,
Desire Lines, Romería,
Ariel, Dead Lover)
Partie 4
(Blue Moon, Magellan,
Two Prosecutors,
Father Mother Sister Brother,
Planètes)
Partie 5
(Sound of Falling,
Affection Affection,
Levers, Dracula,
A Useful Ghost)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
