ON AND ON AND ON
Evelyn Pakinewatik | Canada | 2024 | 10 minutes
On retrouve d’abord des images, des plans fixes de paysages forestiers pluvieux captés dans un superbe 16 mm. La caméra d’Evelyn Pakinewatik se tient au plus près des arbres, s’attarde à leur écorce détrempée et aux gouttelettes qui s’y amoncellent, scrutant avec attention la lumière qui fuse entre les branches ou qui étincelle la surface trouble d’une étendue d’eau. Puis une voix, celle d’Albert Ward, aîné Mi’kmaq de la nation Eel Ground, ne tarde ensuite à se faire entendre, pour accompagner la contemplation du territoire d’une parole à la fois sage et hésitante. Ce doute qui s’exprime, c’est l’incertitude d’un trop-à-dire et le temps pourtant si court de l’enregistrement : « It’s so much to explain that we can’t do in few minutes. It just goes on and on and on. » Depuis ce dispositif en apparence très simple de juxtaposition entre le son et l’image, On and On and On développe une double modalité d’observation extrêmement féconde, à la fois émouvante et pointant vers la nécessité d’une passation des pratiques de résistance devant l’impression d’une fragilisation climatique et politique.
Le film de Pakinewatik se présente comme un film de deuil, un travail de mémoire à la suite du décès de Ward en février 2021. Il s’agit aussi par la force des choses d’un récit de transmission, qui réfléchit le legs d’un monde partagé au-delà des vies individuelles qui le traversent. Lorsque la voix entendue se remémore une vision rêvée, un songe dans lequel une immense vague inondait le territoire, c’est la responsabilité de prendre soin d’un lieu dont on pressent la fin qui s’exprime depuis le souvenir prophétique. Devant les images de On and On and On, la place centrale qu’occupe le motif de l’eau me renvoyait à une lecture récente, celle de Theory of Water, dernier livre de l’autrice Michi Saagiig Nishnaabeg Leanne Betasamosake Simpson. Elle y propose de trouver dans l’image de l’eau (Nibi, en Nishnaabemowin) l’inspiration d’une pratique de résistance politique attentive aux interconnexions qu’impliquent ses flots circulaires : « I’m thinking about Nibi as theory here because Nibi offers us an invitation to learn from its embodied practice, a practice of cycling that is global, is permeable and brings about a continuous rebirth on our planet. Nibi asks us to ground ourselves intimately in land and place, and relate that grounding to other movements, geographies, cultures and lands. » [1] On and On and On poursuit lui aussi le rythme de ce courant, que celui-ci s’apparente à la source d’un émerveillement ou semble plutôt relayer l’angoisse de l’inondation prévue. Mais l’eau se fait surtout la matière d’un lieu auquel s’attarder, et c’est là que la captation sonore comme celle de ses images s’allient, par le biais d’une douce injonction partagée par Ward : « You’ve got a reason for living in this world. » (Thomas Filteau)
[1] Leanne Betasamosake Simpson, Theory of Water : Nishnaabe Maps to the Times Ahead (Toronto : Knopf, 2025), 7.
Prochaine projection : 14 août à 20h30 (Cinéma du Musée)

prod. Juan Francisco Salazar / Alejandra Canales
COSMOGRAPHIES
Juan Francisco Salazar | Australie | 2024 | 95 minutes
« Il faut se demander pourquoi certain·e·s veulent coloniser la lune alors que d’autres en revanche veulent danser devant elle comme on danse devant une vieille amie. » Dans cette phrase proférée par l’astronaute maori Xuê Noon, la narratrice fictive de Cosmographies, se condense peut-être le projet du film qu’on est en train de regarder : comprendre quelles sont les manières d’habiter qui font vibrer la texture du monde et quelles autres le mettent à sac. Ici, le terrain de la lutte est le désert d’Atacama, un lieu longtemps pratiqué et nourri par les communautés Licanantay qui leur est disputé par les scientifiques et les industriels. Ces deux derniers, soutient le film, sont moins différents qu’ils n’y paraissent au premier regard, puisque si la destruction orchestrée par les seconds est évidente, les premiers exercent aussi une forme de domination épistémique et territoriale
L’habileté de Cosmographies, c’est de camper sa matière documentaire au format relativement classique (entretiens individuels avec plusieurs militant·e·s autochtones et gardien·ne·s du territoire qui protègent, habitent et observent le désert d’Atacama au Chili) dans un récit encadrant de fiction spéculative mettant en scène l’exploration spatiale de mars par la Aotearoa Space Agency en 2051. Ce choix ne fait pas que complexifier formellement le film ou l’inscrire dans une tradition afrofuturiste, il permet aussi de poser un regard renouvelé sur le désert et l’exercice de désertification coloniale qui attend les autres astres sur lesquels les puissants cherchent actuellement à faire main basse (autant en termes d’extraction de ressources minérales que de connaissances). Cosmographies joue par exemple avec l’idée de terra nullis, ce mot qui sert à désigner les espaces considérés vacants par les États impérialistes — et par conséquent d’en justifier l’accaparement et l’exploitation. Comme dans l’Amérique du 16e siècle, les colonisateurs construisent le désert/le vide qu’ils prétendent voir. Pourtant, les hautes Andes sont loin d’être dénuées de vie — encore faut-il savoir regarder. C’est à cet exercice que s’adonne la caméra de Salazar en papillonnant d’un témoignage à l’autre, d’une captation du terrain à l’autre, comme si le réalisateur était convaincu que les astres inscrivent des choses dans le ciel, mais aussi dans les sols. De fait, les débris d’astéroïdes millénaires, le souvenir des troupeaux de lamas et les rotifères peuplent ces lieux qu’on déclare vides pour y installer des carrières de salpêtre et des agences spatiales. Or la vraie aridité, insiste Cosmographies, c’est toujours déjà celle d’un capitalisme qui élimine les écosystèmes et les imaginaires. (Laurence Perron)

prod. LHI Productions / Aagimaak Productions
THE HUNTER AND HIS APPRENTICE
Reamonn Joshee | Canada | 2024 | 8 minutes
Ce qui fait que ce court métrage du cinéaste Reamonn Joshee fonctionne si bien, c’est très concrètement sa capacité à dépasser les bornes de sa propre narration afin de créer par de simples allusions un univers de fiction à la fois intrigant et cohérent. Comme si le monde dans lequel il est campé se prolongeait par-delà les contours du cadre, par-delà l’horizon de ces plaines brumeuses et de ces forêts enneigées dans lesquelles déambulent le titulaire chasseur et son apprenti. L’image est pétrie d’une certaine patine, d’une usure naturelle qui confère à ce récit par ailleurs minimaliste une étonnante densité ; sa temporalité nébuleuse, quelque part entre la science-fiction et la fable historique, est habilement embrouillée par une forme empruntant ses codes et ses conventions au cinéma muet. Avec pour résultat une sensation de flottement et d’incertitude qui alimente le mystère ambiant, nimbant chaque geste à l’écran d’une étrange portée mythique. Voici un film qui comprend quoi raconter et, inversement, quoi ne pas raconter — laissant à son public le soin de compléter le portrait, sans jamais lui forcer la main. L’histoire émerge autant d’une atmosphère, d’une série de détails suggérant certaines pratiques que d’une série d’actions précises. Transcendant habilement ses moyens limités, The Hunter and his Apprentice s’avère prometteur pour une multitude de raisons — établissant un imaginaire original en quelques traits, sans s’embourber dans les clichés d'un cinéma de genre trop souvent érigé sur la répétition de poncifs familiers. Une très belle découverte, donc, qui donne le goût de voir où iront par la suite ses auteurs. (Alexandre Fontaine Rousseau)
INKWO FOR WHEN THE STARVING RETURN
Amanda Strong | Canada | 2024 | 18 minutes
Pour son nouveau court métrage, la réalisatrice michif/métisse Amanda Strong adapte, à l’aide d’un style d’animation qui lui est propre, une histoire bien connue de Richard Van Camp. On y suit le personnage de Dove, un protagoniste charismatique au genre fluide qui doit apprendre à utiliser son « Inkwo/medecine » pour protéger ce qui lui tient à cœur.
Amanda Strong porte cette histoire avec une grande efficacité narrative. Seulement 18 minutes concises suffisent pour nous faire voyager « two lifetimes ago », puis pour explorer plusieurs moments de la vie de Dove et la faire combattre des créatures mangeuses de chair dans une histoire qui nous met en garde contre la cupidité et qui nous parle de l’importance de prendre soin de la nature qui nous entoure. Bien que racontés efficacement, les enjeux soulevés restent complexes et ne sont pas sous-développés pour autant. Le « Inkwo » de Dove est un don, mais peut également être une malédiction et, en même temps qu’ils se défendent contre les créatures, Dove et sa communauté apprennent à affronter l’adversité ensemble.
Au moment de la conclusion du film, la quête de la protagoniste ne fait que commencer. Un magnifique plan balaye l’univers animé d’Amanda Strong, montrant les défis qui attendent Dove et bien que le désir de connaitre la suite se fasse sentir, le court métrage ne se termine pas sur une déception. À première vue, c’est même une conclusion qui pourrait donner l’impression d’un scénario inachevé. Toutefois, c’est un procédé qui s’agence avec le discours du film. Le combat de Dove ne fait que commencer parce que notre combat collectif pour protéger ce qui nous entoure est également loin d’être terminé. Un film fantastique, dans tous les sens du terme et qui, malgré le fait qu’il se déroule « two lifetimes ago », demeure porteur de messages bien actuels. (Vincent Careau)
*Texte originellement publié dans notre couverture du festival ImagineNATIVE 2025

prod. Aruac Filmes / Hutukara Associação Yanomami / et al.
THE FALLING SKY
Gabriela Carneiro da Cunha et Eryk Rocha | Brésil/Italie | 2024 | 110 minutes
Le ciel va tomber sur la tête de tout le monde. Il écrase la forêt, la montagne, le cadrage, au fur et à mesure que les paysages se répètent, qu’on apprend à les reconnaître à force de voir le village yanomami. Ce peuple vit dans une région à cheval entre le Brésil et le Venezuela, dans de grandes structures collectives et circulaires que la caméra scrute par de lents panoramiques. Les Yanomamis ont aussi une culture où le chaman est au centre de la communauté, prodiguant ses soins par feuilles broyées, hallucinogènes, et entretenant le mythe de ce ciel prêt à tomber sur Terre.
Dans la cosmogonie yanomami, après la chute du premier ciel, les esprits xapiri le redressent pour le tenir à bout de bras, ce qui jette dès les premières scènes nocturnes de The Falling Sky une impression d’apocalypse qui doit advenir pour que le monde puisse apprendre de ses crimes, renaître de ses cendres. Les lampes torches, la radio, les médicaments sont quelques rares intrusions de modernité dans un univers encore pétri de rituels et de danses qui virent en transe. Comme une lamentation sur la fin du monde, le film de Gabriela Carneiro da Cunha et Eryk Rocha (fils de Glauber, le grand auteur du Cinema Novo) est un film sur le démantèlement de la Terre, l’effondrement de la biosphère, la disparition des territoires ancestraux et du mode de vie qu’ils permettaient aux Yanomamis.
C’est un film déprimant, poignant, où des chamans qui lisent les étoiles se savent filmés, sublimés dans la nuit, à dire « on vous avait prévenu·e·s ». Pendant que les napës (les Blanc·he·s) extraient des minéraux pour les envoyer par la mer jusqu’en Chine, la communauté doit prendre soin de ses membres tout en veillant à demeurer loin des centres habités par ces mêmes napës, porteur·euse·s de maladies ou de méfiance. La lutte des Yanomamis s’apparente alors non seulement à une lutte pour leur propre survie, mais aussi à une lutte cosmique, filmée à contre-jour du ciel et résumée à travers le chaman Davi Kopenawa, l’un des plus importants porte-paroles de sa nation.
Or, le protagoniste du film n’a rien d’une figure d’activiste classique, d’un personnage héroïque que la mise en scène isolerait. La frontalité patiente de celle-ci rappelle en fait qu’il est censé s’agir d’un documentaire, mais la solennité des images, la force de la culture qui se déploie dans la parole prophétique repoussent sans cesse le documentaire vers la fiction des récits que les sorciers racontent. C’est comme si le documentaire se pliait sous la magie du rituel, confrontant le cinéma à une énergie insondable. Un « tonnerre possédé » ou une « forêt qui se rebelle », comme dirait le liseur d’étoiles.
The Falling Sky est un grand film. Qu’il soit passé inaperçu à la Quinzaine des cinéastes en 2024 et qu’il eût fallu attendre une année et demie avant de le voir sur les écrans montréalais ne s’explique pas. En revanche, cela redit encore l’importance de la programmation de Présence autochtone et celle de s’y intéresser. (Mathieu Li-Goyette)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 11 août à 18h (Cinéma du Musée)
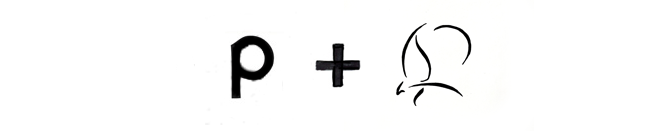
Partie 1
(On and On and On, Cosmographies
The Hunter and his Apprentice,
Inkwo for When the Starving Return,
The Falling Sky)
Partie 3
(Alien Weaponry, Endless Cookie,
Pidikwe, Ka Whawhai Tonu,
The Dim)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
