MESSY LEGENDS
Kelly Kay Hurcomb et James Watts | Canada | 2025 | 122 minutes | Underground
Telle une relecture montréalaise du Slacker de Richard Linklater où plusieurs personnages se passent le bâton d’un récit déambulatoire et libre de superposer multiples embranchements et juxtapositions, Messy Legends du duo montréalais Kelly Kay Hurcomb et James Watts (Death Trip) épate par son ambition dévorante et inversement proportionnelle à ses moyens fauchés. Mais c’est surtout la puissance de son évocation nostalgique d’un je-ne-sais-quoi proprement montréalais qui force le sourire en coin et tire la larme à l’oeil : le film d’Hurcomb et Watts se dévoile finalement comme un hommage nerveux aux amitiés et aux modalités de la fête ; une ode à cette époque de la vingtaine où tout semblait encore possible au détour d’une soirée.
Dédié aux party people du Plateau Mont-Royal, Messy Legends organise sa symphonie de récits du « désordre » autour d’une longue excursion sur la Main à la rencontre de personnages au bout du rouleau par pur concours de circonstances. Il y a d’abord Jessi, la « messy legend » du court métrage dont le film est adapté, qui arpente Saint-Laurent à la recherche d’un party qu’elle trouvera dans les toilettes du Barfly. Ailleurs, c’est Emma qui s’est embarrée à l’extérieur de chez elle pendant un trip de LSD et un infirmier qui perd ses clés et son portefeuille. Un booker attend un band qui ne se pointe pas à son gig ; un couple se magasine un trip à trois et Mitchell, un chauffeur de taxi, fait le pont entre les personnages en plein délire paranoïaque. Rufina rôde sur l’artère, tel un ange qui voit tout ; Emelia B., diva de renom, ne veut que d’une soirée de fête à Montréal tandis que Jay, rentré de New York, envoûte les passants de ses solos de saxophone dissonants. Finalement, Tranna Wintour rencontre son plus grand fan.
Tournant en mode guérilla avec une caméra tantôt à l’épaule, tantôt cachée, Hurcomb et Watts brouillent les pistes, ainsi que les visages de leurs figurants afin de confondre improvisation et écriture. Ce détail ingénieux révèle l’étendue de la construction d’un film qui entretient une impression d’impromptu. L’immédiateté de toute cette architecture narrative est prenante. On s’emballe face à l’empilage de récits anxiogènes, mais outre ce montage paniqué, c’est l’accumulation des diverses résolutions de caméras digitales superposées ici qui force l’admiration et confère au projet une texture unique qui n’aurait pas survécu à un plus grand budget. Et bien que le métrage étire un sujet en apparence bancal sur une durée que l’on pourrait qualifier de complaisante, Messy Legends assume pleinement sa qualité d’œuvre « milléniale » en mariant sa forme à l’immensité des nuits montréalaises. Hurcomb et Watts se portent en quelque sorte à la défense de la réputation de Montréal, ville propice à la création, et refusent d’enterrer le souvenir de ce qu’elle était. Tandis que l’embourgeoisement s’intensifie, que les fermetures des lieux de la culture s’accumulent et que le coût de la vie ne cesse de grimper, on pourrait même dire que Messy Legends fait œuvre utile. (Ariel Esteban Cayer)
Prochaine projection : 29 juillet à 21h30 (Cinéma du Musée)
HOSTILE TAKEOVER
George Mihalka | Canada | 1988 | 93 minutes | Fantasia Rétro
Forcé de venir faire des heures supplémentaires un samedi, un employé de bureau décide de séquestrer ses collègues ainsi que son patron. Bientôt, les policiers encerclent l’édifice, cherchant à comprendre la raison de cette prise d’otage dans l’espoir de régler rapidement la situation. Mais l’homme qui en est responsable ne formule aucune demande. Aucune motivation claire ne semble justifier son passage à l’acte, hormis peut-être l’envie subconsciente de prendre le contrôle, de détenir un instant le pouvoir en faisant basculer à la pointe d’un fusil le rapport de force opposant l’exploitant et l’exploité. Ce qui distingue d’emblée ce thriller méconnu de George Mihalka des autres films reposant sur une prémisse semblable, c’est l’absurdité du geste central qui élève le huis clos tendu au rang d’étrange fable existentielle. Déterré à l’occasion d’un hommage rendu par Fantasia à ce vieux routier du cinéma de genre québécois et canadien, Hostile Takeover cristallise habilement les qualités propres à son œuvre.
On reconnaît d’abord ce sens du cadrage acéré par lequel l’asphyxiant My Bloody Valentine (1981) se différenciait déjà de la masse des slashers produits dans le sillage de Friday the 13th (1980) et Halloween (1978). Autour des contraintes imposées par un récit claustrophobe à souhait, se déroulant essentiellement dans un seul et même décor relativement anonyme, Mihalka construit une sorte d’étau formel se resserrant peu à peu sur ses protagonistes. Sa mise en scène est toutefois ponctuée de ruptures brusques, prenant souvent la forme de soubresauts oniriques, qui confèrent à l’action un caractère imprévisible telle une bombe, susceptible de sauter à tout moment. Le dispositif crée évidemment de la tension, mais il permet aussi d’échapper au réalisme monotone auquel aurait aisément pu se cantonner le film. Hostile Takeover, au contraire, s’en éloigne progressivement — ouvrant ainsi une brèche vers l’intériorité de ses personnages.
De toute façon, Mihalka ne s’intéresse pas tant à cette prise d’otage qu’à ce qu’elle révèle au sujet des individus prisonniers de cet engrenage. En tant que cinéaste, il se place d’abord au service de ses interprètes qui ont ici les coudées franches pour livrer une flopée de prestations mémorables. Malgré la violence de la situation, il ne perd jamais de vue l’humanité unissant les unes aux autres les victimes de ce drame. Encore une fois, on pense à My Bloody Valentine — à ses ouvriers, captifs d’une machine les écrasant graduellement puis subséquemment fauchés par un tueur masqué. On sent bien qu’il existe, au cœur même du cinéma de George Mihalka, une conscience des enjeux de classe s’exprimant dans Hostile Takeover avec une clarté particulièrement incisive. Voici un film drôlement tranchant qui s’attaque de front aux sources de sa désillusion, déjouant ainsi le piège tendu par son propre nihilisme. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. ENK Promotion / Piss Factory
LOOKING FOR AN ANGEL
Akihiro Suzuki | Japon | 1999 | 60 minutes | Underground / Fantasia Rétro
Chaque image de Looking for an Angel se retrouve nimbée d’une lumière azurée, recouverte d’un ton bleuté suffocant, « presque transparent », pour reprendre le titre d’un roman de Ryû Murakami. La teinte recouvre les souvenirs fragiles qu’investissent des proches de Takachi (Koichi Imaizumi), jeune garçon dont la mort récente initie cette plongée labyrinthique dans le répertoire des rencontres significatives et des liens fugaces qui ont pu précéder son décès. Une sorte de road movie où le périple antichronologique se déploie dans les lieux de la réminiscence d’une vie aux côtés de l’ami disparu, Looking for an Angel travaille avec la matière d’un onirisme nostalgique, comme un journal de deuil composé par une mémoire partagée.
Ce film fraîchement restauré d’Akihiro Suzuki se présente comme une relique provenant d’une frange assez peu connue de l’industrie japonaise du pinku, le film étant produit par une sous-branche de la Nikkatsu, ENK Productions, qui visait à développer un corpus de pinku gais parmi lesquels se retrouvent des œuvres aujourd’hui assez rarement vues et réalisées par des figures centrales du genre, tel Beautiful Mystery (Genji Nakamura, 1983), Muscle (Hisayasu Satô, 1989) ou encore I Like You, I Like You Very Much (Hiroyuki Oki, 1994). En apparence, par sa manière de se restreindre à une durée d’une soixantaine de minutes, à l’instar de la majorité des pinku, ou par ses plans subjectifs de mains glissées sur des corps en sous-vêtements, Looking for an Angel possède la facture classique de ces productions où se sont régulièrement confrontées — et à l’occasion ont pu très bien s’accorder — les esthétiques exploratoires de ses réalisateurs à la visée érotique et marchande de leur production. Mais ici, la sensualité du pinku qui a toujours été retorse, souvent violente et régulièrement compliquée, nous paraît plutôt sous le signe d’un chagrin tendre et mélancolique.
Quand on aperçoit pour la première fois Takachi, ses traits se perdent dans une lumière du jour trop franche, qui contraste avec l’intérieur de l’appartement duquel une amie s’extirpe pour observer le garçon, l’attendant sur le trottoir d’en face. Et la seconde fois qu’on nous montre Takachi, c’est par son visage pixelisé sur la surface d’une télévision, alors que ses proches se regroupent dans un petit appartement pour d’intimes funérailles et que sur l’écran cathodique est visionné l’un des films pornos (hétéros) dans lesquels jouait Takachi. Et déjà, l’érotisme auquel travaille Suzuki prend la forme de la recherche d’une présence fugitive, comme le désir entretenu envers un corps alors disparu. Takachi explicitera lui-même, dans une litanie finale, ce vocabulaire sensuel de la perte que développe Looking for an Angel et qui en fait une œuvre qui contraste fortement avec l’esthétique de la capture des corps désirants dont témoignent la majorité des pinku : Tout ce dont je prends soin, je le perds. Tout ce que je désire, je ne peux jamais l’avoir. Tous ceux que j’aime, je ne peux jamais rester à leurs côtés. Tout endroit où je veux être, je dois le quitter. Ce qui en résulte au sortir de la salle, c’est un film flottant, beau comme un rêve triste. (Thomas Filteau)

prod. Wonder Wheel Productions
MOTHER OF FLIES
John Adams, Zelda Adams et Toby Poser | États-Unis | 2025 | 92 minutes | Cheval noir
Fantasia est une affaire de famille et rien ne l’illustre mieux que la relation qu’entretient le festival avec la famille Adams. Non, pas celle-là. L’autre. Celle dont les cinq derniers films ont été présentés en première mondiale à Montréal. Il suffisait de les voir saluer Daniel et remercier Mitch Davis ce jeudi, avant la projection de Mother of Flies, pour comprendre que Toby Poser, John et Zelda Adams sont ici à la maison. Qu’il y a quelque chose de précieux dans le lien qui s’est créé, au fil des ans, entre ce public et ces cinéastes. Franchement, le spectacle était attendrissant. Or, je dois bien l’admettre : entre la famille Adams et moi, ça n’a jamais vraiment cliqué. Malgré tout le capital de sympathie que j’ai pour leur démarche totalement indépendante ainsi que leur rapport tribal à la création, les films eux-mêmes n’ont jamais su me convaincre. Du moins jusqu’à celui-ci, qui a finalement eu raison de mes réticences.
Il suffit de quelques images pour comprendre que Mother of Flies constitue un tournant dans leur œuvre, une concrétisation des idées qui bouillonnaient sous la surface parfois ingrate des longs métrages précédents. À commencer par celle, toute simple, de tourner en cercle fermé des histoires familiales ; s’il est inconcevable de séparer les Adams de leurs créations, c’est que les films eux-mêmes s’avèrent ouvertement indissociables de ce contexte particulier duquel ils émergent. Le cinéma existe ici comme manière de gérer ensemble des traumatismes intimes partagés, à travers un langage totalement idiosyncratique empruntant certains codes au récit de genre sans toutefois s’y limiter. Dans le cas présent, il est question de maladie, de croyance et de guérison : un père (John) et sa fille atteinte d’un cancer (Zelda) acceptent l’invitation d’une mystérieuse sorcière (Toby), qui affirme être en mesure de prévaloir là où la médecine traditionnelle semble avoir échoué.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que John et Toby ont tous deux survécu à un cancer au cours des dernières années ; et que Zelda y est, par conséquent, prédisposée génétiquement. C’est donc d’un autre type de lien filial dont traite le film, un mauvais sort qu’il s’agit de conjurer par le biais du rituel cinématographique. Mother of Flies aborde avec une ouverture tout à fait singulière les thèmes de la magie et de la communion avec la nature, déployant à travers une poésie visuelle empreinte de débrouillardise une méditation juste et sentie sur la figure de la sorcière. Avec, en prime, une sincérité propre à ce cinéma artisanal dont l’existence même relève du miracle. Récipiendaire du Cheval noir du meilleur film, Mother of Flies est l’aboutissement d’un parcours inusité et d’une vision unique que Fantasia a su soutenir et défendre alors qu’elle n’était encore qu’à l’état d’ébauche ; et force est d’admettre qu’il y a quelque chose d’inspirant au fait de la voir fleurir ainsi, pour s'épanouir enfin avec une telle assurance. (Alexandre Fontaine Rousseau)
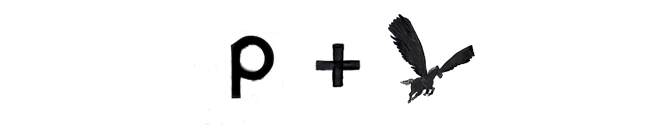
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(Occupy Cannes, Queens of the Dead,
Lurker, $POSITIONS, Lifehack, Stuntman)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
