ALIEN WEAPONRY: KUA TUPU TE ARA
Kent Belcher | Nouvelle-Zélande | 2024 | 97 minutes
Depuis sa création par deux frères maoris en 2010, le groupe de thrash metal Alien Weaponry a signé trois albums et parcouru plusieurs fois l'Europe et les États-Unis, accompagnant en tournée de célèbres formations dont Slayer, Black Label Society et Gojira. Cette ascension est le prétexte motivant le long métrage de Kent Belcher, qui a documenté le parcours du groupe durant six années, mais qui nous propose avant tout un récit d'apprentissage intime. L'ambition de totalité est palpable : à travers des vidéos et images d'archives personnelles, on nous montre la première guitare reçue en cadeau vers l'âge de 3 ou 4 ans, les spectacles maison et les pratiques maladroites, auxquels viennent s'ajouter le lancement du premier album, la première tournée, le premier tatouage. C'est véritablement le passage à l'âge adulte des frères de Jong auquel on assiste alors qu'ils s'émancipent enfin de leurs parents, qui géraient jusqu'alors leur carrière et les accompagnaient partout en tournée ; qu'ils accomplissent leur rêve d'enfance : jouer sur une scène du légendaire Wacken Open Air ; et qu’ils doivent affronter le départ de leur bassiste et ami d'enfance, qui choisit d'emprunter son propre chemin. « We're not normal teenagers, you know », dit Lewis à la caméra. Il a raison dans la mesure où ce que son frère et lui accomplissent est effectivement exceptionnel, mais ce que le film nous révèle est plutôt l'absolue normalité de leur vie intérieure et de leurs réactions toutes juvéniles face au monde.
Alien Weaponry: Kua Tupu Te Ara adresse aussi l'enjeu du rayonnement de la culture maorie, qui est au cœur du projet artistique de la formation — elle chante majoritairement dans la langue de ses ancêtres, joue des instruments traditionnels, intègre des pūkanas et des hakasdans à ses performances — et l'engouement de la foule française ou allemande qui s'époumone à scander par cœur des paroles autochtones est éloquente. Lors des passages plus calmes, quand les frères parlent de leur peuple et de son histoire, des extraits d'archives néo-zélandaises sont intercalés pour illustrer le combat ardu mené par leurs prédécesseurs contre l'État afin de protéger leurs droits. Mais au-delà des leçons d'histoire et des prestations du groupe, auxquelles le film accorde finalement peu d'attention, c'est le portrait que le film dresse de cette jeunesse maorie triomphante mais tout compte fait ordinaire qui est le plus édifiant. Henry et Lewis de Jong, qui viennent d'un milieu modeste et aimant, n'ont rien de surhommes ultra-privilégiés ; leur talent est à la mesure de leur assiduité et de leur passion. Le combat pour défendre les droits des Maoris doit persister, mais la réussite internationale de Alien Weaponry prouve que les jeunes Autochtones ont aujourd'hui une chance de faire entendre leur voix et de célébrer leur identité librement. (Anthony Morin-Hébert)
ENDLESS COOKIE
Seth Scriver et Peter Scriver | Canada | 2025 | 97 minutes | Ouverture imagineNATIVE
Des demi-frères au grand nez ressemblant à une balloune dégonflée et une jeune fille faite en biscuit, voilà le genre de personnages mis en vedette dans le documentaire animé Endless Cookie qui a donné le coup d’envoi à la 25e édition du Festival imagineNATIVE. Cet ovni cinématographique a vu le jour lorsque le réalisateur canadien Seth Scriver, basé à Toronto comme le festival, a décidé de s’allier au meilleur conteur d’histoire qu’il connait, son demi-frère autochtone Peter, originaire de Shamattawa dans le nord du Manitoba.
Tout débute lorsque nous voyons Seth s’envoler en direction de la communauté de Peter, avec l’intention de faire un film qu’il qualifie de « Funny, beautiful, political, spiritual, complex, simple and true ». Bien que l’étiquette finisse par bien s’appliquer au film, force est d’admettre que le documentaire, dont la production s’est étalée sur un peu plus 7 ans, n’est pas aussi « simple » que prévu. Dès les premiers instants dans la maison familiale de Peter, les tentatives d’entrevue de Seth sont interrompues par le chaos accoutumé de la communauté, des jouets des enfants, jusqu’aux chiots qui vivent sous le perron. Lors de son deuxième voyage dans la réserve, Seth décide d’embrasser le chaos du quotidien. La folie des différents personnages rencontrés dans la réserve devient un magnifique terrain de jeu pour le style d’animation coloré de Seth, et le reste du film devient un enchaînement d’anecdotes personnifiées. Endless Cookie fait voyager dans le territoire de chasse de Shamattawa jusque dans un Toronto des années 1980 et nous fait rencontrer les étranges silhouettes dans le cauchemar du fils de Peter.
La ligne peut cependant être mince entre l’apparence d’un chaos contrôlé et un film qui devient réellement décousu. Heureusement, c’est à travers des moments farfelus où les histoires de Peter se font interrompre par les récits d’un nouveau protagoniste à l’animation toujours plus éclatée que les thèmes de la famille et de la vie en communauté servent de fil conducteur et parviennent à maintenir la cohésion de l’ensemble. Comme lorsque les frères se remémorent des anecdotes torontoises de pizza, de toilette et que le touchant personnage de Cookie réussit à placer un inspirant monologue sur ses ambitions, le tout suscité par les étiquettes de la section des surgelés.
De multiples années finissent par passer entre les différentes visites de Seth chez son demi-frère et, bien que l’œuvre s’étale sur seulement 97 minutes, les entrevues sans filtre et les rires contagieux donnent effectivement l’impression que nous connaissons les personnages depuis bien plus longtemps. Sept années après le début de la production du film, la voix de Cookie qu’on entend n’est peut-être plus celle d’une jeune fille de neuf ans et cette œuvre déjantée n’est peut-être pas si simple finalement, mais elle reste cependant « Funny, beautiful, spiritual, political, complex, […] and true ». (Vincent Careau)
*Texte originellement publié dans notre couverture du festival ImagineNATIVE 2025
PIDIKWE (RUMBLE)
Caroline Monnet | Québec | 2025 | 10 minutes
Tourné en pellicule précisément pour capter la beauté du grain et de l’esthétique des films anciens, et plus spécialement ceux réalisés à l’époque des années folles, Pidikwe de Caroline Monnet est un objet d’art autant qu’une œuvre cinématographique, tout à fait aligné avec la démarche pluridisciplinaire de la cinéaste et artiste visuelle. S’inscrivant dans le prolongement d’un de ses thèmes de prédilection, soit l’impact du colonialisme à l’aune du regard et des pratiques des Premières Nations, elle met ici en scène six femmes autochtones de générations différentes, dans un tourbillon de couleurs vives déployées au cœur d’un studio plongé dans le noir, à l’exception d’ampoules Edison suspendues, de puits de lumière et de projecteurs qui enveloppent et baignent ces figures dignes et libres. Vêtues de costumes bigarrés et joyeux évoquant les robes chatoyantes et richement décorées des années 1920, ces femmes sont visiblement heureuses de mettre toute leur énergie dans leur danse pour pleinement habiter cet espace.
Radieuses et envoûtantes dans ces plumes, ces paillettes, ces perles et ces fourrures qui scintillent et qui éclaboussent l’écran de vivacité et d’audace, elles évoquent tant les ensorcelantes actrices d’antan que les fières matriarches autochtones d’un pow-wow. Les duvets d’autruche voisinent les plumes d’aigle, les tenues pailletées côtoient les broderies perlées traditionnelles et les wampums, les mouvements de charleston s’entremêlent aux sautillements des danses cérémonielles, les battements joyeux des bras rejoignent les gestes rituels de purification. La partition évolutive abstraite — davantage une rumeur ponctuée d’harmonies et de pulsations grondantes dans un crescendo très lent — élève ce film qui n’a pas besoin de paroles pour passer son message d’affirmation, de reconquête et de réappropriation du corps de la femme autochtone par elle-même. Une œuvre atypique, étonnamment émouvante et tonifiante. (Claire Valade)
KA WHAWHAI TONU: STRUGGLE WITHOUT END
Michael Jonathan | Nouvelle-Zélande / Australie | 2024 | 115 minutes
L'expression « guerres māories » désigne une série de campagnes militaires ayant opposé les forces coloniales britanniques aux populations polynésiennes autochtones de Nouvelle-Zélande entre 1845 et 1872. À l'apogée du conflit, 4000 guerriers māoris ont su tenir tête à environ 18 000 soldats britanniques. Le long métrage de Michael Jonathan se penche plus spécifiquement sur la bataille d'Ōrākau, un affrontement ayant eu lieu en mars 1864 durant lequel 300 autochtones résistèrent aux assauts répétés des troupes représentant la couronne anglaise. Ce siège est souvent considéré comme l'une des batailles les plus importantes, dans la chronologie de ces guerres. Si je prends le temps de le préciser, c'est que je suspecte que vous ne savez rien de tout cela. Tant mieux si je me trompe. Mais avouez qu'on ne parle pas souvent de résistance autochtone en Nouvelle-Zélande dans les livres d'histoire occidentaux.
S'il racontait une autre histoire que celle-ci, d'ailleurs, il y a fort à parier que je ne sentirais pas le besoin d'écrire sur Ka Whawhai Tonu. Pas forcément parce qu'il s'agit d'un mauvais film, mais plutôt parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci d'un point de vue strictement cinématographique. Il s'agit en effet d'un drame de guerre assez typique, honnête et fonctionnel sans pour autant posséder de qualités formelles ou narratives distinctives. Les images y sont belles, d'une manière un peu trop conventionnelle. Le scénario fonctionne, mais s'articule et se déploie de façon généralement prévisible. Les interprètes ont la particularité d'être, dans la mesure du possible, les descendant·e·s des gens présents à Ōrākau en 1864. Ils s'acquittent de leur tâche noblement. Mais, par-delà ce geste inspiré, la mise en scène ne fait pas vraiment de vagues ; elle se contente de reproduire une formule, une esthétique ayant fait ses preuves au point de devenir neutre.
Mais puisqu'il est ici question de résistance autochtone, il y a quelque chose d'intéressant à voir cette forme familière se retourner contre elle-même et contre les récits coloniaux traditionnels qu'elle a l'habitude de colporter. À certains égards, l'espèce de prévisibilité balisée dont souffrirait dans un autre contexte le film joue ici en sa faveur. Les rôles sont inversés, dans un récit qui nous donne l'impression d'avoir été raconté mille fois avec d'autres intentions. Il ne s'agit plus de magnifier le soi-disant courage des forces militaires britanniques, mais de célébrer la résilience du peuple māori. L'exercice d'écriture de l'histoire s'accomplit ici dans un vocabulaire simple, limpide, accessible — loin des enjeux syntaxiques propres aux canons parfois réducteurs de la critique cinématographique. Voilà qui n'est pas, en soi, improductif. Après tout, il faut décoloniser tous les genres cinématographiques. Y compris le drame historique un peu trop classique pour son propre bien. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Three Fires Film Productions
THE DIM
Ginew Benton | États-Unis | 2023 | 82 minutes
J’étais à Bruxelles lors de la projection du 7 août organisée par la revue à la Métropolitaine. Il fallait bien que je rattrape le temps perdu, et que je plonge à mon tour dans ce long épisode de Twilight Zone, ne serait-ce que pour l’amour du cinéma de genre artisanal ; pour la gloire des titres en Word Art, des bourdonnants silences habités, des disparités d’étalonnage, des acteurs démonstratifs et des dialogues explicatifs, des slogans volontairement ringards comme « A New DIMension of Evil » ; pour le dévouement admirable d’une équipe réduite, incluant l’homme-orchestre Ginew Benton (qui, en plus de signer la mise en scène et le scénario, est aussi responsable du cadrage, du montage, de la direction artistique, de la production, de la conception et du mixage sonores, des costumes et du transport) ; pour l’inspirante économie de moyens dont fait preuve le film, et pour ses quelques élans d’ingéniosité, qui contribuent à un visionnage très divertissant, doublé d’une ethnographie astucieuse des Shinnecock et des Unkechaug de Long Island.
Benton n’a pas besoin de grand-chose pour concrétiser sa vision d’un personnage autochtone malheureux, au bord de la rupture amoureuse, qui un jour se retrouve dans une dimension parallèle après avoir traversé un portail en forme de tesseract dans la forêt. Il mise notamment sur une bande sonore éclectique très lisible, où les pièces grunge dédiées au spleen de Troy cèdent au synthwave à la Stranger Things, puis aux notes de piano planant pour les moments de tristesse nostalgique et les discussions entourant le trauma colonial. Il compte surtout sur une petite production efficace dont chaque élément contribue humblement au potentiel d’évocation de la narration. Usant d’une direction artistique économe, le réalisateur accentue les contrastes entre les paysages naturels et les intérieurs oppressants de l’université Stony Brook, puis du repaire industriel des hommes en noir ; l’utilisation des filtres bleutés crée quant à lui un clivage marqué entre les deux mondes parallèles du récit, arpentés par une caméra d’iPhone aussi flexible qu’inspirée qui se livre à d’amusantes chorégraphies avec le protagoniste, qu’elle escamote du cadre et lui assigne des plans subjectifs fantomatiques pour mieux le situer dans une sorte d’interstice carcéral.
Force est finalement de constater que, malgré le recours à certains lieux communs du cinéma de science-fiction, le concept d’espace liminal que travaille ici le réalisateur s’avère idéal pour aborder - de manière parfois significative, parfois confuse - les questions centrales du scénario à propos de l’éloignement interpersonnel, de l’aliénation, de la dissociation culturelle, de l’hybridité identitaire et des errances colonialistes. C’est même l’occasion d’intégrer certains éléments de la cosmogonie iroquoise (incluant le récit de la déesse Atahensic) aux théories mathématiques du multivers, de recouper le monde des sciences occidentales et les pratiques chamaniques ancestrales, de rattacher le Montauk Project aux rites de purification par la fumée au sein d’un Long Island qui, à l’instar de Troy, se trouve écartelé entre deux univers contigus, mais antagonistes. (Olivier Thibodeau)
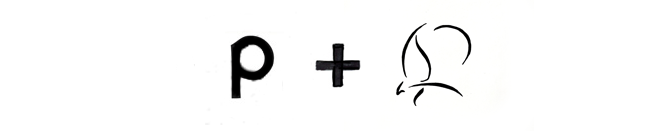
Partie 3
(Alien Weaponry, Endless Cookie,
Pidikwe, Ka Whawhai Tonu,
The Dim)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
