
prod. Wapikoni Mobile
L’INNU DU FUTUR
Stéphane Nepton | Canada (Territoires non cédés) | 2021 | 5 minutes | Compétition 1
Attirant notre attention sur une autre facette de la mémoire entravée des descendants autochtones, Stéphane Nepton met en scène « une santé culturelle absente » et le fait de porter en soi un « maillon brisé » dans la chaîne de l’héritage personnel et communautaire. Comment agir et vivre dedans et dehors des racines qui n’ont pas pu tout à fait arriver jusqu’à soi, à cause de mesures coercitives d’effacement identitaire ? Que faire de ce trou mémoriel alors que l’on vit en ville, loin d’une nature qui encercle et forme le sens spirituel de là d’où l’on vient ? Le cinéaste situe sa propre figure postée dans différents coins de Montréal avec en guise de visage une percée paysagère qui tout à la fois indique l’effacement et l’enfouissement d’une mémoire à retrouver. Le mouvement des choses qui défilent dans la rue est également pris à rebours, extériorisant la posture de la personne en quête de « cette rivière sous la rivière » tel que Nepton le formule bellement. Avec l’apparition de mots innu qui ponctuent les images, la voix off explique humblement le sens de la quête, la façon dont cela procède, voire la potentielle impossibilité de satisfaire une réappropriation entière. Lorsque les traits du visage du cinéaste se révèlent, on saisit que le sens s’est toutefois trouvé à travers l’épreuve féconde, à même d’envisager un passé devenant de plus en plus un présent simplement parce que l’on tend vers une plus grande écoute de la rivière. Chapeauté par le studio d’apprentissage du Wakiponi, L’Innu du futur offre un témoignage sensible qui taille sa place à l’aide d’idées et de paroles dont l’efficacité repose sur la franchise, la douceur et l’ingéniosité. (Maude Trottier)

prod. Kinomada
BELLE RIVER
Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin | Québec | 2022 | 11 minutes | Compétition 1
L’objectif d’un drone caresse la surface détrempée d’une série de routes louisianaises inondées, capturant la quiétude étrange d’un lieu où la nature retrouve rapidement ses droits, où les canards pataugent au milieu des rues, mais où les Cajuns se retrouvent complètement abandonnés, ignorés par la promesse trumpienne de restaurer l’Amérique à sa gloire passée. Les images sont absolument magnifiques, frisant parfois l’abstraction pittoresque et le rythme est parfaitement contemplatif, idéal pour capter l’essence d’un monde où le temps semble figé, où les activités locales se poursuivent nonobstant le demi-mètre d’eau accumulé au sol. Les témoignages en voix off recueillis par les auteurs auprès des habitants, rendus dans un créole savoureux où prolifèrent les « tas », nous éclairent un peu quant à la situation, mais semblent servir principalement à injecter une dose de couleur locale au récit, de même qu’à immortaliser une langue apparemment vouée à la disparition (au vu du vieillissement de la population). Ce sont surtout les images qui racontent l’histoire des lieux, l’histoire d’un pays où la FEMA n’a pas plus d’intérêt à sauver les populations pauvres de la Louisiane que les intérêts corporatifs que représente le gouvernement central, pour qui le poids de la tragédie réside moins dans les vies perdues que dans le potentiel lucratif de la stratégie du choc. L’un des témoignages résonne avec particulièrement d’éloquence, soit l’assertion d’un homme résigné à la pataugeoire. « Nous avons toujours vécu dans l’eau », déclare-t-il, considérant comme un simple effort d’adaptation le fait de devoir désormais vivre dans celle-ci, à l’instar des écrevisses que les Cajuns pêchent traditionnellement, et dont le sort est également régi par des pouvoir extérieurs à eux-mêmes.
La caméra de Fournier, Matteau et Nolin est très inquisitive, elle aime glisser le long des panoramas locaux et capturer moult détails évocateurs dans des compositions photographiques superbes montées avec soin. Les camions brisent tant bien que mal les flots et les bottes de caoutchouc permettent aux habitants de se promener entre les maisons et de rejoindre les vérandas encombrées de leurs cambuses riveraines tandis que retentit à l’horizon le bruit obsédant d’un soubassophone. On assiste ainsi à la nouvelle normalité d’un peuple dépossédé qui, plutôt que d’interroger les raisons de la furie déchaînée des éléments et de l’abandon vécue auprès d’une société dont ils n’occupent que la marge, se résout simplement à sa condition. Tout cela alors que l’épouvantail Trump veille au grain, recouvrant le paysage de l’ombre de ses vaines promesses et que la digue continue à fuir, inlassablement, inexorablement, sous l’œil d’une caméra qui s’en sert pour clore le propos, et accuser le laisser-aller de pouvoirs inhumains pour qui le sacrifice des minorités linguistiques et des classes pauvres est depuis longtemps devenu un fait anodin. (Olivier Thibodeau)

prod. OUAT MEDIA
GIRL WITH A THERMAL GUN
Rongfei Guo | Chine | 2020 | 11 minutes | Compétition 1
Il existe deux genres de films de propagande. Ceux que l’on regarde dans une salle de classe à l’occasion d’un cours d’histoire ou de montage, ces films brutalistes, univoques, souvent impressionnants de perfection technique puisque la propagande n’aime que les choses bien foutues ; puis ceux qui nous passent sous le nez, comme en veille, qui n’ont l’air de rien, qui échappent même parfois aux cinéastes à qui on peut bien prêter les meilleures intentions, mais qui pourtant étendent toujours un peu plus à chaque diffusion le domaine de la soumission tranquille.
Sous ses allures de comédie musicale pandémique bien rodée, Girl with a Thermal Gun excelle dans les deux catégories avec sa bonne humeur et son ton entraînant. On y suit un livreur de marchandises uberisé, tombé amoureux d’une employée d’épicerie chargée de la tâche de braquer le pistolet-thermomètre à l’entrée. Tandis que cette dernière incarne la réglementation zélée, lui traduit le cheap labor qui abonde en Asie et dont on ne voit pour l’instant ici que la pointe de l’iceberg. Il est devenu commun là-bas de faire appel à ces travailleurs à la volée pour exécuter toute commission, des courses à la lessive jusqu’à l’arrosage des plantes et la promenade canine. Pratique, dites-vous ?
Bien sûr, à condition de ne pas réaliser que ce marché de la gig economy (ou économie à la demande) dépend, et particulièrement en Chine, d’un amarrage technofasciste aux exigences existentielles. Discipliné·e·s par la surveillance étatique d’employeurs qui usent d’apps aux fonctions ubiquitaires, ces travailleurs efficaces dont Rongfei Guo fait l’apologie n’ont d’épanouissement que celui d’une réalisation impossible : rêves de succès financiers et d’ascension de l’échelle sociale, images de richesse abusive formant un horizon collectif pour 1 milliard et demi de personnes.
Pourquoi donc, Girl with a Thermal Gun, gagnant du Prix du meilleur film narratif à Tribeca, s’avère-t-il un éloge de cet endoctrinement ? Simplement parce qu’il dissimule sous sa fluidité chorégraphique et son imaginaire guilleret une adhésion sans hésitation au Moloch asiatique, sans clin d’œil capable de percer tout avilissement ou cynisme potentiel, pas plus dans ses gestes millimétrés que dans sa chanson de murmures à la gloire de marques célèbres, harmonisés dans une esthétique du triomphe économiste. Un peu comme la version dystopique d’une comédie musicale pensée pour nous faire rire de la réalité pandémique, le film de Rongfei Guo a quelque chose de terrifiant, avec ses individus trop dociles, son amour des stéréotypes de la jeune beauté chinoise à l’allure immaculée. Aucune alternative n’y est proposée, aucune échappée entrevue pour son personnage condamné à danser à l’intérieur des paramètres de son application mobile et de mesures sanitaires ayant décuplé l’omniprésence des stratégies de contrôle de l’état chinois.
Trop lisse pour ne pas être une entreprise au cœur louche, Girl with a Thermal Gun est un chant de soumission, un rêve d’ambitions à caser et d’humains à compartimenter ; une poésie de grande surface aseptisée, un sournois film de facing. (Mathieu Li-Goyette)

prod. The National Film School / IADT
FALL OF THE IBIS KING
Mikai Geronimo et Josh O’Caoimh | Irlande | 2021 | 10 minutes | Compétition 2
Les courts comme Fall of the Ibis King ont d’impressionnant cette capacité à raconter des récits complexes sans les complexifier. Ici, c’est au théâtre et à l’animation nimbée par les lueurs de sa scène que revient la responsabilité de faire tenir une histoire tragique dans un mouchoir de poche ensanglanté. Un acteur amoureux, devant livrer sur scène un faux couteau à la grande vedette de la pièce, dissimule mal sa jalousie maladive. Épris de l’actrice principale, il ne supporte pas que celle-ci soit éternellement captivée par la tête d’affiche du spectacle, un acteur réputé taisant un problème d’alcoolisme chronique, le rendant instable dans sa posture, incertain dans ses lignes, potentiellement violent pour ses proches.
Ces sentiments complexes, ces contradictions de l’amour et de la haine, le film de Mikai Geronimo et Josh O’Caoimh (sélectionné à la dernière Mostra) les diffuse dans l’animation comme une huile essentielle : les alternances raides entre les environnements drapés du rouge de la scène, puis d’autres creusés par des noirs verdâtres et oxydés ou encore soulignés par une lumière dorée, confèrent au film une plasticité dont le pouvoir d’évocation émeut à tout instant. Pas un seul plan de Fall of the Ibis King n’est ainsi laissé au hasard, dans le vide ou le vent, l’ensemble répondant d’une consécution tragique où le trait comme le cadrage travaillent un approfondissement émotionnel qui a la force et la brutalité d’une chute qui ne pardonne rien.
Au-delà de l’animation et des puissances prémonitoires, éthérées qu’elle évoque, c’est surtout par son montage que la disgrâce de ce roi de la scène marque le plus durablement. Conviant à la fois les scènes psychiques et mentales de ce drame triangulaire, les deux animateurs irlandais font preuve d’un sens du rythme évident, maniant des dimensions à la fois concrètes et symboliques, plantant patiemment, au moyen d’inserts (sur les cordages ou les carottes) et de coupes rapides (dansées ou tombées), une rythmique d’unisson qui s’incarne progressivement, où l’inévitable ne fait plus qu’un avec la convergence des trajectoires affectives. On en ressort attristés, mais surtout subjugués par une esthétique de l’amour désespéré dont la complexité n’entrave aucune lisibilité. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Thomas Corriveau
THEY DANCE WITH THEIR HEADS
Thomas Corriveau | Québec | 2021 | 8 minutes | Compétition 7
Clair favori de la foule réunie au Centre d’expérimentation musicale (par-delà le très venteux pont de Saint-Anne) pour le programme du jeudi, They Dance With Their Heads est une œuvre magnifique de part en part, écrite avec un humour charmant et rendu dans un style d’animation protéiforme incroyablement dynamique. Le tout commence avec un « zoom » vers une tête tranchée qu’embête un corbeau sur une île de roches déserte fouettée par les flots. Partant d’un canevas statique dont le contenu s’anime tranquillement, l’auteur donne vie à un monde palpitant. Constitués de traits de peinture métamorphiques, constamment changeants, tous les décors possèdent une apparence organique, transcendant ainsi d’emblée le potentiel d’expressivité traditionnellement associé aux arrière-plans dans le cinéma (d’animation) classique. Tout chatoie ici, et nous attire inexorablement. Une fois cadrée en gros plan, les yeux de la tête tranchée s’ouvrent et elle commence à nous parler à la manière du narrateur d’un récit fantastique. « Ah ! You’ve come to see me, my friend », déclare-t-elle du tac au tac, « it’s good to see you ». L’effet surréaliste est amusant de prime abord, mais c’est finalement la façon anodine que la tête a de nous entretenir qui garantit le comique de la situation. La voix de cette tête appartient à l’acteur, danseur et metteur en scène Marc Béland, qui commence dès lors raconter des bribes de sa propre vie. « I used to be a dancer », affirme-t-il, faisant marrer la foule, « but now, I’m a choreographer », entraînant avec cette déclaration stoïque une salve de rires supplémentaires.
Rares, voire singuliers, sont les textes biographiques aussi particuliers, aussi enlevants, aussi évocateurs d’une puissance créatrice qui émane des artistes créateurs à la manière d’un éther enivrant. En effet, si la fluidité extrême et la facture métamorphique des surfaces, des matériaux et des gestes à l’écran contribuent à stimuler sans cesse le spectateur, elles permettent aussi au réalisateur d’émuler le flot chaotique des pensées de Béland. Après avoir vu sa tête chipée par le corbeau, puis échappée dans la mer, le sujet se remémore les gymnatstiques liquoreuses de ses danseurs, dont les corps somptueusement détaillés, dessinés au crayon, se tordent, se décomposent et flottent en apesanteur à l’écran à l’occasion d’un énième ballet de formes, incarnation sensuelle d’un art corporel du mouvement sublimé dans un art graphique du mouvement. Le processus de dissociation, d’abstraction et de reformation des objets dans l’espace évoque en outre l’un des grands thèmes du cinéma d’animation, soit le rapport continu entre la vie et la mort, que rappelle également l’idée d’une tête morte-vivante. Avec une œuvre qui s’échelonne sur plus de 40 ans, l’artiste visuel et animateur Thomas Corriveau est visiblement passé maître de son art, parvenant parfaitement ici à allier la maestria technique à une appréciation analytique du médium animé, témoignant ainsi d’une intelligence hors pair qui ne saurait en rien faire obstacle à l’appréciation populaire de son travail. (Olivier Thibodeau)

prod. Sandrine Berger
SIKIITU
Gabriel Allard | Québec | 2022 | 26 minutes | Compétition 8
Remarquable par ses images très richement photographiées, par son récit au classicisme trompeur et par la fraîcheur de regard qu’il pose sur la vie au Nunavik, Sikiitu met en conte la relation entre Ali, jeune amateur de hip-hop amouraché d’une idole bling-bling, et un père qui, comme dans tout bon récit père-fils, incarne la solidité de la tradition. Fort de la juste distance qu’exige le genre du documentaire dont il est un habitué, Allard sait très habilement nous faire entrer dans ce quotidien nordique sans affectation exotisante ni complaisance ethno-sentimentale. Sans être banalisée, la réalité montrée l’est au même titre que ne le serait n’importe quelle réalité, naturellement portée par la fiction, fondue en elle. Si bien que si la dureté du froid et le mode de vie si particulier qu’il impose sont tout à fait présents dans Sikiitu, nul misérabilisme ou défaut de positionnement judicatoire n’entache l’approche des personnages, simplement humains et quelque peu têtus. L’alternance entre les scènes de chasse avec le père et les séances de visionnement des vidéoclips de Rich E. Murdoch, ce rappeur au sexisme loufoque, fournissent l’habillage contextuel, situent l’imaginaire d’Ali et canalisent ce qui relève moins d’un choc de cultures que d’un phénomène d’acculturation. Ce que rejette Ali, le Ski-Doo sans cesse en panne et la dimension paumée qu’il y associe, ce que rejette son père, la culture blanche et ses valeurs de pacotille, se confrontent et cette tension progressive va bien sûr éclater. Mais plutôt que se contenter du seul schéma d’engueulade intergénérationnelle classique et pathétique, l’éclatement s’accapare le plan pour nous faire basculer dans une rêverie délirante aux accents fantastiques. Voilà que l’humour grinçant et l’invention visuelle côtoient la prise de conscience, tout en restant au plus près de la fonction thérapeutique qu’attribuent les cultures autochtones au songe et au rêve. Dépeignant avec finesse et adresse les écueils liés aux mécanismes d’intériorisation de la culture blanche, Gabriel Allard signe un film à la facture esthétique prégnante, qui fait corps avec les astuces scénaristiques et les dialogues « witty » d’Eric K. Boulianne et Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon. (Maude Trottier)
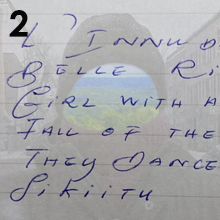 |
jour 1 |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
