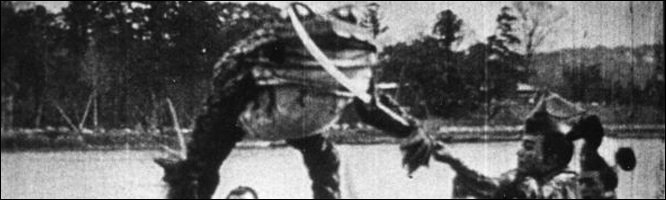Index
The First Winter // Ryan McKenna (2012)
Jiraiya le ninja // Shozo Makino (1921)
In Another Country // Hong Sang-soo (2012)
Lacan Palestine // Mike Hoolboom (2012)
L'oeil de l'astronome // Stan Neumann (2012)
The Wolf Children // Mamoru Hosoda (2012)
>> Festival du Nouveau Cinéma 2012

2012.10.20
LACAN PALESTINE (2012)
Mike Hoolboom | Canada | 70 minutes
Depuis une trentaine d'années,
Mike Hoolboom poursuit une carrière peu connue du grand public en affinant un cinéma où la théorie rencontre l'image pour rendre claire la pensée tout en revigorant les sources utilisées. Filmant lui-même en vidéo quelques segments de son magnifique
Lacan Palestine, Hoolboom nous confronte à la situation palestinienne, à la construction d'un imaginaire collectif occidental (représenté par de nombreux extraits de films hollywoodiens allant de
Kingdom of Heaven à
Watchmen) où l'impérialisme américain devient tangible et nous apparaît enfin comme la manipulation à peine subtile d'une histoire ancestrale épicée au goût du jour.
En superposant des images des adaptations cinématographiques de l'Exode judaïque et des luttes autour de la Bande de Gaza, le vidéaste prend un malin plaisir à raconter de nouveau une Histoire de l'humanité et de l'Amérique en instaurant son récit des origines, celui de la Terre promise américaine auprès de celle, toujours promise depuis l'époque du Christ, de Jérusalem. Peuple venant en aider un autre à trouver son espace sacré, l'Amérique redonne au peuple juif son Mur des Lamentations que filme Hoolboom et qui semble vouloir délimiter cette ville dont la régence s'assure à coup de massacres, mais surtout de martyrs. Après un magnifique film sur le suicide de son fidèle collaborateur (
Mark), la mort s'infiltre encore dans les images qu'il maîtrise uniquement par le montage et le choix des extraits. L'essayiste hors pair de l'image revient toujours aux questions de mémoire et de la matérialisation de la pensée humaine dans le monde réel (dépression, suicide, génocide), voire du chemin qui sépare l'idée (non instinctive) de son exécution.
Avec Lacan en tête – le grand psychanalyste qui structura l'inconscient et qui tenta de repérer les balises constituantes d'un discours du moi et de l'autre –, mais aussi le théoricien de l'orientalisme Edward Said, il évite les raccourcis et se concentre à réutiliser des images d'archives connues (qu'elles proviennent du cinéma ou de l'actualité) pour établir un discours nuancé et troublant sur le fond mythologique et profondément religieux qui dicte encore les décisions géopolitiques les plus importantes. À comparer les images crues du quotidien palestinien aux vieilles frasques d'un Charlton Heston muni d'une longue fausse barbe, bras en l'air cherchant à ouvrir un chemin à travers sa Mer Rouge truquée, l'auteur cherche à nous mettre sous les yeux l'absurdité des origines de nos lois et la gravité de leur influence jusqu'en nos temps modernes. Stipulant qu'il n'y a là, dans la manière dont la Palestine est envisagée, rien de contemporain ou de résolument brillant, il critique l'archaïsme en politique, la bêtise du divertissement, mais aussi de ceux qui n'y ont jamais vu le signe avant-coureur d'une domination culturelle qui allait être la pierre d'assise d'un conflit dont l'enjeu artificiel n'a encore d'égal que sa brutalité consommée, comme le cinéma, par petits et grands. (Mathieu Li-Goyette)
Diffusion : Vendredi 12 octobre à 17h00 (Centre PHI) et dimanche 14 octobre à 13h30 (Excentris)
>> Retour à l'index

2012.10.19
IN ANOTHER COUNTRY (2012)
Hong Sang-soo | Corée du Sud | 89 minutes
Souvent comparé à celui de
Woody Allen, le cinéma d’Hong Sang-soo est caractérisé, a priori, par une impressionnante productivité (au rythme de plus ou moins un film par année depuis 2004) et d’une répétition autant narrative que thématique, parfois au tenant vaguement autobiographique et à saveur souvent obsessionnelle. Chez Hong, il y a une obsession du quotidien, une fascination avec le mondain, l’humain dans ses moindres détails. Son tout dernier,
In Another Country, nous (re)présente cette fascination pour la répétition sous la forme de trois récits, quasi identiques (mêmes lieux, mêmes personnages – à quelques traits de caractère près), qui s’empilent, telles des esquisses, pour former un tout; tel un carnet de voyage, il s'avère l'un des moments les plus charmants et ludiques que l'on puisse vivre cette année au cinéma.
Trois fois Isabelle Huppert donc, qui joue ici une étrangère en visite dans un petit village de Corée du Sud. Hong, par le hasard d’une rencontre lui aussi, trouve l’interprète à travers laquelle dévoiler (et rendre comique) les idiosyncrasies du Sud-Coréen moyen face à l’étranger, mais – encore et toujours – face à lui-même. Dans ces trois histoires conçues de subtiles répétitions et d’une succession d’hasards méticuleux (Huppert couchera-t-elle avec le maître nageur? Trouvera-t-elle le phare du village? Tournera-t-elle à gauche ou à droite?), les interactions humaines et culturelles restent à l’avant-plan et un attachement fort se crée face à ces personnages. De par notre investissement émotif, Hong tisse, sans qu’on ne le réalise, de puissantes tensions narratives qui seront habilement résolues une fois la troisième déclinaison narrative montrée. Huppert retrouvera un parapluie et, dans la simple beauté du geste, Hong pourra clore un exercice qui aurait pu se dérouler ad vitam aeternam.
Une comédie ravissante sur la quête du scénario parfait, Hong, tel un philosophe sans prétexte autre que d’observer ce qui lui plaît, déconstruit les attentes (il n’y a aucune attente particulière à se faire, nous rappelle-t-il deux fois plutôt qu’une) du cinéma narratif conventionnel pour nous forcer à regarder : les lieux et les personnages, puis le caractère humain dans quelques-unes de ses déclinaisons possibles, infiniment plus intéressantes qu'un quelconque archétype prisonnier d’une trame narrative rigide.
Belle continuation d’un cinéma d’expérimentation, de comédie humaine et d’observation rafraîchissante du quotidien, ce dernier film est aussi une franche célébration de ces multiples choix qui forgent notre propre personnage, notre vie (et nos amours). De la même façon que Seong-jun, personnage de
The Day He Arrives (2011), se retrouvait dans une boucle de restos, boissons et de sessions de palabre entre amis proches, Huppert se perd (puis se retrouve) dans une systématique répétition de trames narratives… Dans lesquelles il fait incroyablement bon de déambuler auprès d’elle. (Ariel Esteban Cayer)
Diffusion : Samedi 13 octobre à 17h00 (Cinéma Impérial) et lundi 15 octobre à 13h00 (Cineplex Odéon Quartier Latin)
>> Retour à l'index
2012.10.17
THE WOLF CHILDREN (2012)
Mamoru Hosoda | Japon | 117 minutes
La presse ne manque pas d’occasions de spéculer sur le potentiel héritier d’Hayao Miyazaki. Qu’il s’agisse de Goro (fils de), Makoto Shinka (dont le cinéma manque encore de subtilité) ou Mamoru Hosoda, réalisateur dont il est question ici, il s’agit en fait d’une compétition imaginaire permettant de repérer des thématiques transversales et des soucis esthétiques qui en découlent (de Ghibli à Madhouse et d'autres rivaux) à façonner un certain cinéma d’animation japonais. Travaillant lui aussi dans la foulée du grand maître tout en façonnant un univers qui lui est propre, Hosoda, étoile montante de l’anime d’auteur à qui ont doit la plus récente adaptation de The Girl That Lept Through Time (2006) – faisant suite à la version de 1983 de Nobuhiko Obayashi, le réalisateur du sublime Hausu (1977)! – et le remarqué Summer Wars (2009), nous offre ici son plus récent long-métrage, Les enfants-loups, ou The Wolf Children dans lequel il confrontera ses personnages (une jeune mère japonaise forte et admirable) et son auditoire de tous âges, à l’appel d’une nature refoulée, engloutie, mais toujours puissante.
En premier lieu, The Wolf Children est un drame sentimentalo-fantaisiste des plus touchants, de ceux qui vous serrent le cœur et vous font pleurer à chaude larme – si vous acceptez ses techniques de manipulations. Je parle ici du magnifique scénario tragique, des émotions à fleurs de peau, de la superbe musique de Takagi Masakatsu, de la chaude lumière traversant maintes gouttes d’eau et rizières, mais aussi d’arrières-plans peints sublimes, conçus pour vous rendre minuscules face à la puissance de la nature…telle que peinte par l’homme, l’animateur, Hosoda le conteur. Mettre la larme à l’œil n’est pas tâche facile, mais Hosoda y parvient à travers ces images mises en contraste avec la ville et sa civilisation où le récit débute et où le réalisateur nous représente comme cruelle et assassine – lorsque l’homme-loup épris d’Hana est tué comme une bête par exemple. Ces forts éléments d’opposition se fondent, se mélangent et s’assemblent pour former l’épine visuelle du récit d’Ame (pluie) et Yuki (neige), les deux enfants-loups nés de l’alliance entre un étrange lycanthrope et Hana. Maintenant mère monoparentale, elle décide de quitter la ville hostile pour élever ses enfants en campagne où ils auront la liberté des grands espaces pour grandir comme bon leur semble : loups ou hommes, ce sera leur choix et les 12 travaux d’Hana, prête à apprendre comment élever ces enfants les plus particuliers. Hosoda, avec une aisance inouïe, met en images une famille d’une humanité confondante, à laquelle on s’attache immédiatement et dans laquelle on s’investit corps et âme sans hésiter. Ces personnages porteront le récit jusqu’à une conclusion naturelle, inévitable, superbe.
Le récit de fantasy (dont les références à une bestialité assumée ne sont pas négligeables et remettent en question l'orientation de ce film « pour enfant ») se transforme rapidement en intense drame familial, traçant le développement (et la séparation) de cette progéniture face à leur mère. Tandis que l’un renoue avec une nature innée, l’autre accepte la civilisation humaine; conflit d’apparence simpliste qui prend des proportions considérables lorsque Hosoda met Hana au centre de son équation. L’amour qu’une mère à pour ses enfants est l’un des plus beaux liens représentables à l’écran et Hosoda remporte le pari de le faire en dessins dans un anime dont les apparences mignonnes cachent la puissance inattendue d’un film complexe et déchirant. (Ariel Esteban Cayer)
Diffusion : Dimanche 14 octobre à 14h45 (Excentris)
>> Retour à l'index

2012.10.17
THE FIRST WINTER (2012)
Ryan McKenna | Canada | 72 minutes
Winnipeg : mythique, froide, inhospitalière. C’est une ville qui occupe une place particulière dans la géographie canadienne et qui cause un paradoxe particulier dans la psyché de ses habitants et de ses artistes. Étrange relation entre amour, dédain et nostalgie, l’esthétique de Winnipeg est unique en soit, et il s’en émane très souvent une position de défaite et un ennui écrasant. L’ennui étant depuis toujours un des plus grands et propices incubateurs pour l’art, il ne faut donc pas s’étonner que sous ses paysages désolés et enneigés, Winnipeg cache une communauté d’artistes et de cinéastes commençant à faire des vagues un peu partout.
Lorsqu’on associe la capitale à son cinéma, le renommé pionnier
Guy Maddin (
Keyhole,
Brand Upon the Brain!,
My Winnipeg) vient immédiatement en tête. Cependant, depuis quelques années, plusieurs talents en émergent. Qu’il s’agisse de Matthew Rankin (dont le plus récent court-métrage fut prisé par l’AQCC et sélectionné aux Jutras plus tôt cette année) ou du collectif Astron-6 (dont le moyen-métrage
Manborg fut diffusé à Fantasia cet été), il devient clair qu’il s’agit d’un cinéma qui développe peu à peu son identité. Ce premier long-métrage de Ryan McKenna, réalisateur de courts-métrages au sein du Winnipeg Film Group (
Honky-Tonk Be,
Chinatown), le confirme et, sans être renversant, offre un portrait bonhomme d’une ville quasi mythique pour toutes les mauvaises raisons.
Comédie amère sur Roberto (Robert Vilar), un jeune slacker portugais se rendant à Winnipeg pour la première fois lorsqu’il apprend que Sophie (Eve Mazjels), flamme d’un voyage, est enceinte, ce premier film arrive à capturer l’essence de la méprisée ville canadienne dans ce qu’elle a de pire : froid infernal, isolation totale, pauvreté et alcoolisme de survie en abondance. On observe ici l’exercice d’autodérision typique d’un jeune cinéma, décidé à jeter un regard sur la désolation, la platitude et le pathétisme des lieux et des personnages qui le façonnent. L’humour tombe à plat, mais ça semble faire partie d’une mission d’aliénation complète, maintenue avec aisance par le character actor Robert Vilar dont le non-jeu rappelle maintes œuvres dites mumblecore – mouvement flou né quelque part au début des années 2000 avec les films d’Andrew Bujalski Aaron Katz, Joe Swanberg et les frères Duplass. Ceci dit, Vilar (sur qui Kier-La Janisse écrivait un profil dans le numéro de mars de feu Spectacular Optical1) se taille une place bien à lui en apportant un certain ton performatif et ironique avec lui dont le style déteint notamment sur Eve Mazjels, enveloppant par conséquent toute la structure narrative du film.
Décrit par son réalisateur – à la blague? - comme faisant partie du mouvement de « brutalisme winnipégois » (un cinéma se voulant dur, humoristique, dérisoire, urbain et campé dans les éléments les plus rudes de l’hiver manitobain – blizzards et engelures),
The First Winter est un intéressant objet culturel plutôt qu'un divertissement recommandable; une anticomédie trop consciente qui en rebutera plus d’un, mais qui détient néanmoins le potentiel d'un film culte auprès des Winnipégois en connaissance de cause. (Ariel Esteban Cayer)
1Janisse, Kier-La. « An Ecstatic Professional ». En ligne.
Spectacular Optical.
Diffusion : Vendredi 12 octobre à 19h30 (Excentris) et samedi 13 octobre à 13h30 (Cineplex Odéon Quartier Latin)
>> Retour à l'index
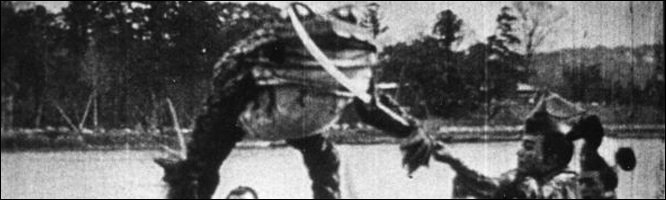
2012.10.16
JIRAIYA LE NINJA (1921)
Shozo Makino | Japon | 21 minutes
Le cinéma, c’est tout d’abord un grand tour de magie et quoiqu’on l’oublie souvent (en cette ère d’effets spéciaux et de toutes les ironies), il suffit de se (re)tourner vers le cinéma élémentaire et tout simplement ravissant du début du siècle pour tomber sous le charme à nouveau. Même si, autant à la maison que sur les bancs d’école, la découverte de l’histoire du cinéma est plus que jamais facilitée par maintes rééditions et restaurations numériques, l’expérience d’assister à une représentation en salle avec accompagnement musical performé en direct, reste, au risque de me répéter, simplement magique, voire potentiellement bouleversante. Retourner à la soupe primordiale pour mieux se retrouver; aux débuts des codes, des conventions, des techniques et des images. Cela dit, il s’agit d’une chose que d’assister à une énième représentation d’un best of de Méliès, mais d’une autre que d’avoir la rare opportunité de visionner une copie 35mm d’un classique du cinéma japonais rarement présenté en Occident.
En ouverture de leur part de la rétrospective Nikkatsu (en collaboration avec le Festival Fantasia et la Cinémathèque Québécoise) prenant d’assaut Montréal pour une deuxième et dernière fois, le Festival du nouveau cinéma présenta le curieux Jiraiya le ninja (1921), premier film d’effets spéciaux nippon réalisé par Shozo Makino, père fondateur du cinéma japonais – et à qui on doit, entre autres, une célèbre adaptation cinématographique du fameux Chushingura (47 Ronins) en 1928. À l’occasion, le tout fut mis en musique par la troupe montréalaise de tambours japonais Arashi Daiko.
À l’instar de Méliès, Makino, truque son audience au montage, substituant Jiraiya par un nuage de fumée et une grenouille disproportionnée gobant tout ennemi sur son passage. La trame narrative (ou ce qui en reste : le film n'a survécu qu’en partie) est purement accessoire à un déluge d’images familières, mais chronologiquement distantes. Combats, pirouettes et autres exploits d’arts martiaux se succèdent dans un cadre fixe plein à craquer. Issu du théâtre, Makino refusa pendant longtemps de bouger ses cadres, dotant Jiraiya d’une étrange qualité relevant de l’anachronisme (on se croirait une décennie plus tôt), tandis que Makino réaffirme encore une fois les origines littéraires du récit qu’il adapte.
En effet, en plus d’être un curieux objet filmique, Jiraiya offre une rare et excellente occasion de replacer la figure populaire du ninja dans le contexte de ses débuts au cinéma. Figure ancrée dans l’imaginaire populaire, Jiraiya est tout d’abord tiré du conte Jiraiya Goketsu Monogatari, dont Makino fait ici l’adaptation cinématographique, donnant le rôle à Onoe Matsunosuke, première grande star du studio Nikkatsu et fréquent collaborateur. Longtemps représentée dans le théâtre kabuki, la légende de Jiraiya survit jusqu’à aujourd’hui à travers plusieurs éléments (les personnages Jiraiya, Tsunade et Orochimaru ainsi que leurs invocations de grenouilles, serpents et limaces géantes), récemment popularisés par le manga Naruto de Masashi Kishimoto depuis 1997.
Qu’il ait servi d’inspiration littéraire (et cinématographique) à l’un des shonen mangas les plus populaires ou qu’il ait simplement rappelé ce qu’il y a de plus magique et d’élémentaire au cinéma, Jiraiya le ninja (1921) fut un beau coup d’envoi et une rare représentation qu’il ne fallait pas manquer. (Ariel Esteban Cayer)

2012.10.15
L'OEIL DE L'ASTRONOME (2012)
Stan Neumann | France | 90 minutes
1610. Cour de Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Johannes Kepler reçoit de Galilée un télescope qu'il pourra garder 10 jours durant. 10 jours pour révolutionner l'astronomie, pour extraire tranquillement la science de la théologie, le sensé de l'obscure sous les yeux investigateurs d'un entourage qui n'attendait qu'un faux pas pour le brûler vif au nom de l'hérésie. L'oeil de l'astronome fait référence autant à cet oeil brûlé par un mauvais médicament administré au célèbre mathématicien par son disciple qu'à la posture habituelle du scientifique, l'oeil fixé dans l'objectif de son télescope tourné vers le ciel ou à l'oeil de boeuf qu'il utilisera pour démontrer la complexité du voyage qu'entreprend la lumière à travers notre cornée. Premier observateur d'une supernova, premier à décrire le mouvement des astres comme une ellipse et non une révolution parfaite, Kepler étonne ses rivaux par sa capacité à exposer les problèmes complexes de l'univers, de la gravité et de l'optique à tous ceux qui y voient encore le dessein impénétrable d'une puissance divine et génératrice de toutes les significations et origines possibles.
La belle idée du documentariste Stan Neumann, qui nous livre ici un premier long métrage de fiction, c'est d'avoir su restituer avec tant de minutie une époque et ses craintes. Face à la science de Kepler, tous fuient au profit d'un obscurantisme plus simple. Magnifique film tourné à la lueur des chandelles, L'oeil de l'astronome rappelle ces oeuvres pour les téléfilms de Roberto Rossellini qui foisonnaient d'une pédagogie passionnante envers l'histoire des sciences, des arts et des civilisations. Film historique dans le sens le plus documenté du terme, L'oeil de l'astronome est une petite révélation festivalière destinée à finir ses jours à la télévision - destin qui ne lui rendra malheureusement jamais justice, et ce, surtout lorsqu'on pense à ses quelques plans brisant le quatrième mur. Ces segments concrétisent une belle corrélation entre la crédulité du dispositif filmique et celle de la religion, puis celle de la précision d'une démarche documentaire et celle de la science. Il n'en faudra pas plus pour que les meilleurs Peter Watkins nous reviennent en tête.
Au-delà de son désir méticuleux de nous rendre sensibles à une époque où les ondulations de l'eau pouvaient être interprétées comme les manigances du Malin, le film de Neumann s'en tire avec des plans magnifiques où les changements de focales deviennent soudainement métaphores de l'obsession du film - comprendre les mystères de l'optique - et prennent un sens simple et nouveau. Le phénomène se reproduit dans l'explication de la rotation des astres autour d'autres astres alors que la caméra suit l'astronome tournant méthodiquement autour de la noble dame qui se prête à son jeu. Caméra pédagogue jusqu'au bout, elle exécute le mouvement décrit, le répète comme l'étudiant qui observe le tableau, retranscrit la matière dans ses notes avant de les relire à voix basse. Neumann répète, sur la forme comme sur le fond, une petite histoire des mathématiques et des astres pour le grand plaisir des curieux qui sauront y voir moins l'ambition d'un cinéaste qu'un amour contagieux du sujet. (Mathieu Li-Goyette)
Diffusion : Mardi 16 octobre à 19h30 (Cineplex Odéon Quartier Latin) et mercredi 17 octobre 15h10 (Cineplex Odéon Quartier Latin)