
À propos de
ANIMALS UNDER ANAESTHESIA: SPECULATIONS ON THE DREAMLIFE OF BEASTS
Un film de Brian M. Cassidy et Melanie Shatzky (Québec, 2016) de 14 minutes.
Présenté en Compétition nationale courts et moyens métrages
(Julie Delporte)

GULISTAN, TERRE DE ROSES
Zaynê Akyol | Canada/Allemagne | 2016 | 86 minutes | Compétition nationale longs métrages
On devrait exiger plus souvent des nouvelles des combattantes du PKK. Celles qui ont pris les armes pour le Parti des Travailleurs du Kurdistan constituent une force doublement redoutable : entraînées au combat et à la discipline de la guerre, elles effraient aussi Daech, car selon la doctrine des islamistes radicaux, il n’y aura nul paradis pour celui qui sera abattu par une femme… Zaynê Akyol, dans ce premier film qui en fait d’emblée une réalisatrice à suivre et à faire connaître, alterne sans jamais déborder les scènes de camaraderie et les confidences d’une combattante, les moments de tension graves avant la bataille et les séances d’entretien de leur équipement rare et précieux. Chaque arme porte un nom, chaque cliquetis de balle qui embarque dans sa culasse, chaque pièce de métal nettoyée le matin, même le bisou sur le manche en bois de l’AK-47, toute cette guerre dans Gulistan est d’abord montrée dans le détail du montage sonore, puis dans son exclusion totale du cadre qui préfère aux armes les visages. En effleurant la guerre sans jamais la montrer tout en y revenant constamment, Akyol parvient à rejoindre la perspective que nous partagent ces femmes, assises en cercle, à prendre plaisir à discuter de leurs mitraillettes et du fait qu’elles n’ont jamais vu de femme mariée qui fût heureuse. Certes il est rare que la guerre soit filmée ainsi, mais ce qui l’est tout autant, c’est la façon dont la cinéaste rend à l’engagement volontaire de ces femmes son sens premier : celui de la défense du territoire ancestral kurde, de la promotion de l'éducation populaire et la libre discussion des idées et des points de vue. Ces revendications sont soutenues par le cadrage et la familiarité collégiale qu'il nous montre ainsi que par le souhait annoncé de faire de la philosophie, du discours engagé et de l’accomplissement de soi la fin des moyens que sont ces armes. Alors que, plus tôt dans le festival, Fuocoammare nous montrait l’infranchissable fossé entre la réalité de la guerre au Moyen-Orient et la nôtre, Gulistan a l’œil braqué sur la violence et la résistance qui est la première à lui faire face, pour mieux lui sourire, pour mieux montrer comment ces femmes et ce peuple s'émancipent. Oui, on devrait exiger plus souvent des nouvelles des combattantes du PKK, car à les voir, à les écouter, on découvre l’exact opposé, le contre-symbole le plus fort, de l’image médiatique de la femme du Moyen-Orient. (Mathieu Li-Goyette)

ISABELLA MORRA
Isabel Pagliai | France | 2015 | 22 minutes
NON-CONTRACTUAL
Paul Heintz | France | 2015 | 16 minutes
DIALOGUE(S)
Philippe David Gagné | Québec | 2016 | 5 minutes
ANDREW KEEGAN DÉMÉNAGE
Justine Harbonnier | Québec/France | 2016 | 12 minutes
A TRAIN ARRIVES AT THE STATION
Thom Andersen | États-Unis | 2016 | 15 minutes
Les cinq documentaires en Compétition nationale ou internationale courts et moyens métrages présentés dans la Salle 2 du Cinéma du Parc, ce 17 novembre, à 18h00, pourraient se lire et se lier sous le thème du langage et de l’exclusion.
Le film Isabella Morra – dont le titre fait référence, pour teinter son déroulement, à une écrivaine italienne de la Renaissance, poétesse méconnue de l’isolement et de la solitude — installe sa caméra dans une cour enceinte de HLM, sise dans une banlieue de Boulogne-sur-Mer, au cœur du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. La caméra roule, filme les enfants démunis, tantôt seuls, assis par terre, le regard vide, dans un obscur réduit d’où l’on entend des véhicules vrombir sans arrêt, tantôt en groupe, livrés à eux-mêmes, bavardant ou s’invectivant, devant un mur délavé dont les portes et les fenêtres sont barricadées. Les plans sont fixes, relativement longs, nous donnant l’impression que la cinéaste a patiemment voulu prélever sur ce morne quotidien divers moments dignes d’intérêt ou, à tout le moins, révélateurs de quelque réalité sociale. Le premier, d’ailleurs, donne le ton : une jeune fille, isolée dans son sombre cagibi, presse obsessionnellement, comme pour lui faire du mal, la main d’une poupée défraîchie qui répète à l’envi des phrases creuses — « Nous sommes sœurs », « Veux-tu jouer à cache-cache ? », « Peut-être que maman peut nous lire une histoire » — révélant ironiquement le manque dont ces enfants souffrent tous. On les voit ensuite promenant chacun son tour un mioche dans une poussette, lequel semble tenir lieu du jouet à deux balles dont on vient de se défaire, puis se chamailler entre eux, répétant à leur tour des phrases creuses mais teintées de violence, dont les mots « pédé », « putain » et « gouine », constituent l’essentiel de leur éloquence. Leur syntaxe, non moins pauvre, est, elle aussi, si écorchée qu’il faut parfois, pour les comprendre, s’appuyer sur les sous-titres. Le langage est à l’image de ces exclus : pauvre, violenté, vidé de son sens. On en fera pour ultime preuve le mot « LOVE » qui égaie sans conviction le gaminet souillé de l’une des fillettes.
Le film suivant, Non-contractual, s’ouvre également sur deux enfants, mais deux enfants qui, quoique visiblement mieux nantis (ils sont à bord d’une voiture de luxe qu’ils font semblant de conduire), n’en recourent pas moins à des propos tout aussi vides et creux, comme s’ils répétaient, à la façon de pathétiques automates, le discours plat de la petite-bourgeoise dans laquelle ils rouillent. Le langage, ici aussi, s’étiole. Puis, cet absurde documenteur nous fait visiter les bureaux du concessionnaire fictif où cette bagnole fut, selon toute vraisemblance, assemblée, et dans lesquels les employés, blafards et amorphes, s’époumonent du mieux qu’ils peuvent (c’est-à-dire très mal et sans trop y croire) à expliquer les tenants et aboutissants de leur aliénante occupation. La mise en scène (rarement à l’aise, dans des positions peu ergonomiques), les cadrages (ils apparaissent toujours coincés dans l’image) et les couleurs (pâles, fades, décolorées) jettent un regard sans concession sur le quotidien de ces adultes dont l’emploi sans intérêt — quoi qu’ils essaient de nous en (ou de s’en) convaincre — s’avère leur glorieux cul-de-sac. Les employés de cette société, visiblement déconnectés les uns des autres, vivent d’ailleurs dans un monde à part : gagnant de l’argent virtuel, achetant en ligne des biens virtuels, ils semblent même visser des boulons virtuels. Lorsqu’ils échangent, c’est pour parler chiffre, salaire, actif, passif, emprunt, investissement, profit, garantie… un univers lexical — voire un univers tout court — dont le spectateur peut se sentir, à bon droit, exclu.
Exclu, le spectateur l’était aussi des échanges masculins que donnait à entendre le film suivant, judicieusement titré Dialogue(s). Filmant tour à tour des militaires dans leur avion de guerre, des « gars de chars » autour de leur bolide modifié et des musiciens de heavy metal dans leur sous-sol décrépit, le réalisateur capte des bribes de leurs discussions fortement codées et nous y donne accès dans un montage syncopé qui en aggravera l’épaisseur. Le noir et blanc aura beau essayer de donner un peu de distance (temporelle et spatiale) à ces échanges, ceux-ci sont bel et bien de chez nous et n’en demeurent pas moins incompréhensibles.
L’esquisse suivante, Andrew Keegan déménage rendait compte, quant à elle, d’un autre dialogue (de sourds, celui-là), entre les propriétaires et les expropriés. L’embourgeoisement qui ronge Griffintown, à Montréal, fout non seulement les habitants du quartier à la porte de leur maison, mais fout également les maisons à la porte de leur quartier. Des promoteurs immobiliers, affamés et aphasiques, ont jugé favorable, plutôt que de la raser, de déplacer la plus ancienne maison du coin, construite dans les années 1820 (et ayant originellement appartenu à un professeur nommé Andrew Keegan), afin de l’intégrer — comme un simple colifichet — à leurs luxueuses habitations. Quel sens revêtira une telle bicoque ancestrale dans cette nouvelle et rutilante syntaxe ? N’en sera-t-elle pas réduite à nous dire que nous vivons dans un drôle de monde, un monde dans lequel les vieilles demeures se déplacent plus facilement que les vieilles personnes — qui jamais ne jouiront d’ailleurs de ces rêves de pacotille placardant les chantiers ? N’est-ce pas ce qu’il faut comprendre de cet habile montage parallèle nous montrant, d’un côté, la maison (dont on ne cadre que le toit) glisser candidement par les rues et, de l’autre, une grand-mère obèse peinant à pousser sa marchette, comme si elles étaient engagées toutes deux dans une course dont on connaît d’avance le vainqueur ? Les cadrages et les coupes deviennent impitoyables quand, lors d’un discours serti de vacuité, les promoteurs vantent leur ingéniosité : la réalisatrice les laisse s’égosiller hors cadre, préférant insister sur un Montréal brumeux et défiguré tout en attendant avec jubilation le moment d’interrompre sans prévenir l’insignifiant sermon au beau milieu d’un verset. Chacun mutile comme il peut, quelquefois avec les moyens du bord.
Enfin, il faut regarder A Train Arrives at the Station, comme la juteuse cerise de ce gâteau à quatre étages. Intégrant dans sa syntaxe des fragments de films ayant le train pour paradigme, ce court-métrage invite le spectateur à jouer et à tenter de retrouver le titre des divers morceaux qui défilent à toute vapeur devant lui. Exclus d’office seront ceux dont le piètre bagage cinématographique les empêchera de performer. En revanche, il reste que le jeu proposé par Andersen nous force à admettre que le train, au cinéma, est un signifiant dont le signifié a connu moult variations : jouet pour enfant, incarnation du progrès, machine de guerre, transport vers les camps, métaphore sexuelle, source inépuisable de gags, endroit romantique, lieu de complots maléfiques, le train ne fait pas qu’arriver en gare, il nous conduit plutôt au pays de la polysémie, là où l’image doit continuer de briller et le sens, de rayonner. (Jean-Marc Limoges)

MANUEL DE LIBÉRATION
Alexander Kuznetsov | France | 2016 | 80 minutes | Compétition internationale longs métrages
Yulia et Katia ont eu comme enfance l’enfer d’être nées de parents qui ne voulaient pas d’elles. Elles ont fait leur bonhomme de chemin en fuguant, en encaissant les coups, en atterrissant tôt, très tôt, dans des orphelinats de Sibérie. Un jour on a même cru bon de les interner, parce que les marques de leur ostracisation les avaient rabaissées au point où elles ne casaient plus dans la société russe. Or lorsqu’on est interné, en Russie, nous explique l’émouvant film d’Alexander Kuznetsov, on perd toute capacité civile : plus de mariage possible, plus de recours aux aides sociales, plus de passeport, plus de liberté, car c’est l’État (et pas n’importe lequel) qui nous a à sa charge. Ainsi, les gens qui pénètrent dans cette « maison de fous », comme elles l’appellent, y sont pour la vie, sans possibilité de libération sinon celle de traverser un épais processus bureaucratique et judiciaire, évaluations psychologiques débiles à l’appui, afin d’en sortir. Tourné en 2011 et 2015, Manuel de libération observe avec douceur le quotidien de ces deux femmes qui tentent le coup, une fois puis une deuxième, montrant leur échec et leur second essai dans un film en deux parties techniquement inégales (même si dans les faits, c’est la maîtrise et la qualité des images tournées en 2015 qui font pâlir la captation de 2011, moins équipée, moins nette, plus brouillonne). Répéter la démarche sans perdre son calme, sans céder aux pulsions suicidaires, toujours reprendre la chanson des évaluateurs sans s’en lasser, à l’image des essais répétés de Katia pour interpréter Für Elise à son piano pendant que tambourine derrière le mur la musique pop de la salle commune, c’est le nerf de leur guerre à elle. À la fois prison déguisée et lieu bouillant de vie et de solidarité, l’institution qui nous est présentée, avec les organes judiciaires qui y sont greffés (comme cette cour où une juge lit impassiblement les refus de renouvellement des droits civils), éreinte les deux héroïnes qui s’en relèvent constamment, avec une force et une dignité que Kuznetsov, photographe de profession, sait capter dans l’instant vivant où leur désir de résistance chavire et refait miraculeusement surface. (Mathieu Li-Goyette)
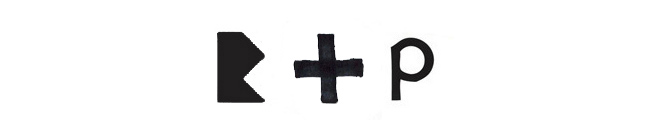
PRÉSENTATION
OUVERTURE : FUOCCOAMARE : PAR-DELÀ LAMPEDUSA
JOUR 1
(David Lynch: The Art of Life, Ta'ang)
JOUR 2
(Angry Inuk, Hier à Nyassan, Kate Plays Christine, Il Solengo)
JOUR 3
(Aim for the Roses, Fuocoammare : par-delà Lampedusa,
Dark Night, S.E.N.S., We Can't Make the Same Mistake Twice)
JOUR 4
(The Botanist, Brothers in the Night,
Manuel de libération, Territoire perdu)
JOUR 5
(Austerlitz, Combat au bout de la nuit, He Who Eats Children
Quebec My Country Mon Pays, Les tourmentes)
JOUR 6
(Brothers in the Night, Gatekeeper, The Great Theater,
Long Story Short, Speaking is Difficult, Uzu,)
JOUR 7
(A Train Arrives at the Station, Andrew Keegan déménage,
Animals Under Aneasthesia, Dialogue(s), Gulistan, terre de roses,
Isabella Morra, Manuel de libération, Non-contractual)
JOUR 8
(Calabria, Le goût d'un pays)
JOUR 9
(Le concours, The Dreamed Ones, Swagger)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
