
ANYWAY, J'PISSE ASSIS
Zak Slattery | Québec | 2025 | 13 minutes | Compétition québécoise
Je suis toujours craintif de voir la transidentité représentée au cinéma ; je suis méfiant du regard bien-pensant qu’on lui réserve parfois, de la violence, de la misère qu’on lui associe, de l’opportunisme des grands auteurs qui se l’approprient et du didactisme missionnaire qu’on destine à des publics dont on évite de trop bousculer la conception binaire du monde. C’est pourquoi je suis reconnaissant des films tendres et touchants comme Anyway, j’pisse assis, qui abordent l’expérience trans avec une pointe d’amertume mâtinée d’une joie chaleureuse, tout en simplicité, de façon franche, mais sans lourdeur.
Basé sur un scénario qui mêle la double appréhension d’un retour au bled et d’une baignade fluviale post-torsoplastie, le film met en scène un trio d’ami·e·s à l’occasion d’un road trip vers leur village natal, incluant un jeune homme trans, rieur et espiègle, mais anxieux de procéder. « Je suis comme stressé, ça me pogne dans le chest », déclare-t-il, dans une allusion simultanée au fait de revoir ses parents et à sa récente opération, dont finissent par discuter les personnages, mais sur un ton léger, bourré d’humour, qui fait beaucoup de bien, qui conjure le tragique et participe au jeu sémantique subtil et réjouissant qui anime le film. Celui-ci s’exprime notamment dans la représentation d’une masculinité rugueuse, mais bienveillante, attentionnée et contrite, celle de l’ami cis de Sasha, à qui l’on réserve même la citation titulaire. « C’est plus propre », explique ce balourd au grand cœur, prêt à céder son « privilège » de pisser debout, mais aussi à écouter attentivement les récriminations de son ami et à lui offrir des excuses sincères. On note aussi la représentation d’un imaginaire usité rempli de stations-service pittoresques et de panoramas côtiers accompagnés de petite guitare folk, évocation d’une félicité champêtre qui recèle son lot de ténèbres auquel Sasha fait allusion en mentionnant la « câlice de marde » que fut son adolescence. Mais aussi en exprimant ses angoisses à propos d’un certain Rémi, un oppresseur d’enfance qui, heureusement, restera toujours en hors-champ, un souvenir pénible contre lequel sa seule vengeance sera de réussir à être soi-même et à s’épanouir en tant que tel, fidèlement à la morale lumineuse d’une œuvre qui refuse la violence pour embrasser la douceur.
APOLÉON
Amir Youssef | France | 2024 | 14 minutes | Carte blanche
Du haut de son piédestal au musée de l’Armée, la statue de Napoléon nous observe, silencieuse, impérieuse, immuable ; le poids de son regard conquérant se fait sentir à travers les âges. Puis, en pénétrant derrière les murs, dans le grand reliquaire de l’Hôtel des Invalides, nous sommes écrasés par toute la charge de son legs, surtout lorsque la voix désincarnée d’une guide vient louanger la grandeur du personnage et l’importance historique de sa « campagne » d’Égypte. Heureusement, l’apparition du titre, Apoléon, surtitré en arabe, et la musique qui en ce lieu paraît irréelle, annoncent déjà une relecture révisionniste du grand récit colonial français. Chose que confirme la caméra en zoomant vers une maquette encastrée dans le mur, par-delà la vitrine, jusque dans une chambre miniature où la figurine du Petit Caporal prend vie. Fidèlement au concept de « Kinemania » élaboré par l’artiste égyptien Amir Youssef, le film s’oppose ainsi, dans une perspective décoloniale afrocentriste, à l’immobilité de l’histoire présentée dans les musées, aux sagas héroïques des grands leaders militaires européens, mobilisant pour l’occasion les figurines de l’endroit dans un contre-emploi magistral, les impliquant dans une réécriture critique savoureuse de cette fameuse « campagne » d’Égypte.
Sélection du festival Visions du Réel pour la carte blanche offerte cette année par Plein(s) Écran(s), Apoléon constitue une incarnation sublime de cette « fascination pour le mouvement » qui caractérise l’idée de « Kinemania ». Fort d’une mise en scène minutieuse, où le concours d’une bande sonore soigneusement travaillée, d’un cadre fluide, de rack focus dynamiques et de maquettes somptueuses transcende le statisme et le dépouillement des figurines, le film nous convie à une incursion immersive, presque haletante dans une tranche d’histoire vivante. Il propose surtout une satire mordante et délicieuse de l’entreprise coloniale et de la mégalomanie des grands conquérants, faisant de Napoléon une figure ridicule, humiliée notamment par le Sphinx, et montrant ses troupes comme une force immuable, mais maladroite et obséquieuse. Debout dans son bureau, le Petit Caporal s’interroge en arabe sur le nom à donner à sa campagne (campagne d’investigation ? campagne de repérage ? voyage exploratoire ?), évoquant l’hypocrisie d’un projet de conquête militaire justifiée par un maigre volet scientifique. Puis, comme tout bon gestionnaire, il mobilise ses troupes pour l’action en exigeant de chacun une lettre de motivation, un relevé bancaire et trois photos de passeport. Une fois en Égypte, ses troupes détruisent malencontreusement le nez du Sphinx et suggèrent de le ramener en France pour une « petite chirurgie ». Youssef s’intéresse surtout ici à la figure complexe des mamelouks, ces miliciens égyptiens et esclaves affranchis dont certains ont suivi Napoléon en France et qui, dans le faîte de la caricature diégétique, organisent un rave en l’honneur de leur maître. Le résultat est un pur délire, parfait pour corroder la ferveur nationaliste de toustes les bonapartistes.
CRUSHED
Camille Vigny | Belgique | 2023 | 12 minutes | Carte blanche
Dans cette carte blanche du festival Visions du Réel, la réalisatrice belge Camille Vigny fait preuve d’un rare jusqu’au-boutisme, adoptant une métaphore visuelle qu’elle exploite jusqu’à la dernière goutte… goutte d’essence sirupeuse, noir de jais, qui évoque les suintements amers d’un cœur (et d’un corps) brisé. Racontant de façon candide et déchirante les violences subies aux mains d’un amour de jeunesse, Crushed superpose à la voix off de la narratrice des images de stock-cars, ces véhicules sacrificiels qu’on course, qu’on percute, qu’on traîne, qu’on retape, puis qu’on course à nouveau devant un public indifférent à leur sort… un peu comme les femmes. Le tout débute par le récit de la rencontre avec Jean, pétri de détails précis, pittoresques. Puis, rapidement, le ciel bleu du sentimentalisme adolescent cède à des images de cour à scrap et la métaphore commence à s’enclencher, inexorablement, impitoyablement, nous tirant vers l’Hadès d’un cloaque patriarcal où les femmes demeurent encore aujourd’hui des punching bags.
La cinéaste parle des formes de son corps sur des images de carrosserie abîmée ; elle capte mille et un détails éclairants autour des circuits de terre battue, des plaques et des décalques aux noms de filles : Héléna, Chloé ; elle démontre sa pulsion de mort par des séquences de course où les véhicules éventrés, dénudés, se percutent et s’effondrent. Tout le processus est si cohérent, si frappant qu’il provoque une douleur presque épidermique. La puissance incantatoire de la narration, bourrée de descriptions factuelles et émotionnelles détaillées, nous permet de cerner toute l’horreur des abus, de la transformation monstrueuse initiée par l’alcool, des pluies de coups de poing, du visage couvert d’ecchymoses, de la lame déchirante que lui destinait son ex-amant. La bande-image comble les trous en illustrant les élans plus poétiques du discours d’une façon étrangement littérale, en accompagnant le souvenir d’un flottement extra-corporel par le spectacle des carcasses automobiles coincées dans la mâchoire des chariots élévateurs, ou en renforçant l’idée du passage à tabac par les coups de massue effectués sur la charpente décharnée des automobiles. « Je vivais quelque chose de nouveau qui m’a fait confondre l’amour et le danger », déclare à un moment la cinéaste, et il semble que cette constatation s’inscrit dans la matière même du film, dans les « je t’aime » inscrits sur de la ferraille tordue, dans cette conclusion douce-amère où la quiétude de la cour à scrap accueille les détails de la fuite ultime de l’autrice, qui a réussi à s’extirper d’une relation toxique dont elle porte toujours les marques à ce jour…

prod. École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV)
DESPUÉS DEL SILENCIO [APRÈS LE SILENCE]
Matilde-Luna Perotti | Québec | 2024 | 14 minutes | Compétition québécoise
La citation glaçante, mais libératrice d’Audre Lorde qui conclut Después del silencio s’adresse aux femmes « qui ne parlent pas », « qui n’ont pas de voix parce qu’elles sont terrorisées ». « On nous a appris que le silence pouvait nous sauver », déclare la poétesse militante états-unienne, « mais c’est faux ». Et c’est précisément ce que démontre ici la réalisatrice Matilde-Luna Perotti dans ce film de fin d’études, gagnant du Golden Dove à DOK Leipzig, dans lequel elle aborde l’abus sexuel commis par son oncle lorsqu’elle avait 18 ans, décidant de crever l’abcès et de faire œuvre utile en joignant sa voix à celles des autres femmes désireuses de dissoudre l’omerta pour mieux conjurer la peur.
Démarrant littéralement par une levée de voile, le film nous introduit à un petit théâtre de l’intime où Perotti sied sur un lit et démarre un enregistrement vidéo où elle apparaît enfant en présence de son oncle. Elle passe ainsi d’un lieu hanté (la chambre à coucher comme site d’intimité) à un autre, soit les souvenirs de sa jeunesse, instaurant ainsi un processus d’exploration symbolique dont la puissance d’évocation n’a d’égal que celle des quelques premiers raccords sur son visage. Après les images d’archives, un échange de textos apparaît à l’écran, où la cinéaste exprime son inconfort vis-à-vis de l’acte perpétré par son oncle, qui l’intime au silence sans quoi sa vie à lui va se terminer, sans quoi il va tout perdre. Puis, l’on retourne sur le visage de Perotti, nous faisant immédiatement comprendre sur qui le poids de la honte repose toujours dans ces cas, sur qui repose la pesanteur du silence. Les choses s’enveniment lors d’un échange candide en voix off avec sa grand-mère, lors duquel elle réclame la parole pour des années de silence, le tout sur des images de films de famille, dans une double mouvance d’exploration critique du passé. Hésitante à assigner la faute à son fils, malgré l’insistance de son interlocutrice, l’aïeule finit par jurer « qu’il a souffert plus que toi », abandonnant alors sa petite-fille à la triste réalité d’un univers patriarcal où le drame de la victime s’efface devant celui de son agresseur.
La seconde partie du film, où la réalisatrice quitte la chambre pour les vastes panoramas côtiers du Bas-Saint-Laurent, semble évoquer une forme de libération, mais s’intéresse en fait à la révélation d’une réalité carcérale. En se « fondant » dans le paysage, Perotti vient illustrer son récit d’abnégation forcée, d’effacement personnel au profit de l’unité familiale. « Il n’a jamais été question de ma douleur », déclare-t-elle en voix off. « Cet abus n’a jamais été le mien. C’était celui de vous tous. » Ce n’est qu’à la fin, lorsqu’elle fusionne symboliquement avec les militantes réunies dans les rues pour exiger la fin du silence, qu’elle semble trouver une certaine quiétude, en participant à un concert de voix qui, seul, pourra finir par renverser le poids de la culpabilité.
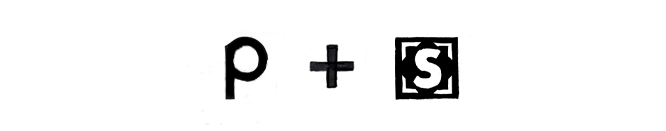
PARTIE 1
(Chez Ghislaine, Mercenaire, Mes murs-mémoire,
Perfectly a strangeness, Cher Zoscar)
PARTIE 2
(Anyway, j'pisse assis, Apoléon, Crushed, Después del silencio)
PARTIE 3
(Le patenteux, La petite ancêtre, Gender Reveal,
Uasheshkun, Rituels sous un ciel écarlate)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
