LE PATENTEUX
Maude Petel-Légaré | Québec | 2024 | 7 minutes | Compétition québécoise
Simple à mort, Le patenteux de Maude Petel-Légaré est un court métrage emblématique d’un cinéma documentaire axé sur une rencontre inattendue, sur la découverte d’une figure excentrique. Un cinéma qui souligne l’extraordinaire des personnes ordinaires, dans ce cas-ci, Henri Painchaud, fier Madelinot, inventeur et conteur à ses heures, entouré de machines merveilleuses héritées de l’imaginaire de Jules Verne. Du moins, si l’on se laisse aller à la fantaisie du personnage, que le film saisit de façon à la fois succincte et perspicace avec une bonne humeur et une espièglerie qui siéent parfaitement à sa personnalité. Le processus évoque une forme d’excavation, pénétrant de plus en plus profondément dans le cœur de son sujet, partant d’une introduction schématique des lieux jusqu’à découvrir ce patenteux invétéré, puis sa plus folle invention, un trébuchet médiéval avec lequel il lance des blocs de ciment de 40 livres jusqu’à 1000 pieds de distance.
Le tout débute par deux plans gris des Îles, des images usitées de ports tranquilles et de casiers à homards sur la plage. Puis, point la Capitainerie, un bar-café où Henri joue au crib avec son ami, avant qu’on le suive jusqu’à son antre côtier pour une longue entrevue entrecoupée d’images de ses patentes, de son ascenseur fait maison, de son atelier, de ses bocaux à vis, de ses déambulations curieuses. Ce qui frappe d’abord, c’est l’accent savoureux du bonhomme, avec lequel il expose sa vision colorée, mais posée du monde. « Tu ne nais pas avec des inventions dans la tête », déclare-t-il à la manière d’un sage, « l’invention est la mère des paresseux ». Or, s’il commence par décrire une propension utilitaire à l’invention, on comprend bien vite qu’il s’agit aussi pour lui d’une compulsion associée à une conception fantaisiste du monde, au plaisir du défi logistique. C’est néanmoins ce que recèlent ses allusions au concept de triangulation appris dans L’Île mystérieuse, ou à ses idées concernant la construction des pyramides de Gizeh, lesquelles posent la table pour la transition subreptice vers le trébuchet, qui constitue pour lui un rêve d’enfant réalisé à la retraite, la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour concrétiser ses rêves, qu’il importe de troquer l’idéalisme pour le pragmatisme et de faire les choses soi-même. Il ressort de là un constat sociologique plus large à propos des insulaires, qui s’arrangent depuis toujours avec les moyens du bord. Comme Réal, l’ami d’Henri, qui devant un besoin matériel, « ne va pas demander à un gars de Longueuil comment ça marche. Il va le patenter lui-même. » Tout ce qui manquerait au film, ce serait de voir Henri interpréter La java des bombes atomiques de Boris Vian accompagné par sa fille à l’accordéon. À moins que… (Olivier Thibodeau)
LA PETITE ANCÊTRE
Alexa Tremblay-Francoeur | Québec | 2024 | 11 minutes | Compétition québécoise
Si ce superbe court métrage d’Alexa Tremblay-Francoeur rappelle quelque chose de l’animation japonaise façon Studio Ghibli par son harmonieuse délicatesse et la merveilleuse souplesse du mouvement de son dessin, l’œuvre avec laquelle La petite ancêtre partage la parenté la plus évidente est l’extraordinaire Crac ! de Frédéric Back (1981). Bien que le style diffère grandement entre les deux films, le clin d’œil du premier à son illustre prédécesseur semble évident, avec cette maison qui tient lieu de condensé d’histoire québécoise comme le faisait la jolie chaise berçante du maître Back. La transformation métamorphique du lieu qui illustre le passage du temps et les changements sociétaux ressemble au glissement évolutif des scènes qui incarnaient les souvenirs de la chaise, comme si le bois la constituant était capable de mémoire. Il y a une très chouette subtilité dans la multiplication des agencements de cette bâtisse ancienne au fil de son histoire, au cœur de son village. Chaque objet, chaque nouvelle addition (meubles et bibelots choisis, fenêtres percées dans les murs, courant électrique installé) rappellent ce qui l’a habitée tour à tour, la cinéaste employant adroitement divers motifs (cercle, vent, ombres) dans son enchaînement de matières ou de passages évocateurs. Autour d’elle, avec les oies qui passent d’une saison à l’autre, les arbustes qui deviennent des géants feuillus, la ville qui pousse et la dépasse de tous côtés, la petite maison au toit rouge vit à son rythme, s’adaptant aux êtres humains qui s’y succèdent. Avec une justesse intéressante, la cinéaste choisit de ne montrer de ceux-ci que des silhouettes qui passent, peut-être parce que c’est son abandon éventuel par d’autres êtres humains, ayant oublié son importance et son histoire, qui mènera la demeure au destin funeste qui l’attend finalement. Il n’y a rien de particulièrement neuf dans la technique ou l’approche, mais le film est d’une élégance folle. C’est aussi un magnifique hommage aux belles ancestrales du Québec qui disparaissent sous les pics des démolisseurs pour finir leurs jours en mornes stationnements, un commentaire aigre-doux sur les pertes patrimoniales indicibles qui ont cours aujourd’hui. (Claire Valade)
GENDER REVEAL
Mo Matton | Québec | 2024 | 12 minutes | Compétition québécoise
J’ignorais ce qu’était un « gender reveal party » avant que mon frère ait un enfant et qu’il m’initie à cette drôle de pratique, à la fois récente et anachronique, symptomatique pour moi d’un repli insidieux sur les valeurs d’antan. À savoir : la répartition binaire des individus et l’adéquation du sexe biologique avec le genre, que les intellectuel·le·s du siècle dernier se sont attelée·e·s à déconstruire, mais que la bourgeoisie banlieusarde bien-pensante célèbre désormais à coups d’explosifs maison sous la poudre rose des avions-pulvérisateurs. Puisant dans les faits divers entourant cette tradition douteuse, prétexte à une comédie de situation queer cinglante, Gender Reveal de Mo Matton propose une satire salutaire, d’autant plus jouissive qu’elle souligne tout le mauvais goût, toute la vaine hystérie de ce type d’événement, en cultivant toutefois la sensibilité camp qu’il leur manque cruellement.
Ting et Mati font partie d’une colocation polyamoureuse avec Rhys. Ce·tte dernier·ère évoque leurs pratiques sexuelles dans un montage torride et racoleur de corps ondulants, de mains lestes et de bouches exaltées, brisant le quatrième mur pour interpeller un public qui devient dès lors complice de sa perspective « dépravée » sur le monde. « Après une série de malencontreuses décisions », nous informe ensuite la·e protagoniste, « nous nous retrouvons avec un plan discutable pour aujourd’hui. » Puis, l’on se retrouve catapulté·e·s en dehors du sanctuaire urbain des trois amant·e·s vers la cour arrière du patron de Rhys, sous les ballons phalliques et les arrangements floraux yoniques, entre les flutes de mousseux bleu et rose, dans l’univers absurde d’une « normalité » obsédée elle aussi par les organes génitaux. Et c’est là que le point de vue queer devient si important, pour transférer le poids de l’étrangeté, le poids de la caricature vers un monde hétéro qui le mérite amplement.
Debout dans leurs atours fabuleux, les trois comparses semblent parfaitement sensé·e·s, détonnant agréablement parmi les convives affublé·e·s d’habits roses ou bleus, qui évoquent les partisan·e·s de deux équipes sportives, prêt·e·s à en découdre. Le pire, c’est l’enthousiasme maladroit qu’on démontre à leur égard. « Salut ma personne » (pour ne pas dire « mon homme »), dit le patron de Rhys de la façon chaleureuse des hommes cis qui pensent avoir tout compris. « Vous êtes le “iel” », poursuit sa copine avec admiration devant cette bête curieuse qui « a fait évoluer » son copain. Mais entre le désir d’être plus inclusif et l’attachement ostentatoire à une logique binaire des sexes qui le désamorce complètement, il y a un pas, que le film utilise pour faire flancher le récit vers moult excès jubilatoires. À commencer par la démonstration hystérique du sectarisme pro-gars, pro-fille qui accompagne l’approche de l’annonce, poussant les « bros » à la poitrine bariolée (B-O-Y pour « garçon ») à affronter les danseuses hip-hop sous les pancartes que brandissent des parents enragés (« Qu’y a-t-il dans ma fille? », « Dévoile l’entrejambe »). Mais c’est vraiment le climax à la Final Destination (2000) qui vaut le détour… (Olivier Thibodeau)
UASHESHKUN
Normand Junior Thirnish-Pilot | Québec | 2024 | 9 minutes | Compétition québécoise
Le cinéaste autochtone Normand Junior Thirnish-Pilot propose avec Uasheshkun, œuvre introspective tournée à Uashat-Maliotenam sur des terres ancestrales de la nation innue, un voyage à la fois sensoriel et spirituel. Dans une nuit d’ombres parcourue de brasillements lumineux, un homme tente, par une cérémonie intime et sacrée, de libérer sa fille d’un entre-monde dont elle est prisonnière. Étrangement récurrente dans plusieurs des courts québécois vus récemment à Plein(s) écran(s), dont Perfectly a strangeness d’Alison McAlpine (2024) et Les faux sapins de Justine Martin (2025), la superbe photographie nocturne (signée ici par Claude Précourt) crée un clair-obscur digne des maîtres de la peinture du XVIIe siècle. Mais c’est pourtant la conception sonore qui s’avère l’aspect le plus intéressant du film, entrelacement de crépitements et de grésillements, de murmures rituels en langue innue, de silences lourds venus des ténèbres les plus profondes, de bruits ambiants indéfinissables. Si ce monde sonore et visuel évoque entre autres des motifs du cinéma d’épouvante (le feu, l’apparition de la disparue, les longs cheveux noirs comme le spectre de Ringu [1998]), c’est le rapprochement des racines ancestrales, de la culture et de l’identité autochtones, la reconnaissance de leurs voies différentes vers une spiritualité concrète qui constituent le cœur véritable du film, et son intérêt principal. Le réalisateur parvient à illustrer la peine et le deuil entourant la mort (vraisemblablement par suicide, bien que cela ne soit jamais dit ni montré explicitement) avec beaucoup de pudeur, de sensibilité et de sobriété dans l’émotion. L’importance qu’il accorde à la lumière et aux quatre éléments traditionnels composant la matière de l’univers (l’eau, le feu, la terre, l’air) dans sa façon de raconter son récit, sorte de conte aux confins du primordial et du contemporain, est par ailleurs particulièrement éblouissante. Que ce soit dans les flammes qui dansent dans l’obscurité, dans la pluie intérieure qui ruisselle tout à coup d’on ne sait trop où, dans la vapeur flottante émergeant du portail de l’entre-monde, cette matérialité qui va à la rencontre du mystique rend merveilleusement palpable cette communion avec l’au-delà et cet amour paternel qui défie les frontières de l’éternel. (Claire Valade)
RITUELS SOUS UN CIEL ÉCARLATE
Dominique Chila et Samer Najari | Québec | 2024 | 16 minutes | Compétition québécoise
Dans leur plus récent film, Dominique Chila et Samer Najari créent un espace disjoint, fragmenté, mais parfaitement cohérent, suturé par les rêves d’ailleurs et les vues de l’esprit qui accaparent les personnages, par les coups de feu et les explosions qui les accablent jour et nuit et menacent de contraindre à l’oubli même leurs désirs les plus désespérés. Superposition d’arrière-plans peints, d’éléments crayonnés, d’images urbaines découpées et d’acteur·ice·s en noir et blanc à l’aspect stylisé qui rappelle la rotoscopie, cet espace se profile comme un no man’s land hanté par la guerre. Impossible d’identifier l’endroit exact où se déroule l’action, on sait seulement que les personnages parlent arabe, de sorte qu’on s’imagine la Palestine, la Syrie, le Liban… Tout ce qui se donne à voir dans la première scène, soit la figure d’un franc-tireur au visage obscurci, tapi devant un mur de briques recouvert de sacs de sable derrière lequel point timidement la ville, évoque une sorte d’imaginaire martial passe-partout qui nous rappelle l’étalement de la terreur qui menace le monde arabe. Mais là où le couple de cinéastes excelle, ce n’est pas tant dans le spectacle d’une violence tentaculaire que dans le parallélisme probant que développe leur scénario, suggérant un cycle de brutalité inexorable qui tourne frère contre frère, et dont les seules échappatoires sont de brèves utopies évanescentes.
Constitué d’une poignée de vignettes reliées par des objets, des cadavres, des fantasmes prospectifs ou nostalgiques, le film crée une toile inextricable qui évoque parfaitement la condition carcérale des protagonistes et le caractère implacable de leur condition. Il suffit de constater l’élargissement du cadre qui caractérise l’enchaînement des trois premiers plans : celui d’un oiseau en cage, celui de l’oiseau accompagné d’un tireur d’élite embusqué (un autre oiseau en cage), puis celui de l’oiseau, du tireur et de deux figures issues des souvenirs de sa jeunesse, lui-même et son ami Mahmoud, qui zyeutent la ville en contrebas avec des jumelles plutôt que la lunette d’un fusil. Or, cet effet de mise en scène ne marque pas ici une libération, mais une régression vers un souvenir d’enfance révolu, qui pourvoit un soubresaut d’espoir suivi tout de suite d’un retour à la réalité. C’est la même chose pour la jeune fille qui, un instant, s’imagine les flots azurés de la Méditerranée, ou pour la mère de famille qui pense gagner un concours de chanson en interprétant Un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland, deux femmes libres pour un instant, mais plombées par la violence le suivant. Rituels sous un ciel écarlate, c’est l’histoire d’un rêve d’ailleurs qui nous abrite un instant avant de s’évanouir sous le bruit des tirs et des explosions, lesquels servent ici d’articulation à un récit tragique où même le petit oiseau, la porte de sa cage ouverte, n’arrive pas à s’enfuir… (Olivier Thibodeau)
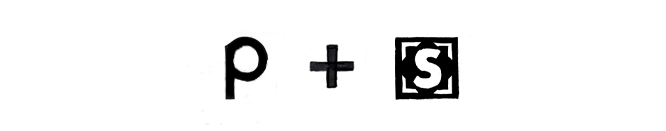
PARTIE 1
(Chez Ghislaine, Mercenaire, Mes murs-mémoire,
Perfectly a strangeness, Cher Zoscar)
PARTIE 2
(Anyway, j'pisse assis, Apoléon, Crushed, Después del silencio)
PARTIE 3
(Le patenteux, La petite ancêtre, Gender Reveal,
Uasheshkun, Rituels sous un ciel écarlate)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
