1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

prod. Hugofilm Features, Pandora Filmproduktion
A PIECE OF SKY [DRII WINTER]
Michael Koch | Suisse | 2022 | 136 minutes | Compétition internationale
C’est un film qui parle de « ça », sans en faire son sujet. « Ça » n’est ni sa prémisse, ni son punch (comme on le ferait dans une télésérie cheap). « Ça » n’est ni son point de départ, ni son point d’arrivée, mais plutôt son pivot, autour duquel tout (l’univers) basculera et permettra à chacun — mais surtout à Anna (Michèle Brand), la mère monoparentale qui s’est récemment amourachée du fruste et taciturne Marco (Simon Wisler) — de prendre position, une position de fildefériste, délicate, difficile, inconfortable, mais pleine de nuance et d’humanité (comme il est maintenant si rare de pouvoir le faire dans une vie qui mime de plus en plus les téléséries cheap). Voilà un an qu’il s’est installé dans ce hameau où les villageois lui jettent encore quelques subreptices regards torves. Marco ne fume pas, ne boit pas, ne parle pas beaucoup, ne s’emporte jamais, il travaille comme un bœuf que la trique démange. Il a séduit Anna, qui s’est donnée à lui, mais qui devra bientôt se tenir sur ce fil avec sa fille. Et la grande force de ce long métrage se terre dans ce qui précède et dans ce qui suit son innommable retournement, son abject point de bascule, son grinçant capotage (que le cinéaste a de surcroît la décence de laisser hors champ).
Dans ce qui précède : l’immensité bleutée du ciel, l’immaculé de ses nuages ouatés, les verdoyants pâturages où pissent et paissent et baisent les bovidés, ce décor champêtre, pastoral, bucolique, où tout appelle au calme et à la contemplation, nous sont rendus par des plans longs et des mouvements lents. Or, ces images dignes d’une étiquette d’Appenzeller se refusant le panoramique sont envahies par le vrombissement des moteurs ou hachurées par les gestes cadencés du labeur dont font preuve ces hommes et ces femmes toujours en équilibre sur les pentes escarpées où de gros rochers risquent de leur rouler sur le crâne et des bottes de foin menacent de leur heurter l’occiput. Point de repos possible, donc, au pied de ces montagnes aux neiges éternelles. Ce paysage en bleu, blanc, vert pourrait inviter à la félicité, mais la façon dont Koch le capte — nimbé de brume, de bruine, de brouillard, de bourrasques, derrière des vitres de voitures souvent suintantes, entre deux interstices d’interminable tunnel ou entre deux pans de bâtiments communaux — suscite sans cesse, sinon une tension, du moins un malaise. Tout prête au bonheur, mais le bonheur n’est pas près.
Dans ce qui suit : on perd les lignes (diagonales) d’horizon, les points de fuite (impossibles), la lumière (aveuglante), on se trouve acculés aux pieds des murs, enfoncés dans l’obscurité des murmures auxquels on ne veut se soumettre ni se résoudre, parce que l’amour — mais n’est-ce pas plutôt de la compassion ? — prend le dessus, nous monte à la tête, atteint des sommets. Dans cet univers où les bêtes sont traitées comme des hommes et les hommes comme des bêtes, Anna se tiendra droite, sur son fil, d’aplomb, contre l’adversité et les commérages, alors qu’elle faillit — assistant au tournage aussi inopiné que joyeusement absurde d’un Bollywood chez les Helvètes —, sourire en coin et larme à l’œil, mélanger « la vie p’is les vues ». Non, la vie n’est pas une vue. La vie est une tragédie grecque. Pour preuve les chants choraux qui la ponctuent — mais auxquels nous ne portons plus attention, trop gavés de téléséries cheap — et qui nous obligeraient, si nous les entendions de nouveau, à adopter un minimum de distance, pour mieux nous permettre de nous rapprocher. (Jean-Marc Limoges)

prod. club vidéo
NOTES SUR LA MÉMOIRE ET L'OUBLI
Amélie Hardy | Québec | 2022 | 8 minutes | Compétition nationale
Notes sur la mémoire et l’oubli est l’une des œuvres que j’anticipais le plus parmi la programmation du FNC cette année. Les courts métrages d’Amélie Hardy sont tellement denses, amusants et cyniques qu’ils sont comme de petites perles de cinéma contemporain. Et c’est bien le cas ici, alors que l’autrice relie, dans une sorte de flot de conscience à peine homogène, quelques notes à propos des deux monolithes titulaires, profitant d’un texte savoureux narré par Alexa-Jeanne Dubé pour tracer un parallèle intellectuel entre l’horreur de l’architecture lavalloise sur la rue Fernando Pessoa et une série d’observations perspicaces sur notre société d’archivage mémoriel et de surveillance interpersonnelle. Disposé en cinq chapitres thématiques, inspiré par un essai de Rafaële Germain, le film mêle les esthétiques et les approches, moins dans une démarche spécifiquement postmoderne que pour le simple plaisir de mettre en scène et d’incarner de façon optimale sa manne de beaux concepts théoriques. Entre les séquences animées de femmes néandertaliennes, les montages hyper rapides de façades banlieusardes, de poètes portugais et de livres ouverts, les mises en scènes d’étudiantes et de fonctionnaires, la valse des zooms, les images d’archives et les contenus web savamment sélectionnés, on a l’impression d’assister à un ouvrage extrêmement épais, condensé dans quelques minutes de pure jubilation cinéphile. Marqué par un humour tranchant, bourré d’esprit, un imaginaire foisonnant et un exceptionnel sens du rythme, l’œuvre constitue une autre réussite pour la réalisatrice exceptionnelle de La vie heureuse (2021), qui m’avait tant envoûté au festival Regard, et à qui l’on souhaite un parcours rempli de pépites de la sorte. (Olivier Thibodeau)

prod. Chi-Fou-Mi Productions
FUMER FAIT TOUSSER
Quentin Dupieux | France | 2022 | 80 minutes | Temps Ø
Mieux vaut ne rien savoir sur le dernier Quentin Dupieux pour garder intact l’effet de surprise, constamment renouvelé de séquence en séquence. Contentons-nous alors de ceci : à un moment, les personnages se retrouvent autour d’un feu de camp et se racontent des histoires à faire peur. « J’en ai une 1500 fois meilleure que la tienne » de dire l’un d’eux, lançant un concours de qui saura mieux effrayer les autres. Mais le plus talentueux des conteurs, c’est bien le cinéaste, qui enchaîne avec brio les récits pour nous en offrir une collection aussi captivante qu’hilarante. Malgré ce côté éparpillé, Fumer fait tousser trouve sa cohérence dans le plaisir de raconter (le sujet même du film) que nous sentons à chaque image, et aussi dans sa manière libre et amusée de se jouer du lien entre corps et esprit. Il s’agit moins là d’un thème à explorer que d’un motif à varier, d’une figure à détourner, prétexte habile aux délires habituels de l’auteur.
Cela nous ramène à ce pneu qui, autrefois, était doté d’un pouvoir télépathique meurtrier (dans Rubber, 2010). Encore ici nous avons droit à un hommage au cinéma de genre, à l’horreur et au slasher, mais aussi aux super-héros japonais (tout tourne autour de la Tabac Force, sorte de parodie des Power Rangers combattant des monstres en caoutchouc) et à la science-fiction hollywoodienne des années 1950. Mais cette fois l’ensemble est enrobé de l’esprit un brin naïf et toujours optimiste d’une émission pour enfants, Dupieux honorant ainsi l’inventivité visuelle de ces cinémas, leur débrouillardise (la possibilité d’évoquer des mondes merveilleux avec presque rien) et leur croyance infaillible au pouvoir de l’émerveillement, à la fascination qu’exerce une bonne histoire bien racontée. Le film s’ouvre sur un enfant qui, en sortant de voiture pour aller uriner, tombe par accident sur un spectacle inattendu et fantastique, suscitant immédiatement sa joie et son émoi : c’est bien ce regard précieux de la découverte étonnée qu’emprunte tout au long Dupieux, et par lequel passe son humour, doucement innocent, comme si rien de mauvais ne pouvait jamais arriver, même quand cela arrive effectivement. Ses interprètes (pour la plupart des habitués de l’auteur) savent maintenir le ton juste, un peu ingénu, un peu blasé, un peu pince-sans-rire, pour créer des décalages comiques qui renforcent le sentiment d’absurde. Autrement dit, il s’agit d’un des meilleurs Dupieux, un de ses plus drôles, et peut-être aussi l’un de ses plus beaux, tant l’ensemble respire d’un amour profond envers le cinéma. Un pur plaisir. (Sylvain Lavallée)

prod. Ryan McKenna
PROMENADES NOCTURNES
Ryan McKenna | Québec | 2022 | 64 minutes | Compétition nationale
Ryan McKenna fait preuve de beaucoup d’ambition avec ce quatrième long métrage, proposant de représenter à l’écran l’expérience même de la démence, celle d’une femme dont il cristallise les derniers moments de lucidité d’une façon étonnamment riche, prenante et vraisemblable, transcendant l’indigence de sa production grâce à une rare intelligence cinématographique. Profitant d’une sensibilité excentrique au diapason de l’état mental déliquescent de sa protagoniste, dépeint dans une mise en scène immersive remplie d’effets optiques hallucinatoires propres à une excursion constante dans les franges de la réalité, l’auteur bénéficie en outre de la performance incroyablement dédiée de Marie Brassard, avec qui il renoue après Le coeur de madame Sabali (2015). Laissée seule dans des espaces théâtraux, à l’occasion de scènes plus objectives tournées dans son appartement auprès de sa fille, Brassard est une véritable bête, performant la déconfiture intellectuelle de son personnage d’une façon sincère, touchante et parfaitement convaincante. Or, c’est dans les scènes plus subjectives, celles qui épousent sa perspective oblique sur la réalité, où se déploie tout l’art technique du film, dans une série de tactiques impressionnistes foisonnante. L’art cinématographique et l’art scénique s’amalgament ainsi d’une façon rarement féconde, alors que l’espace de jeu des acteurs s’étend loin par-delà les murs de quelque lieu circonscrit, vers des espaces naturels à la fois sereins et oppressants, mais aussi dans la profondeur de champ, jusque dans les dédales de l’esprit fiévreux d’une protagoniste condamnée par le temps.
On n’assiste initialement qu’à de légers décalages entre la réalité et le contenu des images, à l’occasion de déambulations nocturnes teintées d’onirisme. On croit d’abord à un rêve éveillé, alors que le personnage d’Ethel se met à traquer un groupe de chercheurs en combinaison Hazmat lors d’une promenade solitaire, puis rentre manger un sandwich à la maison, où gît subrepticement un homme immobile sur le canapé. Ce n’est qu’au fil du récit que, tranquillement, se révèle et se déploie sa folie grandissante, puis que l’on comprend que l’homme entraperçu est en fait son époux décédé et que les choses étranges qu’elle aperçoit la nuit sont les fruits de son imagination. Le film a cette façon brillante de nous monter en bateau, de nous faire glisser le long d’une spirale où le tangible s’efface au profit du fantasme, suivant une progression analogue à celle de l’esprit fatigué de l’héroïne.
Promenades nocturnes constitue surtout la quintessence du cinéma indépendant, en cela que la créativité investie dans chacun des départements — dans une direction photographique, un travail sonore une conception visuelle et un usage de décors naturels particulièrement évocateurs — est garant d’une efficacité que l’argent ne saurait jamais acheter. D’un point de vue humain, le film est aussi très perspicace, s’attardant à démontrer simultanément la frustration grandissante d’une protagoniste qui sent son esprit lui glisser entre les doigts et d’une proche aidante courageuse, mais exaspérée par la dépendance et l’incohérence croissantes de sa mère. (Olivier Thibodeau)
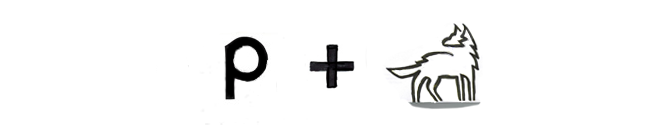
PARTIE 1
(No Bears, Plan 75, Before I Change My Mind, Jerk)
PARTIE 2
(A Piece of Sky, Notes sur la mémoire et l'oubli,
Fumer fait tousser, Promenades nocturnes)
PARTIE 3
(Alma Viva, Grand Paris, Jacky Caillou, Will-O'-the-Wisp)
PARTIE 4
(De humani corporis fabrica, Alcarràs, Decision to Leave, Coma)
PARTIE 5
(La Fièvre de Petrov, La edad media, Diaspora, Aftersun)
PARTIE 6
(Call Jane, Queens of the Qing Dynasty, Klondike,
Samurai Wolf, The Banshees of Inisherin)
PARTIE 7
(The Maiden, Italia, le feu, la cendre, Tori et Lokita, Cette maison)
PARTIE 8
(Human Flowers of Flesh, Les pires, Rimini, La maman et la putain)
PARTIE 9
(La dérive des continents (au sud), The Novelist's Films, Sparta, Paradoxe)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
