
prod. Busca Via Filmes
ÊXTASE
Moara Passoni | Brésil/États-Unis | 2020 | 75 minutes | Compétition internationale
L’égocentrisme de la perspective que développe ici l’inspirante Moara Passoni est salutaire pour le cinéma tout entier puisqu’il permet l’avènement d’une subjectivité complètement nouvelle, inédite et singulière, fruit d’une démarche artistique dont le caractère introspectif en exacerbe le pouvoir d’évocation. Native de São Paulo, fille d’une mère activiste devenue députée, la réalisatrice narre pour l’occasion le récit de sa jeunesse, faisant preuve à cet égard d’une stupéfiante générosité, doublé d’un penchant irrésistible pour l’impressionnisme qui lui permet d’aborder de façon expérientielle les passions anorexiques qui ont marqué son adolescence. « L’anorexie, c’est l’extase », déclare-t-elle en voix off, alors que s’écrase à l’écran une joggeuse aux yeux pâles dont le corps malnutri est épuisé par l’effort. Étrange assertion pour quiconque n’a jamais dansé avec la mort ou n’a jamais pu s’enivrer de sa propre folie, mais dont le spectateur apprendra bientôt à cerner le sens, au gré d’un long et touchant monologue qui nous invite au cœur même de la psyché tortueuse de l’autrice, matérialisée astucieusement grâce à un florilège d’images documentaires et poétiques superposées.
Ce qui nous frappe le plus lors du visionnage de cet opus intime, c’est l’inventivité formelle et narrative dont fait preuve Passoni, évidente dans son impressionnant lexique visuel, mais surtout dans la façon experte dont elle manie les arts de la substitution et de la superposition. Non seulement combine-t-elle de façon émotionnellement homogène les documents glanés dans ses archives personnelles avec les images tournées, captées dans divers lieux suggestifs de sa jeunesse, mais elle procède surtout à mille juxtapositions discursives, pierres d’assise d’un univers lyrique captivant, parfaitement ad hoc pour décrire son paysage mental autrement inaccessible. Les photos de sa mère, qui manifeste enceinte dans la rue, sont associées à des images d’une jeune fille qui coure vers la fenêtre pour l’apercevoir, puis par des plans subjectifs à hauteur d’enfant dans les halls du pouvoir exécutif, décrivant ainsi d’une façon quasi onirique le rapport lacunaire qu’elle a pu entretenir à son égard. C’est pourtant dans ses efforts de stratification narrative que le film tend vers le sublime, pourvoyant toujours une profondeur inattendue à la photographie déjà fort expressive de Janice d’Avila. En effet, si la voix off de l’autrice ne cesse d’étoffer les images, les images elles-mêmes s’étoffent l’une l’autre par chevauchement créatif. L’autrice parvient ainsi à télescoper non seulement les idées et les impressions qui accaparent son esprit, mais aussi les diverses temporalités de son récit, le passé et le présent, ainsi que les modes documentaire et fictionnel, l’avant-plan et l’arrière-plan, le politique et l’intime, mais surtout le psychologique et le physique, incarné à l’écran par une parade de corps meurtris et fracturés : corps tordus des ballerines, corps fractionnés des pinups de Playboy, corps découpés dans le musée d’histoire naturelle et corps émaciés par l’anorexie, aperçus dans des photos impressionnantes que seule oserait montrer une âme animée de pure sensibilité, une âme magnifique et fragile dont la présente œuvre pourrait éternellement s’enorgueillir d’être l’heureux récipient. (Olivier Thibodeau)

prod. James Benning
MAGGIE’S FARM
James Benning | États-Unis | 2020 | 85 minutes | Les nouveaux alchimistes
Deux buissons ébouriffés plantés en amorce du cadre, un petit chemin qui se poursuit sur la gauche, dans ce qu’on devine être un bois ; un autre petit chemin qui se poursuit sur la droite, vers ce qui semble être une clairière : deux voies, deux directions à prendre au tournant de l’embrasure, à suivre du regard ces angles-gouttières sur lesquels l’on se met à glisser ne sachant trop où l’on pourrait s’arrêter. Heureusement, ce premier plan s’étire, dans le silence d’une nature éloignée, peu à peu troublée dans le fond du mixage, mais demeurant comme figée dans un temps de légiste, un temps d’autopsie du paysage, sans mouvement, sans action, acquérant à chaque nouvelle minute qui passe des attributs de peinture eu fil qu’il feint de se soustraire au cinéma. Le plan dure, dure, et finalement ça coupe, vers un environnement un peu plus envahi par le béton, avec quelques sons mécanisés qui se font entendre, mettant déjà moins à l’épreuve notre patience qu’excitant notre curiosité.
Pour quiconque ayant déjà vu un film de James Benning, ce vétéran américain du cinéma expérimental, la description précédente choque moins par la lenteur évoquée que par le travail sonore, puisque Benning est certes connu pour faire des films d’une lenteur presque muséale (Stemple Pass [2012] est composé de quatre plans de 30 minutes chacun, Nightfall [2011] est fait d’un seul plan fixe de deux heures montrant la lumière décliner), il est surtout célébré pour adjoindre à l’image des textes d’archives (des coupures de journaux comme des journaux intimes), travaillant son historicité, ce qu’elle cache, dans sa beauté plastique presque décorative. Mais ici, pas de voix off, sinon celle convoyée par quelques chansons, nommément « Maggie’s Farm » de Dylan, où le barde chante pour tous les travailleurs asservis par leur besogne, leur fonction, une complainte révolutionnaire qui résonne quelque part au creux du Maggie’s Farm de Benning. Autre nouveauté, Benning filme son lieu de travail pour la première fois, lui qui enseigne depuis plus d’une vingtaine d’années à la California Institute of the Arts et qui parcourt ici les lieux du campus en inclinant les angles bétonnés et perpendiculaires des couloirs ou en s’intéressant à la rouille d’un hangar, au bosselage d’un abreuvoir. Sans texte lu, le film travaille plutôt le vide en tant que matière à investir, que socle ouvrant sur des voies dont on ne connaît pas encore les issues (on a bien dit qu’il filmait une école).
« I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more / Well, I try my best / To be just like I am / But everybody wants you / To be just like them », chante un Dylan qui résonne entre les murs, comme si Benning se justifiait d’une part de ne pas coller à sa propre méthode, mais aussi comme s’il nous disait que l’enseignement de l’art ne pouvait se faire que dans l’organisation de ce vide à remplir auquel nous ouvre le film. Si l’absence de la voix produit un creux déstabilisant dans la démarche, les compositions à la plasticité forte (quelles belles plinthes caoutchouteuses ! quelle corbeille de couloir !) et aux angles contigus qui se perdent dans un fond d’espace qu’on nous interdit, produisent une construction fantomatique, où chaque image se sédimente dans la précédente tout en prophétisant sur la suivante, participant à produire un espace qui nous fait peu à peu faire le tour de l’école par des voies de jonction qui n’ont d’autre causalité que leur matière. On ne tourne pas les coins de mur de plan en plan, on devine plutôt la continuité à travers les traces sédimentaires de la construction humaine : voilà du béton jaune, revoilà du béton jaune encore, ou cette clôture-là, quadrillée, qu’on retrouve ailleurs et qui n’est pas cette clôture droite, qui nous interdit la continuité spatiale de l’exercice en proposant un espace passionnément impossible : une capitale de l’indétermination, une ferme où cultiver le dévoiement, l’endroit où Benning enseigne qu’il ne faut jamais être là où l’on peut nous attendre. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Inti Films
NIGHT HAS COME
Peter van Goethem | Belgique | 2019 | 56 minutes | Les nouveaux alchimistes
À l’écart du cinéma convivial, mais prosaïque de Felix van Groeningen et de l’univers autarcique des frères Dardenne, chez qui l’éthique dévore le réalisme, c’est dans les marges que je recherche désormais les perles du cinéma belge. Dans les Marolles dansantes de HAMSTERs (2017), brillant éloge de la folie, et dans cette merveille montagiste signée Peter van Goethem, étude mnémonique astucieuse et représentant précoce de la science-fiction pandémique. Night Has Come serait intemporel en effet s’il n’était pas si actuel, si son « virus » diégétique n’avait pas pour seul but de cerner les mécanismes de la dégénérescence biologique (donc de l’évanescence inexorable de la mémoire), mais d’évoquer aussi le sentiment de paranoïa en germe dans le terreau fertile de la société biosécuritaire.
Night Has Come est un objet rare : un film narratif constitué entièrement d’images empruntées, glanées comme par un moine exalté dans les archives de la Cinematek, puis étoffées par l’ajout d’une bande sonore incantatoire. L’auteur les dénature ensuite pour mieux les revitaliser en les inscrivant dans le récit en voix off d’un homme mourant, réfléchissant à voix haute sur la condition humaine. Le résultat est un cocktail métaréflexif d’une rare perspicacité, où l’étude de la mémoire individuelle s’accompagne d’une étude de la mémoire nationale, déclinée dans les fragments de trente-deux films, tournés pour la plupart entre les années 1930 et 1960, parfois même par des cinéastes tutélaires du Plat Pays, dont le célèbre documentariste Henri Storck. Outre le pouvoir d’évocation des images elles-mêmes, qui nous font vivre par procuration l’effervescence des sorties familiales sur la plage d’Ostende ou de la construction immobilière dans le Bruxelles des années 1960, la langueur de landes lointaines baignées de brume fantomatique, le rythme sérénissime de la vie rurale ou l’agitation des populations urbaines, c’est dans l’enchaînement dramatique des séquences que réside l’essence de l’œuvre, qui s’avère avant tout une démonstration ludique de l’illusionnisme inhérent à l’art du montage cinématographique.
La signification que prennent ici les images, au sein du récit foisonnant (et fort expressif) du vieil homme, venu décrire à l’écran l’avènement d’un virus rampant, fruit de potentielles manigances gouvernementales, est donc tributaire d’un mensonge, le mensonge d’une narration génératrice de mémoire, incarnée par un travail de montage qui aborde de front la question primordiale de la subjectivité assumée (pour reprendre le concept-clé de Gilles Marsolais, que ce dernier opposait au mythe de l’Objectivité). En effet, la perspective consignée à l’écran est entièrement fabriquée, et c’est en cela que le film de van Goethem constitue une vraie leçon de cinéma, de cinéma documentaire en tout cas, puisqu’il met en exergue le processus de création du réel à partir du matériau filmé. En plus de remettre en question la notion de « vérité » documentaire, le film produit ainsi d’amusantes et hypnotiques chimères que nous prenons plaisir en chasse : l’idée de science-fiction rétrofuturiste d’abord, nourrie à la fois par plans expérimentaux d’émulsion chimique et de grosses machines électriques à cadrans, ainsi que celle de paradoxe audiovisuel, où la bande sonore contribue à générer l’angoisse à partir de l’anodin et du joyeux, des images d’une visite chez le marchand de glaces ou dans le marché aux puces de la Place du Jeu de Balle. (Olivier Thibodeau)

prod. Comme des Cinémas
POISSONSEXE
Olivier Babinet | France/Belgique | 2020 | 89 minutes | Temps Ø
Le troisième film d’Olivier Babinet, Poissonsexe fraye un genre qui nous semble prometteur, dans ce qu’il amalgame, retourne et laisse présager de consolation, alors que nous disposons de peu pour ce faire. Il s’agit nommément d’une dystopie romantique dont la tonalité s’annonce subtile, en opposition à nos supputations, réelles ou imaginaires, sur le futur. Comment aborder l’angoisse de notre temps à travers la légèreté, tout en restant près de ses enjeux ? Le film de Babinet pose, en ses abords, cette très belle question. Concrètement, il met en scène la vie d’un quarantenaire, Daniel, chercheur spécialisé en biologie marine aux prises avec le rêve inaccompli d’avoir un enfant. Paumé et ingénu, ce dernier (incarné par le cinéaste et ici très bill-murrayesque Gustave Kervern) rue dans les rancarts de la petite ville où il a échoué et où, en l’occurrence, échouera la dernière baleine vivante sur terre, motif tragique que nous sommes bien placés pour comprendre. Nous le comprenons d’emblée, dans ce futur très légèrement en avance sur le nôtre, les poissons ont disparu de l’hydrosphère. À l’issue de cette disparition, Daniel use d’un drône aquatique pour traquer la moindre trace de vie résiduelle. De fait, il en trouvera une et pas la moindre : celle d’un axolotl, animal absolument fascinant, s’il en est un, étudié notamment pour sa capacité à se reproduire au stade larvaire (« un bébé pubère », tel que le résumait Éric Méchoulan). Or, de la nature de ce petit être, on ne dit pratiquement rien de tout le film. De fait, l’axolotl ne semble avoir été choisi pour figurer dans ce film qu’en vertu de son physique sympathique. L’axolotl est autrement dit plus cosmétique que source d’informations sur les modes incroyablement inventifs d’adaptation et reproduction de cette vie animale pourtant au centre de l’histoire. On peut alors se demander : comment est-il possible de rater une telle occasion narrative et réflexive, alors que le parallèle entre course à la reproduction humaine et animale est souligné à grands traits ? Et plus largement : pourquoi tenir à cadrer le récit dans un environnement scientifique si ce n’est pas pour puiser dans tout ce qu’il offre pour inspirer les réparties, voire à approfondir et impulser la trame scénaristique ? Bref, à la belle question qu’il tend, Poissonsexe n’apporte pas de réponses convaincantes. Il se contente d’adopter la « goofiness » et la « cuteness » de la comédie hipster américaine, mais sans non plus présenter le mordant de sa « wittiness ». Il est, de la sorte, une bluette plutôt décevante. (Maude Trottier)

prod. 1976 Productions/Six Island Productions
SAINT-NARCISSE
Bruce LaBruce | Canada/Québec | 2020 | 110 minutes | Présentations spéciales
Le village de Saint-Narcisse, en Mauricie, n’aura jamais été aussi sexy que sous la lentille de Bruce LaBruce, qui en fait un paradis pastoral gorgé de lumière où il fait bon s’embrasser dans les bois et jouer tout nu dans la rivière. La façon dont il profite des décors locaux est presque épique ; on s’imagine un explorateur qui découvre un pays sauvage, rendu exsangue par son propre cinéma, et décide de le re-mettre en scène pour en extraire la couleur. L’intérêt que porte LaBruce à la beauté québécoise se reflète aussi dans sa distribution, plus belle que bonne, où domine l’éphèbe Félix-Antoine Duval, flanqué d’Alexandra Petrachuk et de Tania Kontoyanni (plutôt bien choisie dans le rôle de la sorcière au grand cœur, mère du protagoniste). Même la chose catholique revêt ici un caractère amusant au vu des nombreux excès iconoclastes et libidineux dont la diégèse est truffée, et où réside finalement le potentiel salutaire de son révisionnisme queer.
Le fétichisme du réalisateur est évident dès le coup d’envoi, dans le gros plan qu’il consent à l’entrejambe du protagoniste sous ses pantalons de cuir. Dès lors, Duval se profile comme un bel objet, pimpant sous sa tignasse frisée et sa barbiche clairsemée, un bel objet qu’il suffit de mettre en motion pour qu’il active d’autres fétiches, enfouis dans une série de rêves enfiévrés qui mettent en scène un moine grivois qui lui ressemble étrangement, doppelgänger en soutane qu’il s’empressera d’aller quérir dans la ville titulaire à la mort de sa grand-mère (Angèle Coutu). Notre Narcisse a un jumeau, voyez-vous, un jumeau incestueux prêt à l’aiguiller dans ses passions égocentriques, pour peu que le héros puisse l’arracher aux griffes du décadent père Andrew (Andreas Apergis, parfaitement visqueux en amant obsédé). Le bois lumineux où se bécotent Duval et Petrachuk cède alors le pas au monastère obscur qui abrite les séminaristes du coin en tant que second sanctuaire fantasmatique, reliquaire des fantasmes d’un Québec au bord de l’éveil (dans les années 1970), mais qui depuis s’est assoupi de nouveau dans une marée de béton sanctifiée par les prêtres du néolibéralisme.
Ce que capture LaBruce en somme, dans cet opus guilleret, c’est un désir de liberté perdu, abandonné aujourd’hui à l’apathie consumériste, mais ragaillardi à l’écran par la représentation insolente d’un des symboles primordiaux de la servitude québécoise : l’institution catholique, qu’il ébranle avec un humour acéré en en faisant le bastion de parties homosexuelles décadentes. L’iconographie chrétienne tout entière est dénaturée pour l’occasion, et on y prend un malin plaisir. La flagellation devient un vrai fantasme masochiste pour le frère du protagoniste, qui se fouette en se masturbant à la vue de moustachus en caleçons dans un catalogue Sears. Même les quartiers ecclésiastiques, avec leurs effigies grandeur nature du Christ ensanglanté ou de Saint-Sébastien, transpercé de flèches, s’apparentent désormais à de vrais donjons S&M, que viennent compléter des statuettes de David et des carafes de vin remplies de drogue. L’expérience du film équivaut ainsi à une émancipation salutaire de la pensée, envisagée avec une sensibilité camp quasi absent de notre imaginaire collectif, capable de travestir même nos plus monolithiques mythes fondateurs. (Olivier Thibodeau)

prod. Les Films du Worso/Wild Bunch
THALASSO
Guillaume Nicloux | France | 2019 | 93 minutes | Temps Ø
Suite de L’enlèvement de Michel Houellebecq sorti en 2014, Thalasso reprend le personnage de Michel Houellebecq joué par Michel Houellebecq pour aller encore plus loin dans l’exploration du narcissisme qui joue à cache-cache — d’aucuns disent un film entre la fiction et le documentaire — en y ajoutant le personnage de Gérard Depardieu joué par Gérard Depardieu. Tout comme le premier, le second amuse dans ses abords, tant, cette fois, la farce y explore et approfondit son propre rouage et réussit à créer son effet, à travers des dialogues consciencieusement ridicules et désarmants de naturel. Mais aussi, en donnant à scruter de près sous des angles pas du tout flatteurs, les corps triviaux de personnes médiatiquement auratisées. Déjà le corps de Houellebecq se trouvait à être exposé dans tous ses désirs d’alcool, de cigarettes, de sexualité et quelques tracas de santé dans L’enlèvement…, lequel exploitait une forme de fascination pour la chétivité maladive de l’auteur, voire sa laideur assumée. Dans Thalasso, ce corps potentiellement malade ou du moins ouvertement dépendant des substances qui l’amenuisent, se soumet cette fois à des soins qui en exacerbent la centralité, d’autant plus qu’il est mis en contraste avec cet autre corps en tout point opposé, celui de Depardieu. Dès les premières images, on entre ainsi dans la sensation de satisfaire de bas désirs, comme ceux de voir quelque chose qui ne nous appartient pas, de vouloir contempler le ventre formidablement gigantesque de Depardieu ou de prendre connaissance des détails sur la dentition manquante de Houellebecq. Cette sensation voyeuriste n’est pas rassurante. Elle interroge la position de spectateur en ne la flattant pas, et c’est bien là que se jouerait l’un des intérêts du film de Nicloux s’il ne succombait pas finalement à un désir de narration grandiloquente et ne se brûlerait pas à la vulgarité de son sujet.
Faisant donc connaissance en étant tous deux confinés dans le même centre de thalassothérapie, au détour d’une cigarette fumée là où on ne peut pas fumer, Houellebecq et Depardieu, ces deux bougres, se font bigres. En se prêtant main-forte dans la nécessité de maintenir un style de vie allant à l’encontre ce que préconise l’hygiénisme thalassothérapique, tout en se soumettant aux dits soins, non sans râler, performance de soi oblige. Un peu de la même façon que la maison de Ginette et Dédé, avec sa bande de truands pas fute-futes, servait d’enclave et de ressort thématique, sinon de miniature sociétale dans laquelle plonger Houellebecq et ses convictions, le centre se fait repoussoir. Il permet de mettre en relief certaines idées lancinantes d’une pensée douillettement retorse et à l’originalité fatiguée, qui fait saucette dans les conceptions courtes et saugrenues de Depardieu. Seulement, si les échanges entre Houellebecq et Depardieu décochent des fusées de stupidité qui se savent comme telles et font ainsi micro-sourire — Dieu : « le mec qui a tout organisé le truc », dit un Houellebecq bourré affirmant par ailleurs que la mort n’existe pas, pour aussitôt se mettre à pleurer en développant une notion de résurrection des corps plus ou moins synonyme du corps de sa grand-mère —, la seconde moitié du film se prend au sérieux et finit par carrément donner la nausée. Encore ici, on se rappellera certains motifs réflexifs des romans, mais pour les voir se saboter et s’autodétruire, en étant sortis du travail stylistique (ou de cet anti-travail) et rentrés dans l’évidence du régime de l’image, en une ultime performativité de l’écœurement vis-à-vis du libéralisme. Écœurement de sujet et d’objet qui, du reste, singe l’empathie au détour des retrouvailles avec la petite bande de truands, tout en flirtant de manière assez grotesque avec une ouverture à ce qui ne serait pas français (le monde des gitans, les pratiques religieuses juives, l’Europe de l’Est, une personne noire réduite à un son rôle sexuel d’amant d’une Denise âgée de 80 ans, qui l’eût cru. Je ne dis volontairement mot sur la question des femmes, puisqu’il faudrait alors expliquer beaucoup pour si peu et que ce film macho comme un vendeur de voitures n’en vaut pas l’effort).
La grande idée chapeautant les deux films est en somme de mettre à égalité des stars avec des gens « ordinaires », Mathieu, Ginette, Dédé et les autres. La stupidité, il est vrai, est également distribuée en tout un chacun, et se veut, imagine-t-on, reconduire le thème de la démocratie (malade comme le corps de Houellebecq). C’est bien sur cet enjeu de discussion que se terminait L’enlèvement…, repiqué dans Thalasso à travers le projet de Houellebecq — pas si invraisemblable après Trump — de se présenter aux prochaines présidentielles. Mais à traiter tous les sujets comme des sujets stupides à commencer par soi, on finit évidemment par rendre stupide le spectateur et cet abrutissement généralisé n’opère rien d’autre au final qu’une idée de suicide collectif qui fait l’économie des personnes qui se battent, de la beauté résiduelle du monde, des relations qui, humblement, honorent la vie. On l’avait compris déjà, le suicide collectif se constitue à même cet effort de conceptualisation de la personne comme étant fondamentalement vulgaire, et le corps de Michel Houellebecq a peu à nous apprendre, sinon qu’il est obsédé par lui-même et que sa disparition prophétisante n’est qu’un narcissisme comme un autre. (Maude Trottier)
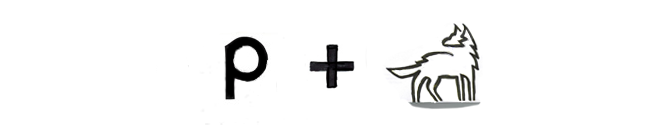
PARTIE 1
(The Cloud in Her Room, Desterro, Topside,
Tout simplement noir, Violation)
PARTIE 4
(Êxtase, Maggie's Farm, Night Has Come,
Poissonsexe, Saint-Narcisse, Thalasso)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
