
prod. Nancy Pettinicchio et al.
FALENA
Nancy Pettinicchio | Québec | 2022 | 17 minutes | Compétition 3
La captivante Nahéma Ricci, vedette du Antigone (2019) de Sophie Deraspe, prête ici ses traits et son exquise sensibilité à une jeune femme curieuse à l’orée de l’âge adulte, avide de découvrir son corps par le prisme de la pratique photographique. Tirant habilement profit de cette prémisse singulière, évocatrice d’une perspective typiquement adolescente sur la sexualité, la cinéaste Nancy Pettinicchio (dont il s’agit de la première œuvre à titre de réalisatrice) élabore un conte initiatique lumineux et perspicace teinté d’un érotisme subtil. Le tout débute avec des images classiques de félicité banlieusarde, alors que Leila (Ricci) et son amie Cassy (Chanel Mings) se promènent à vélo à travers les rues ensoleillées d’une petite ville tranquille, entre les parterres gazonnés de grandes maisons unifamiliales et les automobiles qui, lentement, arpentent les rues labyrinthiques qui les enceignent. Les décors autour d’elles possèdent cette qualité intemporelle digne d’un lieu de pure nostalgie, un monde statique où les jeunes jouent encore au Nintendo 64 dans des sous-sols couverts de tapis où filtrent des rais de lumière par-delà des stores verticaux. On ressent pourtant l’approche du crépuscule de l’adolescence lorsqu’on voit Leila faire ses boîtes dans l’optique de quitter le nid familial. On sent qu’il s’agit du « dernier été » pour les deux amies, le moment d’ultimes découvertes identitaires, lesquelles se produisent ici au contact d’un personnage inattendu.
Attirée magnétiquement par une vente de garage lors de ses déambulations à vélo, la protagoniste y trouve une petite photo dans une boîte, qu’elle glisse subrepticement dans sa poche. Sur celle-ci on peut voir l’autoportrait d’une femme nue, prise en 1973. Photographe elle-même, Leila devient alors obsédée par l’idée d’immortaliser son propre corps dans son plus simple appareil. Elle hésite, animée par sorte une de gêne pudique, se mire dans la glace au sortir de la douche, à la fois fascinée et anxieuse. Elle en néglige même sa relation avec Cassy, préférant aller boire du vin avec Annette (Nathalie Gascon), l’autrice de la photographie initiale, qui se transforme pour elle en une figure cathartique. Profitant de l’interprétation entière de ses trois actrices, Pettinicchio fait aussi preuve d’une grande adresse dans la mise en scène, parvenant à cerner parfaitement la douce amertume qui accompagne le moment du départ vers le monde adulte, de même que cette espèce de passion ambiguë que peuvent ressentir les jeunes à l’idée de s’envisager eux-mêmes comme des objets esthétiques, voire comme des objets de désir. Évitant les pièges du narcissisme, l’autrice multiplie les miroirs à l’écran pour mieux évoquer chez la protagoniste une pulsion exploratoire aux fortes implications psychanalytiques. Lors d’une séquence particulièrement réussie, sa caméra se retrouve dans la piscine, au niveau d’une Leila grisée qu’elle filme alternativement au-dessus et sous la surface de l’eau, oscillant entre deux mondes : l’univers prosaïque d’une cour banlieusarde où elle discute avec Cassy et l’univers souterrain, onirique et sensuel, où s’exprime subrepticement son ça. (Olivier Thibodeau)

prod. Colonelle Films
LA VIE HEUREUSE
Amélie Hardy | Québec | 2022 | 16 minutes | Compétition 3
Distinctement contemporain, délicieusement anticonformiste et brillamment scénarisé, ce documentaire expérimental d’Amélie Hardy (gagnante du prix de la relève aux RIDM de 2018 pour Train Hopper) rappelle Les vacances de monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati dans son exploration des loisirs stressants d’une population encore plus anxieuse qu’à l’époque, sursollicitée et moutonnière. Le tout débute par un mitraillage extrêmement astucieux d’images trouvées, façon Heat Waves (2022), Going South (2018) ou Present. Perfect. (2019), mais sur l’acide, alors qu’on pige sur YouTube à la recherche d’abrasives excentricités, aboutées grâce à un montage tout aussi abrasif. C’est le processus de mitraillage qui compte ici, au rythme d’une chorale de voix qui nous vantent les mérites du stress. Ce type de vocalise dogmatique nous accompagnera d’ailleurs tout au long du film, sauf que c’est une voix anesthésiante qui nous enveloppe ensuite, dont le ton ésotérique rappelle les vidéos de méditation ou de croissance personnelle. Celle-ci sert de contrepoids au caractère violent d’images documentaires ingénieusement cadrées. De façon subtile d’abord, alors que les panoramas de cieux bleutés sont zébrés par des cordes de bungee, dont les praticiens s’adonnent à un passe-temps dominical encore plus stressant que leur existence quotidienne. « Imaginez un endroit où vous pouvez vous reposer », suggère la voix, pôle serein d’un montage dialectique qui alterne brutalement entre de tranquilles paysages et diverses activités de divertissement anxiogènes (nager dans la piscine à vagues, sortir dans le club, danser dans le mush pit, aller voir les muscles cars). Ce n’est qu’auprès des nudistes informes à l’épiderme raviné que l’on se trouve finalement apaisé. Loin des canons de beauté obligatoires, de la pudeur imposée et du rythme fulgurant, bref de tout ce conformisme qui fait de nous des machines avides de travail et de consommation. (Olivier Thibodeau)

prod. Pôle 3D
LES LARMES DE LA SEINE
Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Étienne Moulin, Hadrien Pino, Lisa Vicente, Philippine Singer et Alice Letailleur | France | 2021 | 9 minutes | Compétition 10 — Animations
Ce film d’animation en images de synthèse, signé coopérativement par une équipe d’animateur∙rice∙s diplomé∙e∙s du Pôle 3D de l’Université catholique de Lille, touche aux indicibles équivalences qui accompagnent les fantômes du colonialisme. Les larmes de la Seine est un film hanté par la mémoire des 200 Algériens tués, certains noyés, durant la nuit parisienne du 17 octobre 1961. Leur présence est incarnée dans toutes ces marionnettes numériques aux textures généreuses, aux poils brossés, aux vêtements bien repassés, simulant une ventriloquie aux mouvements vivaces, cherchant à bénéficier à la fois de la matérialité du stop-motion et de la fluidité algorithmique d’une physique sans saccades. À l’animation s’ajoutent les partis pris frappants de la réalisation : une caméra au poing feintant le 8 mm, utilisée pour capter la préparation à la manifestation, puis une mise en scène fantasmatique, virant au délire transhistorique et critique.
Ayant suivi dans le trépas les Algériens assassinés par les policiers de Paris, nous voilà engloutis dans la seconde moitié du film, comme transvasés dans un présent récent, accompagnant les fantômes du massacre dans une salle de spectacle imaginaire où lentement mais sûrement le souvenir terrible du Bataclan surgit. Les larmes de la Seine devient Les larmes de la scène, alors que les policiers s’installent en lieu et place des terroristes pour retuer les morts et, en quelque sorte, leur mémoire. Car au-delà de l’évident discours sur la violence cyclique qui s’impose en héritage des abus coloniaux, c’est aussi de la violence de ces bouleversements socio-historiques dont traite le film, celle d’une identité repositionnée en ennemi terroriste, invisibilisant une certaine mémoire de son exploitation passée. Or ces Larmes ont l’intelligence de détourner constamment les effets attendus et de se concentrer plutôt sur le crescendo de sa fête macabre et joyeuse, immobilisant les époques sur une piste de danse anachronique, comme une manière de ne voir les victimes qu’au présent, de nous rendre égaux dans le bonheur mais surtout dans la souffrance. (Mathieu Li-Goyette)
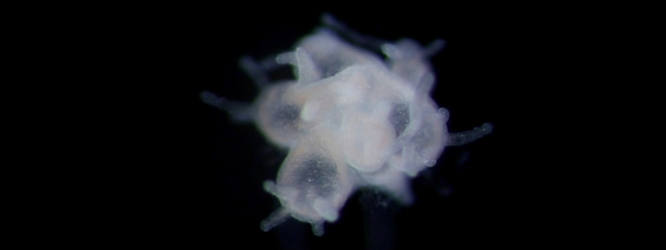
prod. Maija Tammi
THE PROBLEM OF THE HYDRA
Maija Tammi | Finlande | 2020 | 10 minutes | Programme Art et essai
Le documentaire expérimental sur les créatures singulières qui peuplent les écosystèmes marins possède une longue histoire. Déjà en 1910, Pathé produisait L’axolotl, un film méconnu, mais extrêmement mémorable, où la simple présence de la créature titulaire à l’écran constitue un événement en soi. Ici la photographe finlandaise Maija Tammi, autrice du livre Sick Photography: Representations of Sickness in Art Photography (2017), reprend le même posture hébétée face à son sujet et nous délecte de la vue des hydres, ces petits polypes d’eau douce réputés immortels par les généticiens en vertu de leur facultés régénératrices et de l’impossible tâche de déterminer leur âge individuel. À l’origine, nous raconte la voix off d’Ava Grayson, les biologistes ne pouvaient dire si ces êtres appartenaient à la faune ou à la flore. Pour en avoir le cœur net, ils décidèrent de découper un spécimen en deux et, après avoir constaté que les deux parties survécurent, conclurent qu’il s’agissait d’une plante… une plante mouvante qui se nourrit par ingestion buccale. À travers un dispositif archi simple, où dominent les plans microscopiques de la créature, on nous révèle ensuite une série de faits surprenants à son propos, des assertions étranges qui évoquent les récits de science-fiction, de même d’ailleurs que la musique électronique déconcertante sur la bande sonore.
Doté d’un fort potentiel didactique, au regard des nombreuses informations qu’il contient, le film de Tammi est surtout fascinant pour le spectacle élégant et singulier des hydres, dont le corps semi-translucide ondule, palpite et s’étire de façons inattendues, accaparant le cadre à la manière d’un danseur saturnien. On a même droit à un plan macrophotographique superbe d’une sauterelle qui se récure l’œil avec sa patte, vision à la fois extrêmement prosaïque et incroyablement exotique pour quiconque n’a jamais pris le temps d’observer avec soin la gens insectoïde. Des simples constatations biologiques (à propos de la bouche évanescente des hydres, du processus de régénération de leurs corps, de leur capacité à se cloner eux-mêmes et à se reproduire sexuellement), l’autrice passe bientôt à des considérations philosophiques, notamment en ce qui a trait à l’immortalité de ses sujets, qui constituent dans cette perspective des entités uniques sur la planète. On évoque même l’idée de l’âme, et de ce qui pourrait bien en advenir lorsqu’un corps se scinde en deux. C’est une métaphysique animalière qu’elle propose en somme, conséquente avec l’idée d’une diégèse qui se situe entièrement au-delà de la perception standard des gens et de leur appréhension troposphérique du monde. (Olivier Thibodeau)

prod. Rémi St-Michel et al.
GRAND FRÈRE
Rémi St-Michel | Québec | 2021 | 17 minutes | Compétition 6
Grand frère est l’envers mature mais pas trop de Petit frère (2014), qui préfigurait à l’époque des longs métrages à venir comme Prank (Vincent Biron, 2016) ou Avant qu’on explose (Rémi St-Michel, 2019), avec le même Étienne Galloy encadré par l’écriture jackass du même Éric K. Boulianne. Le premier film se terminait sur les adieux des deux lurons (Galloy et Boulianne en acteur-scénariste), une fin douce-amère venant clôturer une journée rythmée à coup de pranks et de dares, le plus jeune s’éloignant dans les entrailles du métro montréalais pendant que le plus vieux s’apprêtait à partir vers Moscou et un destin encore inconnu. Accomplissant un dernier tour sur la piste des conneries d’usage, Petit frère était un film sur cette immaturité qu’on ne veut pas abandonner derrière soi, ce cœur d’enfant trash à préserver par peur de devenir trop sérieux. En cela, Grand frère constitue une suite assez brillante, alors qu’il reprend la structure du précédent comme pour mieux la subvertir, dans un effet dialectique où les niaiseries d’autrefois ont dégénéré et où les habitudes se sont transformées jusqu’à s’étioler sous les effets du temps et de la distance. Dans cet écho dualisé, St-Michel et Boulianne retournent la blague, faisant passer dans un premier temps Grand frère comme la simple évolution vécue du film précédent – façon Boyhood de Linklater (2014) – alors qu’il s’agit plutôt d’actualiser le fond, de réquisitionner des personnages et d’aborder les dérives conspirationnistes – le petit frère est devenu un flat-earther antivax – en épluchant en couches successives et subtiles les effets qu’on eut l’éloignement, voire la migration, sur le duo autrefois inséparable. À peine un film de bros, Grand frère est surtout un film d’écoute et de compassion, qui réitère au passage l’originalité comique de ses auteurs et confirme leur évolution probante depuis Petit frère, en particulier dans l’aménagement bataillé mais mérité, parmi les coups de tête et les engueulades de ruelle, de cette tendresse qui n’a plus rien d’une petite écriture. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Couronne Nord
OPÉRATION CARCAJOU
Nicolas Krief | Québec | 2021 | 18 minutes | Programme #13-17
Le chantage familial, c’est mal. Sauf quand votre père est un tyran ordinaire, qui vous fait chier avec la gestion de votre appareil dentaire et de votre allocation hebdomadaire. Opération Carcajou (ainsi nommé en référence à l’escouade Carcajou, responsable de la lutte contre la drogue que marchandaient les motards au milieu des années 90) est un conte initiatique inspiré par le cinéma de genre, où les personnages sont des caricatures, où l’humour flirte avec le drame, où le scénario regorge de gags savoureux, où le mot d’ordre est le plaisir du spectateur, nonobstant l’immoralité du récit. Servi par une excellente distribution que dirige avec aplomb le réalisateur Krief (incluant le célèbre acteur de télévision Ariel Ifergan dans le rôle du patriarche), le film nous plonge au cœur d’un conte universel au contexte semi-spécifique. Dans un monde de banlieue qui ressemble à tout autre, le jeune Nicolas tente de faire un peu d’argent en tondant le gazon, mais c’est sans compter sur l’intransigeance de son paternel qui, autour de la table familiale, refuse de lui donner une avance sur son salaire en prétendant vouloir lui inculquer la valeur de l’argent devant sa sœur modèle. Mais lorsque la police envahit la maison à la recherche de la mallette remplie de billets cachée dans les platebandes, toute la légitimité de son discours disparaît en fumée. Les scènes avec les policiers, qui suivent le petit protagoniste jusque dans les toilettes et se moquent de la découverte d’un monceau de mouchoirs souillés dans sa poubelle, sont particulièrement amusantes, mais c’est finalement l’interprétation qui nous reste en mémoire, alors que brillent les charismatiques Yasser Essoulimaniet Michmahëll Aubourg Clergé dans des rôles pour adultes. (Olivier Thibodeau)

NALUJUK NIGHT
Jennie Williams | Canada | 2021 | 13 minutes | Compétition 4
Ce qui frappe le plus dans Nalujuk Night, court métrage primé, tourné dans le Nunatsiavut(territoire autonome géré par les Inuits du Labrador), c’est l’incroyable variété et la grande qualité de son lexique visuel. Usant d’une envoûtante photographie noir et blanc, parfaitement adaptée pour capturer l’atmosphère onirique étrange qui règne lors de la fête titulaire, Williams et son équipe d’opérateurs (Duncan De Young et Nigel Markham) ne se cantonnent pas aux plans d’observation, mais composent aussi de riches tableaux forts d’un énorme potentiel affectif. Ils créent ainsi un documentaire hybride, inspiré largement par les codes esthétiques et le montage anxiogène du cinéma d’horreur, idéaux pour étoffer la représentation de cette célébration païenne durant laquelle des figures squelettiques apparaissent au village de Nain pour récompenser les bons enfants et matraquer les mauvais. Transcendant les limites du cinéma direct, dont il partage néanmoins la proximité avec ses sujets, le film propose une exploration sensible de l’événement, maximisant le pouvoir d’évocation macabre des décors nocturnes en plus d’émuler techniquement le phénomène de pollinisation culturel responsable de l’avènement de cette fête, qu’on assimile à un mélange impie entre Noël et l’Halloween.
Au début du film, deux figures sombres se profilent à l’horizon, arpentant de façon sinistre une plaine enneigée fouettée par le vent. Les détails de leurs costumes, leurs mains gantées, leurs bottes poilues, leurs gardes en bois de cerfs et leurs masques monstrueux sont révélés à l’écran dans des gros plans accompagnés par le bruit de tambours faisant office de battements de cœur et d’une bande sonore grinçante digne des slashers. Ils s’avancent inexorablement vers le village isolé, dont la quiétude est représentée par une série de plans dépeuplés. Filmées en contre-plongée ou au ralenti, les deux figures rappellent les croquemitaines classiques, cernant et poursuivant les méchants petits enfants de l’endroit. Le film est entrecoupé aussi de plans ethnographiques plus habituels, qui évoquent les œuvres phares du direct, où l’on voit des villageois rassemblés pour les festivités sur la place publique (comme dans Les raquetteurs, 1958) ou réunis dans de chaleureuses chaumières (comme les insulaires de Pour la suite du monde, 1963). D’étranges révélations émanent de ces séquences, l’interprétation de la chanson allemande Mon beau sapin par un orchestre de cuivres, par exemple, ou ces chants en langue traditionnelle accompagnés par le « Happy New Year » anglo-saxon, signes éloquents d’une certaine hybridation culturelle que le film émule en parallèle grâce à sa propre patine postmoderne. Le résultat est une œuvre bizarre et singulière, emblématique de la nation canadienne, proposant une sorte de plongée interstitielle, entre la peur et la joie, le réalisme et la fantaisie, les traditions autochtones et indo-européennes. (Olivier Thibodeau)

GRANNY'S SEXUAL LIFE
Urska Djukic et Émilie Pigeard | France / Slovénie | 2021 | 14 minutes | Compétition 10 – Animations
Même en 2022, l’éducation populaire au plaisir féminin reste à faire. C’est peut-être pour cela que les réalisatrices Urska Djukiv et Émilie Pigeard recourent à des symboles si grotesques, tordus, puissants pour représenter le corps féminin « traditionnel », emprisonné à la maison comme agent de pondaison et de réconfort. C’est peut-être pour cela également qu’elles usent de témoignages si percutants et candides pour décrire les mœurs sexuelles anachroniques de la Slovénie de grand-maman. Pour nous rappeler la résilience des dogmes délétères de la masculinité triomphante et pour en révéler la profonde absurdité. Les hommes à l’écran, escadron de nymphomanes militarisés, partagent donc l’aspect caricatural des femmes, constituant le pôle belliqueux d’une économie esclavagiste des genres où les épouses doivent ouvrir les jambes au risque de goûter au fouet.
Reconnue pour le caractère hybride de sa mise en scène et pour ses préoccupations féministes, Djukiv trouve ici une alliée parfaite en l’animatrice lilasienne Émilie Pigeard, dont le style naïf permet d’accentuer le caractère ironique de cette courte ethnographie des abus conjugaux, mais aussi d’emblématiser le trauma infantile provoqué par ceux-ci. « Mon père est rentré à la maison un soir et a lancé à notre mère un regard spécial. Elle ne voulait pas le suivre. Il est sorti et est revenu avec un fouet », déclare une intervenante anonyme en voix off sur des images grossières de fermiers poilus qui font trembler le sol en marchant. Constitué principalement d’une série de témoignages d’époque, tirés des propos recueillis par Milena Miklavčič pour son livre Ogenj, rit in kače niso za igrače (2014, traduit au générique par Feu, fesses et serpents ne sont pas des jouets), plaqués sur des séquences animées ad hoc, le film évoque une grande chorale des sans voix, dont l’enchevêtrement de secrets intimes donne froid dans le dos. « Je n’oublierai jamais la douleur », confessent une gamme d’intervenantes à l’unisson, révélant ensuite les différentes techniques qu’elles utilisaient pour apaiser la violence coïtale, qu’il s’agisse du recours à la graisse de porc ou à une demi-bouteille de vin…
L’esthétique naïve préconisée par Pigeard, qui use de personnages dessinés au crayon et de peinture à l’eau, tracés à grands traits maladroits qui rappellent l’art infantile, a de quoi choquer par le simple contraste qu’elle propose avec le caractère distinctement adulte des thèmes abordés. Or, c’est sa facture profondément expressionniste et brutalement métaphorique qui bénéficie le plus à la thèse du film, laquelle contribue à un florilège de parodies absurdes des archétypes d’antan et à une sorte d’essentialisme critique du corps féminin. La ménagère nue qui cuisine au milieu d’une maison qui peine à la contenir, dont les seins font office de gicleurs, prêts à asperger une flopée d’enfants suppliants, et dont les lèvres vaginales se distendent soudainement pour propulser une volée de bébés constitue à ce titre un symbole puissant. (Olivier Thibodeau)
|
|
jour 4 |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
