JOUR 5
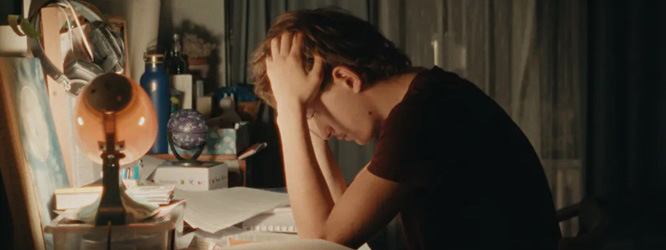
prod. Proton Cinema / MPhilms
EXPLANATION FOR EVERYTHING
Gábor Reisz | Hongrie / Slovaquie | 2023 | 152 minutes | Section Harbour
Explanation for Everything est si parfaitement contemporain qu’on risque vite de le revoir — il a déjà remporté le prix Orizzonti du Meilleur film à la Biennale de Venise. Filmé dans ce style direct éreintant du nouveau réalisme dramatique, où l’on préfère effectuer des panoramiques saccadés entre les personnages plutôt que d’opter pour des champs-contrechamps, question de bien faire durer les malaises, le film nous catapulte dans un monde stressant de frustrations quotidiennes issues de dogmes sociaux ridicules. Abel Trem a l’air du flanc-mou d’adolescent tout ce qu’il y a de plus ordinaire — il flâne sur le sofa, alors qu’il doit étudier, il filme des niaiseries avec son téléphone et il débranche le réfrigérateur à cause du bruit, sans réaliser qu’il va couler partout. Mais, en fait, c’est un brave garçon qui a bon cœur, et son récit est vraiment touchant. Amoureux d’une camarade de classe qui, elle-même, est amoureuse de Jakab, leur professeur d’histoire, Abel fige complètement au moment de passer son examen oral. Troublé par la vue de son béguin, Janka, qui vient de s’effondrer en larmes par chagrin d’amour pour l’instituteur, il perd complètement ses mots devant ce dernier, et n’arrive pas à formuler une seule idée pertinente à propos de Jules César et de l’empire romain. « Pourquoi portes-tu un badge national ? », lui demande anecdotiquement Jakab lors de l’examen puisqu’il n’est généralement porté que le 15 mars. Pressé par son père droitiste, il dira ensuite que c’est à cause du badge qu’il a échoué, ce qui causera un incident diplomatique monumental.
Le film de Reisz évoque à certains égards le Loony Porn (2021) de Radu Jude, en cela qu’il narre le récit d’un problème anodin qui prend des proportions dantesques et devient un cirque médiatique infame via le prisme d’une opinion publique hystérique, sclérosée par un conservatisme endémique. Mais il fait plus en épousant la perspective de divers personnages (en l’occurrence, Abel, son père György, Jakab et Erika, la journaliste arriviste responsable d’avoir ébruité l’affaire), démontrant chacun des heurts quotidiens qui les ont fragilisés jusqu’au point d’ébullition. Ce que l’on retire, c’est l’image d’un monde où les masses oppressées, plutôt que de se rebeller, subissent et se divisent, entretenant une haine qui les poussent à s’entredéchirer. Tant qu’à se faire chier comme célibataire à entendre ses voisins baiser, pourquoi ne pas utiliser notre peu de pouvoir pour traîner quelqu’un dans la boue ? Comment ne pas détester les anti-nationalistes quand notre père a gâché sa vie pour la nation et que c’est la seule fierté qui nous reste ? Comment ne pas s’énerver contre un vieux droitiste qui, sous un prétexte, obtient des privilèges pour son fils, alors que notre propre emploi est en jeu ? Plus intimement, comment ne pas vouloir faire souffrir l’homme dont est amoureux la femme de nos rêves ?
La conformité à un système scolaire ridicule, où l’on échoue sur la foi d’un seul examen, est particulièrement symptomatique du problème de l’obéissance et de cette mentalité immobiliste qui nous élève les uns contre les autres. « Tu viens de gâcher ta vie », dit György à son fils avec le plus grand sérieux du monde. Et tout le monde dans la salle éclate de rire, parce que c’est ridicule de dire ça à un adolescent. Mais en même temps on comprend, on comprend que les notes, c’est une autre façon indue, comme l’argent, de déterminer la valeur des gens, et que, pour quelqu’un sans imagination, le futur passe nécessairement par la glorieuse marque du conformisme qu’est la diplomation.

prod. Handmade Films
SHE FELL TO EARTH
Susie Au | Hong Kong | 2024 | 92 minutes | Tiger Competition
Un wu xia de science-fiction ? La proposition est vraiment tentante, mais ce n’est pas tout à fait ça non plus. C’est plutôt comme une interprétation conceptuelle du wu xia, où la danse contemporaine remplace les chorégraphies martiales, où l’on s’intéresse au caractère marginal et passionné des personnages et non à leurs talents de pugilistes, et où la mise en scène, traditionnellement dynamique, est remplacée par une version cocaïnée aux pupilles dilatées et aux doigts tremblotants. La réalisatrice Susie Au travaillait autrefois dans le vidéoclip, et cela transparaît ici dans le mitraillage constant de plans où l’objectif recadre constamment, où l’on multiplie les inserts sur tout, tout le temps, où l’on effectue des zooms, des ralentis, des rack focus, des mouvements de drone, des plans tournoyants, un peu pêle-mêle, pour injecter de l’énergie au récit mais sans les justifications dramatiques d’usage — ça donne le tournis par moments, mais on ne peut pas dire que ce soit ennuyant visuellement… Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé, mais je crois que le film possède définitivement un potentiel culte pour les amateur·ice·s de cinéma psychotronique, surtout que ça se termine dans une sorte de délire mystique où les images de cosmos se superposent à des images de mer, d’arbres et de figures mystérieuses venues nous révéler toutes les ramifications d’un scénario légèrement confus qu’opacifient encore les sous-titres lacunaires. C’est une façon plus amusante de philosopher, en tout cas, que les scènes où Book, l’intellectuel de service du film, cite Kant ou Rilke en s’adressant à la caméra.
Malgré tout, il existe ici un récit sympathique, qui tourne un peu en rond, mais dont la sensibilité adolescente cadre bien avec la mise en scène survitaminée de Au et les enjeux feuilletonesques du scénario signé par Shu Xie. C’est l’histoire d’une jeune extraterrestre devenue amnésique en passant dans un trou noir, un blanc canevas, pur et innocent, tout d’albâtre accoutré, qui doit retrouver son identité au contact d’autres extraterrestres (Om et North Pole) qui, ielles aussi, sont tombé·e·s sur Terre dans des roches, et de divers êtres humains, qui ne peuvent pourtant pas la voir. Tout débute avec une pluie de pierres hurlantes qui s’écrasent partout sur Hong Kong ; l’une fait « Aaaaaah » (c’est Ah-mour, l’héroïne), l'autre fait « Ooooooooom » (c’est Om la plus adorable des Vénusiennes, qui « fly, fly, fly » au-dessus de la ville et crie « superpower! » dans l’espoir d’activer un talent caché qui puisse affecter son environnement — on est juste triste qu’elle soit laissée de côté après la première demi-heure). Le film fera d’ailleurs beaucoup de millage avec ces roches, qui servent à la fois de personnages, d’accessoires et d’enjeux scénaristiques, tout comme il misera énormément sur le pouvoir d’invisibilité des protagonistes. C’est un conte initiatique, bref, où l’on s’exprime dans des litanies à propos de la mémoire et de l’incommunicabilité, mais aussi physiquement, avec des entrechats et des danses impromptues sur le trottoir — on dirait presque une comédie musicale par moments. Malheureusement, puisque tout le message du film tourne autour du besoin de connexion, on aurait préféré que le parcours prosaïque des personnages humains soit plus intimement connecté à celui de leurs contreparties étrangères…
*
JOUR 6

prod. Viktor Israel Strand
IT IS LIT
Viktor Israel Strand | Suède | 2024 | 72 minutes | Section Bright Future
Ça fait du bien de voir des invités de festival se présenter en hoodie avec des vieux jeans noirs sales (un peu comme moi) — ça fait changement du clinquant indécrottable de la Berlinale ou de Cannes… et ça te rappelle que le cinéma indépendant, c’est fait par des gens ordinaires. Je pense ici à l’artiste visuel Amund Öhrnell, qui dans le film de Strand est prisonnier d’une chemise-cravate, qu’il porte dans presque chaque scène comme le symbole d’une servitude généralisée. « Nous n’avons d’autre choix que le capitalisme en Suède », dira d’ailleurs le réalisateur après la projection, « le choix a déjà été fait pour nous ». Et c’est pourquoi son œuvre est si farouchement anti-corporative. Filmé en noir et blanc, dans un style fauché qui rappelle le Dogme, usant de raccords déroutants entre des plans d’ensemble et des gros plans, misant sur une distribution semi-professionnelle et un scénario absurde bourré de digressions oniriques, It is Lit s’impose comme une parodie du conformisme à tous les niveaux.
Impliqué dans une affaire de vente d’un site historique à un intérêt délétère quelconque, Johan (Öhrnell) est préoccupé par des impératifs matériaux et interpersonnels plus immédiats (son bonus, par exemple, ou la rédemption de son collègue Björn, qu’il traîne dans une excursion nocturne de découverte de soi qui s’apparente par moments à Blair Witch Project [1999]). Il ne s’agit donc pas littéralement ici d’une satire de la vie de bureau — il n’y a même pas de « bureau » à proprement parler, que des « collègues » de bureau, le milieu de travail étant représenté dans des décors abstraits qui évoquent un échafaudage conceptuel à la Dogville (2003). Il s’agit plutôt d’une étude loufoque de l’aliénation et de son corollaire fantasmatique, l’évasion. Ce n’est pas dire qu’il ne contient pas de scènes hilarantes de coquecigrues entrepreneuriales — la séquence où Lina se pâme devant un bout de mur médiéval et dit vouloir respecter l’histoire en la rebâtissant, provoquant l’apparition soudaine de bouteilles de champagne et de plateaux de biscuits dans le cadre, est absolument délirante. Or, la plupart du récit se déroule en périphérie du monde du travail, dans la tête de Johan pour être exact, dont l’univers mental est parasité, circonscrit par l’intrusion de ses collègues dans chacune des activités récréatives.
On voit alternativement le protagoniste enterrer des cochonneries avec son acolyte Kristoffer sur un site de construction, se baigner, flâner au parc avec ses camarades Pontus et Lina et se promener la nuit avec Björn. Toute échappatoire, semble-t-il, le ramène inévitablement au quotidien. Et c’est là que l’imaginaire du film lui permet de s’émanciper. Obsédé par le bruit que fait son voisin d’en bas, il descend et cogne à sa porte, puis, dans une scène digne d’un film de mafia, l’intime à monter pour mieux le flinguer avec un pistolet… fait de ses doigts. Réuni avec sa collègue Marielle sur le plancher de son salon, il l’observe à travers un iris qu’il a fabriqué en roulant un contrat, qu’il pointe ensuite vers une tête de chevreuil accrochée au mur, puis vers Pontus, qui vient d’apparaître chez lui de façon incongrue, juste à temps pour voir Marielle mourir de soif après que Johan a oublié de lui apporter un verre d’eau. C’est drôle, c’est inattendu, et ça te rappelle qu’il y a encore de la magie, de l’ingéniosité dans ce monde noir et blanc que nous avons laissé bâtir autour de nous.

prod. Ghosts City Films
KING BABY
Kit (Redstone) et Arran (Shearing) | Royaume-Uni | 2024 | 91 minutes | Section Bright Future
Le « King Baby », tel qu’il est représenté dans le film, c’est l’incarnation du souverain égoïste, misogyne et incompétent, incapable de survivre sans le service d’autrui. Mais, ce n’est que l’une des facettes que revêt ici la monarchie, au sein d’une fable brillante, perspicace et hilarante sur les relations de pouvoir dans une société hiérarchique. Elle existe aussi sous une forme plus douce, qui finit également par sombrer dans la démesure — le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, prouve-t-on ici pour l’énième fois. Ce qu’il y a de constant par contre, dans les rapports de domination phallocentrique — et le mot est juste puisque les bites abondent dans le scénario de Kit et Arran — c’est la conception des femmes comme canevas où projeter les désirs et les frustrations masculines. Et c’est là que l’humour vire au vinaigre.
Bien qu’il s’agisse avant tout ici d’une fable symbolique, où deux hommes quittent la société pour vivre dans une monarchie autarcique au sein d’un château ruiné, l’un comme servant, l’autre comme roi, on a quand même droit à une brève introduction en voix off qui donne tout de suite le ton. « Rarement les fables commencent-elles par l’abandon d’une mini-fourgonnette Ford », nous dit-on avec cette espièglerie toute typique de l’humour britannique. On nous explique ensuite que l’histoire se passe il y a peut-être 10 ou 20 ans, et que les deux hommes ont peut-être déjà porté des prénoms ordinaires et vécu dans des maisons banales. Mais pour l’instant, ils ne sont que souverain et serviteur, dans ce qui ressemble à un atelier d’art dramatique se déroulant dans un décor rupestre dépouillé qui contient une baignoire, un lit et une table, et où Graham Dickson interprète à merveille le monarque, prétentieux, suffisant, macho tandis que Neil Chinneck incarne parfaitement le subalterne flagorneur et obséquieux. Au gré d’une bande sonore fantastique digne d’un ménestrel médiéval, les deux hommes s’opposent ainsi dans moult mises en scène d’un comique étudié (le bain et l’essuyage du roi, l’adresse aux sujets, la chasse au lapin, et bien sûr le festin du gibier en Jell-O, préparé avec soin par le serviteur). La permutation éventuelle des deux rôles laisse entrevoir l’apparition d’un despote éclairé, mais l’expérience sociologique teintée de tragédie shakespearienne qui s’ensuit nous prouve le contraire.
Mais il y a aussi un troisième personnage, une femme de bois, muette, sans traits faciaux, façonnée soigneusement par le laquais pour plaire à son souverain, qui désire y foutre son foutre. Conçue comme un objet de plaisir, elle devient vite une cible de récriminations, puis un exutoire de colère, au gré des échardes que le roi se prend dans les lèvres et le gland. C’est surtout une ardoise vierge où chacun des deux hommes projette les émotions qu’il souhaite y voir — dans de gros plans absurdes où l’on nous retourne son visage lisse de mannequin d’artiste. C’est un pur produit de l’imaginaire macho, mais c’est aussi le récipient de son fiel le plus abject, une vue de l’esprit sans agentivité qui n’a d’autre fonction que de pourvoir aux désirs des maîtres. Et c’est certainement là l’effet de pouvoir le plus terrifiant et le plus pernicieux qu’aborde le film. Plus en tout cas que la subordination relationnelle des deux hommes, qui dans leur mesquinerie, reconnaissent au moins la force de volonté de leur vis-à-vis…
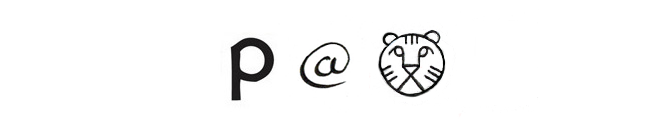
PARTIE 1
(Head South, Rei,
A Man Imagined, La Parra)
PARTIE 2
(Blackbird Blackbird Blackberry, So Unreal,
Confidenza, Slide)
PARTIE 3
(Explanation for Everything, She Fell To Earth
King Baby, It is Lit)
PARTIE 4
(Blue Imagine, Natatorium,
The Parangon, Songs of All Ends, Nécrose)
PARTIE 5
(Maia - Portrait with Hands, A Spoiling Rain,
Krazy House, Los delincuentes)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
