
SOUND OF FALLING
Mascha Schilinski | Allemagne | 2025 | 149 minutes | Compétition officielle
Le deuxième long métrage de Mascha Schilinski (après Die Tochter [2017]) est un dédale romanesque qui subjugue, qui attire, attrape et retient le regard et l’attention. On y entre sans trop savoir ce qu’on verra, et on en ressort sans jamais avoir pensé regarder sa montre, avec un sentiment de plénitude comme on n’en ressent qu’une fois toutes les quelques années. C’est un film-univers comme il s’en fait très rarement, qui m’a comblé comme lorsque j’étais sorti de Tranque Lauquen (Laura Citarella, 2022) ou bien avant cela en quittant Tree of Life (Terence Malick, 2011), ces films qui semblent inventer leur propre langage au fur et à mesure qu’ils s’adressent à nous, qu’ils se déploient sans aucune forme de complaisance ni de cruauté en utilisant tout l’amour du cinéma pour nous parler d’amour.
Et pourtant, quel film sur la cruauté ! Sur la cruauté qui peut exister dans une famille, se transmettre à travers les âges, les ressentiments. Sur la cruauté qui parfois se révèle être une preuve d’amour et qu’on ne comprend que bien plus tard, souvent seulement une génération plus loin, car Sound of Falling se déroule dans le désordre à travers quatre générations, sur un siècle allemand au grand complet, des casques pointus de la Première Guerre jusqu’aux AirPods. À chaque génération son trauma, ses femmes qui survivent malgré tout, ces héroïnes qui nous prennent par la main pour nous faire découvrir les ténèbres de cette famille qui cherche à faire de son mieux, mais qui demeure toujours incapable de complètement s’en tirer.
Dès la première scène, avec cette goutte de sueur salée qui doucement remplit le creux du nombril d’un bellâtre amputé et que lèchera la fille du maître du domaine de son doigt curieux, Schilinski nous dit que sa mise en scène fera comme ce doigt. On goûtera, on sentira, on entendra aussi le son de la chute, des murmures, tous ces éléments du détail humain qui en disent souvent si long sur les états d’âme et que la cinéaste décrit, qu’elle écrit comme sur la grande partition d’un orchestre à quatre voix. Tout le film rime, tout son montage vit au battement de ses femmes qui se consolident, montrant comment le courage cumulé dans l’histoire finit éventuellement par ressembler à de l’émancipation.
Pour y arriver les narrations se croisent, les transitions nous font passer d’une époque à l’autre, d’un instant de joie à un de mélancolie, avec la même facilité qui nous assomme quand vient le temps de constater avec quelle rapidité certains sentiments peuvent s’évaporer pour laisser leur place à d’autres. Dans ce va-et-vient entre le réconfort et l’hostilité, The Sound of Falling raconte la chute d’une famille et de ses membres, la difficulté pour elle de se relever, et surtout la force de ses femmes à supporter ce regard masculin dont elles parviennent progressivement à s’échapper.
Ainsi il s’agit d’une œuvre brillante dans sa représentation du trauma qu’elle parvient à montrer sans jamais le reconduire, d’une introspection féministe toute articulée autour de la force des regards et de la pesanteur qu’ils imposent aux corps. Tout est ici regardé parce que tout est potentiellement regardant, comme une histoire intergénérationnelle du male gaze que la cinéaste traque à travers le siècle, observant comment ce regard tyrannique plie la réalité à ses désirs et parvenant, par-dessus tout, à travers des manières nouvelles (et qui pourtant rappellent constamment Dreyer, Bresson, Sjöström, Malick) à émanciper les corps asservis, à trouver du bonheur pour résister aux pires situations, à se passionner par l’idée de jouer des tours pour simuler une douleur et apprendre à s’en protéger.
C’est un film qui se découvre comme un grand roman, un film sur lequel on pourrait écrire très longtemps et qui sera sans doute analysé très longtemps, avec le sentiment qu’il présente quelque chose d’inépuisable dans ses généreux mystères et qui, sans tout faire comprendre, procure au moins la certitude d’avoir vu quelque chose de très ample, de très beau, de très grand. (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture du Festival de Cannes 2025
Prochaine projection : 18 octobre à 20h15 (Cineplex Quartier Latin)
AFFECTION AFFECTION
Maxime Matray et Alexia Walther | France | 2025 | 101 minutes | Compétition internationale
Dans une ville de la Côte d’Azur désertée par les plaisanciers·ère·s, Géraldine, une employée municipale laconique, mène l’enquête sur des disparitions successives : d’abord un petit chien blanc, en fuite depuis l’explosion accidentelle d’une mine antipersonnel, puis sa belle-fille, et finalement le père de celle-ci. Comme pour inaugurer cette série de fugues, un retour : celui de la mère de Géraldine, partie vivre en Thaïlande il y a dix-sept ans sur un coup de tête.
Outre ce sobre résumé, il est peu aisé d’écrire sur Affection Affection : le film part dans plusieurs sens (lire : des directions comme des interprétations), alors forcément, quand on l’aborde, on a envie de faire pareil. Construit comme un habile jeu de mots, il ne fait l’économie ni de l’humour, ni de la polysémie poétique. Géraldine, son personnage d’enquêtrice en apparence froide et cartésienne, est avant tout une éternelle abandonnée ; au centre du récit, elle est pourtant par essence un personnage secondaire, celle que les autres laissent derrière, dont la présence est superflue. Au fil des rencontres et des découvertes qu’elle fait, la narration donne toujours l’impression de danser autour du trauma et de la fracture sans en révéler les contours avec précision.
Même si la comparaison semble relever de la facilité, la page du site du FNC consacrée au film n’a pas tort de dire qu’Affection Affection rappelle Twin Peaks. Mais en dehors des similitudes manifestes — un flirt assumé avec le kitsch, une grande place taillée à l’onirisme, une galerie de personnages secondaires un peu loufoques, une enquête évanescente autour de la disparition d’une jeune fille — il me semble que c’est ailleurs que la ressemblance la plus fondamentale entre les deux œuvres apparaît. Tout comme il y avait chez Lynch cette idée omniprésente voulant que, sous la surface patinée et ordonnée des choses, se trouve la menace d’un mal rampant, toujours prêt à poindre, Matray et Walther travaillent à construire l’impression constante d’un malaise quant à l’imminent surgissement du pire.
Mais quel fléau le vernis cache-t-il ici, si ce n’est plus l’esprit de Killer Bob ? Tout au long du visionnement, on se le demande alors que le film, fluide, coule habilement entre nos doigts qui cherchent à l’agripper. Son récit se déploie comme une immense torpeur — qui n’est pas sans rappeler celle des vacanciers richissimes de la Côte d’Azur — jetée sur le monde et trouée ici et là par des cris d’alarmes : une femme morte (tuée ?) en mer, des mines antipersonnel sous le sable lisse, et la Thaïlande toujours, au loin comme un bout d’inaccessible où l’angoisse vient choir comme une vague partie de loin.
Sur les murs de la ville, des graffitis annoncent « THIS IS THE WAY THE WORLD ENDS ». Plus tard dans le film, une protagoniste, lectrice de T.S. Eliot, récitera dans toute sa longueur le vers du poème dont cet avertissement est inspiré : « This is the way the world ends / not with a bang but a whimper. » Affection Affection pourrait bien être l’une des façons les plus maîtrisées de mettre en cinéma le gémissement feutré de cette apocalypse personnelle et collective qui menace de nous avaler sans grand coup d’éclat ni protestations. (Laurence Perron)
LEVERS
Rhayne Vermette | Canada | 2025 | 92 minutes | Les nouveaux alchimistes
LE film que je voulais voir cette année au festival. D’ailleurs, j’aimerais bien que ce texte ne soit qu’une ébauche en attente d’une sortie en salle, un préambule à une exploration plus fouillée de cet objet fascinant. J’aurais aimé que le temps me permette d’y retourner, et de mieux m’imprégner de son essence semi-chimérique, de m’abreuver de son flot hypnotique, où chaque impression passagère rappelle à la fois le mystique et le quotidien. De célébrer dûment le travail d’une cinéaste manitobaine emblématique qui s’écarte légèrement du chemin tracé par son premier long métrage, l’incontournable Ste. Anne (2021), pour mieux toucher à l’essence de cette ville qu’elle affectionne tant. En effet, bien qu’elle ne manque pas ici d’étayer la mythologie de la désormais mythique Sainte-Anne-des-Chênes, Vermette mâtine la facture documentaire de son film précédent d’une structure distinctement impressionniste, en adéquation avec le potentiel d’évocation des expérimentations visuelles réalisées avec ses trois caméras brisées. On pourrait utiliser une panoplie de métaphores pour tenter de décrire l’expérience, parler d’une ethnographie onirique, d’un kitchen sink lynchéen, mais rien qui puisse vraiment rendre justice à cet effort héroïque, sensitif, pour prendre la mesure d’un lieu perdu entre le prosaïque et le cosmique, le terrestre et le divin, la piété chrétienne et le spiritisme, l’autochtonie et le colonialisme, la nature splendide et les intérieurs chaleureux, le français et l’anglais, nos deux grandes solitudes nationales. Je dirai simplement que ce fut salutaire pour moi de voir un film qui cultive si obstinément le secret, qui aborde de manière si pittoresque la persistance du colonialisme, bref, qui éclipse si artisanalement la royauté cannoise des Carla Simón et des Lav Diaz…
Le film se divise en chapitres, tous identifiés par une (ou trois) cartes d’un tarot sur mesure, qui mêle certains arcanes classiques comme LE MONDE, LA LUNE, LE JUGEMENT, LE DIABLE à des figures plus… circonstancielles, comme LA FONCTIONNAIRE, LA SCULPTRICE et LA PROVINCE, références ludiques à la Sainte Trinité de la création artistique canadienne. Au fil de ces chapitres, réunis autour d’une histoire lâche de statue municipale, se mêlent des vignettes du quotidien et une série de rituels et de gestes mystérieux accomplis par quelques personnages récurrents, mais surtout par des silhouettes morcelées, floutées par la lentille d’une caméra brisée ou auréolées par le clair-obscur d’un monde sans soleil où des menhirs tombent du ciel et où il neige à même la pellicule. Ainsi, les accidents de voiture avec des ours côtoient indistinctement les explosions solaires, les engueulades à propos des règles du crib partagent la scène avec les apparitions monstrueuses de la Vierge, invoquée grâce à l’eau bénite tirée des larmes des femmes autochtones. Des flashs impressionnistes dansent avec des images stratigraphiques baignées d’étrangeté sur pellicule texturée aux reflets rougeâtres, des travellings oniriques sur des espaces domestiques hantés se gorgent des échos d’une bande sonore incantatoire, les petites idées et les idées transcendantes s’accouplent. Tout cela en l'honneur de la glorieuse Ste-Anne, qui pourrait très bien devenir un jour notre Twin Peaks, notre Trenque Lauquen. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 18 octobre à 21h00 (Cinémathèque québécoise)

prod. Saga Film / RT Features / et al.
DRACULA
Radu Jude | Roumanie / Autriche / Luxembourg / Brésil | 2025 | 170 minutes | Les incontournables
Il y a quelque chose dans ce Dracula de Radu Jude qui nous oblige, comme ses figures vampiriques multipliées, au vacillement entre la vie et la mort, entre l’enthousiasme effronté de son enfilade de grossièretés burlesques et une certaine lassitude générée par l’accumulation ad nauseam – expression à prendre ici littéralement – de ces mêmes variations outrancières autour du célèbre suceur de sang. Logé entre le Nosferatu d’Eggers en salle l’année dernière et le Dracula de Besson encore à venir, ce dernier film de Jude, mesquin comme toujours, s’inscrit dans cette longue lignée d’adaptations pour composer une suite de sketchs obsédés par la question de la contrefaçon. Installé devant sa table, dans une petite chambre qui prend presque les traits d’une cellule carcérale, celui qui se présente comme le scénariste et réalisateur (Adonis Tanța) d’une adaptation filmique « super-commerciale » de Dracula, fait face à l’échec de la première itération du projet en demandant l’assistance d’une succession d’intelligences artificielles qui composeront tour à tour leur version du mythe.
On souhaiterait d’emblée supposer un recoupement entre le vampirisme sanguin du personnage classique et les forces de dévoration propres aux politiques fascistes et à aux systèmes capitalistes déshumanisants qui restent encore ici les objets de fascination sur lesquels s’échafaudent le cinéma de Jude. Ou encore, on devinerait l’ombre du monstre dans la pratique outrancière du vol d’images que pratiquent celleux qui programment les intelligences artificielles génératives afin de nourrir leurs banques de données. Certainement, Dracula porte en lui toutes ces lectures, et bien d’autres, mais Jude s’affaire surtout à s’emparer de la forme du trolling pour composer une matière discordante et déraisonnable d’agitation des foules. On aurait bien du mal à distinguer la trace d’un discours parfaitement cohérent dans ce projet qui conjugue sa première critique, celle de l’IA, à l’usage répété d’images générées artificiellement par une technologie déjà surannée afin de sculpter son procédé comique dans la matière même d’une esthétique de l’hybridité grotesque et de la laideur.
Il s’agit également de proposer un certain retour au domicile de ce vampire transylvanien dont l’inspiration, la cruelle figure historique de Vlad Țepeș l’Empaleur, sert à rejouer l’ambiguïté d’une culture nationale roumaine qui s’affaire à l’ériger en culte marchand : visite au musée de l’empalement, vente d’icônes de l’égérie proto-vampirique, spectacles cheaps et lugubres rejouant la fascination touristique en plaçant dans les mains des spectateur·ice·s les pieux en attente de transpercer les corps des interprètes. Jude tire ainsi toute son énergie contestatrice en puisant dans une certaine pratique de l’amoralité dont la force de subversion se mesurera finalement à la capacité de chacun·e à supporter ses blagues phalliques de vieux bonhomme, qui renvoient tout autant à l’ouverture d’un érotisme contestataire de toute tentative de fixation du discours juste qu’au sentiment d’être emprisonné aux côtés d’un mononcle à la parole un peu trop leste. Le Dracula de Jude s’avère finalement un film fleuve et diffus qui contraste parfaitement avec l’excès de clarté que représente son Kontinental ‘25 également présenté au FNC cette année, et si la rencontre des deux films nous rappelle que le réalisateur conserve le cœur à la bonne place, c’est peut-être finalement pour nous indiquer l’endroit précis où la morsure devrait l’atteindre. (Thomas Filteau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 17 octobre à 18h30 (Cineplex Quartier Latin)

prod. 185 FIlms / Haut Les Mains / et al.
A USEFUL GHOST
Ratchapoom Boonbunchachoke | Thaïlande | 2025 | 130 minutes | Compétition internationale
La prémisse du premier long métrage de Ratchapoom Boonbunchachoke est irrésistible : une femme, morte après avoir inhalé de la poussière industrielle, revient hanter son ancien mari en s’installant dans une balayeuse. Un bien joli appareil, d’ailleurs, d’un rouge tapant et d’une forme doucement futuriste, qui peut se déplacer seul, parler et caresser la peau avec ses brosses et ses tuyaux. Au départ, l’idée apparait comme une métaphore des relations queer, alors que la famille du mari accepte mal que sa compagne soit une balayeuse, mais peu à peu d’autres formes de fantômes se manifestent et le propos se déplace vers une critique du capitalisme (un ouvrier mort en usine revient hanter son lieu de travail) et du gouvernement (le massacre de 2010 en Thaïlande est mentionné à quelques reprises). Si le titre prend son sens par la question, ironique, à savoir comment un spectre peut être « utile » à la société, aux entreprises, à l’État, le film y répond en le présentant comme une possibilité de résistance au pouvoir. Par le fait même de son existence, le revenant représente un défi à la mort, aux conventions ; il nous dit que l’ordre soi-disant « naturel » des choses ne l’est pas (il est tentant d’y voir une filiation avec Apichatpong Weerasethakul, même s’il s’agit d’un cinéma fort différent).
En fait, A Useful Ghost a toutes les allures d’un buffet cinématographique, avec des changements de ton et de genre, des détours de récits surprenants, des trames narratives qui s’enchâssent les unes dans les autres. La mise en scène s’apparente à celle d’un Roy Andersson, avec des cadres frontaux soulignant l’absurde et des interprétations plutôt impassibles, mais s’en distingue par ses couleurs chaleureuses. Cela sert bien la veine comique de la première partie du film, mais pas la seconde, plus lourde, alors que cette esthétique nous maintient à distance des personnages, renforçant l’impression qu’ils sont déterminés par leur signification thématique. Le plaisir se perd peu à peu, à mesure que disparaissent les histoires d’électroménagers possédés, et le discours devient aussi appuyé que confus, à force d’accumuler les couches de signification. Dommage, car il y a une belle ambition dans ce premier effort, mais Boonbunchachoke semble finalement plus préoccupé par le potentiel formel de ses nombreuses idées, ce qui nous empêche de nous réjouir franchement devant cette fantaisie pourtant savoureuse d’une révolution des spectres contre la classe dominante. (Sylvain Lavallée)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 17 octobre à 18h00 (Cineplex Quartier Latin)
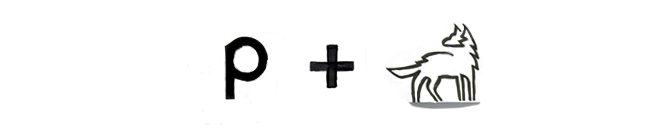
Partie 3
(L'arbre de l'authenticité,
Wrong Husband,
Desire Lines, Romería,
Ariel, Dead Lover)
Partie 4
(Blue Moon, Magellan,
Two Prosecutors,
Father Mother Sister Brother,
Planètes)
Partie 5
(Sound of Falling,
Affection Affection,
Levers, Dracula,
A Useful Ghost)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
