
prod. Les Productions Kinesis inc.
FESTIN BORÉAL
Robert Morin | Québec | 2023 | 75 minutes | Les nouveaux alchimistes
Il est dur de déterminer si Robert Morin a perdu foi en l’humanité ou s’il ne s’intéresse désormais qu’à des sujets qui la transcende. C’est du moins le genre de questionnement que provoque le changement de paradigme qui caractérise son cinéma depuis les dernières années. Après Sept paysages (2022), qui délaissait les panoramas (sub)urbains qui avaient fait la renommée de son auteur et repoussait les êtres humains en périphérie du monde naturel qui lui servait de sujet, Festin boréal poursuit dans la même veine, s’imposant comme une œuvre contemplative attachée à l’écosystème forestier et au cycle des saisons. S’articulant autour d’une vague narration de la prédation, celle-ci s’intéresse néanmoins toujours à la subjectivité individuelle, à l’instar des premiers tapes existentiels du réalisateur, sauf qu’il s’agit ici d’une subjectivité animale, laquelle évoque bientôt un devenir-animal, mais surtout un devenir-décédé, un devenir-festin. Avec son manque de subtilité et sa perspicacité désinvolte de toujours, Morin interroge ainsi la finalité de la mort, mais surtout le rôle des humains dans le dérèglement du cours naturel des choses.
Le film débute avec un plan de drone caressant sur un bois embrumé, que complète une série d’images au sol dignes du National Geographic. Parmi celles-ci, on ne manque pas d’apercevoir un bout de bois d’élan accoté contre une racine, présage du massacre à venir… On s’intéresse ensuite aux animaux (tortues, oiseaux, ours, loups) avant de s’arrêter sur un autre élan, vivant cette fois, qui se promène majestueusement parmi les arbres. L’atmosphère du film est alors sereine, presque anesthésiante. Puis soudain, une flèche vient se loger dans le flanc de l’animal et le montage s’affole, multipliant les plans subjectifs de la bête paniquée, qui fuit la scène avant de s’effondrer au sol et mourir. Elle devient alors le festin titulaire, mais pour la faune locale, et non pour le chasseur de trophée qui l’a abattue ; on n’apercevra d’ailleurs celui-ci que quelques jours plus tard, alors qu’il vient vomir à côté de la carcasse puante, puis mesurer la longueur des bois et prendre un égoportrait triomphant devant sa proie. Le reste de l’œuvre s’intéresse au lent processus de décomposition du cadavre, saison après saison, mais surtout à la sociologie des charognards (vautours, coléoptères, mille-pattes, asticots, ours et loups) venus lutter pour leur portion de la dépouille — on a même droit à des prises de vue à l’intérieur de celle-ci, où s’introduit une belette pour venir grappiller quelques bouts de chair durant l’hiver.
À l’instar des Sept paysages, Festin boréal est un film méditatif, spirituellement prosaïque, que le montage dynamise pourtant beaucoup, nous laissant néanmoins le temps de réfléchir amplement à l’existence, mais surtout à la beauté d’un cycle où la mort crée la vie, tel qu’en témoignent la présence de toute cette gent nécrophage que la photographie somptueuse et la prise de son saisissante animent glorieusement. Il nous confronte à la laideur également, celle des hommes et de leurs machines de mort. Outre celle d’un chasseur de peaux autochtone, qui passe en motoneige et vient rendre hommage à la carcasse de l’élan — seules les Premières Nations sont encore dignes de confiance semble dire Morin — toute irruption de l’humanité dans le cadre est toujours violente et perturbatrice. Entre le spectacle de la décomposition de la bête et les plans d’aurore boréale qui closent le film, une séquence bée d’ailleurs comme une plaie. On y voit des porteurs et des abatteuses mécaniques venant déchiqueter et malmener les arbres de la forêt. Or, il s’agit sans doute là d’une violence nécessaire, comme le choc de la flèche du début, question de mieux apprécier l’expérience sereine d’une décomposition qui n’aurait pas été précipitée par l’appât du gain ou de la gloire. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 15 octobre à 18h30 (Cinéma Moderne)

prod. DKB Productions / Socco Chico Films
INDIVISION
Leïla Kilani | France / Maroc | 2022 | 127 minutes | Compétition internationale
Indivision suit une intrigue immobilière se déroulant au Maroc, qui nous est racontée à travers le regard d’une enfant de treize ans fascinée par les oiseaux, Lina (Ifham Mathet). La famille Bechtani possède un immense domaine dans la forêt de Mansouria qui est dans la mire d’un promoteur immobilier. Ses membres ont ici une décision à prendre : vendre le domaine et accéder à une fortune ou rester sur la terre patrimoniale. Voilà ce qui divise le clan. La prémisse s’annonçait poétique et féconde — on sent tout le potentiel ici de réfléchir à l’ascenseur social, aux racines, à l’héritage, au rapport à la nature et à l’écosystème, à la délinquance des investisseurs étrangers, à la dialectique campagne-ville, etc.
Mais il n’en est rien. Le monologue intérieur de Lina — personnage qui a fait vœu de silence après le décès de sa mère — manque peut-être justement de silence, de trous, de rêveries. Sa narration est candide, dans le sens de kitsch, et agace dès les premières minutes. Ça ne s’améliore pas avec le temps, car une grande part de l’intrigue est vue à travers la caméra de Lina, influenceuse qui a des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi, de nombreuses séquences familiales nous sont rapportées à travers le cadre peu esthétique de cet écran, tandis que s’y surimposent des encadrés de textos qui nous lassent dès les premiers instants. Ce choix de mise en scène interroge et montre combien il est difficile de problématiser la question de la virtualité de nos rapports dans les œuvres cinématographiques sans y laisser une grande part de poésie.
Enfin, l’écueil principal d’Indivision réside à mon sens dans le fait que cette œuvre s’échine à raconter plutôt que montrer, à expliquer plutôt que suggérer, au point qu’on se sent à notre tour infantilisé comme spectateur. La puissance du cinéma n’est-il pas de laisser les images parler d’elles-mêmes, de former des tableaux qui évoquent et suggèrent à travers les corps, les silences, la juxtaposition des plans ? Or, Leïla Kilani accorde ici une trop grande importance au texte, et les nombreux dialogues, auxquels s’ajoute le monologue intérieur de Lina, en viennent à étouffer l’œuvre. Et ce malgré les quelques beaux plans de la Mansouria et le jeu du père (Mustafa Shimdat), qui exhausse un peu le tout, dans cette œuvre qui a parfois des airs de théâtre filmé. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 8 octobre à 17h45 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)

prod. Quijote Films / Rei Cine / et al.
THE SETTLERS (LOS COLONOS)
Felipe Gálvez | Chili / Argentine / France / Danemark / Royaume-Uni / Taïwan / Allemagne / Suède | 2023 | 97 minutes | Compétition internationale
J’avais un bon feeling à propos du film. La bande annonce est assez excitante, malgré le nombre alarmant de pays impliqués dans la production. Mais le programme aurait pu mieux me le vendre. Il suffisait de dire qu’il s’agit d’un western historique (plutôt qu’un drame historique qui joue avec les codes du western), mais surtout qu’on y voit Mariano Llinás en arpenteur pédophile (une version perversement romancée du célèbre scientifique argentin Francisco Moreno). Parce que c’est vraiment d’un western dont il s’agit ici, avec ses grands panoramas pittoresques de nature patagonienne et ses gros visages rugueux, intenses, suants, rougeoyant à la lumière du feu crépitant, sa violence raciste écœurante, son machisme tonitruant, ses cowboys, ses « indiens » et son riche propriétaire terrien (José Menéndez, responsable du génocide des Selk’nam). On a même droit à un soldat écossais (le tueur d’autochtones notoire Alexander MacLennan), qui servira ici de point focal, malgré l’attention portée latéralement à l’un de ses subalternes onas, Segundo, qui lui survivra heureusement, question d’être mieux instrumentalisé par les fondateurs de la nation chilienne, un pays fondé dans le sang nous rappellera-t-on… un peu comme le nôtre.
Le film se déroule au tout début du 20e siècle, dans la Terre de Feu, sur la pointe méridionale du Chili, ainsi que de l’Argentine. MacLennan est alors mandaté par Menéndez pour trouver un passage vers l’Atlantique pour ses moutons, mais aussi pour faire le ménage parmi les autochtones locaux, dont les terres lui ont été cédées par le gouvernement chilien. Pour son expédition, le rustre à la tunique rouge prendra avec lui un jeune métis, guide et tireur habile, de même qu’un cowboy texan, Bill, qui se méfie d’emblée du perfide sang-mêlé et du Britannique chiant avec qui il est forcé de chevaucher. Les tensions entre les trois hommes ne feront que s’accentuer au gré des rencontres : celle avec un détachement argentin chargé du balisage des frontières, avec qui ils devront boxer « amicalement » sous une musique orchestrale haletante ; celle avec un groupe d’autochtones paisibles, qu’ils massacreront avec une violence alternativement stylisée et troublante ; et celle avec la bande du Colonel Martin, un officier écossais inquiétant qu’ils rencontreront aux confins du monde. Le dernier chapitre délaisse la nature sauvage pour les intérieurs cossus du manoir de Menéndez à Punta Arenas, où ce grand seigneur du massacre sera forcé de discuter de l’héritage sordide de MacLennan avec un intellectuel nationaliste venu de la capitale.
Si le film s’inscrit dans le genre western, c’est aussi, et surtout, pour la place centrale qu’il accorde au thème de la frontière. Le récit débute d’ailleurs avec le bruit du métal qui se déploie pour former des clôtures autour des terres de Menéndez, puis par le spectacle de la violence anthropophage (du son, du montage, des images gore) qu’implique la pose de ces clôtures, alors qu’un homme se tranche le bras dans le processus, avant d’être sommairement exécuté par MacLennan, qui déclare : « Un homme sans bras ici est comme un homme en moins. » Et s'il interroge la violence que représente la frontière entre la propriété publique et privée, l’œuvre fustige également celle qui existe entre les races — « Regardez la délicatesse de ce crâne », prescrit le personnage de Llinás en caressant son gigolo autochtone, juste avant de se retirer dans ses quartiers avec lui — mais aussi entre les nations — « Tu n’es pas un Britannique, mais un Écossais », crie un Colonel Martin homicide en écumant, après qu'on l'ait qualifié de « digne Anglais ». Le résultat est un film qui est à la fois magnifique, troublant, pervers, excitant, instructif et fascinant, où la beauté côtoie constamment l’horreur, où la violence entache la quiétude sereine des lieux, dans un portrait cruellement lucide de l’épopée génocidaire que constitue la genèse de l’Amérique. (Olivier Thibodeau)
Prochaine projection : 11 octobre à 18h15 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 11)

prod. Limerencia Films
TÓTEM
Lila Avilés | Mexique / Danemark / France | 2023 | 95 minutes | Compétition
« Le temps est cyclique dans la culture mésoaméricaine » dira l’une des invitées à la fête (d’adieu) de Tona, un jeune peintre atteint d’un cancer en phase terminale, et cela réfère en quelque sorte à l’essence du film, qui s’affaire à tresser une boucle aérienne entre la vie et la mort, qu’il fait cohabiter dans un espace chaleureux, mais fragile, où règne l’entraide et la camaraderie familiales. Le drame s’avère ainsi touchant, sans être sirupeux, profitant d’un réalisme émotionnel et esthétique (gracieuseté d’une caméra à l’épaule intimiste) qui sonne toujours juste. Concentré lors d’une seule journée, du matin au crépuscule, durant laquelle se déroulent les préparatifs frénétiques, puis la fête en l’honneur de Tona, le récit du film privilégie d’abord la perspective infantile, celle de Sol, sa fille (adorable Naíma Sentíes), une enfant curieuse, et anxieuse de revoir son père, qui s’est cloîtré pour qu’elle n’ait pas à assister au spectacle de sa déchéance.
L’œuvre nous place initialement dans une posture exploratoire à l’égard d’un monde qu’on découvre avec candeur, où les questionnements naïfs à propos de la mort (« Papa va-t-il mourir ? », « Quand est-ce que va se produire la fin du monde ? ») ne parviennent jamais à sectionner le lien direct à la vie que tisse le film, celui d’une famille (qui essaime dans la grande maison où sont réuni·e·s pour l’occasion frères et sœurs, tantes, nièces, cousins et grands-parents), mais aussi celle de la faune locale (les bêtes se multiplient à l’écran : fourmis, chats, limaces, chiens, mantes, perroquets et scorpions servent tous à évoquer de façon vaporeuse l’atmosphère du moment). L’utilisation judicieuse d’un espace de tournage restreint, qui se décline dans une variété impressionnante de décors d’apparence singulière, permet alors d’évoquer un univers qui nous dépasse, un univers où il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. La diégèse se présente conséquemment comme un monde de cloisons, moins carcéral qu’invitant, où on frappe à la porte pour qu’on nous ouvre, où on se tient dans l’embrasure pour écouter les adultes et découvrir leurs secrets, où on franchit le seuil pour s’immiscer à de nouvelles réalités (celle du vin, notamment, qui goûte comme le sang). Le film nous propose en somme l’expérience de la vie en germe, qui s’épanouit devant nos yeux (celle de Sol), puis se flétrit dans le personnage de Tona, dont la douleur est palpable, dont la maigreur est cadavérique, dont le parcours laborieux à la rencontre de ses pairs se fait sentir de manière épidermique, et dont l’expression finale, à la croisée de la joie et de la tristesse démontre parfaitement l’émotion ambiguë que le film vise à nous faire ressentir face à tant d’amour déployé pour conjurer l’avancée inexorable de la mort.
Tótem est un film sur le « care », mais plus largement sur le caractère réconfortant, tactile, parfois abrasif, mais toujours vibrant de la proximité interpersonnelle. C’est un film dont la texture même évoque l’essence de l’humanité, dont on ressent chaque heurt microscopique comme une déflagration, chaque questionnement comme un exercice métaphysique transcendant, chaque caresse comme une étreinte chaleureuse, chaque étourderie comme une charmante errance, chaque démonstration d’amour comme un rempart contre l’oubli, tel que démontré par la peinture que livre Tona à sa fille, et qui contient une représentation de tous ses animaux préférés. Tótem, c’est un film de maisonnée, où l’on s’immisce moins comme un invité que comme un témoin privilégié de ce que peut constituer une humanité maillée, à la vie, à la mort. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection : 10 octobre à 20h00 (Cinéplex Quartier Latin - Salle 12)
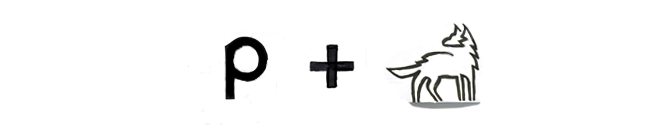
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
