
prod. MLC Productions / Camera Chaos
TIE MAN
Rémi Fréchette | Québec | 2024 | 99 minutes | Les fantastiques week-ends du cinema québécois
Il y a de ces films qui semblent avoir été écrits pour Fantasia, comme ce Tie Man avec son justicier qui se promène dans les rues de la ville, le visage caché par un rideau de cravates que des criminels lui ont agrafé au front en voulant le tuer. Accompagnés de son père, sorte de marionnette-zombie qui gratte sa guitare pour chanter les aventures du héros, et d’une policière borgne qui cherche à venger sa famille, iels essaient ensemble d’arrêter un riche entrepreneur qui compte s’emparer de la mairie en remplaçant les commerçant·e·s par des clones sous ses ordres. On comprend le ton, plus proche d’un Toxic Avenger que d’un blockbuster de superhéros, autant pour le gore juteux, l’humour vulgaire et irrévérencieux, que pour l’absence de moyens. Car si une telle prémisse peut indiquer une production de grande envergure, en réalité Tie Man a été tourné en quelques jours pour un budget minime, financé par Frissons TV. Initialement diffusé en six épisodes, le cinéaste, Rémi Fréchette, a remonté et retravaillé le matériel en postproduction pour en faire un long métrage qui, même s’il conserve sa structure épisodique (qui convient bien au matériel), se tient comme un tout autonome.
C’est l’inventivité et la débrouillardise que l’on a d’abord envie de saluer devant un tel film, qui est parfaitement conscient de ce qu’il est et travaille ses limites pour en tirer le plus d’expressivité, souvent par l’humour, comme pour ce délicieux doublage volontairement maladroit, ou ces décors mélangeant écrans verts et maquettes. Le projet est casse-cou, dans la mesure où il pourrait facilement se résumer à une blague de cégépien qui n’aurait pas dû être ressuscitée, mais Tie Man assume parfaitement son esprit collégial, qu’il traite avec un savoir-faire artisanal réjouissant. Alors le récit maintient son intérêt sur la durée, en introduisant régulièrement de nouvelles idées (sans doute aidé en cela par sa structure sérielle initiale) et en nous surprenant par sa capacité à créer un univers visuel original et cohérent à partir de rien. Si les scènes d’action et l’ultraviolence sont plutôt réussies, il reste que c’est l’humour qui marche le mieux, les dialogues ridicules qui parodient les tropes du genre et les situations absurdes qui exploitent la nature risible d’un héros masqué de cravates. Il faut dire aussi que c’est le genre de film qui gagne à être présenté dans un contexte de foule, en particulier celle de Fantasia, pour bien en rehausser la folie par celle du public, pour accueillir chaque trouvaille par des applaudissements nourris et des éclats de rire, dans une célébration commune du cinéma de genre. (Sylvain Lavallée)
BUFFET INFINITY
Simon Glassman | Canada | 2025 | 99 minutes | Septentrion Shadows
Dans la petite ville de Westbridge, un nouveau commerce vient d’ouvrir ses portes. Situé dans le complexe commercial de Highway 1, Buffet Infinity est un restaurant All You Can Eat qui vient faire compétition aux commerces du coin, notamment le comptoir de sandwichs familial de Jennifer Joy Avery. Formellement construit comme une séance de zapping sur télé cathodique, les plans de Buffet Infinity se succèdent comme autant de contenus télévisés qui alternent entre extraits fictifs d’infomercials, de journal télévisé et de prêches télévangélistes. À travers ce foisonnement, il nous appartient de grapiller les éléments grâce auxquels construire progressivement une intrigue aussi inquiétante que diffuse. Tandis que Buffet Infinity et Jennifer’s Sandwiches se livre une bataille par pubs interposées en bonifiant sans arrêt leur offre respective, des enfants disparaissent massivement, d’étranges sons parasitaires polluent la tranquillité d’esprit des résident·e·s, et un cratère sur le parking du centre commercial ne cesse de s’agrandir. Petit à petit, le buffet dévore tout : d’abord les magasins avoisinants avec son modèle d’affaire agressif, puis l’espace médiatique, et la surface de l’écran. À terme, il avalera la liberté d’expression et de pensée, la psyché des consommateurices, la réalité même.
Choisir de regarder Buffet Infinity, c’est accepter qu’on court le risque d’être déçu·e. L’idée d’un long métrage de 1h45 composé exclusivement de fausses publicités a quelque chose d’excitant. C’est aussi un pari facile à perdre. Et donc d’autant plus gratifiant à remporter. Malgré quelques longueurs (le film pourrait bénéficier d’un resserrement qui ne porterait aucun préjudice à son déroulement), l’exercice mené par Simon Glassman ne tombe ni dans le piège de la méta-référence intello pompeuse, ni dans le piège du plaisir un peu trop onaniste de celui qui se fait rire tout seul. L’exercice n’est pas parfait mais il est certainement réussi.
Buffet Infinity a pour prémisse cette hantise que la dimension prédatrice de la publicité se littéralise sous nos yeux en un ogre concret nous dévorant réellement. Les publicités fictives qu’on y voit sont au départ de facture amatrice (elles rappellent celles de la télévision communautaire) et, petit à petit, deviennent de plus en plus lisses, formatées, professionnelles ; comme si une intelligence émergente était en train de se perfectionner sous nos yeux, que la conscience qu’elle développait s’affinait en vue de mieux comprendre sa proie. On trouve dans Buffet Infinity un discours sur le capitalisme rampant, le contrôle idéologique que les vainqueurs du libre-marché exercent sur l’organisation politique du monde, la bataille tordue et violente entre la capture des désirs par l’économie et la promesse évangéliste d’une transcendance collective. Tout le cauchemar de l’Amérique y est concentré, et on peut se le procurer pour quatre paiements faciles de 9,99$. Glassman arrive à construire sa narration comme un symptôme, comme quelque chose qui surgirait par mégarde, un lapsus non intentionnel que le surmoi publicitaire aurait laissé glisser dans le champ du discours, hors de sa boue libidineuse. Grâce à son exercice de style, il parvient à exacerber ces angoisses de manière très manifeste et très oblique simultanément. (Laurence Perron)
Prochaine projection : 28 juillet à 21h25 (Cinéma du Musée)
THE WOMAN
Hwang Wook | Corée du Sud | 2025 | 101 minutes | Cheval Noir
Hwang Wook prolonge son intérêt pour les glissements de ton et les zones d’étrangeté dans le quotidien, amorcé notamment dans Mash Ville (2023), faux western contemporain où l’absurde déborde sur un réel décalé. Le cinéaste entretient une forme de trouble que The Woman poursuit dans un cadre plus narratif et domestique. Le film s’inscrit dans la lignée des thrillers coréens — notamment Mother de Bong Joon-ho (2009) — tout en en déformant les codes jusqu’à l’excès, dans un emballement formel qui intensifie la tension psychologique jusqu’à flirter avec une forme de farce ambiguë.
Lorsque Sun-kyung récupère un aspirateur gratuit auprès d’un inconnu via une application, elle lui offre en retour un paquet de fraises. Un échange en apparence anodin, jusqu’à ce qu’un ami brièvement présent soit retrouvé mort, faisant basculer la scène dans une zone incertaine entre malaise social et soupçon de crime. La protagoniste, à l’image du film, incarne une figure floue, borderline, entre héroïne de thriller et anti-héroïne de satire noire.
The Woman repose sur un jeu de retournements où le doute s’installe dès les premières scènes. Ce flottement entre drame et incongruité rend le film à la fois fascinant, irritant et inclassable. Objet surchargé, où chaque geste devient louche, la tension naît du dérèglement des codes sociaux et perceptifs — comme si le quotidien lui-même tournait à la comédie anxiogène. Parler comme injurier devient inquiétant, manger, obscène ou dégoûtant, chaque interaction engendre le malaise : de l’entretien professionnel loufoque aux fraises sanglantes dévorées comme un rite cannibale.
Le film emprunte les codes du thriller psychologique, sans réelle assiduité, et l’enquête progresse sur un mode instable, se délite dans un climat suspicieux, avec une causalité bancale et des suspects caricaturaux. La majorité des scènes, dans leur grotesque outrancier, déclenchent un ricanement perplexe, car le second degré n’est jamais explicité. Ne sachant pas, rit-on avec le film ou dans le malaise qu’il provoque ?
En contraste avec la densité du propos, le cinéaste opte pour un minimalisme visuel qui recentre l’attention sur l’expressivité des corps et des visages. Ce dépouillement, loin d’apaiser la dynamique, accentue l’ambiguïté : en l’absence de repères narratifs clairs, chaque geste renforce le sentiment d’étrangeté. Par un cadrage simplifié, l’usage de regards caméra indirects dans les séquences dialoguées en champ-contrechamp et une caméra à l’épaule nettement instable, il capte les micro-mouvements accentuant un déséquilibre latent. Plan après plan, ce dispositif construit un climat dramatique porté par la seule force des affects choisis.
Présenté comme un thriller haletant — ce qu’il est à sa manière — le film semble croire en son propre dispositif dramatique, sans assumer ses effets secondaires. Le suspense bascule dans l’invraisemblance, tout en entretenant le doute : Wook joue-t-il avec les codes de façon contrôlée ou s’enfonce-t-il dans ses propres effets ? S'agit-il de maladresses, ou d’une œuvre critique sabotant délibérément ses propres ressorts ? Le film ne tranche pas — tout comme les œuvres précédentes de Wook, qui jouaient avec l’absurde, d’une manière qui semblait assumée pour certain·e·s, dissonante pour d'autres. Peut-être est-ce là son geste le plus singulier : maintenir cette incertitude.
Et si The Woman est un film raté — au sens noble de l’échec fertile —, il est peut-être si décalé qu’il atteint, malgré lui ou à dessein, une forme de réussite critique, instable et singulière, puisant sa force dans cette ambivalence. C’est le trait le plus intriguant de The Woman : Hwang Wook ne cligne jamais de l’œil. Il laisse le spectateur seul face à l’aberrant, dans l’inconfort — comme un Dupieux déréglé se prenant (presque) au sérieux. Ce n’est pas tant un récit à suspense qu’un dispositif flottant, carnavalesque, où la vérité et l’intention comptent moins que le spectacle trouble qu’elles produisent. (Anne Marie Piette)
Prochaine projection : 28 juillet à 14h40 (Salle J.A. De Sève)

prod. Mostra Cine / Ajimolido Films / et al.
THE VIRGIN OF THE QUARRY LAKE
Laura Casabé | Mexique, Argentine, Espagne | 2025 | 90 minutes | Sélection 2025
Adapté de deux nouvelles —« La virgen de la tosquera » et « El carrito »— tirées du recueil Los peligros de fumar en la cama (2009) de l’autrice argentine de récits d’horreur intriqués de réalisme magique Mariana Enriquez, The Virgin of the Quarry Lake propose une incursion à la fois charnelle et politique dans l’horreur, où le surnaturel révèle la brutalité du quotidien.
Nous sommes en banlieue de Buenos Aires, à l’été 2001, quelques mois après l’Argentinazo, l’un des moments les plus violents des révoltes populaires de la crise économique qui ravagea l’Argentine et sa population de 1998 à 2002. Alors, l’itinérance atteint des sommets, les actes de vandalisme deviennent coutumiers, les pannes de courant quotidiennes et la tension entre citoyens pour le moins inquiétante. Malgré la précarité et l’instabilité engendrées par la dépression, Nati (Dolores Oliverio), Josefina (Isabel Bracamonte) et Mariela (Candela Flores) comptent bien profiter de la saison estivale pour s’amuser et notamment, pour perdre leur virginité. Comme les cigales dont le chant hypnotique nous immerge dans la moiteur de l’été, Nati, la leader du groupe, redouble d’ardeur et se languit de donner libre cours à sa passion pour Diego (Augustín Sosa), ami de longue date avec qui elle a récemment développé une relation romantico-sexuelle. Dès les premiers plans du film, Casabé insiste sur la frustration, la colère et la souffrance de Nati qui voit malencontreusement ses plans contrecarrés alors que son crush se rapproche de Silvia (Fernanda Echevarría), une femme un peu plus âgée que le reste du groupe, rencontrée sur le chat ICQ. Alors, la colère de Nati ne connaîtra plus de limite. Elle ira même jusqu’à invoquer la sorcellerie pour se débarrasser de sa rivale. En convoquant une sorcellerie populaire, l’héroïne ne fait pas qu’exprimer son désarroi : elle rejoue, à sa manière, les gestes d’une revanche symbolique contre une société qui ne lui offre d’autre arme que son corps adolescent.
Casabé filme l’adolescence dans ce qu’elle a de plus incandescent, de plus trouble aussi : un sentiment d’injustice qui cherche son objet, un désir en mal d’actualisation. La caméra reste au plus près des visages, des peaux, des souffles. À la manière de Lucrecia Martel dans La niña santa (2004), Laura Casabé privilégie la frontalité des plans rapprochés pour traduire l’intériorité de ses personnages, sans jamais passer par une psychologie trop évidente. Le hors-champ sonore — stridulations, halètements, craquements — devient quant à lui un vecteur d’inquiétude, un canal d’affects investi avec précision. Autre point commun avec Martel : dans The Virgin of the Quarry Lake, les adultes sont absents ou inopérants, démissionnaires ou dépassés — la mère de Nati l’a abandonnée pour s’exiler en Espagne, un voisin tabasse, presqu’à mort, un pauvre itinérant, le conjoint de sa grand-mère ne peut se passer de lui servir des discours convenus sur l’amour tout en lui rappelant que les garçons n’aiment pas les filles troublées, ce qui permet à la cinéaste de créer un univers où la réalité et la sensibilité adolescente priment et ne sauraient être réprimées.
Malgré la richesse de cette proposition esthétique, le film n’échappe pas à certains travers narratifs. La rivalité entre Nati et Sylvia, moteur du récit, demeure en grande partie enfermée dans un imaginaire stéréotypé de la jalousie féminine. La figure de la « rivale » — plus âgée, mystérieuse — ne bénéficie jamais du même soin d’incarnation que l’héroïne, et peine à échapper au rôle de catalyseur de l’hostilité adolescente. Là où on aurait pu espérer une subversion ou un déplacement de ce trope, le film le reconduit plutôt, sans mise à distance ni renversement, en maintenant les femmes dans une rivalité centrée sur le regard masculin. Par ailleurs, le scénario de Benjamin Neishtat laisse en suspens les personnages de Josefina et Mariela, réduites à des fonctions périphériques — complice silencieuse ou faire-valoir — alors même que leur inclusion dans le trio initial laissait espérer une exploration plus collective de l’adolescence féminine. Quant à Diego, pivot de l’intrigue, il demeure une figure fantomatique, vaguement érotisée, jamais interrogée dans sa propre position de pouvoir ou de désir. Cette construction lacunaire affaiblit par moments la portée politique du récit, en recentrant le conflit sur des dynamiques relationnelles genrées et profondément stéréotypées.
Ces limites n’annulent pas les qualités du film, mais elles en balisent les angles morts. Elles rappellent aussi que les récits d’initiation — même lorsqu’ils s’ancrent dans les marges ou adoptent des formes hybrides — ne sont pas exempts de redites ou de conventions à questionner. Reste que l’ambiance trouble, la puissance suggestive de la mise en scène et la performance des acteurs confèrent à The Virgin of the Quarry Lake une force singulière : celle d’un conte horrifique originalement enchevêtré de critique sociale. (Frédérique Lamoureux)
Prochaine projection : 2 août à 21h35 (Salle J.A. De Sève)
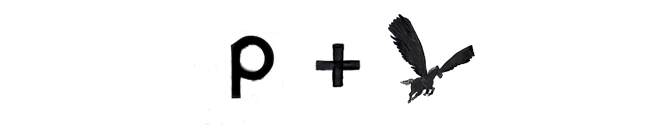
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(Occupy Cannes, Queens of the Dead,
Lurker, $POSITIONS, LifeHack, Stuntman)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
