EVERY HEAVY THING
Mickey Reece | États-Unis | 2025 | 89 minutes | Underground
Le plaisir que procure le cinéma de Mickey Reece est difficile à exprimer. Au gré d’une filmographie protéiforme de plus de vingt films, le cinéaste entretient une œuvre unique, mais quelque peu insaisissable dans le panorama du cinéma régional américain, où les films sont souvent autant de prétextes à aborder diverses influences et esthétiques sans se cantonner à aucune : le souvenir du Nouvel Hollywood qu’évoquent les portraits d’homme esseulés de Country Gold (2022) ou encore Alien (2017), au sujet d’Elvis Presley ; le huis clos bergmanesque Strike, Dear Mistress, and Cure His Heart (2018) ; le nunsploitation Agnes (2021) ou encore la Jean-Rollinade qu’était Climate of the Hunter (2019).
Avec Every Heavy Thing, ce sont les dérives technocratiques contemporaines que Reece cherche à métaboliser, au fil d’une écriture comique surannée qui se place dans un contrepoint ironique aux airs sérieux que suggèrent le thriller paranoïaque et l’esthétique cyberpunk ici empruntée. Campé à Hightown City et Lowtown City, villes fictives de l’Oklahoma, son récit est cependant loin des années 1970 ressuscitées ailleurs. On est plutôt face à un imaginaire de la fin des années 1990 — on pense à des films érotiques comme Sliver (1993) ou Sixteen Tongues (2003), voire même à The Matrix (1999) — et donc à une production culturelle tournée vers l’avenir qui tentait déjà de mettre en garde contre un capitalisme psychopathe et dévorant.
Notre héros lambda Joe (Josh Fadem) semble issu de cette époque au bord du précipice : il travaille au pupitre des publicités du « dernier journal hebdomadaire alternatif au pays » et bien qu’il ne veuille pas faire de vagues, il se retrouve malgré lui impliqué dans un sombre complot lorsque plusieurs femmes disparaissaient aux mains d’un tueur invisible dont il sera le témoin. S’ensuit un récit déambulatoire où se chevauchent plusieurs idées et thèmes qui ne s’harmonisent jamais tout à fait, mais qui contribuent à la texture doucement anachronique de la chose. Une logique cauchemardesque s’empare de la vie du protagoniste et les dialogues voguent d’idée en idée : la déresponsabilisation de l’individu, l’hétéronormativité, l’arrivée de technologies invasives comme la réalité virtuelle ou le Neuralink, le conservatisme américain…
Les tropes sont familiers, mais déconstruits avec irrévérence — c’est la marque de fabrique de Reece, s’il y en a une — et son film nous place dans une posture où tout est possible : sous intrigues en queue de poisson, surenchère de personnages secondaires loufoques et attachants (Barbara Crampton et Vera Drew viennent faire un tour) et deus ex machina absurdes : autant de scènes reliées par des effets de montage appuyés (division de l’écran, glitch art) et des jeux d’éclairage expressionnistes compensant pour la pauvreté relative de la production. C’est cet élan et cette liberté qui rappellent pourquoi on retourne, année après année, vers le cinéma de Mickey Reece, qui ne laisse jamais présager ce qui suivra. (Ariel Esteban Cayer)
Prochaine projection : 23 juillet à 14h30 (Salle J.A. De Sève)
LUCID
Deanna Milligan et Ramsey Fendall | Canada | 2025 | 120 minutes | Septentrion Shadows
Mia travaille à temps partiel dans une chaîne de restauration rapide tandis qu’elle peine à payer et réussir ses études en arts visuels. Dénigrée par son professeur (sorte de figure mi-pygmalion mi-Foucault) et méprisée affectueusement par ses camarades de classe, elle est en panne d’inspiration et échoue à « trouver sa voie ». Pour pallier ce manque, elle quémande l’aide de Syd (sorcière interprétée par l’exquise Vivian Vanderpuss) et de ses mixtures. Lucid est le nom de la drogue (présentée sous forme de cœur en sucre) que cette dernière lui prescrit pour surmonter ses problèmes. Mais Syd est claire : pour arriver à débloquer sa force créative, Mia devra d’abord affronter les traumas oubliés de son enfance (spoiler : il y a de l’hypnose, des abandons, de la violence conjugale et des hippies meurtriers dans sa généalogie familiale).
Le jeu des acteurices, le dynamisme de la caméra, l’esthétique très punk et éthérée des plans, les choix de bande-son, la scénographie, la suggestivité métaphorique des images : tout est formellement et techniquement savoureux dans ce long métrage tiré d’un court de 2022. Et pourtant… en dépit de ces qualités, Lucid demeure un voyage onirique de body horror pseudoféministe (deux-trois quotes superficielles sur le patriarcat sont en tout cas censées nous en convaincre) et qui, pour être réussi, n’en reste pas moins relativement creux. À l’instar du professeur exaspérant de Mia, qui l’enjoint d’arrêter de lui dire uniquement ce qu’il a envie d’entendre et de jouer le stéréotype de l’artiste conceptuelle torturée, qui l’implore de lui montrer quelque chose de sincère, de cru et vrai, on se demande ce qu’il y a, dans cette proposition, de substantiel.
Lisant un entretien accordé à Variety par les réalisateurices, je trébuche sur ces mots de Milligan qui m’offrent une piste de réponse : « Lucid reflects the importance of independent voices […] Our power is in our individuality — especially in today’s politically polarized climate where young folks crave authentic expression and hope. » Vraiment ? Le pouvoir de l’individualité, c’est ça, le sésame qui manque pour rompre la crise du sens ?
Lucid aurait pu être une critique de la manière dont l’institution et le marché éviscèrent les jeunes artistes, exigeant d’elleux qu’iels capitalisent sur leurs traumas personnels pour les plaisirs de l’audience. Lucid aurait pu être une revendication du droit à ne pas transformer ses cauchemars en réussite sociale. Lucid aurait pu être un refus catégorique de participer au grand ballet de la réification de l’art dans un monde en feu, un monde où on condamne des activistes pour avoir lancé des cannes de soupes sur des reproductions sous plexiglas des tournesols de Van Gogh (c’est peut-être d’ailleurs pour contourner la difficulté cognitive de réfléchir à la starification de nos bobos dans le climat contemporain que l’action a été située dans les années 1990). Or Lucid n’est rien de tout ça. Il est simplement, comme la substance qui lui donne son titre, une délicieuse friandise hallucinogène qui fait voyager le regard avec beaucoup de brio, mais pour le pointer, ultimement, nulle part ailleurs que sur son propre nombril. (Laurence Perron)
CONTACT LENS
Lu Ruiqi | Chine | 2024 | 78 minutes | Underground
Une jeune fille innomée vit au plus près d’une image, faisant défiler les menus gestes qui meublent son quotidien aux côtés d’une séquence projetée sur l’écran rétractable accroché au plafond de son petit appartement d’une pièce. Sur cette image se distingue le corps d’un ersatz de Jeanne Dielman, où une actrice chinoise s’affaire dans une petite cuisine, mimant les traits d’une Delphine Seyrig et poursuivant les gestes ménagers qui rythment le chef-d’œuvre d’Akerman. La toile s’abaisse devant la baie vitrée de la protagoniste, de la même manière que son sofa se déplie en un lit la nuit venue, comme tant d’aspects transformateurs d’une existence où l’exiguïté du lieu de vie citadin implique toute une chorégraphie des espaces pliés et dépliés. L’écran, c’est à la fois un lieu de passage, pendant de la fenêtre qu’il recouvre et seuil ouvrant deux domiciles l’un à l’autre, tout autant qu’il se fait paroi divisante. Il y a le moment où le corps de la protagoniste se frotte sur l’envers de la toile, en tentant d’ouvrir sa fenêtre sans pourtant déranger le film en cours, ou lorsque le visage de la pseudo-Dielman se heurte à la limite de la surface close à laquelle elle est contrainte, son corps aplati lorsqu’il s’efforce à en franchir la frontière.
De mon premier visionnage de Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, sur l’écran du téléviseur de mon salon d’adolescence, je garde le souvenir d’une lente reconfiguration du regard. Le récit se tapissait dans la variation des moindres mouvements du corps de l’actrice, et invitait à murmurer sur le ton d’une trépidation non feinte que l’oubli d’appuyer sur l’interrupteur contrôlant la lumière d’une salle de bain pouvait devenir l’objet d’une observation tendue. C’est depuis cette même logique de non-hiérarchisation de l’attention que se déploie ce premier film de la jeune cinéaste Lu Ruiqi : anthologie des sons et des mouvements à l’impressionnante sensibilité elliptique, trame d’une existence dédiée à la solitude créatrice et dont l’arrière-plan littéral serait celui du travail domiciliaire féminin dont l’imposition cloîtrée était l’enjeu central du film d’Akerman.
Elle est « comme une bête », cette image, propose la protagoniste à une nouvelle amie rencontrée au hasard de ses errances dans un parc, caméra à la main. « J’ai adopté ce film », poursuit-elle. Et c’est tout un travail du soin potentiel qu’un regard peut rendre aux corps observés qui s’y devine alors, car dans ce rapprochement entre le capté et le vivant animé, le cinéma devient la figure d’un fertile entourage, par le refus du temps prédéterminé de la projection classique et le choix de son accompagnement ininterrompu. Travail du lien entre deux cinémas de la réclusion, qui voit dans la rencontre des surfaces closes la possibilité d’un lieu de partage, Contact Lens est un bijou d’expérimentation qui ponctue admirablement cette première semaine festivalière. (Thomas Filteau)
Prochaine projection : Aujourd'hui, le 22 juillet à 21h25 (Cinéma du Musée)

prod. What’s Wrong with Your Dog?
GOOD BOY
Ben Leonberg | États-Unis | 2025 | 73 minutes | Sélection 2025
Good Boy repose d’abord sur une bonne idée de mise en scène : construire tout un film d’horreur autour de la perspective d’un chien. Il s’agit d’une pierre d’assise d’autant plus solide que ce type de cinéma se construit autour de la notion de point de vue. Le récit fantomatique est affaire de perception, de présence absente à la lisière des sens. Il repose aussi sur le principe de croyance. Il ne fonctionne réellement que si son public accepte de se prêter au jeu de l’invisible. Or, en filmant à hauteur de chien du début à la fin, le cinéaste Ben Leonberg nous place d’emblée dans une posture de réception idéale afin de croire en ses spectres. Il limite notre entendement, dirige notre regard et nous force dans une certaine mesure à abandonner notre propre rationalité. L’instant d’un film, nous sommes ce chien. Alors quoi de plus naturel que de se méfier des ombres, de fixer avec insistance le coin de la pièce ?
Le dispositif se révèle d’autant plus habile qu’il repose sur un perpétuel jeu de projection de notre part. Puisque nous prêtons constamment des intentions à l’interprète canin, dont on se permettra tout de même de souligner au passage l’excellence indéniable, nous sommes d’emblée dans un rapport d’empathie soutenu à l’image. La mise en scène vient établir une relation primaire, instinctive et sensorielle, à l’action ; l’incompréhension est tangible parce que nous la partageons, dans une certaine mesure. Comme le chien cherchant à saisir ce qui arrive à son maître, nous tentons de lire les émotions muettes d’un être appartenant à une autre espèce. Good Boy place l’empathie au tout premier plan, rappelant que celle-ci est au cœur même de la notion d’horreur. Il s’agit, après tout, d’une qualité que nous attribuons naturellement à nos compagnons canins.
Bien sûr, on pourrait reprocher au scénario de se complaire dans les lieux communs de l’horreur contemporaine. Sur le plan thématique, on saisit vite que Good Boy propose une énième métaphore du deuil ; or, le glissement de perspective qui s’opère ici met en lumière ce sentiment de perte sous un jour nouveau. Car, une fois de plus, l’incompréhension du protagoniste confère un supplément de gravité à cet enjeu. Ce n’est pas seulement qu’il faut accepter la mort d’un être cher. C’est que la notion même de perte échappe à l'entendement canin, qu’il lui manque en quelque sorte les mots afin de la saisir et de l’exprimer. Nous renouons ainsi avec l’essence même de la perte en tant que disparition ; et les fantômes retrouvent ici tout leur sens, redevenant les manifestations d’une absence avec laquelle nous cherchons tant bien que mal à composer. (Alexandre Fontaine Rousseau)
CIELO
Alberto Sciamma | Royaume-Uni/Bolivie | 2025 | 108 minutes | Sélection 2025
Pour Santa (Fernanda Gutiérrez Aranda), fillette de huit ans vivant sur les hauteurs de l’Altiplano bolivien, le ciel n’est ni une abstraction mystique ni une métaphore consolante : c’est une direction, un cap tangible, un au-delà dont elle entend forcer les portes. Dans Cielo (récipiendaire du Prix du jury, du Prix des spectateurs et du Prix de la meilleure cinématographie à la dernière édition de Fantasporto, au Portugal, où a d’ailleurs eu lieu sa première), Alberto Sciamma tisse une fable trempée dans l’eau trouble du réalisme magique, où le merveilleux ne vient pas enchanter le réel, mais tente, parfois maladroitement, d’en révéler la violence structurante. C’est parce que la vie terrestre de Santa et de sa mère — rythmée par les coups d’un père violent et la misère matérielle — ne peut que motiver le désir de fuir ce monde que l’enfant choisit la rupture radicale : d’un geste qu’on devine chargé de nécessité autant que de désespoir, elle fracasse le crâne de son père à l’aide d’un lourd rocher, puis, après s’être réjouie de la mort du patriarche avec sa mamita, elle enfonce contre toute attente un poignard dans le ventre de la figure aimée, mais dans le seul but de la ressusciter une fois le paradis atteint.
Si ce choix narratif n’est pas des plus efficaces (bien que l’on admette l’univers fantastique du film, tuer pour ensuite ressusciter demeure pour le moins contre-productif), il détermine cependant la suite du récit, car le périple de Santa est motivé par son désir de conduire sa mère jusqu’au ciel, « más allá de las estrellas » (« plus loin que les étoiles »). Une fois orpheline, la fillette se hâte de préparer une embarcation de fortune qu’elle charge d’un poisson aux vertus surnaturelles et du cadavre de sa mère dûment disposé dans un baril en plastique, destination (et ici, la lourdeur symbolique du film s’affirme) la constellation… du poisson.
Sur son chemin, Santa croise nombre de personnages à la lisière du grotesque et de l’allégorique — qui, tour à tour, lui prêtent main-forte et lui mettent des bâtons dans les roues. Pourtant, tous, du prêtre désabusé au groupe de lutteuses aymaras féministes, les Fighting Cholitas, en passant par le shérif au cœur de pierre, finissent par tomber sous son charme. Et c’est peut-être sur ce charme que s’assoit trop facilement Sciamma dans Cielo, notamment en misant sur l’attendrissement qu’inspirent le personnage de Santa et sa jeune actrice, ainsi qu’en accumulant les retournements dramatiques qui, presque systématiquement, aboutissent à de mièvres résolutions chargées de sensiblerie. Si, dans de nombreuses entrevues [1], le cinéaste se targue d’offrir un film au récit surprenant, il échoue à développer les nombreuses péripéties de son héroïne en autre chose qu’en moments de tendresse frelatés.
Certes, Gutiérrez Aranda, bien que son jeu manque quelque peu de nuance — elle emprunte tout au long du film l’intonation enjôleuse de la fillette qui connaît son charme et qui en use pour narguer et manipuler les adultes —, fait sans doute un excellent travail dans ce premier rôle, et certes, la cinématographie d’Alex Metcalfe est digne de mention — le chef opérateur rend avec virtuosité les nombreux paysages, de l’Altiplano à La Paz, en passant par les sols immaculés du salar d’Uyuni et les sommets de la cordillère des Andes, que traverse Santa au cours de son périple vers le ciel étoilé. Mais, plus que l’émotion et la beauté, c’est l’impression que le film veut trop, qu’il cherche à tout prix à séduire le spectateur qui subsiste en moi au sortir de la salle. À vouloir trop bien faire, à trop vouloir tout faire, Cielo noie des idées potentiellement fécondes sous le poids de la surenchère et, par la même occasion, tue dans l’œuf la magie, pourtant si importante dans le film. (Frédérique Lamoureux)
[1] Notamment dans un entretien réalisé au moment de la présentation du film au festival SXSW Londres (« Alberto Sciamma et Fernanda Gutiérrez Aranda interview on Cielo at SXSW London », The Upcoming, 7 juin 2025, https://www.youtube.com/watch?v=5Y3a5wIDicA) ainsi que lors de sa présentation au festival Fantasia.
THE DEVIL'S BRIDE
Arūnas Žebriūnas | Lituanie | 1974 | 78minutes | Fantasia Rétro
Il est difficile de parler en termes clairs et cohérents de The Devil's Bride. L’expérience qu’il procure s’apparente à un étrange rêve enfiévré dans lequel tout le monde chante sans cesse. Je vous voir venir : « C’est une comédie musicale, c’est normal que ça chante.» Mais pas autant que ça. Vous ne m’aurez pas. Habituellement, il y a des pauses. Des ralentissements dans le flot de l’action, des moments d’accalmie. Or, moins de 24 heures après la projection du film, me voilà hurlant à qui veut bien m’entendre que le petit diablotin roux habitait dans le grenier du moulin à vent et que la carriole noire tirée par des hommes-chevaux portant des chapeaux melons s’est engouffrée dans l’eau du lac tandis que la distorsion lysergique d’une guitare électrique poursuit sa danse obscène dans mon esprit. Certaines œuvres fonctionnent à la manière d’hallucinations, nous faisant douter de notre emprise sur la réalité ; et cet opéra rock lituanien de 1974, où s’entremêlent orgies célestes et folklore paysan, s’inscrit sans contredit dans cette lignée de films culte auxquels on ne peut croire qu’après les avoir vus… et encore.
Je pourrais bien sûr vous expliquer qu’il est ici question d’un démon qui, après avoir été expulsé du paradis, aboutit dans un étang puis signe un pacte avec un fermier pour épouser sa fille ; que celle-ci tombe amoureuse d’un autre homme et que ça complique évidemment les choses pour tout le monde. Que le récit s’étire sur quelques décennies, que les villageois finissent par se tanner de la présence de cette créature dans les parages, qu’ils tentent alors de s’en débarrasser à coup de rites religieux et de gui. Qu’au bout du compte, on se dit que le pauvre bougre n’était peut-être pas si méchant que ça, qu’il rêvait simplement de profiter un peu de son passage en ce bas monde. Voilà qui ne rendrait aucunement justice à ce ballet surréaliste somptueusement photographié, dont les images se bousculent joyeusement à l’écran tandis que les chansons se succèdent les unes aux autres sans interruption aucune. Il se dégage de ce Devil’s Bride une énergie contagieuse, sa mise en scène tumultueuse procurant une ivresse cinématographique véritablement réjouissante.
Or, malgré son sublime sens de l’excès, Arūnas Žebriūnasne laisse jamais son film s’étirer en longueurs inutiles. La frénésie de celui-ci naît au contraire de son extrême concision, qui confère à l’ensemble un rythme haletant tout en accentuant cette impression d’une tempête psychédélique zébrée d’éclairs poétiques. Suivant l’élan d’une ligne de basse à la syncope irrésistible, la bacchanale reprend. Le mouvement circulaire de l’action nous happe à nouveau. C’est plus fort que nous. Impossible de résister à cette transe collective. Cédant à l’entrain général, on se joint à la farandole. Animés par une force mystérieuse, nos membres s’agitent. Notre volonté s’effrite. Il y a des films comme ça, qui nous enivrent et nous possèdent. Qu’il vaut mieux vivre, ne pas chercher à comprendre. Comme un sort s’abattant sur nous, auquel il s’agit plutôt de s’abandonner. (Alexandre Fontaine Rousseau)
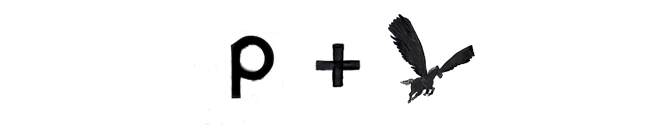
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(Occupy Cannes, Queens of the Dead,
Lurker, $POSITIONS, LifeHack, Stuntman)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
