JOUR 3

prod. Takes Film / Alva
BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY
Elene Naveriani | Géorgie / Suisse | 2023 | 110 minutes | Section Harbour
Comme vieux garçon de 40 ans, il est dur pour moi de ne pas être sensible au récit d’amour tardif d’Etero (monumentale Eka Chavleishvili), une tenancière de magasin à l’aube de la cinquantaine qui un jour, après avoir frôlé la mort, décide de baiser spontanément le livreur de détergeant qui lui fait de l’œil, question de se débarrasser de sa virginité. Il est dur pour moi de ne pas consentir à évacuer l’image fantasmée d’un premier amour de conte de fée, et d’embrasser le réalisme cru de cette romance étrangement probable et cathartique. Car la beauté du film, c’est aussi son apparente laideur aux yeux de la société de consommation : la sensualité libératrice de ces vieux corps plissés qui s’étreignent dans des décors de villages post-soviétiques, au gré d’une mise en scène austère exempte de romantisme. On a bien droit à une séquence touchante sur une route de montagne pittoresque que sillonnent Etero et Murman en écoutant du Charles Aznavour — j’y ai laissé quelques larmes — mais, même là, il n’y a rien d’artificiellement embelli. Le pique-nique qui s’ensuit n’a rien de l’idylle vénusienne. On y parle de nuages et de paysages, puis Etero confie que, dans son enfance, les mûres (blackberries) étaient « ses parents, ses ami·e·s et ses amants ». « Je vais être ta mûre », répond son amant, dans une démonstration de quétainerie à la fois ringarde et adorable. On est surtout content·e du sourire laborieux qu’elle provoque chez la protagoniste, dont les rides tendent à former une moue naturelle qui lui colle au visage comme le stigmate d’une tristesse immuable.
S’il excelle comme étude de personnage, Blackbird Blackbird Blackberry constitue également une étude de milieu particulièrement perspicace. Centré sur le personnage d’Etero, que la caméra cherche ou suit sans cesse, émulant jusqu’à son moindre regard — tel qu’en témoigne le zoom du début sur le carouge à épaulettes (blackbird) qu’elle aperçoit près du ravin, le film l’invite non seulement à nous guider à travers ses propres espaces, mais à travers tout le village également, qu’elle arpente comme l’un de ces piliers. Petit à petit, l’exploration de la maison familiale, où elle vit désormais seule, dévoile le poids carcéral du regard masculin, particulièrement celui de son frère, qui, dans un flashback fantasmé, la traite de pute pour avoir couché avec Murman, et dont elle finit par décrocher le portrait du mur. L’habitation, faite de grands espaces solitaires, dépouillés, constitue d’ailleurs un reflet de ses propres carences. Ses errances, elles, nous permettent de la confronter à un autre écueil, inattendu, soit la féminité toxique de ses amies commères, bâtie comme le berceau de la médisance et du mépris, la police de la conformité, qui jalouse sa liberté et ridiculise son physique. Et l’on comprend que la solitude d’Etero, aussi revendiquée soit elle à son âge, est aussi une construction sociale, le produit, en quelque sorte, de l’éducation genrée. À ce titre, la progression du récit, qui tend à ramener la protagoniste dans une logique hétéronormative plus stricte, n’est jamais idéalisée, mais remise en question, culminant avec une fin ouverte savoureuse où la dégustation d’un de ces méga-millefeuilles géorgiens sert de baume passager face à l’anticipation d’un avenir incertain que d’autres jugeraient jubilatoires.

prod. Yellow Veil Pictures
SO UNREAL
Amanda Kramer | États-Unis | 2023 | 101 minutes | Section Harbour
J’étais surpris de découvrir que le nouveau film d’Amanda Kramer était un documentaire immersif à propos de la représentation de l’informatique dans le cinéma de science-fiction des années 1980-1990. Mais c’était avant de réfléchir un peu — après tout, il n’y a pas encore que les machines qui sont capables de réfléchir — et de réaliser que le projet correspondait parfaitement aux penchants habituels de l’autrice pour la rétrospective cinéphile et pour l’esthétique vintage. Et même si les images de So Unreal sont toutes empruntées (des extraits d’archives, surtout, et quelques graphiques ad hoc imaginés par Jon Cooper), le parcours qu’il nous propose est aussi fascinant que toujours… et c’est un peu ça le problème.
Porté par un essai sublime et foisonnant, poétique mais lucide, signé par Kramer et Britt Brown, narré en voix off par l’incandescente Debbie Harry, qui en commentant sa propre image de Videodrome (1983) ajoute un niveau de réflexivité amusant au discours critique du simulacre informatique, le film se déploie comme un enchaînement d’images hypnotique et magnifiquement monté (par Benjamin Shearn, collaborateur de longue date de la réalisatrice). Les critiques d’un corpus de films ad hoc, dont les innovations narratives, thématiques ou conceptuelles sont soulignées avec perspicacité, s’intègrent alors à un discours historique et sociologique plus vaste sur l’influence délétère des technologies numériques et sur l’avenir incertain du cinéma. Les récriminations, parfois grossières, que contient le texte (on annonce notamment la mort du septième art face à la VR, aux faux acteurs et aux écrans verts) sont toujours sauvées par l’esprit et la passion qui en caractérisent le style. On nous fait surtout comprendre ici comment faire de la bonne critique de cinéma « narrative », où l’on raconte les récits, mais aussi les archétypes de Looker (1981), Tron (1982), Brainstorm (1983), Electric Dreams (1984), The Terminator (1984), Tetsuo (1989), Mindwarp (1991), Sneakers (1992), Arcade (1993), Hackers (1995), The Net (1995), Strange Days (1995), Virtuosity (1995), eXistenZ (1999), The Matrix (1999) et autres perles du genre en évoquant poétiquement leurs sources et leurs implications. J’étais sceptique quand l’ami Sylvain Lavallée avait mentionné qu’il est possible de créer un bon texte critique en ne faisant que décrire l’action d’un film — eh bien, c’est ce que nous démontrent ici Kramer et Brown.
Mais ce sont surtout les images que nous sommes venu·e·s voir. Question de bien apprécier les souvenirs nostalgiques de notre enfance, la candeur de la représentation technologique d’époque, la technique impliquée dans la conception des effets spéciaux, au même titre que leur pertinence au sein d’un discours sur la technologie ou leur puissance d’anticipation face à celle-ci. L’esthétique informatique au cinéma possède une qualité immersive évidente dans l’image de la spirale psychédélique, qui précède souvent l’entrée dans le monde virtuel, et c’est ainsi que So Unreal nous accroche. Et si les séquences de films accaparent la grande majorité du récit (on se souvient avec la même affection des chefs-d’œuvre de Cameron que des films de Brett Leonard que l’on voyait à l’époque sur TQS ou sur VHS), les publicités d’époque, les effets de synthèse primitifs utilisés dans les vidéoclips et les documentaires sur les premiers ordinateurs personnels constituent un nectar tout aussi enivrant. Force est d’ailleurs de constater, bien avant la mi-chemin, que c’est l’enchaînement constant des images, la concentration et la fragmentation médiatiques qui nous maintiennent inexorablement accrocs. C’est le paradigme imagier actuel qui nous happe, et paradoxalement, c’est en cela aussi que le film prouve le potentiel décérébrant et esclavagiste des machines à images, de même que l’assertion selon laquelle nous avons collectivement décidé d’avaler la pilule rouge après le 11 septembre et de laisser aux algorithmes le soin de dicter la prochaine chose que nous allons voir. Heureusement, l’algorithme, ici, c’est Kramer. Mais nous ne serons peut-être pas si chanceux·ses la prochaine fois…
*
JOUR 4

prod. Indiana Production
CONFIDENZA
Daniele Luchetti | Italie | 2024 | 136 minutes | Big Screen Competition
Le scénario de Confidenza, sorte de récit romantique rétrospectif s’intéressant à l’histoire d’amour-passion entre un professeur de littérature (complexe Elio Germano) et une ex-étudiante (impérieuse Federica Rosellini), s’articule autour d’un mécanisme assez brillant qu’il incombe d’expliquer. Un soir, par souci de partager plus que des mots doux, les deux amant·e·s consentent à se livrer un secret qui aurait le pouvoir de détruire leur vie respective. Le public n’entend pas ce qui est chuchoté à l’oreille — on s’en fout — mais l’idée de remettre son existence entre les mains de l’autre est à la fois merveilleux et terrifiant. C’est l’avènement de la peur, qui animera Pietro tout au long de sa vie, même après son mariage avec une autre femme, particulièrement au gré de ses succès, jusqu’à la prestigieuse remise de prix honorifique lors de laquelle Teresa sera invitée à parler. Et même si le scénario pâtit de l’une des tares habituelles du genre, soit la construction d’un récit en flashback dont la perspective initiale, celle de Teresa, se transfère magiquement vers celle de Pietro, la puissance de ce mécanisme nous garde constamment en haleine, et cerne à merveille la paranoïa qui anime les hommes, particulièrement depuis l’époque #MeToo, à l’idée de voir une femmes faire disparaître leurs privilèges en révélant la vérité à leur propos.
Dire du film qu’il s’agit d’un thriller est donc à la fois problématique et exact. C’est du moins un thriller dans la tête du protagoniste, qui malgré ses leçons à ce sujet, n’aura jamais su isoler l’amour de la peur au sein de sa propre existence — l’exercice scolaire, qui consiste à inscrire diverses réalités dans deux colonnes séparées, correspondant à l’amour et la peur, rappelle étrangement Donnie Darko (2001), avec lequel le film partage également une ambiguïté très féconde entre le rêve et la réalité. Mais c’est aussi problématique de parler d’un thriller parce qu’en s’identifiant presque exclusivement au personnage de Pietro, tout le suspense, toute l’horreur réside alors dans le pouvoir des femmes de faire tomber les hommes en accédant à la connaissance — comme si on remettait sur elles tout le fardeau du péché originel. Et même si se lancer dans l’histoire d’amour tordue que recèle le film s’apparente à mettre la main dans les ronces, l’exercice permet au moins d’adresser de façon frontale le problème endémique du machisme et de la misogynie en Italie.
D’un point de vue technique, il est dur de ne pas mentionner le pouvoir d’affect de la bande sonore doucement mélancolique, typique de Thom Yorke, mais surtout de la mise en scène précise de Luchetti, qui excelle dans la mise en relation spatiale des personnages et qui parvient à capter moult impressions éthérées chez ceux-ci, parvenant toujours à montrer une douleur et une tristesse cataclysmiques dans leur expression la plus subtile de moue affectée ou de regard vers l’horizon, vers la bouteille de vin à moitié entamée, peut-être, qui pourrait bien constituer une preuve d’infidélité. De manière spéléologique, on dénude ainsi toutes les couches de poison qui caractérisent l’amour-passion, et qui font de nos conjoint·e·s de remplacement des personnages secondaires dans nos vies. Seul le désir de violence reste explicite à l’écran, mais il demeure toujours dans le domaine du fantasme. Et c’est là que le film exprime son génie, dans cette violence illusoire qu’anticipe, souhaite et entretient malgré tout une psyché masculinité inepte.

prod. Bill Plympton
SLIDE
Bill Plympton | États-Unis | 2023 | 79 minutes | Section Harbour
J’ai rencontré Bill Plympton ! Il était là, en personne, avec son chapeau de cowboy vert, pour présenter le « final cut » de son nouveau western — la version présentée plus tôt à Annecy n’était qu’un « rough cut » apparemment, mais les choses ne sont pas tout à fait claires puisque le réalisateur prenait encore des notes durant la projection… Après un très court Q&A, il a même dédicacé des petits dessins à tout le monde — c’est le genre d’homme qu’il est. En arrivant à sa table, je lui ai dit, tout timidement, que c’était un honneur de le rencontrer, et que ça faisait 25 ans que je le suivais. « Où regardais-tu mes films à l’époque ? », m’a-t-il demandé. Sur VHS ! Et je suis content de constater que la même énergie maniaque et le même dévouement à son art l’animent toujours aujourd’hui.
Slide, c’est du pur Plympton, et c’est une autre production héroïque pour lui, faite à la main sur une période de sept ans — c’est l’envers du travail machinique que nous faisons désormais faire aux intelligences artificielles. Comme à chaque fois, toutes ses lubies s’y retrouvent : des figures malléables, friables, dont chacune des parties du corps peut prendre vie indépendamment, de constantes parenthèses oniriques, où les états de la matière deviennent indistinguables, et plein de personnages caricaturaux aux traits gribouillés, cadrés dans un style cinématographique survitaminé où les échelles de plan changent constamment et où les angles de « caméra » adoptent les postures les plus excentriques. À ce titre, il faut vraiment voir la séquence d’ouverture, où le personnage-titre arrive à Sourdough Creek, et qu’on l’observe à partir de tous les points de vue possibles : les doigts sur la guitare, sous les vautours et les nœuds coulants accrochés aux arbres, même d’en-dessous de son cheval, jusqu’à un tourbillon dont il tentera de s’échapper en courant à la verticale sur les flots.
Tout bouge vite chez Plympton, comme dans un vidéoclip. Tout est ingénieux, tapageur, tumultueux, excessif et grossier. Voilà d’ailleurs pourquoi le western est un genre tout désigné pour son travail, lui qui déborde déjà de caricatures ambulantes : le politicien corrompu à la gâchette facile, les prostituées aux bustiers vibratoires et les filées interminables d’ouvriers suants qui attendent leur tour de valse, le héros flegmatique à la guitare, inspiré par Clint Eastwood, qui entre en ville en glissant sur des castors, mais surtout les trâlées de mercenaires pittoresques engagés pour le tuer. De l’aveu du réalisateur, il s’agit peut-être ici du film avec le plus de méchants, et à en croire la fusillade finale, où l’on se cache jusque dans les poissons pour tirer, c’est peut-être vrai… Le western, c’est aussi une façon d’intégrer plein de numéros musicaux délirants — ce n’est pas pour rien qu’il a une guitare, le Slide, et que la protagoniste féminine veut devenir chanteuse. Et puis, c’est facile d’ajouter une petite critique anticapitaliste en plus, parce que le monde de l’Ouest, c’est un monde colonialiste. Et même si c’est du colonialisme immobilier dont on parle ici, facilité par l’exploitation ouvrière et la manipulation religieuse qui sévit encore aujourd’hui aux États-Unis, le propos est d’autant plus pertinent… On attend maintenant avec impatience le prochain long métrage du vénérable animateur, City Cats, un film noir new-yorkais mettant en scène deux détectives félins. Ça promet !
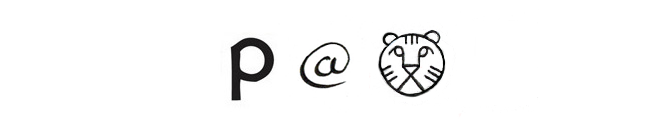
PARTIE 1
(Head South, Rei,
A Man Imagined, La Parra)
PARTIE 2
(Blackbird Blackbird Blackberry, So Unreal,
Confidenza, Slide)
PARTIE 3
(Explanation for Everything, She Fell To Earth
King Baby, It is Lit)
PARTIE 4
(Blue Imagine, Natatorium,
The Parangon, Songs of All Ends, Nécrose)
PARTIE 5
(Maia - Portrait with Hands, A Spoiling Rain,
Krazy House, Los delincuentes)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
