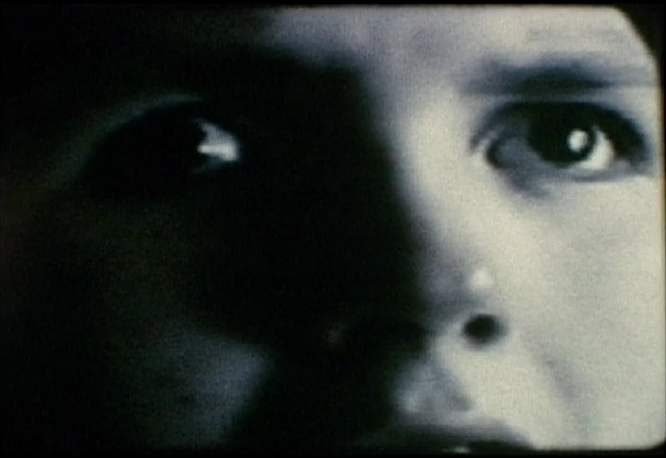
:: Sébastien (Le Petit Jésus, André-Line Beauparlant, 2004) [Coop Vidéo]
Et meure Paris ou Hélène,
Quiconque meurt, meurt à douleur
Telle qu’il perd vent et haleine ;
Son fiel se crève sur son cœur,
Puis sue, Dieu sait quelle sueur !
Et n’est qui de ses maux l’allège :
Car enfant n’a, frère ne sœur,
Qui lors vousît être son pleige.
— François Villon, Le Testament, vers 1461
La condition sociale aux marges de la moralité et l’esthétique de la laideur caractérisent tant les œuvres de François Villon, ce mauvais garçon du 15e siècle à la plume érudite ayant échappé par deux fois à la pendaison, que celles de Robert Morin, ce réalisateur outsider qui, depuis le début de sa carrière dans les années 1970, échappe à la guillotine de la standardisation de l’industrie du cinéma, préservant ainsi précairement son intégrité. Dans un registre qui traite de thèmes similaires, mais très différemment, et par les mêmes moyens d’expression sans compromis, les documentaires d’André-Line Beauparlant sont des vitrines qui exposent entièrement l’intime sans jamais contourner les tabous. Des extensions politiques, sans être qu’identitaires. L’enchevêtrement de ces œuvres vidéographiques se rejoint dans l’espoir d’un salut, entre deux overdoses pour se dissocier de l’insoutenable et autant d’invocations qui ne trouvent pas d’écho. Deux plaidoyers en faveur d’une authenticité face à l’adversité qui met à nu la fragilité humaine.
En « triturant la fiction » pour y intégrer des éléments du réel, Quiconque meurt, meurt à douleur (1998) rassemble des personnes ostracisées dans un huis clos afin de leur donner la possibilité de « japper contre la société » [1]. Le drame, où vérités et mensonges s’accouplent pour proliférer les supercheries, met en scène des ex-toxicomanes également coscénaristes d’un siège de trente-six heures dans une piquerie où un caméraman de téléjournal et deux policiers sont pris en otage. Pour Le Petit Jésus (2004), André-Line Beauparlant devait initialement tourner une conversation muette avec son frère Sébastien, dont la qualité de vie a été lourdement compromise par une série de mauvaises décisions médicales ayant provoqué un manque d’oxygène à sa venue au monde. Cet échange silencieux devient une recherche qui examine la place qu’occupe la religion catholique au sein de sa famille lorsque celui-ci décède en 2003. À travers leur caméra subjective sans préjugés, le couple Morin-Beauparlant laisse les événements impromptus les guider vers des chemins de croix insoupçonnés. Des pérégrinations parfois traumatiques et parfois douces.

:: Le Petit Jésus [Coop Vidéo]
« J’avais 11 ans quand mon frère est né. C’était le 30 août 1977. C’est la première fois que j’ai vu mon père pleurer. Il fallait prier et, surtout, être très sage. » Un râlement sourd, comme un petit animal blessé, accompagne les premières images chaudes et pixélisées de Sébastien, le « Petit Jésus ». L’expression de son visage évoquera l’extase de sainte Thérèse du Bernin. André-Line brise la glace pour aborder le choc de la naissance de son frère à la patinoire, à la suite d’un match de hockey où sa mère occupe la position de gardienne de but. Un lieu incongru qui accorde peut-être le recul nécessaire pour revisiter une plaie encore vive. Ce quatrième enfant de Pierrette était le plus désiré : « Tout le temps de ma grossesse, je me disais : “Ce serait l’fun s’il restait petit. Me semble que j’aurais le goût qu’il reste bébé longtemps. J’ai été choyée…” ». Ce qui devait arriver arriva. La condition précaire des protagonistes de Quiconque meurt, meurt à douleur, due aux injustices systémiques plutôt qu’à une disgrâce du Bon Dieu, les condamne aussi à une fin tragique inéluctable : une dérape étourdissante rythmée de coups de mitraillette et de lamentations.
Dans les deux œuvres, le·la créateur·ice du contenu filmé est révélé·e. Leur présence désoriente l’ordre établi. La caméra de Sylvain, qui était là pour couvrir la descente policière, est rapidement réquisitionnée par Yellow, le plus cultivé des intoxiqués. Le point de vue, jusque-là journalistique, bascule du bord de ceux et celles qui ont perdu leur foi envers l’establishement : « Là c’est nous autres qui tiennent le gros boute, comprends-tu ? » Alors que la dope commence à manquer et que la tension monte dans l’appartement miteux, l’éloquent vingtenaire à lunettes s’adresse directement à l’objectif : « Depuis que la télé a fermé les églises, c’est les kodaks qui ont remplacé les curés. […] Ça donne du pouvoir. […] Là, t’es pogné en enfer, toi aussi, avec des diables tout autour de toi. » Cette perspective télévisuelle, « un regard de partout et de nulle part à la fois » [2] souvent propre aux médias de masse et typique aux mécanismes de l’immersion, est critiquée par une prise de parole, voire un activisme en faveur des personnes marginalisées que l’autorité normative cherche à taire.
Malgré le fardeau de ses afflictions silencieuses que ses sanglots trahissent, la mère d’André-Line n’a jamais cessé de croire à la Providence. Tout juste sortie de l’hôpital, accompagnée de son mari Jean, elle se rend à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal pour confier le sort de son nouveau-né au « Patron des causes difficiles » : « Je lui ai dit “Si tu veux qu’il fasse partie de moi, tu vas m’aider à ce que ça marche.” » Les cannes et les béquilles suspendues entre les piliers de la chapelle votive, en remerciement d’une protection demandée et obtenue, poussèrent peut-être Pierrette à croire en l’impossible. Longtemps, le couple endurci par l’adversité a voulu croire au miracle du rétablissement de leur fils, ce qui les poussa à intégrer le mouvement catholique des Cursillos. Vêtues d’une toge blanche, éclairées par le faible faisceau des lampions, Doris Rainville et Micheline Beaumier, ferventes disciples engagées au sein de cette communauté, racontent avoir vécu une « triple rencontre » — avec soi, avec autrui et avec Dieu — lorsque Sébastien leur a été présenté. La lumière de ses yeux « reflétait la lumière de Dieu », explique Doris. Le regard d’un enfant « qui ne pourra jamais pécher ». Un aller simple vers le Créateur.
Dans Quiconque meurt, meurt à douleur, la « triple-rencontre » opère aussi chez les adeptes de la drogue. Mais plutôt qu’un passe-droit aux portes du paradis, un TGV les propulse à destination du châtiment éternel. Le portrait de ces consciences altérées aux prises de démons intérieurs est touffu. Du bourgeois au plus démuni, la dépendance touche d’égal à égal les strates sociales. Ceux et celles dont le quotidien se ponctue par les fix ne restent pas insensibles au manque d’autrui. Leur main tendue aux plus mendiants apaise les soubresauts du manque.
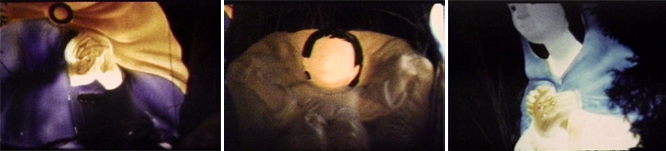

:: Le Petit Jésus [Coop Vidéo]
« Seigneur, je vous en prie. Faites que mon frère guérisse. Faites que mon père travaille moins. Faites que ma mère arrête de pleurer. Je vous en supplie. Amen. »
24 décembre 1977. Année de naissance de Sébastien. « Peut-être que, ce soir, il y aura un miracle, parce que ma mère va faire Marie, mon père Joseph et mon frère, le Petit Jésus. » Les parents drapés de leurs tuniques, et Sébastien, emmailloté dans ses langes, s’offrent fièrement au regard de l’assistance venue célébrer la messe de Noël dans une crèche artisanale bordée de poinsettias. « Je voulais que ça aille bien, je ne voulais pas de chicane, je voulais qu’on soit heureux, je voulais que mon frère soit normal. »
Retour à l’ode à la déchéance, qui se poursuit. Le pusher Bécik qui monte la garde injecte un des deux « cochons » à l’héroïne. Menottés, ensanglantés, le flingue sur la tempe, ils souffrent le martyre. Au fur et à mesure que les heures avancent, ils perdent espoir au miracle de leur libération.
« Quand même qu’on aurait été révoltés, ça donnait quoi ? », déplore Madeleine Robert, la tante d’André-Line, que l’on a découvert dans Trois Princesses pour Roland (2001). Ce premier long métrage documentaire aborde sa résilience face à la violence conjugale qu’elle subit, ainsi que celle de sa descendance. Elle prend une bouffée de sa cigarette. Elle y a cru, au miracle. Pour Sébastien, et sûrement pour elle aussi.
La révolte, elle habite tous les colocataires en crise existentielle de la docu-fiction de Morin. « Ça par de là », raconte Bécik, en pointant son bras tatoué de la croix de Jésus. « À partir de 5 ans, y’a rien que ça qui marchait. Ok ? » Il serre fermement ses poings bagués. Un poing américain. « Quand quelqu’un parlait à mon vrai nom, je ne savais même pas que c’était à moi qu’il parlait. Ok ? Pis quand tu continues de même, 15-20 ans, ton identité, t’en as pu. »
![]()
:: Bécik dans Quiconque meurt, meurt à douleur (Robert Morin, 1998) [Coop Vidéo]
Yellow explique comment ses semblables pallient ces traumatismes de l’enfance qui s’étirent comme un élastique toujours à la limite de se rompre : « On se soigne avec quoi ? On se soigne avec qu’est-ce qu’on a. Moé pis Rachel, nous autres, c’est la coke. Avec la coke, il y a de la joie. Mais ça ne dure pas longtemps. C’est de l’ouvrage, la coke, comprends-tu ? 20 minutes un buzz. » En Enfer, le bonheur est éphémère.
À 14 ans, André-Line a compris que son petit frère n’allait jamais s’en sortir. « Son handicap le rendait beaucoup plus fort. C’est le Seigneur en dedans de lui qui le faisait vivre », bafouille la pieuse Micheline du mouvement des Cursillos, comme si elle peinait à justifier la teneur de ses propos. Pour tante Madeleine, la photo de Sébastien, glissée entre des roses artificielles, symbolise la protection de l’au-delà : « Qu’est-ce qu’il a fait de mal cet enfant-là ? Il n’a rien fait de mal. C’est un ange qui me protège. »
Dans Quiconque meurt, meurt à douleur et Le Petit Jésus, il semble que l’être humain cherche toujours à trouver la guérison ailleurs qu’en lui-même : en Dieu, Saint-Joseph, l’alcool, l’héroïne, le regard d’un enfant qui ne pourra jamais pêcher. Que les âmes meurtries exhalent leur souffrance à pleins poumons ou les avouent à demi-mot, Robert et André-Line leur accordent miséricorde en sensibilisant le public à la douleur des laissé·e·s pour compte.
[1] Les expressions citées entre guillemets, empruntées à Robert Morin, illustrent sa vision.
[2] Ce concept critique l’universalisation des connaissances et l’« objectivité » scientifique. Il provient de la philosophe Donna Haraway et est tiré de son célèbre article Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective (1988).
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
