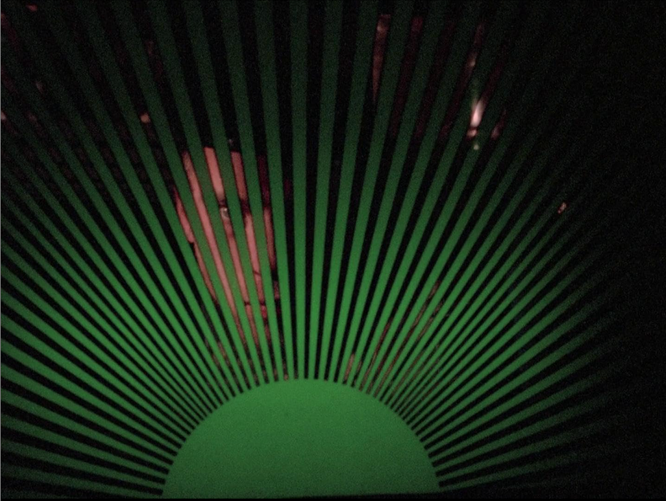
:: Decoder (Muscha, 1984) [Fett Film]
Comprendre la nausée, le goût acide qui demeure en bouche après le film, le bourdonnement tenace, la sensation de tenir entre ses mains une batterie fuyante et corrodée qu’en plaçant à son oreille comme un coquillage on entend siffler. Decoder (attribué à Muscha mais réalisé à huit mains en Allemagne de l’Ouest, 1984) dissout : difficile de tenir ensemble l’entièreté des filons déployés dans le film, de les faire résonner en harmonie. On comprend vite cependant que l’harmonieux sera suspect. Le ton comique, absurde, se frotte à une violence systémique de même qu’intime ; le rêve prend la place du réel sans annonce ; surtout, la trame sonore est râpeuse, grésille et rouille l’évidence des sons entendus. Un bruit de vent se fait entendre dans des scènes intérieures, la musique industrielle reproduit sourdement les affrontements de la rue, le morceau « Seedy Films » de Soft Cell appuie sur la note sensuelle jusqu’à produire une ambiance indigeste.
FM est un musicien expérimentant avec l’enregistrement, le remaniement dissonant d’extraits audio, les synthétiseurs analogues. Un jour au fast-food où il traîne, ennuyé et se bouchant les oreilles, il réalise que la musique d’ambiance n’a pas qu’une fonction décorative. Au contraire, la Muzak (du nom d’une compagnie produisant fameusement ce type de « musique d’ascenseur ») joue un rôle pacifiant. Sans que la clientèle du H-Burger ne le réalise, elle adoucit et les rend artificiellement enjoué·e·s, donc faciles à contrôler par le gouvernement, complice de cette soumission subconsciente. Prenant à rebours sa découverte, FM se donne comme mission de distordre cette trame sonore au pouvoir subliminal afin qu’elle provoque le mouvement contraire, soit un élan de rébellion irrépressible. Le musicien s’isole avec ses machines et, comme fiévreux, à partir d’enregistrements sonores modifiés qui vont de la conversation à de perturbants échos de violence, il assemble sa propre muzak révolutionnaire. Une des grenouilles domestiques de son amie-partenaire Christiana, de même qu’un culte mené par un·e gourou qu’interprète Genesis P-Orridge (artiste queer radical·e et figure fondatrice de la musique industrielle), se révèlent être des pièces cruciales du casse-tête. Essentiellement, nous voyons FM et Christiana, sa partenaire, chiller pendant une heure trente : attendre l’aimée à la sortie du peep-show où elle travaille, tuer le temps, se raconter ses rêves, fumer à l’intérieur. Plutôt que de se toucher et se regarder, Christiana et FM s’écoutent sans se voir, parlant dans le communiqué d’un téléphone alors qu’iels sont dans la même pièce. En contrepoids au regard brûlant des clients lubriques, c’est le son, encore, qui promet un lieu de résistance et de désir, une intimité hors du male gaze et de sa violence.
Decoder commence et je suis happé·e par l’éclairage surréel, jouant dans les contrastes et les impossibilités de la lumière (un halo bleuté illumine FM en contre-plongée alors qu’il marche dans la rue, en après-midi), le jeu plus théâtral que naturaliste (mettant l’accent sur l’orchestration systémique et cachée dans l’envers des scènes même banales de nos quotidiens). Derrière le groupe des spectateur·ice·s venu·e·s assister à la projection, dans le bar où Decoder est à l’affiche, deux hommes dans la soixantaine prenant un verre se voient contraints de plonger dans ce récit avec nous, leur conversation rendue difficile par la trame sonore souvent assourdissante. Grommelant d’abord, ils se taisent. Après une trentaine de minutes, l’un des deux veut partir. L’autre, ne quittant pas l’écran des yeux, propose de se reprendre une autre fois pour aller jouer au billard. Le plan initial est déjoué. Le spectateur captivé dit à peine au revoir à son ami. Je repenserai beaucoup à cette scène inattendue, qui dédouble dans le réel la fonction hypnotique de la muzak, le film agissant alors dans la salle tel le refrain subliminal du H-Burger. Ici, cet ensorcellement n’est cependant pas synonyme de soumission, mais plutôt de curiosité, d’un d’inconfort pas complètement désagréable, occasion d’une échappée temporaire hors de l’hétéropatriarcat. Pour s’en extraire, l’on peut céder et se laisser séduire par autre chose, en l’occurrence un film dans le bar où l’on venait prendre un verre, et l’horizon pendant un moment est réfracté.

:: FM et ses amis dans une lumière impossible, travail de la directrice de la photographie Johanna Heer [Fett Film]

:: Christiana et ses grenouilles [Fett Film]
Au terme du visionnement, nous nous regroupons autour d’une table, nous demandant évidemment pourquoi la grenouille et comment les scènes d’émeutes ont-elles été tournées et réalisant que ce qui dégoûte l’un·e ne révulse pas l’autre (pour certain·e·s ce sont les images de violence, pour d’autres ce sont les bruits discordants). Après un silence nous attaquons la dernière question : qu’est-ce qui dans ce film est queer, finalement ? Car il n’y a pas de configuration romantique particulièrement subversive, de scène de sexualité explicitement queer. Bien que la nature de la relation entre FM et Christiana soit insaisissable, leur lien peut nous informer sur les diverses fluidités (relationnelles, de genre, d’orientation sexuelle, etc.) qui, lorsque laissées à elles-mêmes plutôt que disséquées ou disciplinées, peuvent se déposer en des formes amphibies. Le film protège, sans insister, le flou de cette relation. Les grenouilles omniprésentes, dont nous ne savions que faire, s’inscrivent aisément dans les paysages poreux du récit. Dans Decoder, sautillant chaotiquement dans l’appartement de Christiana, sans cage mais sans habitat non plus, elles conservent, avec leur genrage équivoque et leurs sexualités polymorphes, un rôle et une symbolique ambigus. Même le nom du personnage principal — FM — se laisse difficilement cerner. Rappelant les ondes radio, les bruits des appareils du protagoniste jamais tout à fait bien syntonisés, le nom « FM » renvoie aux limbes d’un grésillement. Mais le queer surgit avant tout dans Decoder par le rapport difficile à la norme, par l’action prise pour s’en défaire. C’est dans le rapport au pouvoir, dans le désir de désordre, de décoder et déconstruire les rouages des puissances normatives, sans en créer de nouvelles, que nous retrouvons une désertion queer du sens, en tant que repère solide et souhaitable.
Le filon du dés-ordre comme moyen d’indiscipline est nourri par l’écriture de Jack Halberstam au moins depuis son ouvrage The Queer Art of Failure [1], paru en 2011, où il creuse l’idée que l’art et la vie queers échouent à correspondre à des normes étouffantes, et que cet échec libère et permet d’imaginer d’autres possibles, d’autres façons d’exister, de s’extraire des injonctions du pouvoir. Devant les personnages de Decoder qui composent l’air d’un désaveu, je pense donc à Halberstam, théoricien des marges, du plaisir dans la ruine des normes, du choix de ne pas les reconstruire. Dans un article intitulé « Unworlding » [2], Halberstam s’intéresse aux esthétiques de l’effondrement, de ce qui apparaît en constant état de chute (des installations, des idées, des œuvres). Il appelle à considérer l’urgence de dé-faire le monde tel que nous le connaissons afin de mieux en imaginer d’autres, de se rappeler que les codes se décodent et se dissolvent. Apprendre à aimer la chute, l’échec en tant qu’action, peut s’avérer « une forme de résistance à la tyrannie absorbée à notre insu par nos esprits [qui] cherche à se dire entre le rire et le tragique, dans une éthique où l’erreur et le ratage deviennent des possibilités émancipatoires et engagées, qui n’ont rien à voir avec une forme de retrait ou de déni du politique » [3]. Dans le bruissement et la cacophonie des machines de FM, assemblant des sons troubles et troublants qui s’extraient des conventions du mélodieux, j’entends ce mouvement cherchant le son que ferait le refus d’une harmonie avec ce qui oppresse. De tels bruits provoquent et dévoilent finalement un dégoût non pas du vivant, mais des institutions et de leurs machines, leur violence. Le dégoût devient outil acide, rejet, renvoi des ordres à dérouter. Et cet outil, dans Decoder, n’est pas que métaphorique, puisque le film provoque une saturation sur les plans théoriques, narratifs et physiques.
Depuis le visionnement de Decoder je suis habité·e par son préfixe, « de », ou « dé » en français. Comme une nouvelle note, entre le do et le ré, dissonante, qui nous entraîne dans sa chute. Le dé- défait, décode, dégoûte. Le dé- signale « […] la cessation, la négation, la destruction de [quelque chose], l'action ou l'état contraire, inverse » [4]. Le dé- me suit depuis comme une note lancinante et légèrement désagréable, inconfortable comme les grincements des enregistrements superposés de FM. Finalement, le dé- se révèle une note indispensable pour une partition qui voudrait magnifier ce qui tombe.
[1] Jack Halberstam, The Queer Art of Failure (Durham : Duke University Press, 2011).
[2] Jack Halberstam, « Unworlding », Journal of Architectural Education, vol. 78, no 2 (2024), 272-276.
[3] Kev Lambert [à propos de Halberstam], « Est-on coupable d’écrire ? » dans Échecs et vomissements : réflexions sur l'insuccès comme mode de vie et philosophie (Montréal : Éditions Somme toute, 2023), 56.
[4] Définition du préfixe « dé- » tirée du CNRTL (Centre national de ressources textuelles et linguistiques) : https://www.cnrtl.fr/definition/dé-
*
Camille Bernier vit à Rimouski et chemine au doctorat en recherche-création. Son projet s’intéresse aux « accidents » dans l’écriture littéraire et la méthode scientifique pour penser une relation transdisciplinaire. Elle éprouve également l’accident créateur à travers la photo, le dessin, la musique et les zines. On peut lire ses textes dans Mailler les eaux (éditions de l’Écume, 2022), un carnet littéraire et scientifique qu’iel a codirigé, dans son recueil La main pose une question de gestes (éditions AURA, 2019), et dans des revues comme Possibles, Moebius et Lapsus. Sous différentes formes, son travail s’intéresse aux langages qui émergent lorsque la pensée achoppe.
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
