
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | à venir...

prod. Trashtown Pictures / Atypical Day
FUCKTOYS
Annapurna Sriram | États-Unis | 2025 | 108 minutes | Sélection 2025
Fucktoys ne perd pas son temps. Le film s’élance dès ses premières minutes dans le vibrant voyage qu’initie sa séquence d’ouverture campée dans un bayou louisianais, où les cartes de sa trajectoire narrative sont — littéralement — posées sur la table : une voyante (Big Freedia) devine dans une lecture de tarot l’apposition d’une grave malédiction sur la protagoniste AP (Annapurna Sriram), travailleuse du sexe au cœur tendre qui tentera d’amasser au fil d’une odyssée picaresque le millier de dollars nécessaire pour payer le rituel qui permettrait de contrer l’inquiétante damnation causée par ce « big sexy curse » (pour reprendre les mots d’une autre voyante rencontrée plus tard). Ce premier film d’Annapurna Sriram est le genre d’œuvre qui nous happe et qui nous enjoint à suivre, sourire aux lèvres, la progression viscérale et visqueuse de ses péripéties malignes et orgiaques, menées toujours par un envoûtant principe de plaisir, que celui-ci soit érotique ou esthétique, comme le suggère l’indéniable beauté plastique de son 16mm qui mime à la perfection la patine seventies de ses références de sexploitation.
Mais le film de Sriram est loin d’être un simple ramassis de ses sources d’inspiration. Il bricole à son tour un univers queer bien à lui, posant les balises spéculatives de la ville de Trashtown et transformant ses paysages louisianais en une réalité alternative où les policiers vêtus de jockstraps et de chaps de cuir donnent la fessée aux vieux bonhommes qu’ils arrêtent ; où les trottoirs remplis de déchets sont parcourus par des nettoyeurs en tenue quasi-nucléaire ; où AP réside dans une chambre aux meubles antiques installée au beau milieu d’un champ.
Ça contraste pour le moins avec le pseudo-naturalisme d’un film comme Anora (Sean Baker, 2024), comparaison facile à proposer non seulement pour l’attention partagée par les deux récits envers leurs protagonistes travailleuses du sexe mais aussi par leur déploiement effréné d’une logique de déambulation. Si Baker construisait son récit autour de l’incursion impossible d’Anora dans un milieu social qui s’évertuait à la repousser (entre autres celui de l’oligarchie russe de laquelle provenait le garçon rencontré), Sriram crée au contraire un monde au diapason d’AP, et ouvre l’espace d’une marge magnifique dans les décombres d’un réel dont le film se fout royalement. Il y aura du frottement, de la tension, du tragique, mais l’angle qu’emprunte son ton trashy est moins celui du dégoût et de la violence que celui de l’enthousiasme partagé des corps ouverts l’un à l’autre : comme lors de la rencontre d’AP avec Danni (Sadie Scott), ancien·ne ami·e dont les retrouvailles mènent à des confessions à cœur ouvert, partagées pendant que les deux personnages sont accroupi·e·s dans une baignoire et urinent dans la bouche d’un anonyme monsieur alors satisfait. En sortant de la projection, j’ai attrapé au passage quelques réactions balbutiées et entendu quelqu’un avouer : « Je crois que c’est un des meilleurs films que j’ai vus. » Et c’est précisément à ce genre de réponses qu’invite Fucktoys, en nous infusant de son propre penchant pour l’excès qui nous invite à ne pas refuser ses plaisirs. (Thomas Filteau)

prod. A.M.A Film
THE HOUSE WITH LAUGHING WINDOWS
Pupi Avati | Italie | 1976 | 110 minutes | Fantasia Rétro
Pendu par les bras, un homme nu hurle. Une figure mystérieuse lacère son corps maculé de sueur et de sang à coup de couteau, tandis qu’une voix caverneuse susurre sa litanie meurtrière compulsive. « Mes couleurs, coulant de mes veines. Douces comme l’automne, chaudes comme le sang. » Un piano dissonant accompagne cette danse morbide, que détaille un ralenti suffocant. L’image, délavée au point de paraître monochrome, possède la texture du cauchemar. Elle scintille d’une lueur troublante, sordide et lascive à la fois. On comprend vite que cette scène en a inspiré une autre, à caractère religieux celle-là ; une fresque représentant le martyre de saint Sébastien, peinte par un artiste maudit, qui sied dans une petite église de campagne employée comme charnier durant la Seconde Guerre mondiale. Le ton est donné. Bientôt, le souvenir d’une série de meurtres remonte à la surface ; et l’homme chargé de restaurer l’étrange tableau est mêlé bien malgré lui à cette sinistre intrigue.
Considérant ma propension à racler régulièrement les fonds de tiroir ainsi que le fond du baril à la recherche d’un quelconque giallo de troisième zone à me mettre sous la dent, il est tout de même étonnant que je n’aie pas vu La maison aux fenêtres qui rient de Pupi Avati jusqu’à aujourd’hui. Parmi les fans du genre, le long métrage de 1976 possède une réputation fort respectable — à laquelle n’a sans doute pas nui sa relative rareté, qui en a amplifié la carrure mythique au fil des ans. Il faut dire aussi que le parcours du cinéaste italien est somme toute atypique. Outre celui-ci, Avati est surtout connu pour des films tels que Zeder (1983) et Arcane Sorcerer (1996). Mais il en a tourné plus d’une cinquantaine, dont d’innombrables drames de mœurs « respectables » qui détonnent dans la filmographie d’un auteur généralement associé au registre de l’horreur.
Voilà qui explique peut-être le rythme placide, presque mortifère au gré duquel se déploie ce récit familier. La mise en scène d’Avati s’intéresse surtout à dresser le portrait d’une communauté rongée par le secret, plombée par le poids partagé d’un silence accablant auquel fait écho la violence aveuglante du soleil plombant. La maison aux fenêtres qui rient est un film qui faisande, se putréfie lentement. Peut-être, d’ailleurs, se complaît-il un peu trop dans cette langueur caniculaire. L’ensemble aurait sans doute gagné à être resserré, ici et là ; et on s’ennuie parfois de l’extravagance stylistique à laquelle nous a habitués le genre. Mais cette espèce de distance mesurée avec laquelle il semble en observer les codes, les lieux communs est loin d’être inintéressante. Une forme de lucidité émerge de l’austérité ambiante, comme si Avati cherchait à filmer la carcasse décharnée du giallo afin d’en exposer au grand jour les tourments et les obsessions. (Alexandre Fontaine Rousseau)

prod. Aiken Heart Films / Fork Tale / Conquering Lion Pictures
THE WELL
Hubert Davis | Canada | 2024 | 91 minutes | Septentrion Shadows
The Well situe son action dans un futur postapocalyptique imminent où un virus se propageant par l’eau décime une partie de la population mondiale, laissant l’autre assoiffée et brutalisée par les autorités qui contrôlent la distribution des ressources. Cette catastrophe n’est pas le noyau du film, mais sa prémisse : il nous en parle sans nous la montrer avant de se pencher sur ses protagonistes, Sara, une jeune adolescente et ses deux parents, qui vivent isolé·e·s dans une forêt et parviennent à survivre grâce à la présence d’un puit non contaminé sur leur terrain. Entre les deux adultes et Sara flotte le fantôme tabou d’un grand frère décédé, et de la menace persistante des envahisseurs.
Tout va très vite dans The Well : ces quelques informations, on les apprend dans le film à peu près aussi vite qu’on lit les lignes où j’en fais la description. La scène posée, voilà déjà que surgit un nouveau personnage, Jamie : un cousin de Sara qui a fui les camps de détention mis sur pieds par les forces de l’ordre pour contenir les foules. À peine Jamie arrivé, le filtre du puits se brise, obligeant les personnages à sortir de leur isolement. Les deux adolescent·e·s prennent donc la route en dépit de l’interdiction parentale pour rejoindre une petite communauté de survivant·e·s dans l’espoir de trouver là une solution à leur pénurie d’eau.
Avec une économie de moyens, The Well arrive à fabriquer sans mal une atmosphère de fin du monde. Pas d’esbrouffe ou de grands déploiements techniques : une palette grisâtre et les lumières ternes que le film affectionne pour sa cinématographie suffisent à construire un univers dense et crédible. C’est sans doute parce que le réel dont il parle n’est pas très éloigné, au moins dans son esthétique, de celui que nous habitons. Les hôpitaux abandonnés, les usines désaffectées, les tours d’immeubles en décrépitude et les paysages dévastés existent déjà, il suffit de tourner la caméra vers eux. D’une certaine façon, The Well fait confiance à la laideur du monde actuel, et ça lui réussit.
Quiconque voudrait passer une heure et demi devant un exercice filmique maîtrisé, à la facture très léchée et classique, aurait trouvé son compte en sortant d’une projection de The Well. Iel aurait la satisfaction de se faire indiquer par la musique à quels moments être ému·e, angoissé·e, et le plaisir confortable de se lover dans un dispositif narratif familier. Rapidement, l’intrigue devient lassante, reconnaissable — sans doute pour avoir été explorée ad nauseam dans les fictions apocalyptiques des cent dernières années. La communauté rejointe par Sara et Jamie est influencée par une gourou aussi impitoyable que maternelle qui n’hésite pas à invoquer des arguments communisants pour créer un esprit de corps malsain dans le groupe. Heureusement, des membres dissidents se rebellent contre ce contrôle coercitif et la manipulation psychologique sur laquelle il repose… etc., etc. On connaît cette trame et le fond idéologique usé qui la sous-tend. Heureusement, tout se termine bien (ou presque), dans l’harmonie de la cellule familiale désormais élargie.
Dans son livre A Paradise Built in Hell, Rebecca Solnit fouille les archives historiques (majoritairement nord-américaines) avec pour objectif de déconstruire le mythe tenace selon lequel les gens ont une propension à s’entredévorer en temps de crise. Donnant plusieurs exemples, elle démontre que c’est souvent la solidarité et l’entraide qui émergent spontanément lorsque tout bascule. Si The Well me ramène à ce livre, c’est que l’un des postulats de Solnit insiste sur la nocivité des récits postérieurs qui mettent l’accent uniquement sur le chaos et l’égoïsme dans leurs représentations de la crise. L’aide mutuelle est un muscle, et c’est par l’imaginaire qu’on l’exerce et le renforce. Je ne suis pas à la recherche de fictions pastorales naïves, mais qui a encore besoin de se faire seriner ce que The Well place en son centre discursif ? Personnellement, j’ai soif d’autre chose, et j’ai envie d’aller puiser ailleurs mes images de l’après. (Laurence Perron)

prod. Vandalism Co.
I FELL IN LOVE WITH A Z-GRADE DIRECTOR IN BROOKLYN
Ken’ichi Ugana | Japon | 2025 | 86 minutes | Cheval Noir
Suite à une série de courts métrages (Moja [2019], Extraneous Matter [2021], Visitors [2021]) l’ayant placé sur la mappemonde du cinéma de genre, le prolifique réalisateur japonais Ken’ichi Ugana semble déjà s’être enlisé dans une phase autoréférentielle et autosuffisante, où la question de son propre succès (d’une échelle toute relative) est dramatisée et mise en relation avec une cinéphilie sans cesse référencée (Kaufman, Romero, Argento, Tsukamoto, Miike, etc.). Car il faut que l’on comprenne ici qu’on est devant un cinéma de fan pour les fans… mais encore faudrait-il s’essayer au cinéma, plutôt que de simplement énumérer le panthéon des grands.
Son film précédent, The Gesuidouz (2024), se penchait sur la carrière d’un band punk obsédé par le cinéma de genre. Dans I Fell in Love, Ugana continue sur la même lancée et met en scène la rencontre entre Shina (Ui Mihara), une actrice japonaise en visite à New York et un jeune technicien de Brooklyn nommé Jack (Estevan Muñoz) qui réalise son premier film en MiniDV, où s’affrontent tueur de slasher et fantôme de la J-horror. Tout le reste est dans le titre.
Ce fantasme adolescent est présenté sans recul : I Fell in Love with a Z-Grade Director souffre de ses personnages narcissiques et immatures dont les travers relationnels sont supposés être attachants sous prétexte qu’une passion dévorante pour le cinéma de genre pourrait tout excuser. Cette qualité enfantine se dégageait ailleurs dans la filmographie d’Ugana, mais elle demeurait sympathique. Ici — et peut-être parce qu’il s’agit d’un tournage bilingue en territoire étranger — l’univers de I Fell in Love est moins convaincant. Ses jeunes rebelles sont des ados costumés de chandails « I Love New York » maculés de sirop de maïs et leur enthousiasme s’avère être leur seul trait de personnalité. Pire encore, les seuls films à l’affiche dans les innombrables salles de New York sont ceux… de Ken’ichi Ugana.
I Fell in Love se rachète quelque peu par sa raison d’être : évoquer les joies du cinéma fauché et des liens qui naissent de sa création. C’est parce que le cinéaste s’amuse visiblement tant à faire ce film qu’on ne lui en veut finalement pas plus qu’il faut. On y décèle également le germe d’une critique du modèle de production japonais duquel Ugana est issu. Shina, introduite d’emblée désabusée et plaignarde, gagne en joie de vivre en tournant enfin un film pour la seule beauté du geste. C’est finalement ce sourire retrouvé qui force à reconnaître le cœur du projet, même si l’on souhaiterait qu’Ugana canalise finalement cet amour vers quelque chose de moins nombriliste… et qu’il fasse davantage de ces genres que nous aimons tout autant. (Ariel Esteban Cayer)

prod. Cattet-Forzani / Kozak Films
REFLET DANS UN DIAMANT MORT
Hélène Cattet et Bruno Forzani | Belgique, Luxembourg, Italie, France | 2025 | 87 minutes | Sélection 2025
Après leurs plongées dans les eaux du giallo (Amer [2009], L’étrange couleur des larmes de ton corps [2013]) et du western spaghetti (Laissez bronzer les cadavres [2017]), le duo belge Hélène Cattet et Bruno Forzani reste fidèle à son projet d’implosion kaléidoscopique du langage filmique du cinéma de genre, en s’attardant dans ce nouvel opus à délier les mailles du film d’espionnage. On retrouve bel et bien une trame initiale, une situation d’accroche, celle de John Diman (Fabio Testi et Yannick Renier, partageant le rôle entre les deux époques de sa vie), espion vieillissant installé dans un hôtel côtier où avait mal tourné une mission accomplie quelques dizaines d’années plus tôt. Mais cette piste s’avère rapidement labyrinthique, et la possibilité d’une progression narrative ne fait que s’estomper au fil d’une infinie course-poursuite mémorielle qui brouille constamment les pistes entre le souvenir et le lieu à partir duquel il est généré. Et cet investissement primaire dans le tissu de la mémoire s’avère une stratégie parfaite pour creuser la question de la subsistance de formes cinématographiques de série B qui se fait le fondement du travail de Cattet et Forzani.
En se débarrassant de l’ambition narrative qui marquait leur dernier film (et il faudrait ici entendre par ambition quelque chose de plus banal : le désir simple, car habituel, de raconter une histoire linéaire), Reflet dans un diamant mort assume pleinement son statut de pur objet de plaisir scopique et d’érotisme cruel. La première séquence propose un superbe jeu de transition qui fait se succéder, par le regard désirant du vieil espion sur une jeune femme en maillot allongée sur la plage, le spritz versé dans le verre de l’un à la marée montante dont l’écume se dépose sur le corps de l’autre. Entre l’image qui fait contraste et celle qui traverse, entre ce qui tranche — talon haut muni d’une lame, bague en diamant cisaillant une joue — et ce qui fait passage — gadget permettant d’observer à travers les murs, portrait dont les yeux dissimulent un véritable regard humain — la grammaire usuelle de l’espionnage souligne la manière dont le cinéma de Cattet et Forzani s’intéresse avant tout à créer des moments de glissement esthétique, à partir d’une tension répétée entre la fluidité de leur montage et la violence de leurs coupes franches. Les corps aussi deviennent des cloisons à franchir, une accumulation hypnotique de masques et de combinaisons, de peaux qui, transpercées, en révèlent une seconde. Reflet dans un diamant mort canalise finalement son attention sur la tension entre alliance et rivalité, cumulant les double-jeux et les agents doubles dans les trajectoires partagées entre le protagoniste et sa rivale, la fugitive Serpentik (Maria de Medeiros, entre autres) qui, dans sa combinaison noire, rappelle immédiatement le culte Danger Diabolik de Mario Bava (1964). Ce sont leurs chassés-croisés qui permettent finalement au film de poursuivre le mode de sa surenchère par la relecture de la relation classique entre l’espion à la masculinité dignifiée et son amante qui n’attend qu’à le trahir, devenue ici un lien abstrait entre les deux personnages qui trouvent une complétion mutuelle dans l’antagonisme. C’est à travers cette insistance thématique que le film peut alors prendre une forme qui problématise sa source esthétique d’une façon plus explicite que les œuvres précédentes du duo, et qu’il réussit à se déplacer, agile, sur la fine ligne entre hommage et réécriture. (Thomas Filteau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2025
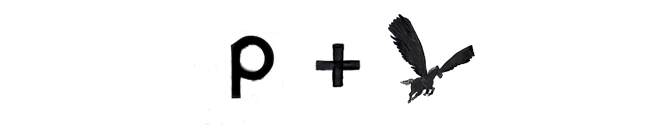
PARTIE 1
(Rewrite, La mort n'existe pas,
The Wailing, Sweetness)
PARTIE 2
(Every Heavy Thing,
Luuci, Contact Lens,
Good Boy, Cielo,
The Devil's Bride)
PARTIE 3
(Fucktoys, I Live Here Now, The Well,
I Fell in Love with a Z-Grade Director,
Reflet dans un diamant mort)
PARTIE 4
(Tie Man, Buffet Infinity,
The Woman,
The Virgin of the Quarry Lake)
PARTIE 5
(Messy Legends, Hostile Takeover,
Looking for an Angel,
Mother of Flies)
PARTIE 6
(à venir...)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
