

prod. Alexandre Larose
III.
Alexandre Larose | Québec | 2022 | 35mm | 11 minutes | Compétition internationale
De la main découle l’idée de poigne. Elle saisit, caresse, et accompagne l’enfant lors de ses premiers pas. Bientôt, elle devient étreinte, mais en se resserrant, elle bascule soudainement vers la fermeté masculine. Elle rassure en menant le tango, mais oppresse en contrôlant l’échange, refusant aux doigts adverses de pianoter. Lorsque les sillons se creusent entre les métacarpes et que le duvet qui les recouvre s’épaissit et grisonne, la poigne devient résistance, elle empêche l’affaissement, point d’appui sur la canne, le bras de chaise ou la rambarde de l’escalier. Elle garde pourtant en mémoire la tendresse des débuts, l’autorité adulte et la douceur fragile de l’âge, l’idée du père en quelques 27 os déployés sous un épiderme fragile. C’est ce geste, matrice conceptuelle et tactile, qui constitue la répétition centrale du troisième épisode (sobrement intitulé III.) des Scènes de ménage d’Alexandre Larose.
Le réalisateur y filme son père Jacques qui descend vers le jardin. Jacques regarde par la fenêtre, traverse la terrasse de bois occultée par une chaise, puis s’engage dans l’escalier avant de disparaître. Il rentrera plus tard pour se rasseoir sur cette même chaise, l’a-t-il jamais quittée ? L’exercice de description est absurde pour aborder le cinéma de Larose tant celui-ci se concentre sur l’insignifiant — encore dans cette série — pour faire émerger, à partir du plus petit détail, des images en arpèges qui étendent, déploient, complexifient un seul mouvement pour composer une symphonie visuelle. On ne peut décrire la technicité du travail effectué ici tant Larose est devenu maître en son propre monde, nous confrontant à une virtuosité analogique qui désarçonne jusqu’au plus aguerri des regards. Imaginez-vous le public d’un festival de cinéma expérimental, perdu à la frontière de Détroit et de Windsor, dont la moitié possède sa propre Bolex, et qui sort pourtant de la salle en se demandant « How the hell did he do that? ». Je me permettrais de caricaturer (pardonnez-moi) le procédé du cinéaste-ingénieur comme suit : pousser la surimpression à son extrême en répétant le même mouvement un nombre indéterminable de fois jusqu’à obtenir une masse de lumière qui condense temps passé, temps présent et temps à venir.
Mais ce qui trouble le plus dans III., c’est que Larose perfectionne sa pratique et parvient à faire oublier l’aspect prodigieux de son travail pour nous transmettre, dans ce qui m’apparaît être la plus aboutie de ses œuvres, la vérité d’un regard. Car le film met le celluloïd au service d’une sensibilité : la main effleure l’espace et raconte l’éventail d’émotions qu’incarne la figure du père. La fluidité imposée de la technique dit l’admiration et la colère, la mémoire de l’enfance et la peur de vieillir d’un fils filmant son reflet déformé et déformant. Je projette ici beaucoup de ma propre relation avec mon géniteur, mais ce biais interprétatif révèle, il me semble, la substance d’un film qui ne parle pas de Jacques mais de « papa », un ange monstrueux dans lequel chacun superpose ses souvenirs et ses espoirs. Larose parvient ainsi à faire ressentir les heures passées à filmer et refilmer ce père, un temps filmique mais avant tout humain qui transmet avec pudeur l’intimité d’un échange. De là naît la possibilité d’investir le film de notre propre rapport à la main paternelle. A l’issue de la projection, je regarde le ciel noir de Windsor, et j’y vois apparaître quelques phalanges tachées de tabac. L’invitation de Larose me ramène alors à l’état le plus primaire de la critique, me poussant à céder au superlatif : « Ai-je vu là l’une des plus belles lettres d’amour à un père de l’histoire du cinéma expérimental ? » (Samy Benammar)

prod. Tetsuya Maruyama
ANTFILM
Tetsuya Maruyama | Japon / Brésil | 2020 | Super 8mm | 3 minutes | Compétition internationale
Je sors étourdi du premier programme compétitif du Festival, ne sachant pas dans quel ordre encenser les films de cette impressionnante sélection. Par-delà la splendeur des Bouquets de Rose Lowder, la virtuosité du III. (2022) de Larose, l’intensité du Camera Test (2022) de Fruhauf, précédant l’expérience quasi-religieuse qu’est earthearthearth (2021), l’odyssée cosmogonique d’une demi-heure de Daïchi Saïto, un film, d’apparence insignifiant, me reste en tête. Comment ANTFILM, film-fourmi, est-il parvenu à faire durer en moi son impression sans être piétiné par les géants ? La réponse a quelque chose à voir avec la biologie surprenante de l’insecte, capable de soulever des charges largement supérieures à son propre poids.
ANTFILM est le seul film du programme sur support Super 8 mm, une technicalité qui n’est pas sans conséquence sur l’expérience ; la mise en place du dispositif par le projectionniste crée un temps mort qui fait durer l’anticipation ; et lorsqu’il apparaît, le rectangle lumineux ne couvre qu’une portion réduite au centre de l’écran. À intervalles réguliers, un clignotement de fourmis mortes perce le noir du film opaque. Photographiées à même la surface du film, elles se manifestent, corps tordus, chacune incrustée dans son photogramme comme dans de l’ambre, dans un bruit blanc et syncopé qui reproduit le rythme de la piste image.
Le geste n’est pas sans rappeler celui de Mothlight (1963), mais le film ne se laisse pas réduire à un ersatz de Brakhage. ANTFILM se distingue par la manière dont il embrasse la matérialité du 8 mm (sa petitesse, son humilité, sa qualité rudimentaire) et par la cohérence structurelle qui en résulte. C’est dans sa poétique du minuscule que le film puise sa force et parvient à s’imposer sur grand écran comme une curiosité morbide et redoutable. (Philippe Bouchard-Cholette)

prod. Pablo Mazzolo
THE NEWEST OLDS
Pablo Mazzolo | Argentine | 2022 | 15 minutes | Compétition internationale
The Newest Olds, le dernier court métrage expérimental du cinéaste argentin Pablo Mazzolo est un poème urbain de 15 minutes dont le protagoniste principal n'est pas un lieu ou un paysage, mais plutôt l'espace liminal de la frontière. Ici, la notion de frontière s’envisage physiquement comme le point entre deux villes, Windsor et Détroit, et deux pays, les États-Unis et le Canada. Mais elle est également conceptuelle, se situant entre différents états d’esprit, différentes politiques.
Quel sens accorder au geste de cinéma dans un monde défini par la violence des États-nations, où l’urbanisme dévore les écosystèmes naturels et où les voix humaines sont absorbées par le capitalisme, le béton des murs et les gratte-ciels aux proportions démesurées ? Quoi de neuf dans The Newest Olds ?
Exploration virtuose et viscérale de la lumière et du paysage dans une approche matérielle de la pellicule, le film est une recherche de l’impossible qui crée un espace cinématographique singulier. Dans les mots du cinéaste : « Shooting the impossible of the real. »
Une séquence récurrente nous confronte aux paysages urbains emblématiques de Détroit du point de vue de Windsor. Nous transportant sur une scène de théâtre, les frontières deviennent un spectacle au gré de la pulsation des bâtiments que provoque les surimpressions frénétiques. Pour produire ces images, Mazzolo travaille par un montage intuitif effectué in camera ou sur tireuse optique.
Tourné en super 16 et en 35 mm, The Newest Olds assemble des couches provenant de différentes pellicules, fusionnant des environnements urbains et naturels, des archives audios et des paysages sonores actuels en une sculpture mobile et fluide, une symphonie célébrant « the memory of the motor city and its present », qui ne manque pas de susciter des interrogations sur l'avenir de notre humanité. (Ralitsa Doncheva)

prod. Narcisa Hirsch
WORKSHOP
Narcisa Hirsch | Argentine | 1974 | 16mm | 11 minutes | Rétrospective Narcisa Hirsch
Née en Allemagne, élevée à Buenos Aires et actuellement installée en Patagonie, Narcisa Hirsch est une pionnière et une légende du cinéma et de l’art expérimental. Initialement formée à la peinture, elle est ce que son petit-fils Tomas Rautenstrauch décrit comme une « famously unknown artist », ayant toujours préféré l'intimité de son domicile et les contextes informels, voire clandestins, pour partager ses films en « mangeant de la crème glacée » avec ses ami·e·s après les projections. Rautenstrauch, directeur de la Filmoteca Narcisa Hirsch à Buenos Aires, présentait mercredi soir la rétrospective Come Out: Films of Narcisa Hirsch, un programme de courts métrages récemment restaurés et soigneusement sélectionnés.
Les films de Hirsch sont des explorations sensuelles, conceptuelles et politiques de la notion de corporalité ayant pour personnage central une « bouche » anatomique et cinématographique. A-Dios (1989), par exemple, est un film disloqué qui se compose de fragments d’images d’individus proches de la cinéaste, et vise à réfléchir le corps masculin. Canciones Napolitanas (1984) se construit, quant à lui, autour du gros plan d'une bouche féminine teintée de rose qui se mord les lèvres, puis dévore la carte postale d’un bord de mer. Workshop (1974) clôturait le programme en nous ramenant dans l’intimité du studio de l’artiste.
Au cœur de l’image 16 mm, on aperçoit la photographie d’une chambre dont la fenêtre donne sur la mer. À côté de celle-ci, le portait d’un singe retient l'attention. Puis, un papillon, peut-être deux. Au-dessus, les portraits des trois enfants de l'artiste dans une baignoire. Plus bas, l’image délavée d’une mer en noir et blanc. Le bruit croustillant d'une bouche qui mâche, suivi d'un léger rire. Une voix masculine demande : « Do you mind if I light up a cigarette ? » Narcisa lui répond : « Please, light one up for me, too. » Ici, l'œil devient bouche, puis oreille. Rien ne bouge, si ce n'est la lumière rouge d'un coucher de soleil projetant une ombre dans l'esprit de celui qui regarde.
Inspiré par A Casing Shelved (1970) de Michael Snow, un film dont Narcisa Hirsch aurait seulement entendu parler, Workshop est une méditation immobile de 11 minutes. Guidé par la voix de la cinéaste décrivant son studio à un compagnon, le film dévoile lentement l'architecture d'une pièce en ne montrant que l’image d’une portion de mur.
Par son travail formel minimaliste, le film s’inscrit clairement dans la tradition dite structurelle et réfléchit, sur le mode de la suggestion, à l'appareil du cinéma en soulignant l’écart entre les images et les mots, le langage et la vision. Le cinéma se révèle ici comme un espace imaginaire entre le visible et l'audible, ce que nous percevons, ce dont on se souvient et ce que nous ne pouvons qu'imaginer. Hirsh nous invite à penser l'acte de création de manière ludique et nous laisse avec cette question : d'où viennent les images et où vont-elles dormir après le générique ? (Ralitsa Doncheva)
* Le film sera présenté à l'occasion de la rétrospective Narcisa Hirsch: Poetics from Patagonia le mardi 14 novembre à 19h30 à la lumière collective, en collaboration avec le Media City Film Festival.
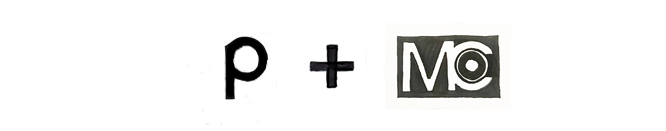
PARTIE 1
(III., ANTFILM,
The Newest Olds, Workshop)
PARTIE 3
(The Secret Garden, Mast-Del,
The House Is Black, Super 8 Constellations)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
