

LES ARTS DE LA PAROLE
Olivier Godin | Québec | 2016 | 93 minutes | Focus Québec/Canada
« Tout a été dit, disait Gilles Vigneault, mais pas par moi. » Voilà un aphorisme qui s’appliquerait bien à l’œuvre inqualifiable d’Olivier Godin. Koroviev. Le Maître (et la Marguerite). Margerie. Couché dans son sang connaissance. Total. Rival. Ami. Le Russe. Un flic au cache-œil. Un nuage a tranché. Un regard unique. Il aime les fleurs et les cimetières. Ce qui pousse et qui repose. Et, une fois semaine, les films japonais. Le Québécois. Maître chanteur. Blogueur. Préférant le Portugal à Charlevoix. Jean-Philippe O’Byrne (ou Auburn). Chef de section alcoolique et suicidaire. Cours de poésie québécoise aux policiers. Cultivons l'ordre. Boit comme un trou et sacre comme un charretier. La Charrette. Le Saint-Élias. Un bateau qui a échoué. Joual vert. Le capitaine Pierre Maheu (parti pris fondateur) a annoté, avant sa mort, mystérieuse, une Bible. (En) quête de Koroviev. Bon Dieu ! Il a créé Adam qui joue du free jazz. Liberté. Disponibilité. Ouverture. Communication. Mais il ne connaît pas son créateur. Le pays ne connaît pas son passé. L’homme reste toujours debout. Le pays devrait faire comme lui. Mais non… il plie, il flanche, il rampe. Et il ne se souvient de rien. Un adjuvant enfermé peut mener Koroviev au Livre. Clément dit vrai. Contacte Coriandre. Fraîche. Jeune comédienne rate de bibliothèque. Jeanne-Mance encore vierge à la perle qui susurre Aux jours de Maisonneuve de Laure Conan. Entrecoupé de chants turoldiens et de Cantiques érotiques. Arrière-petit-fils des Anciens Canadiens. Si l’un récite Loranger, poète oublié, l’autre cite L’Oublié, d’Angers. Félicité. (Pour un Québec) « Plus fort ! » Koroviev s’attache et s’entiche. Mais elle chuinte et suicide. Chalut, au passage, qui se crosse, semble-t-il, en pensant au Premier Ministre, charge et change avec Clément. Homosexuel revenant voir sa femme qui prend sa tapette en main. Il crèvera, prostré, d’un cancer. Meurt aussi la brigade des policiers poètes. Coupes budgétaires. Le chef se suicide itou. Impact de l’austérité. On retrouve la Bible. Il l’appelle son fils. Et là-dessus, Godin jette une de ces lumières aveuglantes de clarté. Fiat lux. Création d'un monde de sons et d’images et à sa ressemblance. Comme disait Mr Northop (Frye) : « This is not the way I could imagine it ». (Jean-Marc Limoges)

DOGS
Bogdan Mirica | Roumanie | 2016 | 104 minutes | Compétition internationale
À qui appartient ce pied ? Où se trouve le corps de son propriétaire ? Qui l’a tué ? Pour quelles raisons ? Qui était donc ce grand-père dont tout le monde parle et qui était « un bon patron, oui, un bon patron » ? Comment s’est-il acheté ces incommensurables acres de terrain ? Qu’y faisait-il ? Dans quelles implications mafieuses trempait-il ? En quoi la police était-elle impliquée ? Imaginez un thriller policier. Mais un thriller policier qui ne se passe pas à la ville, la nuit, sous la pluie. Un thriller policier qui se passe plutôt dans un immense champ de blé, en plein jour, sous un soleil torride. Un thriller dans lequel il n’y a ni vamp, ni héros, ni victime, ni coupable, ni mobile, ni alibi, ni poursuite, ni fusillade, ni arrestation, ni dévoilement, ni explication. Un thriller dans lequel il n’y a même pas de scène de cul. Un thriller dans lequel il n’y a pratiquement pas de gros plans, ni de zooms appuyés, ni de montage frénétique, ni de musique tonitruante. Un thriller dont les personnages, rarement cadrés de près, mais toujours par une caméra discrètement flottante, évoluent dans une suite de plans d’une durée sans fin. Un thriller dans lequel les chiens enragés s’appellent Police, et la police, tirant comment elle l’entend quand elle l’entend, crache piteusement le sang. Un thriller dont on a réduit les mécanismes du genre à leur plus simple expression et devant lequel, malgré cette épuration, vous n’arriverez pas à décrocher. Un thriller sans surenchère. Un thriller minimaliste. Mais pour un maximum d’émotions. (Jean-Marc Limoges)

L'EFFET AQUATIQUE
Sólveig Anspach | France | 2016 | 83 minutes | Les incontournables
Il l’aperçoit dans un bar, alors qu’elle congédie fièrement un mec ; elle est maître-nageuse, pour la retrouver, il s’inscrit à un cours de natation, même s’il sait déjà nager. À partir de cette prémisse de comédie romantique tout ce qu’il y a de plus classique (ce sempiternel thème du mensonge et de l’amour), Sólveig Anspach tire un film assez surprenant, qui n’a cesse de changer de directions, entre poésie et burlesque, pour mieux suivre les hésitations maladroites de ses personnages. On passe de Montreuil à l’Islande, on suit un congrès international de maître-nageur, on perd la mémoire, on fait des projets de piscine israélo-palestinienne, l’accumulation de ces péripéties saugrenues n’est pas sans séduire, mais en retour rien ne semble développé au-delà d’un gag sympathique, ni la vague satire de la bureaucratie, ni le choc entre les cultures. La cohérence de l’ensemble tient avant tout aux deux interprètes principaux : Samir Guesmi, avec sa gueule rêveuse, ou perdu, on ne sait jamais trop s’il est conscient de ce qu’il fait ou s’il se laisse porter par l’intuition du moment, et Florence Loiret Caille, résolue, libre, mais pas moins perdue, à la recherche d’elle-même, deux êtres qui, comme dans toute bonne comédie romantique, doivent d’abord se retrouver eux-mêmes avant de se retrouver ensemble. Le charme opère, certes, ce qui suffit bien à nous accrocher un sourire au visage, mais le film peine à prolonger ce plaisir somme toute bien superficiel au-delà de la projection. (Sylvain Lavallée)
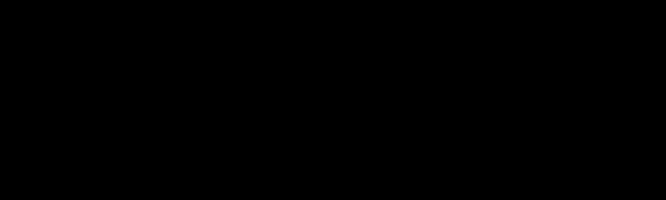
I HAD NOWHERE TO GO
Douglas Gordon | Allemagne | 2016 | 100 minutes | Les nouveaux alchimistes
À l’instar de son Zidane, un portrait du XXIe siècle (2006) (peut-être l’un des meilleurs films dudit siècle), I Had Nowhere to Go de Douglas Gordon défie toute catégorisation. Et s’il faut absolument tracer un parallèle entre ces œuvres, disons simplement qu’elles concernent toutes deux l’étude de la représentation, facilitée ici par l’absence quasi totale d’images. En effet, le présent film se résume presque exclusivement au spectacle d’un écran noir, rarement ponctué d’images furtives (parfois thématiques, parfois contrapuntiques). Sur la bande sonore, le cinéaste et intellectuel lituano-américain Jonas Mekas narre le récit de sa vie, structuré comme une série non chronologique d’entrées de journal. Nous découvrons ainsi l’Europe de la Deuxième Guerre mondiale et le New York des années 50, comme bercés par les paroles du vieil homme, rare survivant d’une génération « déplacée ». Évidemment, ce type de structure renvoie directement aux diary films du sujet (Diaries Notes and Sketches, Reminiscences of a Journey to Lithuania, As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty...), classiques du cinéma expérimental auxquels on dérobe ici le pouvoir d’évocation visuel. Forcés de nous rattacher presque uniquement à la narration en voix off (et aux effets sonores contrapuntiques) comme fil d’Ariane, nous en arrivons finalement à constater la superficialité de l’art cinématographique en tant que vecteur de monstration. Comme le dit Mekas lui-même (en écho d’ailleurs à Mike Hoolboom, qui abordait la question dans son We Make Couples), le 20e siècle a vu la naissance quasi simultanée de la psychanalyse et du cinéma, l’un offrant une connaissance superficielle, et l’autre profonde de son sujet d’étude. Évoquant ici l’idée de profondeur via la simple noirceur de l’écran, le film nous contraint en outre à adopter une position interprétative quant aux paroles de Mekas. En d’autres mots, il nous contraint à invoquer nos propres images, dénonçant ainsi la connotation consensuelle des images hollywoodiennes, proposant plutôt une expérience unique à chacun de ses spectateurs, lesquels se feront tous leur propre film. En somme, si I Had Nowhere to Go nous permet de réfléchir, réfléchir sur le cinéma, sur l’histoire, sur l’idée de représentation, sur la psychologie, c’est surtout parce qu’il nous abandonne à nous-mêmes. Certains diront qu’il s’agit là d’une forme de paresse chez l’auteur, et d’autres crieront au génie. Une seule chose est sûre, c’est que le film constitue un triomphe d’anticonformisme, empêchant par sa seule structure toute interprétation consensuelle, relançant ainsi le débat sur la nature du cinéma, amorcé plus tôt, et poursuivi ici par l’hypnotique Jonas Mekas. (Olivier Thibodeau)

THE ORNITHOLOGIST
João Pedro Rodrigues | Portugal | 2016 | 118 minutes | Les Incontournables
« Certaines choses adviennent, il suffit d’y croire »
— Saint Antoine de Lisbonne.
João Pedro Rodrigues a su se renouveler au cours de sa trajectoire : cet ex-étudiant en biologie, devenu étudiant en cinéma — sous l’égide, entre autres professeurs, de Paulo Rocha — est devenu cinéaste affirmé. Son cinquième long métrage, The Ornithologist, dépouille les thèmes de spiritualité et de révolution intérieure qui lui sont récurrents, et s’inspire de Saint Antoine, une figure essentielle du catholicisme au Portugal qui, au fil du temps, « n’a cessé de se transformer ». Une fête nationale porte le nom de ce saint né à la fin du 12e siècle et vivant de simplicité évangélique en communion avec la nature ; elle détermina déjà le titre d’un court métrage de Rodrigues daté de 2012 (Matin de Saint Antoine). Ici s’arrête la comparaison entre les deux films, on peut toutefois considérer Saint Antoine comme une figure inhérente à la culture portugaise, et précieuse pour le cinéaste. Conte mythique contemporain abordant avec humour et réalisme fantastique le fanatisme chrétien et les sacrifices rituels, The Ornithologist raconte l’histoire de Fernando (Paul Hamy), un ornithologue sous trithérapie, parti en solo au cœur de la forêt, à la recherche de trop rares cigognes noires. Tandis qu’il observe la créature à l’aide de ses jumelles, la distraction emporte momentanément son kayak dans le courant, et perdant le contrôle, ce dernier chavire. Au même titre que Saint Antoine fût sauvé par les Franciscains de Messine lorsque son embarcation dériva sur les côtes de la Sicile, Fernando sera sauvé des eaux, épargné d’une mort certaine, ses sauveteurs substitués par un duo de Chinoises en pèlerinage vers Compostelle. De drôles de rituels se profilent dans la forêt environnante, entre la mascarade et le supplice. Ayant perdu leur chemin et dérivée dans la région de Douro — non loin de la frontière espagnole —, les deux adoratrices, en bonnes fanatiques, séquestrent Fernando qui fait désormais office de catalyseur rédempteur. Dépossédé de son équipement et privé de ses médicaments, Fernando entame une lente métamorphose. Les scènes d’érotisme homosexuel en plein air apportent une sensualité substantielle qui n’est pas sans nous rappeler L’Inconnu du Lac (Alain Guiraudie, 2013) ; ayant un charme et une grâce similaire à ce que l’on trouvait à Pierre Deladonchamps, Paul Hamy y paraphrase « le désir », celui ressenti par son personnage pour son partenaire de jeu, mais également celui du cinéaste envers son acteur. Rodrigues, en choisissant ses acteurs, part toujours d’un « désir non consommé qui se consomme dans l’acte de filmer ». The Ornithologist est un voyage physique naturaliste doublé d’un cheminement spirituel de transformations intérieures. Il souligne de façon mystique, folklorique et grotesque, le contraste fascinant entre corps physique et élévation spirituelle dans la symbolique religieuse qui cherche à « traduire en images ce qui est fondamentalement transcendantal », allant jusqu’à la transfiguration des corps de ses protagonistes… Fernando sera bientôt rebaptisé « Antoine ». (Anne Marie Piette)

SPARK
Stephen Shellenberger | Québec | 2016 | 85 minutes | Focus Québec/Canada
S’efforçant ici de décrire la paranoïa de son alter ego diégétique, coincé au milieu d’une intrigue de surveillance électronique aux allures familières, Stephen Shellenberger prouve plutôt sa propre folie des grandeurs. Bien qu’il parvienne savamment à transcender les limitations budgétaires de son œuvre, misant sur une facture onirique et un ton personnel, les implications de son récit dépassent largement la simple anecdote. Convaincu qu’il est traqué par un « sick, sick group of people », Michael (Shellenberger) est un homme défait, errant dans les rues de Montréal à la recherche des responsables de son calvaire. Retrouvant finalement la trace d’une érudite nommée Rose, celle-ci lui révèle, à l’occasion d’un échange sidérant, que le père de son ex-copine disparue est en fait un scientifique militaire travaillant sous le continent antarctique, et que c’est lui qui l’a fait prendre en chasse afin de lui dérober son âme. Michael se convainc alors du bien-fondé de ses peurs, et livre un long poème lyrique à propos de la conformité et des dérapages de la technologie. Certes parfaitement outillé pour la livraison dudit poème (faîte de l’expressivité diégétique), il l’est beaucoup moins pour l’exposition dramatique du récit, car il s’agit bel et bien ici d’un film dramatique auquel nous assistons ici. Les appellations « film d’art » et « film expérimental », bien qu’elles décrivent adéquatement une certaine excentricité formelle chez l’auteur, ne sont pas aptes à décrire son film, lequel ressemble plutôt à une fiction estudiantine (une exceptionnelle fiction estudiantine, mais une fiction estudiantine néanmoins). La bande sonore est d’une monotonie exemplaire et le recours à d’innombrables lieux communs du cinéma de genre torpille toute prétention à la plausibilité du récit. L’échange entre Michael et Rose, filmé à l’aide d’obscurs champs-contrechamps, tient quant à lui du pur délire de création littéraire, nous distançant encore plus de la réalité tangible de la surveillance électronique. Or, malgré ses lacunes scénaristiques, l’auteur se révèle pourtant un expert pour filmer l’intimité, multipliant les plans suffocants de son visage éploré, si bien qu’on aurait souhaité qu’il circonscrive son récit, pourtant opportun, à sa seule personne, nous évitant ainsi l’abrasive parade d’activistes anti-cellulaires, de hackers paranoïaques et de professeurs fous ici présents, pâles reflets d’archétypes hollywoodiens. (Olivier Thibodeau)
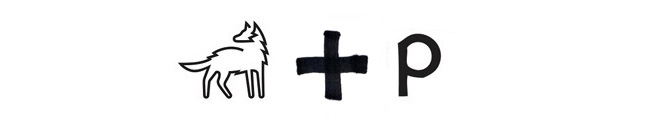
PRÉSENTATION
OUVERTURE : TWO LOVERS AND A BEAR
JOUR 1
(Alipato, Death in Sarajevo, Diamond Island, Je me tue à le dire,
Safari, Sixty Six, The Death of J. P. Cuenca, Welcome to Iceland)
JOUR 2
(Déserts, Late Shift, Lost and Beautiful,
Maquinaria Panamerica, The Last Family)
JOUR 3
(Daguerrotype, Director's Cut, Sur les nouveaux alchimistes,
Happy Times Will Come, Life After Life, Pacifico)
JOUR 4
(A Quiet Passion, Apnée, Aquarius, Autre part,
Fallow, Sadako vs. Kayako, Sunrise, Werewolf)
JOUR 5
(A Lullaby to the Sorrowful Mystery, Bitter Money,
La Chasse au collet, Lampedusa, Sand Storm, We Make Couple)
ENTREVUE
Xavier Seron et Julie Naas (Je me tue à le dire)
JOUR 6
(A Decent Woman, Belgica, Lily Lane,
Mes nuits feront écho, Notes on Blindness, The Untamed)
JOUR 7
(Les arts de la parole, Dogs, L'effet aquatique,
I Had Nowhere to Go, The Ornithologist, Spark)
JOUR 8
(The End, Évolution, The Giant, Yamato (California), X Quinientos)
JOUR 9
(Maudite poutine, One Week and a Day, Prank,
La tortue rouge, Weirdos)
ENTREVUE
Felix Van Groeningen (Belgica)
JOUR 10 + PALMARÈS DE LA RÉDACTION
(Invisible, Mademoiselle, Stealing Alice,
Le vertige des autres, Yourself and Yours)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
