

prod. Charlotte Yates Productions / NZ On Air / Whakaata Māori
IHIMAERA LIVE
Lala Rolls | Aotearoa (Nouvelle-Zélande) | 2011 | 52 minutes | Rétrospective Witi Ihimaera
Organisé en 2011 par la compositrice-interprète Charlotte Yates, le concert Ihimaera présenté au Festival des arts d’Auckland en Nouvelle-Zélande réunissait 12 autres compositeur·rice·s ainsi que 55 musicien·ne·s, tout·e·s rassemblé·e·s pour rendre hommage au premier romancier maori, Witi Ihimaera, en adaptant des poèmes spécialement écrits ou retravaillés pour l’occasion. Détaillant la difficulté de rendre en chanson les vers d’un écrivain habitué aux formes longues, le documentaire télévisuel, tout à fait standard dans sa forme mais tout à fait touchant dans son contenu, accomplit le double travail de réfléchir à l’adaptation musicale de textes littéraires tout en initiant le public à l’univers maori de l’auteur. Chargé de fresques magiques qui ne s’éloignent jamais totalement de la vie vécue, l’œuvre de Ihimaera sera au centre de cette 33e édition du Festival Présence autochtone qui lui rend hommage en grand à travers la projection de quatre adaptations de ses livres (la plus connue étant celle de Whale Rider [Niki Caro, 2002]) et l’organisation d’une classe de maître.
L’univers de Ihimaera, comme bien des univers issus des imaginaires autochtones, en est un de fierté d’être au monde, mais aussi de fierté de cette appréhension du sensible, dont le rapport à la nature innerve une émotivité que chacun de ses protagonistes, toujours un peu subversifs, toujours un peu à côté de leur « place », incarnent en porte-à-faux. Être rejeté par la tradition, mais savoir intimement qu’on en fait encore partie, telle est souvent la trajectoire (quasi autobiographique) de ses personnages, une manière bien délicate de montrer les voies de survivance d’une tradition ancestrale affrontant le changement du monde. Ainsi les mots de ses textes n’ont rien d’un monolithe traditionaliste. Appelant à l’unité, à la coopération et plus largement à un partage des savoirs, les textes d’Ihimaera parviennent à discourir sur la singularité sans en faire le seul horizon de ses récits, rendant alors tout à fait censée l’intervention d’une pléthore de musiciens aux origines culturelles diverses sans que le concert et sa préparation ne deviennent une simple orchestration de « musique du monde » un peu fusion. Au contraire, en préservant à la lettre les vers de l’auteur, chaque collaborateur·rice s’inscrit d’emblée dans une posture révérencielle face au texte original, lui donnant un rythme, une mise en bouche que les Pakeha (terme maori pour désigner les descendants des colons en Nouvelle-Zélande) s’approprient dans le roulement de tambour vocal propre à la langue maorie.
Présenté en amont du festival, deux jours avant son lancement officiel, le film marquait la première activité de cette 33e édition, une sorte de film de préouverture, mettant la table pour l’arrivée en ville de Ihimaera à travers des dimensions à la fois musicales et littéraires, bref une œuvre bien choisie pour une manifestation culturelle comme Présence autochtone qui déborde de la seule programmation cinématographique pour s’étendre jusqu’aux grandes scènes de la Place des festivals. Difficile maintenant de ne pas espérer qu’un jour, celles-ci puissent accueillir une reprise de ce concert qui mériterait bien de souffler à nouveau. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Anorak Film / Eye Steel Film / Red Marrow Media
TWICE COLONIZED
Lin Alluna | Danemark / Groenland / Canada | 2023 | 91 minutes | Film d'ouverture
La Groenlandaise Aaju Peter a été une première fois colonisée par la rigoureuse et implacable éducation protestante danoise, une deuxième fois par l’isolement canadien du Grand Nord, où elle a fini par élire domicile après des années d’études remarquées à faire son barreau, à devenir une avocate militante, prête à parcourir le monde pour défendre les droits des autochtones, à combattre la loi par la loi. Le documentaire de Lin Alluna, première co-production des peuples inuits, est en soi une belle incarnation de la vocation de sa protagoniste : une entreprise impossible à accomplir en solitaire, un effort permis grâce à un commun accord entre nations désirantes de porter à l’écran une condition et à la faire reposer sur les épaules de l’une de leurs plus impressionnantes figures contemporaines.
Car Peter ne s’en laisse imposer par personne. Pas face aux ministres, ni face aux militant·e·s, aux juges, au visage iconique de Bardot qui pleure pour les phoques ou à la cofondatrice des cosmétiques Lush, ridiculement peinte en rouge sang pour manifester contre cette chasse pourtant millénaire. Parmi ce cirque qui frôle parfois l’hystérie, la présence de Peter est calme, assurée, en contrôle de ses émotions et de ses gestes comme on imagine les grand·e·s orateur∙rice∙s en être capables face à l’adversité. Cherchant à créer des liens entre les communautés autochtones, Peter voyage vers d’autres communautés inuites, vers les Samis d’Europe du Nord, cherchant à générer une coopération septentrionale qui pourrait à l’unisson développer des politiques internationales, idéalement la création d’un forum autochtone récurrent au sein de l’Union européenne, qui permettrait de visibiliser les enjeux de la condition autochtone auprès des représentant·e·s du monde occidental. À ce point-ci le film d’Alluna se dissout malheureusement dans la bonne volonté de son sujet idéal, s’éparpillant dans plusieurs directions sans jamais que son montage ne soit capable de porter complètement la trajectoire de Peter, personnage pourtant fascinant, dont les danses ponctuelles et spontanées, par exemple, auraient pu évoquer une structure, voire une figure rythmique, légendaire, à la hauteur de son héroïsme juridique.
Ce qui distingue sans doute Twice Colonized, dont la forme léchée est surtout marquante dans son utilisation d’une trame sonore collaborative d’Olivier Alary, Celina Kalluk et Johannes Malfatti, c’est plutôt la mise en parallèle du parcours de Peter et celle de sa séparation récente de son partenaire de vie, un homme blanc laissé hors champ, qui la téléphone tout au long de son chemin de combattante. L’air menaçant, ses appels sont au fond des rappels à l’ordre, une manière de surveiller ses faits et gestes, ses nouvelles relations, la soupçonnant d’avoir déjà trouvé partenaire. Peter la forte est filmée à résister de répondre, à résister à sa propre colère, à résister aussi à l’envie de retourner dans les bras de celui dont la voix ne nous apparaît plus du tout bienveillante mais dont on imagine la familiarité, alors qu’elle travaille à l’émancipation de ses compatriotes au rythme où elle œuvre à la sienne. Twice Colonized rappelle ainsi à quel point tout processus de décolonisation est aussi collectif qu’il est personnel, qu’il concerne des législations barbares rédigées au 19e siècle autant que des relations toxiques qui se perpétuent dans la manière dont les individus autochtones sont encore diminués, encore commodifiés par la passion de la possession coloniale. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Ek Balam Producciones / Asombro Producciones / et al.
TWO RIVERS (DOS RÍOS)
Anaïs Taracena, Laura Bermúdez | Guatemala | 2022 | 44 minutes
Le beau Two Rivers d’Anaïs Taracena et Laura Bermúdez existe à la croisée des chemins, à l’intersection de deux genres majeurs des cinémas autochtones, le film de lutte et le documentaire territorial ; il se situe entre la douce quiétude de la nature et la violence d’un système postcolonial qui continue à oppresser les premiers peuples au profit d’une industrie cataclysmique. Usant d’un style direct, idéal pour suivre la trace d’une activiste du mouvement « La résistance », opposé à la construction de barrages hydroélectriques, mais aussi au pillage effectué par les compagnies minières sur le territoire ancestral des Q’eqchi’, le film déploie de façon organique une série de questions pressantes relatives à l’existence, aux droits et à la pérennité de cette nation de l’actuel Guatemala (et du Honduras). Le risque de violence encouru par les femmes militantes, l’érosion des cours d’eau provoqué par l’intervention corporative, l’impact des ouragans sur les populations locales, l’incarcération politique des opposant·e·s au système, mais aussi le caractère essentiel de l’agriculture effectuée par les autochtones se dégagent ainsi naturellement de son récit personnel. C’est l’occasion de se mettre dans sa peau, et de plonger dans un monde complexe de relations fragiles, d’intrigants rituels, d’abattement et d’espoir face à la menace constante des forces du « progrès ».
C’est aussi l’occasion de plonger dans les fleuves eux-mêmes, de s’en imprégner et de communier avec la nature. En effet, c’est dans son rapport au territoire que le film vient surtout nous chercher, dans sa représentation déférente de celui-ci et dans l’intérêt qu’il porte au contact privilégié que les protagonistes entretiennent avec lui. Il n’y a qu’à voir la myriade de plans de drone le long du Cahabón pour s’en convaincre — on notera d’ailleurs l’omniprésence de ces prises de vues aériennes dans la programmation du mercredi soir au Musée, type d’images que semblent aujourd’hui privilégier les cinéastes autochtones pour représenter l’immensité et la majesté des grands espaces naturels. Or, ceux-ci servent aussi ici à appuyer une belle métaphore anthropomorphique, soit l’idée de « veines tranchées » par le projet de centrale hydroélectrique le long de son cours. Mais l’acte de communion entre l’être humain et la nature ne s’arrête pas là, s’exprimant également dans les plans apaisants où les protagonistes se baignent allègrement dans les flots du fleuve, et nous entretiennent des sinuosités de son tracé ; il transparaît aussi dans l’utilisation des plans pittoresques de cieux déchaînés et autres feuilles gorgées d’eau, emblématiques de l’humeur des personnages, et dans les séquence d’agriculture, où les femmes cueillent à même le plan les piments que nous sommes habitués de voir dans des bocaux de saumure… Même l’utilisation de la voix off sur la bande sonore, dont le flot accompagne et renvoie à celui des fleuves titulaires, vient appuyer la métaphore, nous servant de tremplin vers un univers d’une sérénité salutaire, doucement anesthésiante, dont il est alors d’autant plus triste de contempler la disparition éventuelle aux mains d’une société technologique complètement aliénée de celui-ci… (Olivier Thibodeau)

prod. Cuyay Wasi
CAMINOS
Rodrigo Otero Heraud | Pérou | 2021 | 80 minutes
Après Two Rivers, notre exploration du rapport à l’eau qu’entretiennent les populations sud-américaines se poursuit d’une façon autrement plus tonitruante et disjonctée avec Caminos, une œuvre bourrée d’images et d’informations, mitraillées à un tel rythme qu’on s’imagine un documentaire didactique, ou un film touristique, réalisé par un clipeur. S’intéressant à la vie (actuelle et passée) dans le district de Cerro Azul, situé sur la côte péruvienne, le film aborde en vrac des questions relatives à la pêche, au surf, à la destruction des milieux naturels provoquée par l’industrie, au pillage des sites incas et aux traces du savoir-faire agricole laissées par cette illustre nation précolombienne. Doté d’une mise en scène hyperactive, qui multiplie ad nauseam les plans de drones véloces sur diverses merveilles naturelles et les images de surfeurs brisant les vagues, réunies dans un montage survitaminé (idéal pour dynamiser les séquences d’archives), le film se présente comme un étourdissant et foisonnant état des lieux. Et face à la manne d’informations qui se succèdent à l’écran, présentées alternativement par des pêcheurs sur des tableaux blancs installés sur la plage, par des champions de surf perchés sur des récifs ou des archéologues du ministère de la Culture, force est de retirer ici au moins quelques connaissances valables, ou du moins, l’impression d’une certaine beauté naturelle évanescente.
Ainsi, le nouveau film de Rodrigo Otero Heraud, connu pour son documentaire Los Ojos del Camino (2017), est un objet qui élude l’analyse tant il semble éclaté. On peut néanmoins en retirer quelques principes organisateurs, qui servent ici de trames lâches pour son propos éparpillé. On pense d’abord à l’idée de filiation, au maillage intergénérationnel qui traverse l’œuvre, nous incombant à considérer l’importance du legs laissé par les premiers peuples, mais surtout à envisager les conséquences de nos propres actions sur les gens de demain. Qu’il s’agisse des traités historiques à propos de l’impact contemporain des systèmes d’irrigation imaginés par les Incas ou des dialogues avec le passé qu’entretiennent divers intervenants en discutant du contenu de quelques vidéos maison (concernant les surfeuses d’antan et le sauvetage des esquifs de pêche), on s’affaire constamment à tracer un lien entre le passé et le présent. Or, le message écologique du film passe également par cette perspective généalogique, alors que les anciens nous révèlent la décroissance des vagues au fil des ans, mais aussi celle des pêches, dû à l’érosion de l’écosystème côtier par l’industrie pétrolière et papetière. Outre les plans aériens sur le territoire, on a ainsi droit à des plans sous-marins sur la faune et la flore qui sous-tendent son existence, et dont l’équilibre est aujourd’hui menacé. On assiste donc à une œuvre hybride, quelque part entre la quête d’ascendance d’un Pierre Perrault et l’éco-anxitété d’un Darwin's Nightmare (Hubert Sauper, 2004), rendue dans un format criard, tout à fait contemporain mais extrêmement généreux, où le malaxage des enjeux relatifs à la vie côtière péruvienne se consomme comme un revigorant concentré de discours politique. (Olivier Thibodeau)

prod. ONF
CHASSEUSE DE SON (EVER DEADLY)
Tanya Tagaq et Chelsea McMullan | Canada | 2022 | 89 minutes
Co-réalisé par Tanya Tagaq, la chanteuse de gorge inuite qui constitue ici le sujet principal, Chasseuse de son est un documentaire exigeant et sublime, sans doute l’un des meilleurs produits par l’ONF au cours des dernières années. Utilisant la pratique de son art vocal comme ciment discursif, l’œuvre se déploie d’une façon sensible, salutaire et schizoïde, entre l’institutionnalisme et l’anti-institutionnalisme, entre le prosaïque et le poétique, entre l’humain et le non-humain, entre l’agonie et l’extase des peuples autochtones, dans un brillant processus d’exorcisme des stigmates laissés par le colonialisme canadien. Il s'agit surtout d’un titre qui embrasse et synthétise parfaitement le style onéfien (en alliant le documentaire direct aux images d’archives et au cinéma d’animation) tout en le transcendant allègrement (agrémentant son didactisme procédural d’une forme d’impressionnisme quasi expérimental).
Débutant par une séquence de sept minutes où deux femmes se livrent à un « duel » sensuel de chants gutturaux — où les bouches se rapprochent jusqu’à l’orée du baiser —, le film développe d’emblée une perspective typiquement inuite. On note d’ailleurs qu’il s’agit là de la façon traditionnelle d’effectuer ce genre de chants, en impliquant deux femmes dans une sorte de compétition amicale qui ressemble à une séance de souque à la corde acoustique. A contrario, le spectacle qui sert de noyau narratif, où Tagaq nous apparaît au micro dans une scintillante robe pailletée, accompagnée par un grand groupe de musicien·ne·s, représente une itération contemporaine du chant de gorge. Or, c’est par le biais de ce spectacle, destiné à un public blanc, que le film nous invite à affûter notre regard, à considérer les racines magnifiques et terrifiantes qui sous-tendent l’expression de cet art.
Entrecoupant le flot du spectacle sensuel et captivant qui se déploie devant nous par des parenthèses de durée variable visant à développer la biographie personnelle, familiale et généalogique de l’interprète, le film bénéficie d’un montage fabuleux, à la fois logique, métonymique, transhistorique et transespèce. Celui-ci nous permet d’entrer directement dans l’intériorité du sujet, au cœur de ses fantasmes extatiques de beautés naturelles (raccords entre son corps frémissant et des images d’aurores boréales) et de pénibles souvenirs d’agression sexuelle (illustrés par des dessins enfantins et des propos poétiques à la fois troublants et providentiels dans les circonstances). Il nous donne aussi accès à la mémoire de sa communauté, à travers les témoignages rétrospectifs offerts par ses parents, combinés à des images d’archives qui nous effleurent à la manière des bribes d’un songe, mais aussi de partager sa vision du territoire, au gré d’un foisonnant lexique d’images pittoresques de lichen et de hameaux paisibles. Tout y passe (les stigmates du grand déplacement instigué par le gouvernement fédéral, les violences misogynes cautionnées par ce même gouvernement, les limites de la représentation occidentale des premiers peuples, mais aussi les douces images de filiation et de communion avec la nature propres à leur traditions), au sein d’une logique hagiographique parfaitement apte à synthétiser les enjeux de ces différentes réalités. Chasseuse de son nous apparaît donc comme une œuvre incontournable qui, en célébrant l’art du chant de gorge inuit, célèbre en fait toute la culture, lésée mais fière, qui sous-tend son existence. (Olivier Thibodeau)
Le film est disponible sur le site de l’ONF

prod. Mesilinka Films
DƏNE YI’INJETL | THE SCATTERING OF MAN
Luke Gleeson | Canada | 2021 | 76 minutes
Au cours des années 60, le premier ministre de la Colombie-Britannique, William Andrew Cecil Bennett, cherche à stimuler l’économie de sa province en nationalisant une partie de son territoire. La société d’État BC Hydro, qui naît de cette initiative, entreprend en 1968 la construction d’un barrage hydroélectrique sur la rivière de la Paix, cours d’eau sillonnant les Rocheuses. Durant sept ans, un chantier sera implanté sur le territoire habité depuis des temps immémoriaux par la nation Tsay Keh Dene. La construction du barrage entraînera finalement un véritable déluge, inondant les terres habitées, causant la mort de plusieurs Tsek’ene et condamnant les survivant.e.s à s’exiler de leur lieu d’ancrage.
Premier film entièrement produit par une communauté autochtone, DƏNE YI’INJETL | The Scattering of Man pose son regard sur les conséquences encore palpables de ce projet d’infrastructure sur les gardiens traditionnels du lieu. Le réalisateur Luke Gleeson, membre de la nation Tsay Keh Dene, nous entraîne à la rencontre des survivant.e.s et des descendant.e.s Tsek’ene,qui ont été délocalisé.e.s durant la construction. Alors que la nation disposait d’une connaissance millénaire du territoire, où ils pouvaient pratiquer leurs activités de subsistance (médicine naturelle, chasse, pêche, transport par canoë), ils se sont retrouvés confinés dans des logements sans meubles ni installations, déportés dans un lieu où il n’était plus possible de reproduire leur mode de vie traditionnel. Plusieurs membres de la communauté ont alors sombré dans l’alcoolisme, d’autres ont développé différentes maladies, sans parler de la perte de leurs repères identitaires culturels et des suicides causés par cette dépossession de leur terre. Le réalisateur va à la recherche de ces récits de traumas vécus et hérités, autant d’histoires jamais entendues, et qui nous sont rendues par des témoignages où résonnent la colère de l’exil forcé et l’effroi causés par les inondations, décrites comme une « catastrophe ».
Si le sujet est grave, The Scattering of Man n’est pas une œuvre misérabiliste ni tapageuse. Parmi ses qualités esthétiques exceptionnelles, on mentionnera d’entrée de jeu sa conception sonore. La musique donne toutes les intonations au film en épousant judicieusement ses différentes ruptures rythmiques. La réalisation appuie énormément sur les contrastes — notamment à travers le montage dissonant de l’image et du son : on surligne ironiquement le rêve entrepreneurial de la BC Hydro en juxtaposant des images apocalyptiques du barrage à une musique toute imprégnée, sacrée, chantée par un chœur mormon. Pour effectuer ses transitions, le film est ponctué de plusieurs fondus au noir, qui aèrent la composition (souvent dense). Il alterne entre des séquences frénétiques, où les images d’archives s’enchainent rapidement, portées par une musique envahissante, et des séquences plus contemplatives où la vitesse décélère grâce à des plans qui se déposent longuement sur un visage, un élément de la nature, portées quant à elles par une musique harmonieuse au tempo langoureux. Ces scènes plus lentes, qui reviennent ponctuellement, sont toujours introduites par une narration absolument poétique en voix off d’un membre de la nation qui raconte la légende de son peuple dans sa langue maternelle.
Il n’y a pas que la musique qui prend une dimension narrative dans le film, la rivière de la Paix, en tant que motif récurrent, apparaît pratiquement comme un personnage à part entière. Toujours saisie dans la même prise de vue en hauteur, on dirait qu’elle prend vie dans ses multiples humeurs, tant elle apparaît différente à la lumière constamment renouvelée des plans dont elle fait l’objet.
Le documentaire entend moins informer que faire sentir, donner à percevoir, à travers des images qui parlent d’elles-mêmes — émergeant du contraste entre le visage de l’antipathique W. A. C. Bennett et ceux des enfants autochtones sur la réserve, des forêts vierges puis rasées, d’un lac navigable puis desséché, des acclamations d’une foule lors d’un rassemblement politique, auxquelles succède la vision d’une maison abandonnée ou d’un canoë englué sur les berges…
Pour boucler ce portrait sombre qui nous plonge au coeur du « néocolonialisme ordinaire » des cinquante dernières années, Gleeson propose une fin consolatrice, tournée vers l’avenir. Quelques scènes magnifiques montrent des aînés en train de transmettre leurs savoirs ancestraux à leurs descendants sur la réserve : on voit notamment des aînées préparer la viande chassée, expliquer à leur petits-enfants la guérison par les plantes, etc. On comprend alors toute la résilience, mais aussi toute la combattivité dont ce peuple a fait preuve.
Enfin, le film se termine comme il s’est ouvert, par un ultime plan sur la rivière de la Paix. Or, cette fois, la perspective sur le cours d’eau est encore plus large, la prise de vue étant effectuée à une altitude encore plus élevée, qui vient donner la pleine mesure de l’immensité et de la puissance du cours d'eau. Pour reprendre les termes d’une des intervenantes : « La nature nous recouvre après notre mort ; elle est en vie, il est inutile de vouloir la dominer. » À travers ce plan ultime, le cinéaste rend hommage à la vision holistique des Premières Nations, en remettant à la nature tous les droits qui lui reviennent. (Sarah-Louise Pelletier-Morin)
*Texte originellement publié dans notre couverture des RIDM 2021
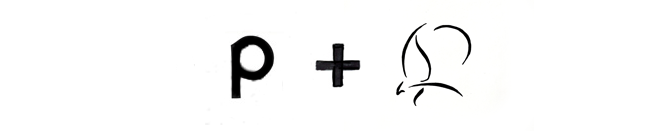
PARTIE 1
(Ihimaera Live, Twice Colonized,
Two Rivers, Caminos, Chasseuse de son,
Dəne Yi'Injet | The Scattering of Man)
PARTIE 3
(Courts métrages Maoris - Programme #2,
Demon Mineral, Kawa,
Wochiigii Io End of the Peace)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
